10/10/2014
La volonté est-elle toujours positive ?
Staline : « Quelle est, camarade Jdanov, la première propriété d’une volonté ? »
Jdanov se tait et Staline répond : « Sa liberté. Elle peut affirmer ce qu’elle veut. Passons. La vraie question est celle-ci : il y a autant de représentations du monde qu’il y a de personnes sur la planète ; cela crée inévitablement du chaos ; comment mettre de l’ordre dans ce chaos ? La réponse est claire ; en imposant à tout le monde une seule représentation. Et l’on ne peut l’imposer que par une seule volonté, une seule immense volonté, une volonté au-dessus de toutes les volontés. Ce que j’ai fait, autant que mes forces me l’ont permis ; Et je vous assure que sous l’emprise d’une grande volonté les gens finissent par croire n’importe quoi !
Milan Kundera, La fête de l’insignifiance, Gallimard, 2013
Le personnage de Staline dans ce roman de Kundera reflète bien la définition du dictionnaire : « Faculté de l'homme de se déterminer, en toute liberté et en fonction de motifs rationnels, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». Et si l’on va plus avant dans le texte ci-dessus comme dans le dictionnaire, une autre définition apparaît aussitôt : « Décision ou détermination ferme de l'individu d'accomplir ou de faire accomplir quelque chose ».
Dans le premier cas, la définition est positive et donne à l’homme le moyen de s’accomplir grâce à sa volonté. Dans le second cas, elle peut devenir négative et plonger l’homme dans l’esclavage mental. C’est la différence entre l’argumentation et la manipulation. L’argumentation est une forme d’expression visant à convaincre un autre de la justesse d’une idée. Elle laisse cependant libre celui qui la reçoit. La manipulation vise à contraindre un autre à adopter une idée en utilisant des moyens de pression divers.
Alors que chacun de nous s’interroge sur sa volonté vis-à-vis des autres, même sous le prétexte de faire le bien. L’enfer est bien pavé de bonnes intentions.
07:31 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : psychologie, société, pouvoir, dépendance |  Imprimer
Imprimer
08/10/2014
Dans le jardin de l’ogre, roman de Leïla Slimani
Elle veut être une poupée dans le jardin de l’ogre. Elle ne réveille personne. Elle s’habille dans le noir et ne dit pas au revoir. Elle est trop nerveuse pour sourire à qui que ce soit, pour entamer une conversation amicale. Adèle sort de chez elle et marche dans les rues vides. (…) Elle ramasse sur le siège en face d’elle un journal daté d’hier. Elle tourne les pages. Les titres se mélangent, elle n’arrive  pas à fixer son attention. Elle le repose, excédée. Elle ne peut pas rester là. Son cœur cogne dans sa poitrine, elle étouffe. Elle desserre son écharpe, la fait glisser le long de son cou trempé de sueur et la pose sur un siège vide. Elle se lève, ouvre son manteau. Debout, la main sur la poignée de la porte, la jambe secouée de tremblements, elle est prête à sauter. (…) « Adèle… » Adam sourit, les yeux gonflés de sommeil. Il est nu. « Ne parle pas. » Adèle enlève son manteau et se jette sur lui. « S’il te plaît. »
pas à fixer son attention. Elle le repose, excédée. Elle ne peut pas rester là. Son cœur cogne dans sa poitrine, elle étouffe. Elle desserre son écharpe, la fait glisser le long de son cou trempé de sueur et la pose sur un siège vide. Elle se lève, ouvre son manteau. Debout, la main sur la poignée de la porte, la jambe secouée de tremblements, elle est prête à sauter. (…) « Adèle… » Adam sourit, les yeux gonflés de sommeil. Il est nu. « Ne parle pas. » Adèle enlève son manteau et se jette sur lui. « S’il te plaît. »
Adèle se rhabille et lui tourne le dos. Elle a honte qu’il la voie nue. « Je suis en retard pour le travail. Je t’appellerai. » Comme tu veux, répond Adam.
Pourtant Adèle est mariée à Richard, médecin, et a un petit garçon de trois ans, Lucien. Ils semblent heureux. Elle aime son mari, son mari gagne bien sa vie, mais il n’est pas porté sur la chose. De plus, Adèle n’aime pas son métier. Elle hait l’idée de devoir travailler pour vivre. Elle n’a jamais eu d’autre ambition que d’être regardée. Alors elle cherche les hommes et, en premier, son patron. Elle a passé ses lèvres sur sa langue, très vite, comme un petit lézard. Il en a été bouleversé. La salle de rédaction s’est vidée, et pendant que les autres rangeaient les gobelets et les mégots éparpillés, ils ont disparu dans la salle de réunion, à l’étage. (…) Elle l’avait désiré pourtant. Elle se réveillait tôt chaque matin, pour se faire belle, pour choisir une nouvelle robe, dans l’espoir que Cyril la regarde et fasse même, dans ses bons jours, un discret compliment. (…) A quoi servait de travailler maintenant qu’elle l’avait eu ?
Mais un jour, Richard apprend cette double vie. Que va-t-il faire ? La répudier, continuer comme si de rien n’était ? Faire une scène mémorable ?
Malgré tous les efforts de Richard, elle dérive, elle plane dans son addiction. Il a attendu sur le quai. Elle n’était pas dans le train de quinze heures vingt-cinq. (…) Richard quitte la gare. Il est en apnée, affolé par l’absence d’Adèle, rien ne parvient à le détourner de son angoisse. (…)
Ça n’en finit pas, Adèle. Non, ça n’en finit pas. L’amour, ça n’est que de la patience. Une patience dévote, forcenée, tyrannique. Une patience déraisonnablement optimiste.
Nous n’avons pas fini.
Reviendra-t-elle ? Nul ne le sait. Le roman se termine ainsi, dans l’incertitude d’une guérison d’Adèle. Malgré les efforts de Richard, malgré l’amour qu’elle porte à son fils. Mais les aime-t-elle réellement ? Ne joue-t-elle pas la comédie d’une femme belle et heureuse ? Ne préfère-t-elle pas cette brutale montée de sang dans son corps qui l’emmène loin de toute raison ?
Non, ce roman n’est pas un beau roman. Dans un style froid, impersonnel, il raconte une histoire crédible jusqu’à un certain point. Oui, elle est crédible cette femme qui ne sait comment vivre. Mais dans le même temps vouloir nous faire croire qu’elle est normale, qu’elle aime son fils et même son mari, cela devient inacceptable. Le récit s’empêtre dans des contradictions et jusqu’au bout on ne sait où il va. La porte ouverte sur l’inconnu, le roman sombre dans une disparition qui a un arrière-goût d’affaire de mœurs.
07:32 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, roman, société, moeurs |  Imprimer
Imprimer
01/10/2014
Mort d’un berger, roman de Franz-Olivier Giesbert
Un roman à la Pagnol ou Giono, qui enchante l’air vif du matin et redonne à la nuit l’odeur des contes. La montagne dans toute sa splendeur unique qui accueille le troupeau des hommes, petit, lent, coléreux et chaque individu si singulier, unique qui tente de se prendre pour Dieu. Le curé est ivrogne, mais si près du ciel qu’il ne peut en redescendre. Le berger, un vieillard de 80 ans, mène son troupeau avec Mohamed VI, un muet bien guilleret qui très vite Juliette Bénichou, tout cela sur fond de mort d’un furieux, Fuchs, qui se fait tuer dans sa maison. La gendarmerie est là, bien sûr, avec un capitaine interrogateur et un berger muet. Tout cela se passe dans l’odeur de la lavande, le son des grelots du troupeau, la vue de la plaine, en bas, immense vu d’en haut, dans l’herbe jaune et fraiche des hauteurs où les moutons vivent le meilleur de leur temps.
berger muet. Tout cela se passe dans l’odeur de la lavande, le son des grelots du troupeau, la vue de la plaine, en bas, immense vu d’en haut, dans l’herbe jaune et fraiche des hauteurs où les moutons vivent le meilleur de leur temps.
Cela commence par la mort de son fils. Un papillon s’était posé sur son front mort. Le vieil homme commença à parler au papillon. Il causait toujours beaucoup aux bêtes. Aux ombles chevaliers, surtout, qu’il allait retrouver de temps en temps au lac d’Allos, après la pêche, certains jours de canicule. Dans son genre s’était une attraction, Marcel Parpaillon. Les ombles chevaliers venaient, de tous les coins du las, l’écouter glouglouter en agitant les bras. Il leur disait des tas de choses qui ne peuvent s’écrire, parce qu’elles sont au-delà des mots.
Quelques jours plus tard un autre malheur. Un matin, quand il arriva à la bergerie, Marcel Parpaillon roula de grands yeux stupéfaits, avec une expression d’horreur, et il lui fallut s’agripper à Mohammed VI pour ne pas tomber, avant de laisser choir son derrière sur une souche de pin. Ses lèvres se mirent à trembler comme des feuilles, et il sanglota, mais sans pleure, car il n’avait plus de larmes depuis la mort de son fils. Il resta un long moment, la bouche en O, tandis que Mohammed VI s’agitait dans le parc à moutons. C’était comme une forêt après la tempête du siècle. Des tas de brebis couchées les unes sur les autres ? Dans un mouvement de panique, elles s’étaient jetées, par vagues, contre un muret de bois, pour y crever. La moitié du troupeau était morte ainsi de peur, de bêtise et d’étouffement.
Et le berger part en guerre contre le loup, contre le maire qui ne veut pas que l’on parle du loup, contre les gendarmes qui cherche maintenant l’assassin de Fuchs. Ils partent en montaison, le berger, Mohammed VI et Juliette. Il se réfugie dans l’air libre des hauteurs. On aurait dit que le temps s’était arrêté. Ça arrive souvent, l’été, dans la patantare. Il suffit que le vent faiblisse et c’est comme si le monde entier retenait son souffle. Ça peut durer toute une journée. Il était dans les deux heures de l’après-midi, mais il aurait pu être tôt le matin ou tard le soir, c’eût été pareil. Le même silence. La même langueur. Une sorte d’éternité.
Le loup est tué, mais le berger est blessé. Il mourra quelques jours plus tard après être redescendu de la montaison. Marcel Parpaillon a rejoint le mouvement perpétuel qui va et vient, en emportant tout, un jour ou l’autre, dans ses ténèbres vivantes. Il est l’eau, le feu, l’air qu’on respire, le sommeil des siens, ou le bonheur qui danse dans leurs yeux. Il est les étoiles aussi. Nous sommes tous des poussières d’étoiles. On prend toutes sortes de formes, des airs importants et des chemins vairés, mais on reste un petits tas d’acides aminés qui pantelle, longtemps après que la flamme a été soufflée.
Quand elle ne s’éteint jamais, c’est un berger.
07:18 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, livre, roman, mort, vie, société |  Imprimer
Imprimer
30/09/2014
Optimisme
La principale objection à l’optimisme ne teint pas à la réalité du monde, mais à un certain positionnement intellectuel. Le pessimisme est plus avantageux : annoncer le pire et, à la moindre catastrophe, se vanter de l’avoir prévu, est simple et stratégiquement payant. L’optimisme est plus périlleux, puisqu’il exige de regarder l’horizon, de déceler la tendance au-delà des accidents, tout en courant le risque de passer pour Pangloss, si bien ridiculisé par Voltaire parce qu’il estimait que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. L’optimisme est guetté – comme tout prisonnier d’une idéologie explicative du monde – par la tentation de rejeter les événements inattendus qui ne corroborent pas sa théorie de départ. A chaque instant l’optimiste devra se demander s’il est bien raisonnable de le rester. Oui, pour l’instant…
Guy Sorman, Journal d’un optimiste, Fayard, 2012
L’optimisme est-il une maladie rare ? On pourrait le croire à en voir l’image de la France à l’intérieur comme à l’extérieur, dans la vie quotidienne comme dans la tête des gens. Le pessimisme envahit la planète France que l’on soit sous le règne de l’un ou l’autre président qui font tout dans le verbe pour paraître optimiste, mais dont les actes laissent un goût étrange de « n’y revenez pas ».
Qu’est-ce qui différencie l’optimiste du pessimiste ? L’espoir en l’avenir pour soi-même, les sociétés et le monde en général. Le plus important est bien l’espoir pour soi-même. Il conditionne le reste. Le psychanalyste Cyrulnik a promu le terme résilience que l’on peut résumer comme la capacité pour une personne, un groupe ou une société à s’adapter à un environnement changeant. Depuis maintenant plus de dix ans, les politiques ont monopolisé ce mot et l’ont inscrit dans le marbre des documents officiels, tels que le Livre blanc pour la défense et la sécurité de 2008, puis de 2013. Mais ils l’ont transformé en capacité à gérer une crise. La résilience est devenue une organisation promue par l’Etat pour être capable de faire face à une crise, quelle qu’elle soit. Bel exemple de pessimisme. On organise la société pour malgré tout s’en tirer dans les crises de plus en plus nombreuses qui peuplent le monde.
Pour Cyrulnik, il s’agit bien d’une force intérieure, personnelle et indivise, qui permet à l’homme dans l’adversité, de faire face et de surmonter les circonstances pour rebondir. Que faire lorsque tout est perdu ? Non pas attendre que l’Etat vous assiste, mais se prendre en main et surmonter son désespoir au lieu de l’entretenir et de laisser les autres le déclarer seule vérité.
La résilience, c’est la grâce devenue réalité.
07:04 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : résilience, optimisme, société, vision du monde |  Imprimer
Imprimer
28/09/2014
Mariage
Hors de toute foi, j’étais convaincu que l’enjeu de la vie commune consiste à se découvrir soi-même en découvrant l’autre, et à favoriser chez l’autre la même découverte.
Le royaume, Emmanuel Carrère, p.21
L'amour est un mystère et il naît par le mystère : mystère de la nature masculine pour la femme et mystère de la nature féminine pour l'homme.
Le mariage consacre l'accession au mystère, la découverte de l'autre.
Cette découverte passe par plusieurs étapes :
-
La découverte du corps de l'autre,
-
L’épanouissement de notre propre nature,
-
la compréhension profonde des natures féminine et masculine.
Par la consécration du mariage, la découverte du corps de l’autre acquiert une signification sacrée. C'est en effet le corps de l'autre qui devient maintenant le corps de "l'homme" ou le corps de la "femme". C'est dans ce seul corps que je réaliserai le mystère masculin ou féminin. Je n'ai pas besoin de connaître d'autres corps puisque celui-ci, dans sa nudité et son innocence amoureuse, symbolise tous les corps d'homme ou de femme. Le corps d'autres hommes ou d'autres femmes n'est plus source de désir puisque le corps de mon mari ou de mon épouse renferme à lui seul le mystère masculin ou féminin. Il est à chaque nouvelle rencontre source de découverte, d'émerveillement, d'épanouissement parce qu'il est la seule porte ouvrant sur le mystère.
C'est pour cette raison qu'il n'est pas bon de déflorer le mystère avant le mariage. Contrairement à ce que disent de nombreux psychologues qui n'ont aucune idée de la notion de mystère et qui ne voient dans l'union des corps que la satisfaction du désir, le corps de l'autre doit être rêvé, idéalisé avant d'être doucement, avec pudeur, avec émotion, découvert. Ce n'est qu'alors que chaque rencontre sera une ouverture sur le mystère, une découverte sans cesse renouvelée, une source d'épanouissement et non de plaisir égocentrique.
Nous marchons sur le même chemin, d'un commun accord, avec le même amour et avec la même vision du chemin menant vers le bonheur, mais pas de la même manière. Cette différence tient à la nature sexuée de l'être. L'homme et la femme n'ont pas les mêmes réactions, les mêmes comportements, les mêmes schémas de pensée. Même si leur vision intellectuelle, leur explication du monde est semblable, la manière de sentir le monde et de le vivre est différente.
Ce qu'auparavant j'aurai difficilement supporté (vivre avec quelqu'un d'aussi différent de nature), est maintenant pour moi source de joie et d'enrichissement. Là encore agit le mystère de l'amour. Je découvre en l'autre une nouvelle façon d'appréhender le monde, une nouvelle vision du monde. De même que le corps de l'aimé(e) devient symbole de l'homme ou de la femme, de même sa manière d'être m'ouvre au monde des hommes ou des femmes. A travers lui ou elle, je comprends maintenant ce qui jusqu'à présent m'avait échappé.
Parallèlement à cette ouverture de mon propre monde vers celui des êtres de sexe opposé à travers l'aimé(e), la présence de celui-ci ou de celle-ci me confirme dans ma propre nature et l'épanouit. Les différentes tendances de celle-ci s'unissent, se resserrent, pour converger. Devant lui ou elle, je me confirme dans mon propre rôle d'homme ou de femme, parce qu'il ou elle attend cela de moi, comme moi j'attends cela de lui ou d'elle.
Cette découverte de la nature de l'autre et l'épanouissement de sa propre nature doivent peu à peu rendre conscient ce qui jusqu'à présent était inconscient : la différence profonde de nature entre l'homme et la femme, et leur complémentarité. C'est cette compréhension de la différence et de la complémentarité des natures qui va permettre de cheminer en harmonie. Sans cette compréhension, la différence agace et peut conduire aux frictions. L'homme macho raille la sentimentalité féminine parce qu'il est incapable de sentiments. La femme couveuse resserre sa protection à tous les aspects de la vis du mari, neutralisant son besoin d'agir et de penser.
La compréhension de la nature de l'autre, la perception de sa complémentarité, nécessitent un effort d'ouverture, de dépassement de l'égocentrisme, ce qui en soit est source d'épanouissement.
07:40 Publié dans 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : femme, homme, mariage, société, épanouissement, spiritualité |  Imprimer
Imprimer
20/09/2014
Jeu
Hier, il a rechaussé les lunettes de l’enfance. Mieux, il a repris les attitudes et même le comportement d’un enfant. Il était libéré et asservi tout à la fois : libéré de toute réminiscence d’adulte (le poids de la responsabilité en particulier) et asservi à la volonté d’un autre pour entrer dans le jeu. Il a retrouvé en un instant cette âme d’un gamin de cinq ans avec son immédiateté et ses émotions. Ils sont partis, une petite fille de cinq ans, vive et autoritaire, un garçon de quatre ans, encore un peu pataud, les joues rondes, les cheveux poils de carotte, et lui-même garçon sans âge, plus petit qu’elle qui voulait commander. Cet instinct de l’autorité est quelque chose d’inné. Peut-être ne restera-t-il rien plus tard, lorsqu’elle atteindra l’âge de raison ou l’adolescence ou encore l’âge adulte. Mais aujourd’hui, elle est à son affaire.
Ils sont sortis du domaine de référence, le jardin aux murs clos pour explorer une jungle située à dix mètres, mais perdue dans un inextricable encombrement de végétation. L’avant-veille, une équipe de la ville était venue faucher l’espace municipal envahi d’herbes et de branchages. Ceux-ci étaient encore à terre, feuilles fanées, tiges cassées, fruits écrasés. Ayant franchi cet obstacle à petits pas incertains, ils arrivèrent près du lit du ruisseau, peu fourni en eau, empli de déchets végétaux amenés par la pluie d’orage de la veille. Ils se glissèrent sous les branches et mirent les pieds dans l’eau, marchant sur les cailloux, sautant de rocher en rocher avant de s’arrêter devant un mur d’épines qui bloquait le passage. Ordre du chef : demi-tour, nous recherchons un autre passage. L’obligation de respecter l’ordre de préséance, la fille, le garçon et l’adulte (eh, oui !), les contraignit à une volte-face complexe qui faillit bien les mouiller en entier.
Retour à l’espace aplani. Ils en profitèrent pour prendre des bâtons tout coupés, le plus gros revenant à la reine Cléopâtre, le plus petit au premier guerrier, le moyen au second. Cléopâtre ouvrait la marche, d’un air digne, avec sérieux, exigeant d’eux de marcher presqu’au pas. Devenue reine, elle estimait que chacun devait se conduire en serviteur. Il fallait porter son arme tantôt à droite, tantôt à gauche, avec assurance et détermination. Retour au jardin. Cette fois-ci, ils passent par-dessus le grillage et ils s’engagent dans le petit bois qui descend vers le ruisseau. Seuls quelques lapins doivent emprunter le trajet étroit et couvert de branches en hauteur. La reine exigea qu’on lui ouvre le passage afin de ne pas avoir à se baisser. Ce qui fut fait.
Qu’en retenir ? Certains enfants ont foi en eux-mêmes. Ils ont des idées, ils les mettent en scène et grandissent de leurs caprices. D’autres suivent, s’amusent sans sérieux et n’acceptent l’autorité d’un seul qu’à condition qu’il satisfasse leur vision du monde. Ainsi s’oppose le jeu sérieux et le jeu tout court. Pour les uns, ils mettent leur vie en jeu. Pour les autres, ils passent un bon moment et c’est tout.
07:47 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jeu, société, enfant, comportement |  Imprimer
Imprimer
18/09/2014
La vie et le multiple
Assis devant sa table de travail, il ne sait que faire. Elle est jonchée de papiers et chacun d’eux est un morceau d’être : des cartes de visite à l’image de leur propriétaire, la présentation d’une exposition, les fils des nombreux appareils permettant de rester en contact avec le monde, des dossiers, une statuette africaine, un étui à lunettes et beaucoup d’autres choses encore.
La vie est semblable à cette multiplicité. Le plus souvent nous sommes fixés sur un but et ne voyons plus cette multitude inopportune. Mais si nous fouillons dans les poubelles, nous comprenons comment nous fonctionnons. D’ordinaire, nous rejetons ce qui ne nous intéresse pas. Parfois aussi, nous rejetons ce qui nous intéresse et que nous avons accumulé. C’est le grand ménage.
Alors la vie passe devant nous, nous la contemplons, nous lui disons adieu et nous ouvrons les yeux sur un monde nouveau.
07:02 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, humain, habitude, déchet |  Imprimer
Imprimer
14/09/2014
Chroniques enfantines, récits de Nathalie Bouvy (Edilivre 2014)
Ce sont des moments épars dans la vie d’une jeune enfant ou même des sensations, des impressions sans suite, des instants d’émotion dans la fuite du temps et des souvenirs. On saisit les incompréhensions des grandes personnes devant ces récits sans rationalité, mais également celles de la petite fille qui s’exprime. Pourquoi tel adulte se comporte-t-il ainsi ? Pourquoi fait-il semblant de ne pas ressentir ce qu’elle même ressent ? Mystère des grandes personnes à l’opposé de la transparence enfantine.
Elle fait des visites à une multitude de tantes. Elles sont vieilles pour la plupart, majestueuses de dignité, dans de grandes maisons cirées, pleines de beaux meubles. L’enfant n’en retire que de petites impressions, le bonbon dans la coupe de verre, les bas mal tourbichonnés de l’une d’entre elles, l’odeur de la vieillesse.
Souvenirs… Souvenirs : Le poêle abandonné sous un auvent qui a aiguisé sa curiosité et fait frémir les grandes personnes. L’autre petite fille, également en barboteuse, avec laquelle elle n’a jamais joué, mais qui la fascine au-delà du talus raide fraîchement biné et parsemé de plantes et arbustes piquants les jambes nues. Les convenances du divan vers lequel elle avance à quatre pattes : dans mon souvenir, le divan est en arc-de-cercle. En passant devant les dames, mon regard arrive juste à hauteur de leurs genoux. J’aime observer leurs boucles d’oreilles et leurs belles robes. Je regarde aussi entre leurs jambes qui se referment brusquement comme les pages d’un livre. J’avance un peu plus vite pour voir si mon regard a bien cet effet inattendu. Les genoux se resserrent rapidement, instinctivement, impulsivement comme si ils se recollaient. Le cadeau de Monsieur Bertholet : une guêpe-cendrier en cuivre. J’étais émerveillée par le cadeau et par l’objet. On pouvait soulever les ailes de la guêpe et on découvrait son ventre creux. Ce fut mon premier cadeau de grande personne, car ce n’était pas un jouet. J’en étais très fière.
Des réminiscences précises dans leurs sensations, auréolées du flou du contexte de l’enfance. Le toucher d’un objet, sa dangerosité, les désirs d’une petite fille, sa lucidité devant les adultes, mais toujours environnée du brouillard d’une réalité ressentie ou inversement de récits racontés plus tard par les uns ou les autres. Les deux sont désormais liés dans la cage des souvenances à n’ouvrir qu'en cas de spleen.
07:41 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, souvenirs, société, enfant |  Imprimer
Imprimer
08/09/2014
Soyez naturels
On entend souvent cette expression : « Soyez naturel ! » Quoi de plus naturel que de l’entendre dans la bouche d’un photographe, d’un professeur, d’un éditeur, d’un metteur en scène et de bien d’autres encore. L’entendant l’autre jour à propos de recommandations faites à des jeunes mariés, je me suis demandé ce qu’elle signifiait. Qu’est-ce qu’être naturel ?
Le vieux geste des français, dit cartésiens alors qu’ils sont généralement le contraire, est d’ouvrir le dictionnaire au mot naturel. « Qui appartient à la nature ; qui en est le fait, qui est le propre du monde physique par opposition à surnaturel » (Larousse). Là il me semble que nous sommes tous naturels, ou tout au moins la très grande majorité des gens. Seuls quelques mystiques baignent naturellement dans le surnaturel. Alors quelle idée de nous demander d’être naturel. Nous le sommes tous.
Poussons donc nos investigations un peu plus loin. « En grammaire, le genre naturel désigne l’opposition de sexe mâle-femelle » (CNRTL). Tiens, quel étonnement ! La théorie du genre s’oppose à cette opposition naturelle. Elle prétend justement qu’elle n’est pas naturelle : nous sommes tous du même sexe à la naissance. Mais on nous dit dans le même temps que « le naturel n’est pas le produit d’une pratique humaine » et que ce produit « n’a pas été acquis ou modifié ». Avouons qu’il est difficile de s’y retrouver.
Trêve de plaisanterie : le naturel est ce « qui est conforme à l’ordre normal des choses, au bon sens, à la raison, à la logique » (Larousse). Là, il est vrai, il devient difficile d’être naturel. D’abord, tout le monde n’a pas forcément du bon sens et encore moins de raison et de logique. Et puis la notion de bon sens n’est pas la même pour tous. Le bon sens d’un chinois n’est pas le bon sens d’un africain. Et même s’il s’agit d’un « Ensemble des manières habituelles de sentir et de réagir » comme le prétend l’Office québécois de la langue française. On constate bien que cet ensemble est assez varié sur terre. Le bon sens et la raison ne sont que très rarement naturels, de même que la manière habituelle de sentir et encore plus de réagir.
Qu’en conclure ? Qu’il n’est justement pas naturel d’être naturel. Etre naturel est plus qu’un apprentissage, c’est le résultat de toute une vie. Je me débarrasse de mon manque de naturel parce que je me suis débarrassé de moi-même. Je suis naturel parce que j’ai laissé mon personnage à la porte de ma vie et que je m’éloigne seul sans mon ombre à mes côtés. Quel soulagement. Je peux courir sans fatigue, je peux penser sans béquille, je peux vivre sans mémoire et m’envoler vers l’avenir ou le tout ou le rien sans regret du passé. Mais est-ce si naturel que cela ? Non. S’il m’arrive parfois de faire abstraction de moi-même pendant quelques instants, la plupart du temps, mon premier réflexe est bien de tout ramener à moi-même pour prendre position dans le monde et m’y maintenir. D’ailleurs, admirons tous les portraits de peinture jusqu’à l’apparition de l’abstrait, mouvement né lui-même de l’apparition de la photographie. Sont-ils naturels ? Ils s’efforcent d’en avoir l’air et pas le fait même ils manquent de naturel. Les premières photographies également. Elles sont figées dans un immobilisme de bon aloi, contraire totalement au naturel. Il y manque le mouvement, il y manque la vie.
Ah ! Là nous avons abordé un point important. Le naturel est dans le mouvement. Etre naturel, c’est ne pas arrêter de faire, mieux : d’être. L’homme, naturellement, cherche la plupart du temps à s’arrêter. Il a besoin de se contempler lui-même pour exister. Il doit se voir dans le monde et prendre sa distance pour se savoir vivant. L’animal est naturellement naturel. Il mange, dort, défèque avec naturel. Il ne cherche pas à se situer dans la nature. Il y est et cela lui suffit. L’homme procède inversement. Son naturel est un apprentissage de vie et le résultat de l’atteinte d’un état quasi mystique. Être naturel suppose que l’on soit bien avec soi-même, avec les autres et avec notre environnement, c’est-à-dire avec la nature. Or ce qui empêche cet état, c’est moi. C’est mon moi qui me fait me contempler sans cesse, me situer parmi les autres, chercher ma place dans un monde où tous cherche une place et veut très souvent la place du voisin. Et cela est vrai dès la naissance. Le jeune enfant ne voit que lui, ne connaît que lui et cela lui demande de nombreuses larmes avant de comprendre qu’il n’est pas seul au monde et qu’il doit faire de la place aux autres, voir leur céder la place.
Être naturel suppose l’oubli de soi. Être naturel consiste à se débarrasser de tout ce qui nous empêche d’être naturel. C’est le contraire du naturel animal, c’est une perfection difficile à acquérir. Les jeunes mariés ont encore beaucoup à faire pour devenir naturels et les mariés et les plus âgés ont trop souvent encore plus à faire pour atteindre cet état idéal qui n’a rien à voir avec le naturel de la nature.
07:42 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nature, naturel, société, homme, moi |  Imprimer
Imprimer
06/09/2014
Pétronille, roman d’Amélie Nothomb
Ce roman débute de manière majestueuse et finit assez lamentablement. Il est vrai que tenir le lecteur en haleine pendant 169 pages sur la manière de prendre une cuite est déjà un exploit. Mais faire tant d’effort pour rendre parfaitement réaliste les rencontres entre l’auteur et Pétronille et terminer par une pirouette si bizarre qu’elle peut sembler drôle, fait du roman un chaud-froid difficile à digérer.
« Pétronille, c’est mon roman exotique ». Elle s’explique : « le grand thème de Pétronille c'est la France (...), qui est l'exotisme absolu. Pour découvrir un pays, il faut aller à la rencontre de l'indigène et Pétronille joue le rôle de l'indigène. Cette "quête picaresque" est celle de la rencontre entre une amoureuse du champagne -qui refuse de le boire seule- et sa compagne de beuverie. »
Chaque chapitre est une aventure de beuverie, une découverte de la France profonde, non pas des campagnes, mais des banlieues. Pétronille se révèle fantasque, intelligente (elle écrit des romans, elle aussi, et ils sont acceptables et acceptées), égoïste et imprévisible, à l’égal de la population française. Amélie, belge, peine à la suivre dans ses élucubrations. Mais le couple fait une bonne paire de beuverie, pleine de bulles de champagne, car on ne boit que du champagne millésimé. Il erre d’une librairie, pour le premier roman de Pétronille, aux rues de Soho à Londres, en passant par les sports d’hiver. Amélie tente de se consoler du départ de Pétronille pour le Sahara en trouvant une autre buveuse, mais cela ne passe pas. Elle retrouve Pétronille à l’hôpital Cochin, l’héberge, ne la supporte plus. Nouvelle rencontre quelques années plus tard. Pétronille joue à la roulette russe. Elle finit par tuer Amélie, propose le manuscrit d’Amélie à un éditeur et le livre finit sur une conclusion à la manière de La Fontaine : Quand à moi, en bon macchabée, je médite et tire de cette affaire des leçons qui ne me serviront pas. J’ai beau savoir qu’écrire est dangereux et qu’on y risque sa vie, je m’y laisse toujours prendre.
Les trois premiers chapitres sont un régal littéraire. Il faut les lire plusieurs fois, en goûter chaque page comme on lèche une glace devant la devanture d’un magasin aux mannequins nus :
« Pourquoi du champagne ? Parce que son ivresse ne ressemble à nulle autre. Chaque alcool possède une force de frappe particulière ; le champagne et l’un des seuls à ne pas susciter de métaphore grossière. Il élève l’âme cers de que dut être la condition de gentilhomme à l’époque où ce bon mot avait du sens. Il rend gracieux, à la fois léger et profond, désintéressé, il exalte l’amour et confère de l’élégance à la perte de celui-ci. (…) J’ai continué courageusement à boire et, à mesure que je vidais la bouteille, j’ai senti que l’expérience changeait de nature : ce que j’atteignais méritait moins le nom d’ivresse que ce que l’on appelle, dans la pompe scientifique d’aujourd’hui, un état augmenté de conscience. Un chaman aurait qualifié cela de transe, un toxicomane aurait parlé de trip. (…) J’ai titubé jusqu’au lit et je m’y suis effondré.
Cette dépossession était un délice. J'ai compris que l’esprit du champagne approuvait ma conduite : je l’avais accueilli en moi comme un hôte de marque, je l’avais reçu avec une déférence extrême, en échange de quoi il me prodiguait des bienfaits à foison ; il n’était pas jusqu’à ce naufrage final qui ne soit une grâce.
07:30 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, littérature, ivresse, société, écrivain |  Imprimer
Imprimer
03/09/2014
une femme... forte (2)
Dommage ! J’aimais bien ce jeune homme à la mâchoire forte. Que faire ? Je m’interroge face à cet être hybride. Vais-je tenter de nouer une conversation ? Mais, comment ? Autour de nous, personne ne semble en proie à un tel questionnement. Ma voisine regarde sa tablette magique sur laquelle elle trace des signes cabalistiques d’un air inspiré. De l’autre côté du couloir, ligne de démarcation infranchissable une fois le train partie et les places attribuées, deux hommes sont en conversation d’affaires regardant une feuille sur laquelle sont alignés des chiffres.
– Tu as oublié de prévoir la commission de la banque ?
– Quelle commission ?
– Elle prend un risque.
– Ah, lequel ?
– Le risque d’être cité si l’affaire tourne mal ou si notre associé rompt le contrat.
– Et cela mérite une commission ?
– Une banque ne travaille jamais pour rien !
Et ils poursuivaient à voix haute et intelligible pour l’ensemble de la voiture leur tripatouillage de commerçant. Une jeune fille d’environ vingt ans, qui avait l’air d’un oiseau sorti du nid, lisait un livre à la couverture colorée dont je ne pus lire le titre. Elle levait parfois les yeux d’un air excédé vers son voisin et son vis-à-vis, ce qui ne troublait nullement les deux bavards. Je n’arrive toujours pas à comprendre pour quelle raison on interdit le plus souvent l’usage du téléphone portable dans les trains, mais on ne peut rien dire contre deux bavards à la voix haute qui discutent sans aucune gêne de problème d’argent, d’amour ou de sport. Ils semblent seuls, perdus dans leur faconde, ignorant le peuple qui s’agite autour d’eux. Et si l’un de nous se décide et leur dit d’une voix doucereuse, mais poli, de parler moins fort, ils haussent le ton d’un décibel pour déclarer qu’ils ont le droit de parler comme ils l’entendent et aussi longtemps qu’ils le désirent.
Je regardai alors mon égérie. Pour la première fois, je vis l’ombre d’un sourire sur son visage glabre. Tiens, me dis-je, ce n’est pas une statue. Elle semble avoir quelque sentiment ou du moins réagir à ce qui arrive à d’autres. Je lui répondis d’un demi-sourire avec un petit hochement de tête. Elle en profita pour me glisser à mi-voix :
– Il n’y a malheureusement rien à faire !
Ce qui me surprit, ce n’est pas le contenu de ce qu’elle avait proféré, mais le timbre de sa voix. Une voix de jeune fille, nette et douce, qui contrastait singulièrement avec son apparence. Et elle agrémenta d’un sourire enjôleur, avec fossette, ses paroles. J’en restais bouche bée. Comment un corps aussi puissant et musclé, pouvait-il proférer des sons aussi purs et féminins. Je croyais avoir une voix charmante et parfois séductrice pour certains hommes, mais celle-ci surpassait mon organe de mille coudées. Elle avait le parfum d’une rose épanouie, la couleur d’un mirage en pleine désert. Elle avait déjà repris sa rêverie douloureuse et sa façon de se réinstaller dans son silence m’empêcha de poursuivre cette conversation entamée. Je replongeais dans mon ordinateur que je fis semblant de consulter avec un intérêt extrême, sans toutefois lire quoi que ce soit. L’écran a l’avantage de n’être qu’une glace face à soi-même. L’interlocuteur ou même le spectateur ne voit que la face de celui qui le regarde. Il croit deviner le contenu de l’écran, mais celui-ci peut être cependant assez différent de son impression. C’est le mystère de l’informatique. On peut jouer avec un sérieux imperturbable ou travailler en simulant de jouer. Et cela convient à tous, les réalistes comme les rêveurs.
Suite à une nouvelle montée en puissance de la conversation de nos voisins, je tentais de ralentir leurs errements verbaux :
– Pourriez-vous, s’il vous plaît, parler un peu moins fort pour que nous aussi puissions profiter de ce voyage ?
Cette remarque entraîna aussitôt la réponse cinglante d’une des deux comparses :
– mais Mademoiselle, il n’est pas interdit de parler dans un train. D’un point de vue culturel, c’est même très bon d’échanger plutôt que de se confiner dans ses pensées.
Tout cela dit à voix haute et moqueuse qui fit se retourner une partie du wagon. Les yeux s’allumèrent, les conversations devinrent encore plus intimes, voire s’arrêtèrent. Je sentais monter sur mes joues une rougeur caractéristique. Je pris le parti de regarder mon interlocuteur comme s’il n’existait pas. Mon regard le traversait et admirait l’horizon sans que rien ne l’arrêtasse. Sa réplique résonna dans le vide, sans écho et, après un instant de déception, il ouvrit son ordinateur et s’installa dans une contemplation de son écran qui sembla le captiver. Ma rougeur s’estompa, mon cœur battit moins fort. Je me demandais ce qui m’avait poussé à une telle réaction, moi qui a horreur de me donner en spectacle et d’intervenir dans des situations collectives. Une minute plus tard, je levais les yeux sur le jeune homme ou la femme forte assise en face de moi. Elle se tourna vers moi et me fit un vrai sourire, une sorte de rayon de soleil reflété sur un lac de haute montagne. Cela me fit du bien, je m’enhardis à lui rendre son sourire, sans rien dire. La connivence s’était installée entre nous, sans une parole. Le TGV commença à ralentir. On arrivait à la gare où je devais descendre. Je fermais mon ordinateur, me levais et m’aperçus que ma voisine faisant de même.
– Vous descendez-là ?
–Oui, c’est ma destination, dit-elle le plus calmement du monde. Vous aussi d’après ce que je vois. Sa voix restait délicieusement pure, une voix de soprano qui a travaillé pendant plusieurs années pour atteindre diction et timbre quasi parfaits. Serait-elle chanteuse ? Cela me parut peu vraisemblable, mais sait-on jamais.
07:36 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, homme, femme, rencontre, impressions |  Imprimer
Imprimer
30/08/2014
Un très grand amour, roman de Franz-Olivier Giesbert (2)
Le livre, Un très grand amour, est plus décevant que La cuisinière d’Himmler. L’auteur se regarde parler, vivre, tout en s’apprêtant à « mourir pour de faux » en raison de son cancer qui tient beaucoup de place. Il nous raconte un de ses amours (séduction, amour, mariage, divorce). Peu importe que ce soit tiré ou non de la réalité. Il s’y livre avec faconde et même s’il nous dit que « ceci est un roman … Tous les personnages de ce livre sont purement imaginaires, sauf l’amour, le cancer et moi-même », on imagine bien la personnalité de l’auteur qui tient beaucoup de place dans ce livre, avec séduction parfois, avec dérision d’autres fois, et qui laisse deviner la multitude des personnages appelés Franz-Olivier Giesbert. Mais laissons-lui la parole : « La vérité m’oblige à dire qu’Isabella m’a redonné vie dans un premier temps. Elle m’a même rassasié de bonheur, jusqu’à ce qu’elle me tue sans préambule, un dimanche de printemps, pour ne laisser de moi que le type qui va maintenant remuer ses souvenirs devant vous avant de retourner dans son cercueil. »
L’auteur a l’art du mot juste, concis et drôle pour se définir : Certes, ma vie est un mensonge. J’allais dire une imposture, mais ce serait forcer le trait. Je suis comme tout de monde, je me laisse porter par le personnage qui, depuis longtemps, m’habite. Dessous, mieux vaut ne pas gratter. Il n’y a que de la poussière, et un peu de poudre aux yeux. Lorsqu’ils en arrivent à se séparer, il dit après s’être consolé avec deux jeunesses : « J’aime beaucoup les femmes, pourvu que ce ne soit pas toujours la même. » Mais on sent bien que ce n’est qu’une manière d’évacuer sa mélancolie.
La conclusion du livre laisse rêveur : Je viens de comprendre ce que j’étais venu faire en ce monde. Je suis un grand frisson qui va, fier et heureux d’avoir découvert l’amour vrai. Est-ce vraiment l’impression que nous a donnée le livre ?
07:59 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, amour, femme, vie |  Imprimer
Imprimer
29/08/2014
Un très grand amour, roman de Franz-Olivier Giesbert (1)
L’auteur est un charmeur. Ce n’est pas qu’il a du charme, mais son souci de séduction en fait son principal trait de caractère. A priori, on ne l’aime pas, tout au moins les hommes. Les femmes, à l’entendre, lui tombe dans les bras chaque jour à chaque instant.
Pourquoi les hommes ne l’apprécient pas ? Il est journaliste, autrement dit raconteur d’informations sans assurance. Il interview avec rudesse et méchanceté, accompagné d’un sourire charmant, mais trop enjôleur, qui ne s’adresse pas à l’interviewé, mais aux spectateurs, en clin d’œil (Que va-t-il répondre ?). Il écrit des livres, des romans, et, il faut bien l’avouer, certains sont très bien écrits avec une intrigue bien bâtie. C’est le cas de La cuisinière d’Himmler. Dans d’autres livres, il se met en scène avec gourmandise et, sous prétexte d’humour envers lui-même, il s’envoie quelques fleurs. Il nous parle de son cancer et de ses problèmes intimes dont on se passerait bien. Enfin, son langage peut laisser à désirer.
Pourquoi les femmes devraient l’aimer ? D’abord nous ne savons pas si, réellement, elles l'aiment. C’est sa parole contre la nôtre. Mais supposons-le. Il est beau dit-on. Disons une belle gueule brutale et virile, ce qui n’est pas sans déplaire aux femmes. Il dispose d’une certaine renommée en tant que journaliste et écrivain, et la renommée est d’un attrait irrésistible pour certaines qui se voudraient égéries. Il est cultivé semble-t-il, ce qui ajoute un bon point à sa faconde. Ajoutons qu’il profère de bons mots facilement, parfois en les empruntant aux autres, mais en le disant.
J’ai longtemps pensé ainsi et ses livres ne me tentaient pas. Et puis, un jour, en mal de lecture, je suis tombé sur La cuisinière d’Himmler. Là, devant l’imagination de l'auteur et la conduite de l’intrigue, je me suis dit que j’avais affaire à un vrai écrivain,. Il sait manier la truculence et l’amour des belles choses, qu’elles soient à décrire, à goûter, à embrasser.
07:51 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : amour, société, femme, vie |  Imprimer
Imprimer
27/08/2014
Le charme 2
Disons tout de même que certains attraits physiques aident à donner du charme à telle ou telle personne. Rappelez-vous la voix de Delphine Seyrig dans les films d’Alain Resnais ou de Marguerite Duras. Une voix caverneuse, enrouée, presque masculine, qui fit dire à Antoine Doinel dans « Baisers volés » : « Ce n’est pas une femme, c’est une apparition ». De même les gestes élégants et les bons mots de l’acteur Sacha Guitry le font plus que charmeur lorsqu’il dit : « Il faut courtiser sa femme comme si jamais on ne l'avait eue… il faut se la prendre à soi-même. » Mais les acteurs sont-ils les seuls à avoir du charme. Certainement non ! Le charme est un plus naturel qui échoue à certains. Il ne doit pas être confondu avec la séduction qui est bien souvent le lot des artistes et plus particulièrement des acteurs. On peut même dire que le vrai charme ne se voit pas le plus souvent. C’est par un heureux hasard, une circonstance particulière que l’on remarque le charme d’untel ou d’unetelle. Il se dévoile subrepticement et vous fait l’effet d’une vaporisation de parfum qui vous rafraîchi le visage. Je connais une petite fille qui par son expression et sa manière de vous regarder, agrémentée d’une fossette qui se dévoile à ce moment-là, vous met à genoux. Ce n’est pas un charme permanent, mais lorsqu’il apparaît vous craquez. Le charme est dans la voix, nous l’avons vu, mais il peut aussi être dans l’élocution. Une voix normale charme si elle a un accent particulier (l’accent français pour les Américains, l’accent russe pour les Français, par exemple).
Plus discret encore est le charme des attitudes. Vous pouvez tomber sous le charme d’une femme parce qu’à un moment elle s’est immortalisée dans une attitude que vous ne pourrez vous empêcher de revoir sans cesse. C’est sa marque de fabrique, son logo même, et son évocation jette un voile noir sur vos souvenirs. Elle est devenue statue immobile qui vous lance des éclairs charmeurs dans le capharnaüm de votre mémoire. Il y a enfin un charme plus subtil, c’est celui de l’innocence et de la transparence. Peut-être avez-vous connu de telle créature qui n’affiche aucune prétention de paraître ou même de faire semblant d’être. Elle est, surnaturelle d’inconscience de son passé et de son présent, intemporelle d’authenticité, bouleversante de fraîcheur. C’est un papillon qui virevolte devant vous en toute simplicité, sans conscience de sa provocation. Ce charme est difficile à émettre volontairement. Il est naturel ou il n’est pas. Il est le plus souvent propre à l’enfance, mais se prolonge à l’adolescence, voire quelquefois à l’âge adulte. Mais très vite, sa prise de conscience chez celui qui l’exerce, dénature ce charme, le transforme en séduction, ce qui lui fait perdre tout ses effets.
Oui, le charme est intemporel, inconstant, inégalement partagé. C’est un don du ciel qu’il ne faut pas dévoyer. Le charme n'est cependant qu'une information et rien de plus. Ce n’est pas un complément de communication comme semble vouloir l’imposer les publicitaires, les voyeurs sur Internet ainsi que les profiteurs de toutes espèces. Le charme est un frisson tendre qui retourne celui qui en éprouve l’effet, mais il peut être une explosion de paillettes ou un voyage garanti dans la vie.
Alors le charme est-il imprévisible ? Ne peut-on, l’apprivoiser ? Le charme c’est la lumière de la grâce qui rayonne en l’être. Il peut être permanent, il peut être occasionnel. Il se révèle aux autres par un lieu du corps ou de l’esprit. Ce peut être une fossette à la joue, ce peut être un geste particulier ou quelques traits d’esprit ou encore des attentions particulières envers telle ou telle catégories de personnes. Le charme fuse alors en pression régulière ou irrégulière par ce défaut de la cuirasse et donne à l’être cette présence charmante que l’on découvre ébloui. Lui-même ne le sait pas et heureusement. Son innocence en esprit lui permet d’être égal à lui-même, en toute quiétude.
07:27 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, amour, homme, femme, séduction |  Imprimer
Imprimer
26/08/2014
Le charme 1
Hier, suite à une réception, nous nous sommes demandés ce que signifie avoir du charme. Qu’est-ce ? Comment se manifeste-t-il ? Comment agit-il ?
Si l’on recherche dans l’histoire et la psychologie ancienne, le charme serait une puissance magique. Il hypnotise celui qui tombe sous sa puissance et le rend inapte au jugement rationnel. Les contes d’enfants parlent de charmes qui rendent incapables d’agir ceux qui le subissent. On dit, de manière plus imagée, qu’un homme est sous le charme de telle femme, alors qu’elle n’est ni belle, ni intelligente. Mais parlons-nous réellement de la même chose ? Il semble que dans les cas cités, les effets du charme soient totalement personnels, c’est-à-dire émanant d’une personne vers une autre personne et une seule dans un but déterminé : séduire, envoûter, manipuler. Dans ce cas, il s’agit d’une relation entre deux, l’exercice d’une influence de l’un vis-à-vis de l’autre.
L’on dit également qu’untel est charmeur, ce qui se traduit le plus souvent par une parole toute orientée vers la séduction ou même la suggestion. Cela se sent le plus souvent et laisse un arrière-goût d’écœurement, voire de malaise, parce que cette ruse n’a qu’un but, obtenir l’objet de son désir quel qu’il soit.
Mais si, de manière générale, l’on dit de telle personne qu’elle a du charme, il s’agit d’autre chose, quelque chose qui est reconnue par un grand nombre de personnes et qui dépasse le caractère volontaire de celui qui l’exerce. Ce n’est plus un pouvoir au but égocentrique, c’est un état de fait, conscient ou inconscient, qui fait dire à la majorité ce qu’elle ressent devant telle personne, mais aussi tel paysage ou tel objet. Le charme est alors en corrélation avec l’adjectif charmant. Cette vision du charme reste attachée à une impression romantique, un amollissement du cerveau qui fait perdre tout jugement rationnel. C’est une sorte de piège dans lequel tombe la majorité par indolence.
Cessons donc de tourner autour du pot et posons-nous personnellement la question du charme d’une personne, cas plus restreint que celui du charme en général qui peut être dévolu à un site, un château, un village, une œuvre d’art, un morceau de musique. Le charme ne peut être assimilé à la beauté. L’expression de Pierre Jean Jouve dans « La scène capitale » (Elle avait serré ses charmes dans un corset majestueux), n’est qu’un exercice de style qui n’a rien à voir avec ce que nous recherchons. Le charme est plus secret que l’attrait physique, moins voyant, moins réel également. Il ne se remarque pas de prime abord et se dévoile progressivement. Une photographie permet difficilement de reconnaître le charme d’une personne, excepté dans son attitude et c’est là un clic fortuit plutôt que provoqué, qui le permet. Les photographes professionnels prennent des centaines de portraits d’une personne pour n’en conserver que quelques-unes. Celles-ci ont saisi le charme de la personne et d’autres non. Pourquoi ?
En cherchant sur Internet ce que pensent les uns et les autres du charme, je suis tombé sur un site destiné aux échanges entre jeunes et ai trouvé un article qui m’a semblé intéressant par la concision de la définition, même si celle-ci reste la vision d’une jeunesse qui ne s’encombre ni de la manière de dire les choses, ni de la manière de les écrire :
le charme dépend d'un comportement, d'un caractere, il refléte ta personnalité!
c'est plus interieur, qu'exterieur, mais en même temps les deux ce conjuguent!
c'est une façon de dire, j'ai envie de te faire l'amour sans le dire, mais avec un regard si profond qu'on en tomberait!
c'est un regard qui te dis je t'aime, sans rien dire, et dont le corps s'exprime a lui tous seul!
c'est un regard enivrant dans lequel tu as envie de te noyer, et tu es hypnotisé par celui-ci, car il révele toute sa beauté interieur!
c'est une façon de dire non! en souriant, avec un regard en coin!
bref une personne qui a du charme, c'est un être: sensuelle, intelligent, attendrissant, doux et piquant a la fois! mi ange mi demon! avec un côté sauvage..................
avec pourquoi pas un beau petit cul en prime!
From : http://www.comlive.net/Avoir-du-charme,37664.htm (23/08/2014)
On peut ne pas être d’accord avec cette définition claironnante, mais elle révèle néanmoins de manière très juste que le charme n’est pas dans l’apparence d’une personne (sa beauté, sa volonté, son intelligence, etc.). Il est d’origine plus intérieure. Il dépasse même les impressions de prestance, d’attrait, de suavité, d’élégance, de délicatesse. Contrairement à ce que semble dire celle qui a écrit ce billet, le charme n’est pas un attribut destiné à éveiller le désir sexuel, même si ses effets conduisent souvent à des situations de cet ordre. C’est autre chose, mais quoi ?
07:13 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, amour, homme, femme, séduction |  Imprimer
Imprimer
25/08/2014
Un été pour mémoire, de Philippe Delerme
Un livre poétique qui égraine des souvenirs d’enfance doux comme le miel au bord de la Garonne dans la chaleur des étés. Mais est-ce réellement un roman ? Non, pas d’intrigue ou presque rien, des senteurs, des images, des goûts, des conversations, des impressions et, parfois, des réflexions, d’une écriture séduisante qui envoûte l’esprit et lui donne des ailes.
Chaleur… Temps arrêté… C’est l’amertume du café sur le début de l’après-midi, le grand soleil en creux des maisons fraîches, et je revois… Les routes de l’été, si blanches de soleil. La pédale qui grince, et cette côte de Saint Paul n’en finit pas, le délicieux virage à l’ombre du bois sec, plus loin la route tremble et fond. C’est l’heure de la sieste, il fait si chaud sur les étés d’enfance à petits coups de pédale envolés vers les fontaines de Saint-Paul. Odeurs mêlées de cambouis, de goudron, rêves croisés de filles et Tour de France…
Et dans ces souvenirs, le rire léger de Marine, une petite fille d’une dizaine d’années, déjà presque adulte dans ces réflexions et simagrées. Elle l’envoûte gentiment, tantôt se poquant de lui, tantôt s’appuyant sur lui. Il fait connaissance d’un autre monde, inconnu, puis quitte tout à la fin de l’été, y compris Marine.
Ce n’est pas une histoire, ce sont des rêves d’enfance, imagés, souriant comme un voile à l’arrière-goût de bonheur, qui charment l’esprit et emprisonnent la mélancolie.
07:03 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, roman, mémoire, souvenir, impression, société |  Imprimer
Imprimer
18/08/2014
Informatique
On aime, non pas d’amour, mais d’utilité, cet engin qui vous livre tout prêt le produit de votre pensée, résumé, mis en page, quasiment pesé et empaqueté. Quelques clics, trois ou quatre touches caressées, mise en route de l’imprimante qui doit vous sortir « La Page », belle comme une image.
Mais hier, tout est différent. Vous vous réjouissez comme à l’accoutumée. Vous rêvez déjà devant cette page emplie de signes qui disent tout de ce que vous pensez. Vous posez votre doigt sur la souris. Elle accepte cette pression douce. Mais la machine fait Couic. Vous pensez vous être trompé. Vous reprenez votre registre de contrôle, suivez la procédure tel un cosmonaute accompli, vérifier à deux fois avant d’appuyer, sûr de vous, la touche correspondante et Couic à nouveau. Que je suis maladroit ! Vous exclamez-vous. Vous reprenez la procédure, cochant d’un trait de crayon chaque étape de l’envol. Vous arrivez au bout de la check-list, fier de vous, en bon ingénieur accompli. Vous vous réjouissez doublement en fin de liste lorsque toutes les tâches ont été menées, dans un ordre parfait, respectant toutes les procédures compliquées qu’impose l’impression d’une simple feuille de papier. Coup de doigt : Couic !
Pourtant est-ce si compliqué de changer l’impression habituelle du format A4 en format DL, vous savez, ces cartons allongés sur lesquels votre esprit erre comme sur la plage, tout en longueur et, en trait fin, et suit le fil de l’horizon qui s’arrête hors de votre vue. Vous avez bien suivi les consignes : mise en page correcte, vous vérifiez la taille de la feuille, l’orientation, les marges. C’est OK. Vous cliquez sur le volet impression et vérifier les paramètres : c’est la bonne imprimante sélectionnée, impression recto, orientation, marges, format, tout est OK. Vous entrez dans les propriétés de l’imprimante : là, il faut dire que les choses se corsent. Bien sûr la notice est en anglais. Non pas la langue de Shakespeare, mais le sabir habituel des machines imaginées par un européen, conçues par un indien, fabriquées par un chinois et mis en vente par un américain qui empoche la mise. Oui, vous aviez peut-être oublié de modifier le format du papier au niveau de l’imprimante, ce qui crée des disjonctions entre l’ordinateur et la fonction impression. Alors vous recommencez pour la troisième fois le déroulement de la check-list, espérant, et ne faisant qu’espérer cette fois-ci, que cela marche. Vous appuyez d’un doigt incertain sur la touche… Couic. Rien ! Pas le moindre frémissement dans la machine. Elle est devenue un corps inanimé, misérable tas de ferraille et de beaucoup de plastique. Elle a perdu son âme à qui pourtant l’on demande peu, juste un tour dans l’essoreuse pour voir sortir à l’autre bout une feuille noircie correctement.
A ce point de votre démarche vous commencez à vous énerver. Si je ne suis pas foutu d’imprimer une simple feuille de papier, comment pourrai-je écrire un livre, vous dites-vous. Vous doutez de votre agilité d’esprit, mais comme aucune autre idée ne vous vient à l’esprit et que c’est bien la panne complète dans votre petite tête, vous appelez le spécialiste de l’informatique. Il arrive, sûr de lui. Il reprend la check-list et d’un léger sourire appuie sur la touche Impression : couic… Ah, dit-il, laissant trainer la fin du mot, la bouche légèrement entrouverte, l’air un peu dépité. Il reprend bien sûr la procédure avec plus d’attention comme vous l’avez fait vous-même quelques minutes auparavant. Appui : couic ! Il se lance alors à corps perdu dans un interrogatoire sous Google, est submergé de réponses et clique sur la première. C’est le site des fanas de l’informatique ou des paumés de l’informatisation. Les premiers répondent aux questions bêtes des seconds qui chaque jour envoient leur message de détresse à des correspondants diplômés se trouvant à l’autre bout du monde. Il faut bien sûr user du traducteur automatique pour comprendre leur langage, et encore, vous n’en comprenez que la moitié. Mais lui, l’informaticien diplômé, comprend tout, sans traducteur. Fermez votre ordinateur et relancez-le. Il n’y croit pas, mais il essaye toujours. Cette fois-ci la check-list est plus longue, cela prend bien cinq minutes avant que la machine pensante puisse dire à la machine imprimante ce qu’elle veut. Et celle-ci se met à gronder ! Elle vrombie, laisse entendre qu’elle va fonctionner, et… Elle fonctionne. Quel bonheur ! Bien sûr, vous jetez un œil sur la feuille sortie de la fente. Déception. Vous constatez que les couleurs se sont dédoublées : le bleu et le jaune n’imprime pas du vert, mais un tas informe de couleurs sales. Votre informaticien ne s’en émeut pas. Son diagnostic : décalage ! Il faut recaler. Alors il procède à une nouvelle check-list, glisse une feuille de papier blanc dans le bac, lance le monstre qui imprime une nouvelle page. Déception, les couleurs restent brouillées. Nouvelle interrogation des spécialistes sur la toile. L’une des réponses énonce : éteindre la machine et la laisser reposer une heure. Elle repartira en ordre, heureuse de vous faire plaisir. Ben voyons ! Tentons tout simplement d’arrêter les deux machines et remettons-les en route. Tout ceci est fait en moins de dix minutes. Pas couic, mais à nouveau des couleurs qui s’entrechoquent. Alors de guerre lasse et parce qu’il est tard, vous raccompagnez à la porte l'expert qui rentre chez lui dépité. Nous verrons demain…
Le lendemain, jour nouveau… L’expert arrive, recale les modèles de format, appui sur "imprimer" et… miracle… la feuille sort, impeccable de netteté et d’arrogance. Pourquoi ? Nul ne le sait hors de l’expert qui seul a dompté la machine rebelle. Il repart, monté sur des roulettes et s’évade vers l’horizon, me laissant pantois, mais heureux. Tout reprend comme à l’accoutumée.
07:46 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : informatique, imprimante, société, travail |  Imprimer
Imprimer
17/08/2014
Le mal et le bien
On oppose sans cesse le mal au bien, comme les deux extrêmes du comportement des hommes, voire de l’univers. On trouve le mal partout. Dans la nature, les cataclysmes viennent et partent sans cesse. Il y a des plantes carnivores et d’autres vénéneuses. Les animaux s’affrontent sans merci pour manger et subsister. Quant aux hommes, il n’est point nécessaire d’en parler : certains pensent qu’ils ne sont que mal et qu’aucun bien n’en sort.
Mais qui d’entre vous a vu le mal personnifié ? De toute chose l’homme attend un bien, même du mal. L’inverse n’est pas vrai. Personne n’attend du bien qu’il produise du mal. Il y a donc une différence notoire entre l’un et l’autre. Le bien supplante le mal parce que du bien comme du mal on attend un mieux, c’est-à-dire un bien supérieur. Les cataclysmes n’ont lieu que pour équilibrer les forces de la nature. Le serpent pique pour se protéger. Le loup mange l’agneau pour subsister. L’homme mauvais ne fait qu’espérer que sa méchanceté lui apporte plus de richesse, de gloire, de pouvoir ou d’autre chose qui sont censés représenter le bien pour lui. L’inverse n’existe pas ou n’est qu’un stratagème qu’utilise le mal pour atteindre un bien. Seule la pensée humaine peut imaginer que le mal personnifié existe. C’est la figure du diable. Il fait le mal pour qu’il y ait encore plus de mal. Il tisse sa pelote par le mal, pour le mal, dans le mal. Mais l’avez-vous vu ?
Le miracle de l’homme est donc cette recherche permanente d’un bien par tous les moyens. Il est attiré par le bien, même si les moyens qu’il utilise sont mauvais. Et seul l’homme est ainsi. Les autres êtres des mondes minéraux, végétaux ou animaux n’ont pas conscience du mal. Ils existent, craignent pour leur vie, cherchent à subsister parce que c’est dans leur nature, voire leur inconscient en ce qui concerne le monde animal. Les animaux ont en effet un inconscient et un conscient, certes beaucoup moins développé que l’homme, mais tout de même. Regardez un chien dormir. Il rêve comme l’homme. Cela se voit à ses gestes inconscients. Regardez tigres et panthères, ils défendront leurs petits jusqu’à la mort. Mais cela ne les empêche pas d’attaquer les petits des autres et d’user de toute sorte de ruses pour en faire leur festin.
Ce qui caractérise l’homme par rapport à l’animal est d’avoir la conscience du bien et du mal. Serait-ce l’acquis qui lui donne ce plus qui est une montagne en soi ou cette conscience est-elle innée ? Seul un regard sur l’enfant peut nous le dire. Non, ce n’est pas inné. L’enfant prend sans aucune interrogation morale ce qui ne lui appartient pas comme l’animal attaque celui qui est plus faible que lui. La notion de propriété, lié à une réminiscence de bien de la possession, est supérieure à celle de partage. Il agit comme l’animal et celui-ci, s’il s’agit de ses propres enfants, est plus évolué que l’enfant humain.
C’est donc un long apprentissage que celui de la notion de bien et de mal. Passer de la notion de bien au sens individuel qui comprend toutes choses qui comblent son receveur au risque d’entrainer des difficultés pour l’autre, à la notion de bien pour tous qui contraint beaucoup plus le receveur, est une des étapes de la vie la plus difficile à franchir.
Pourtant il existe des hommes qui agissent sans recherche de bien. Le mal pour le mal existe. La haine et l’idéologie en sont le moteur. Disons que dès l’instant où l’homme n’a plus de buts réfléchis, où l’éclaircissement de la raison fait place à l’aveuglement de la rage, le mal peut apparaître dans toute sa froideur et sa cruauté. L’homme en proie à cet aveuglement se fabrique un monde imaginaire qui conspire contre lui-même et sa représentation du monde. Il croît encore chercher le bien, mais c’est le mal qui l’emporte, hors de toute raison.
Alors méfions-nous de nos pensées toutes faites sur le monde et les hommes. Elles peuvent être dangereuses.
07:20 Publié dans 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philisophie, vie, morale, connaissance, éthique, raison, société |  Imprimer
Imprimer
14/08/2014
Le destin
Plutôt que de se poser la question d’une manière anonyme, demandons-nous concrètement si nous avons un destin. La réponse n’est pas facile et chacun répondra selon la vie qu’il a eue ou qu’il s’est fait. Car le destin concerne la vie de tout un chacun. Mais demandons-nous également ce qu’on appelle vie. Parlons-nous de ce qui traverse des événements et est interféré par eux ou exprimons-nous ce que nous ressentons au plus profond de nous-même, ce lieu en nous plus nous-même que nous-même. Au-delà de ce moi sujet et prisonnier des battements d’aile des papillons que sont les événements qui influent sur notre devenir, y a-t-il un Soi plus stable, ai-je une âme qui recherche quelque chose et que recherche-t-elle ?
La question commence à devenir plus ardue. Il ne s’agit plus de savoir si je suis libre de mener ma vie comme je l’entends ou si ce qui m’arrive est un destin qui m’est imposé ou m’a été confié. Il est question de m’interroger au plus profond de moi-même non pas sur la vie en général, mais sur comment je conçois ma vie.
Vaste débat, me direz-vous. Trop vaste débat pour trouver une réponse qui n’a jamais été trouvée réellement. Mais dans le même temps, il existe énormément de réponses toutes faites, très différentes les unes des autres auxquelles on peut croire ou ne pas croire. Mais que signifie ce terme de croire ? S’agit-il d’adhérer à une opinion, un concept, une croyance, c’est-à-dire se rattacher à quelque chose sur laquelle d’autres ont réfléchi, ou la question est-elle, non plus de croire, mais de pénétrer dans le brouillard pour tenter d’y trouver quelques points de repère afin de savoir et non seulement de croire. Faites votre quête vous-même et ne vous laissez pas imposer votre propre vision de vous-même par les autres. Mais, me direz-vous, nous passerons alors notre vie à réfléchir. Sûrement pas ! Nous irons bien au-delà et c’est notre propre vie qui nous guidera. Nous prendrons de la distance par rapport à ce qui nous arrive. Nous regarderons de loin les événements qui ont fait notre vie et surtout nous chercherons comment nous avons réagi face à ces événements. Nous finirons par comprendre qu’il y a certaines constantes dans ces réactions. C’est normal. C’est le fruit de notre héritage génétique, puis de notre éducation, enfin de notre environnement. Mais ceci ne concerne que notre vie extérieure.
Alors cherchons à distinguer comment réagit notre vie intérieure à ces événements. Comme cela nous mène loin ! La question du destin est devenue notre interrogation finale : qui suis-je et où vais-je ? Oui, la question a évolué, mais l’interrogation reste la même. Cette vie m’est-elle imposée en grande partie ou suis-je capable d’en faire ce que je veux ? Retour à la case départ. Mais nous avons cependant progressé. Nous avons élargi considérablement le cercle de notre réflexion et de nos expériences et maintenant nous nous posons la question différemment : y a-t-il, au-delà de ce moi qui tente de réagir ou même d’imposer sa volonté face aux événements qu’il subit, un espace de liberté réelle dont je suis maître ?
Fouillons dans nos souvenirs : ai-je déjà expérimenté l’existence de cet espace de liberté ? Ai-je déjà ressenti à un moment quelconque de ma vie cette aspiration qui m’a conduit à m’envoler vers la liberté. Oui, cela je le crois : tous nous expérimentons à un moment ou à un autre ce grand vide qui nous fait dire : il y a autre chose derrière ma vie quotidienne. Qu’est-ce ? Je ne sais. Mais maintenant je vais chercher, cela va devenir un des buts de ma vie. Et nous savons que nous avons trouvé notre vrai destin. Nous cherchons tous la même chose, mais la réponse à ce que nous cherchons est différente pour chacun parce que chacun est différent.
C’est cela notre destin : réaliser notre liberté malgré les événements quotidiens qui obscurcissent notre vision. Et cette liberté est la mienne, différente de celle des autres, qui doit être vécue dans la liberté des autres qui eux-mêmes doivent vivre leur propre destin. N’est-ce pas merveilleux ? Chacun d’entre nous est unique et se doit de découvrir son propre destin, c’est-à-dire exercer sa liberté personnelle en harmonie avec la liberté des autres.
07:14 Publié dans 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vie, philosophie, connaissance de soi, liberté, société, réflesion |  Imprimer
Imprimer
13/08/2014
La déclaration, l’histoire d’Anna, de Gemma Malley (2007)
Mon nom est Anna. Mon nom est Anna et je ne devrais pas être là. Je ne devrais pas exister. Pourtant j’existe. Ce n’est pas ma faute si je suis là. Je n’ai jamais demandé à naître. Même si ça n’excuse pas le fait que je sois née.
Anna est un Surplus : excédentaire, en trop. Dans d’autres pays, on les éradique. Ici, en Grande-Bretagne, on les élève dans un Foyer de Surplus. Ils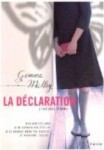 servent de main d’œuvre bon marché et ils doivent travailler dur, très dur, pour prouver leur gratitude. Elle a de la chance, elle a fait un stage dans une maison avec moquette et canapé, chez Mrs Sharpe. Elle était gentille et lui avait même proposé un jour de mettre du rouge à lèvres. Elle aurait aimé rester sa servante. Elle ne l’a pas frappée une seule fois. Les Surplus n’ont pas droit aux objets personnels ; rien ne peut décemment leur appartenir dans un monde auquel ils imposent déjà leur présence, comme dit Mrs Pincent, l’intendante. Et pourtant Anna tient un journal personnel qu’elle cache dans une des salles de bain de l’établissement.
servent de main d’œuvre bon marché et ils doivent travailler dur, très dur, pour prouver leur gratitude. Elle a de la chance, elle a fait un stage dans une maison avec moquette et canapé, chez Mrs Sharpe. Elle était gentille et lui avait même proposé un jour de mettre du rouge à lèvres. Elle aurait aimé rester sa servante. Elle ne l’a pas frappée une seule fois. Les Surplus n’ont pas droit aux objets personnels ; rien ne peut décemment leur appartenir dans un monde auquel ils imposent déjà leur présence, comme dit Mrs Pincent, l’intendante. Et pourtant Anna tient un journal personnel qu’elle cache dans une des salles de bain de l’établissement.
Qu’est-ce qu’un surplus ? On le découvre peu à peu. C’est la surprise dans un monde figé par la longévité, remède contre la vieillesse, grâce au Renouvellement qui permet d’obtenir des cellules flambant neuves pour remplacer les anciennes et rectifier le reste de vos cellules en plus. De plus le Renouvellement permet de ne plus vieillir. Si au début les Autorités étaient contre ce traitement, elles l’adoptèrent et les gens cessèrent de mourir. La population ne tombait jamais malade et cela générait des économies substantielles. L’inconvénient fut que la terre devint vite surpeuplée. Aussi la Déclaration de 2065 a limité le nombre d’enfants à un seul par famille. Puis, comme elle croissait malgré tout, les naissances furent interdites, sauf si l’un des deux parents s’Affranchissait de la Longévité. Une vie pour une autre, préconisait la Déclaration.
L’arrivée de Peter, un nouveau Surplus, va changer la vie d’Anna. « C’est toi Anna Covey ? Je connais tes parents. » Peter progressivement fait naître en Anna le désir d’une autre vie. Ils finissent par s’enfuir et sont poursuivis par la brigade des Rabatteurs. N’en dévoilons pas plus. Il faut laisser au lecteur la joie de la découverte.
C’est un roman qui n’a aucune prétention littéraire. Il est cependant raconté avec brio, dévoilant progressivement ce monde stupéfiant, figé et protectionniste. Certes, il est un peu éculé de choisir deux adolescents pour révolutionner ce monde. Mais ce n’est pas qu’à la fin du livre que l’on prend conscience qu’il s’agit bien de faire la révolution dans cette société égoïste. Le fil conducteur est l’apprentissage de la liberté pour Anna, qu’elle refuse tout d’abord, puis qu’elle finit par entrevoir et à laquelle elle adhère. Comment ne pas se demander s’il n’en est pas de même dans notre société : des règles, pas de sentiments qui n’amènent que des ennuis, le travail magnifié, une vie discrète et disciplinée laissée aux autorités qui font les choix. Alors on se réfugie dans son monde, différent pour chacun, un monde où la créativité est le seul moyen de sortir debout et fier comme ces Surplus qui deviennent finalement Légaux en tant qu’Affranchis.
07:57 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, roman, littérature, société, aventure |  Imprimer
Imprimer
11/08/2014
Voyage difficile
Un train est un lieu où la vie privée des gens s’étale au grand jour. Cette vie est le plus souvent normale et on ne la remarque pas. On relève de ci de là quelques petites anomalies, telles ce Monsieur qui discrètement se cure le nez ou cette dame dont la chair déborde du fauteuil, obligeant chaque passager empruntant le couloir à se contorsionner avec douceur. On observe parfois un couple qui, contre toute attente, est assis dans une intimité qui aurait dérangé la plupart des gens il y a encore quelques années. Mais comme dans les trains tout le monde fait comme chez soi, cela importe peu.
Les petits enfants prennent possession d’un train et ont beaucoup de mal à prendre conscience qu’ils ne sont pas seuls sur ce terrain de jeu. Les parents (de ces enfants) ont également beaucoup de mal à comprendre qu’ils sont responsables de la conduite de leur enfant et que leur liberté de faire ce que l’on veut est limitée par la liberté des autres. Les enfants ont une autre caractéristique. Ils ne savent pas parler, ils crient. Pas tous, mais un certain nombre, ceux à qui l’on n’a jamais dit de parler doucement. Il appartient aux parents de leur apprendre que leurs propos n’intéressent pas forcément l’ensemble de la population d’une voiture de chemin de fer. Enfin, il est évident que les enfants tâtent le terrain pour savoir jusqu’où ils peuvent aller. Un voyage se déroule donc sur plusieurs épisodes.
Une entrée dans la voiture peut être bruyante, mais avouons qu’elle est généralement calme. L’enfant (petit) est intimidé et tient sagement la main d’un de ses parents. Ceux-ci l’installent et s’assoient autour de lui. Il est le roi, mais on ne le montre pas. Il prend son pouce, loge sa tête entre les seins de la mère et accepte de faire semblant de dormir pendant un certain laps de temps, généralement court. Les parents devisent à voix basse d’affaires importantes (Où as-tu mis son doudou ? Il va s’endormir ! Etc…). Tout semble pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sauf que l’enfant n’a pas vraiment envie de dormir. Les yeux ouverts, il observe son environnement et son entourage. Il commence à faire quelques remarques : « Dis Papa, tu as vu, le monsieur, il a un gros ventre ! » ou encore : « Pourquoi la dame elle a un chapeau. Il pleut pas dans le wagon ! » Ces questions ne dérange pas le père qui lui raconte quelque chose dans l’oreille du style : « C’est parce qu’il mange trop ou c’est parce qu’elle n’a plus de cheveux au-dessous. » Aussitôt l’enfant reprend : Ah bon, qu’est-ce qu’il mange ? » Nouveau conciliabule, mais cette fois-ci le père a l’air gêné. Ce qui n’empêche pas l’enfant de reprendre : « Parle plus fort, j’entends rien ! ». La mère dit alors au père : « Emmène-le aux toilettes. » Le père, trop heureux de ce divertissement, se lève. Les femmes ont souvent l’art de modifier l’attention par une remarque ou une demande plus générale empêchant la conversation de s’appesantir sur des paroles un peu lourdes. Ce n’est pas forcément une remarque d’intérêt culturel du style : « Il y a une nouvelle exposition à la galerie Tartepeintre. Tu sais, l’artiste qui assemble des épingles et fait des sculptures piquantes ! » Non, généralement, lorsque la famille déjeune, c’est plutôt : « Qui reprend de ces délicieuses nouilles au beurre ? » Mais cette petite demande a l’avantage de détourner la conversation sur du plus concret ou du moins gênant.
Cette promenade au bout de la voiture est cependant un calvaire pour le père et une détente pour l’enfant. On passe au deuxième épisode. Il fait connaissance avec l’assemblée, regardant un peu partout, échappant à la main paternelle, courant dans l’allée centrale et bousculant ceux qui ont le malheur d’avoir qui un coude débordant du fauteuil (après son passage le monsieur se masse le coude longuement), qui un pied malencontreusement pas dans l’axe du corps (là c’est l’enfant qui manque de s’étaler, ce qui contraint la personne à lui faire un sourire et à s’excuser auprès du père), qui encore le fil de la souris de son ordinateur qui pendouille à l’extérieur et dans lequel l’enfant se prend les pieds (l’ordinateur est rattrapé de justesse par son propriétaire). Tout ceci se passe sur un ton badin dans la plus parfaite correction, même si les parents n’ont qu’un sourire à l’égard des personnes dérangées sans aucun mot d’excuse. C’est normal, semblent-t-ils dire. Quelle idée de s’étaler sur l’allée centrale !
Troisième épisode : retour à la place attitrée. On aurait bien voulu qu’elle soit attitrée ailleurs, mais là, il n'y a pas le choix ! La mère tente de distraire l’enfant une fois installé : « Tiens, voilà tes petites voitures ! » L’enfant considère les trois jouets, s’essaye à en faire rouler une. Elle tombe bien sûr de la table qui n’est pas faite pour cela. Le père la ramasse et lui donne. Aussitôt il recommence, elle tombe à nouveau, le père la ramasse. Troisiè… Non le père la rattrape au vol et lui dit d’arrêter. Alors l’enfant jour au stockcar. Les accidents arrivent vite au royaume des enfants. C’est beaucoup plus drôle qu’une vie sans histoire. Entre temps, les décibels commencent à monter malgré les airs attendris des spectateurs qui ne se doutent pas que cela ne fait que commencer. L’enfant, enhardi par ces signes encourageants, commencent à parler. Une vraie trompette ! Et, de plus, un moulin à paroles. Toute la voiture sait de quoi il parle et avec qui. Les parents ne semblent pas émus par ces échanges doucereux pour eux. C’est le mode de communication normal. Eux-mêmes cependant parlent de manière atone ce qui contraint l’enfant à sans cesse dire : « Quoi ? Quoi ? » Personne ne comprend personne, mais cela augmente la tension.
Vous abandonnez votre livre, abaissez légèrement votre siège et tentez de vous réfugier dans le sommeil ou, au moins, une légère somnolence qui vous fera oublier ces petits inconvénients des voyages. Le ronronnement du train, trente secondes de silence, vous font revenir à de meilleurs sentiments. Vous pensez à des choses agréables. Vous partez à la mer et pensez au bain que vous prendrez en arrivant ; vous vous rendez à la campagne et faites une promenade dans les bois à la recherche de champignons. Bref, votre vie reprend le dessus sans rien pour la faire trébucher. Erreur !
Quatrième épisode : un cri suraigu retentit dans la voiture : « Dis Maman, regarde, des vaches. », dit l’enfant en montrant le paysage. On lui pardonne cet étonnement (un enfant des villes n’en voit probablement pas suffisamment souvent). Mais on lui pardonne moins ce cri. On est cependant bien contraint de passer. On se réinstalle, on ferme à nouveau les yeux, on se réfugie dans ses pensées. Nouveau cri, on ne sait même plus pour quelle raison. Il s’accompagne d’une dégringolade des voitures que l’enfant fait tomber sans motif. Ramassage, sourire, apaisement. Mais rien vers l’enfant qui continue de plus belle. Excité, il ne parle plus, il hurle et secoue ses voitures les unes contre les autres.
Alors, excédé, vous vous levez, rassemblez vos affaires, prenez votre valise et changez de voiture. Que ne l’ai-je fait plus tôt, vous dites-vous une fois installé. Comme tous les voyageurs, vous sortez vos oreillettes, réglez votre appareil et vous vous plongez dans les délices d’une symphonie de Mozart. Vous vous endormez. Vous êtes malheureusement très vite réveillé par un arrêt à une nouvelle gare. Zut ! Une famille s’installe de l’autre côté de l’allée. Cette fois-ci, vous n’attendez pas, vous changez de place.
07:46 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : voyage, société, enfance, parents, éducation |  Imprimer
Imprimer
06/08/2014
Bains de mer
Retour en Méditerranée et ses plages chaudes après de nombreuses vacances en d’autres lieux.
Première impression : le bruit, un bruit confus fait d’abord, comme sur tous les bords de mer, du Fraooo…om, Fraaa…am des vagues venant faire leur dernière révérence à vos pieds. Il emplit vos oreilles de son bercement chaotique, incessant, fractionné. Vous ne l’entendez plus, mais il est là, permanent, comme du poil à gratter sous votre chemise. Il faut changer de lieu comme il faut changer de chemise pour s’en débarrasser. Puis les cris aigus des enfants. Que disent-ils ? Peu importe. Ils crient, et comme le bruit alentour est constant, ils rajoutent quelques décibels à leur manière habituelle de s’exprimer. Cela signifie qu’ils s’amusent. Enfin, les conversations d’adultes, plus douces certes, réservées au cercle des proches dont vous profitez obligatoirement étant à très faible distance de tout un chacun. Madame qui raconte que l’autre jour son petit s’est fait piquer le pied en entrant dans l’eau. Monsieur qui explique qu’il a vu, également sous l’eau, un poisson d’au-moins soixante-dix centimètres. Il était énaurme ! Et ses proches le regardent, peu convaincus, mais n’osant pas le contredire. Le jeune homme qui raconte son ascension du Mont Blanc un jour d’orage et la fille qui lui demande s’il n’a pas eu peur. Le vieillard qui demande à tous ses voisins s’ils n’ont pas vu une petite fille au maillot vert. Tous ces bruits, conversations, manifestations de joie, vous font penser au métro. Pas celui de Paris où les gens ne parlent pas et remâchent leurs problèmes en eux-mêmes, le visage fermé ; mais celui de Rome, où les conversations vont bon train et vous laissent cois.
Deuxième impression : le mouvement qui envahit vos yeux comme le bruit agresse votre ouïe. Certes, le mouvement, faible, des vagues qui viennent arracher quelques grains de sable sous vos pieds, mais surtout cette impression de désordre indescriptible, chacun ne pensant et n’agissant que pour lui-même (mais y pense-t-il ?). Un tableau cubiste de jambes en perpétuel mouvement, de bras s’étendant, de pieds écrasant le sable, de cheveux volant sous la brise, de postérieurs s’enfuyant. Curieux que ces gens qui viennent chercher le repos en vacances, ne cessent de bouger, sauter, se retourner face au soleil comme le fait la saucisse posée sur la grille du barbecue.
Troisième impression : la couleur ou plutôt les couleurs, sans ordre, sans organisation, mêlées au mouvement. Un véritable caléidoscope. Elles sont exacerbées par les rayons du soleil, attirent l’œil droit comme l’œil gauche. Votre regard ne sait plus où aller pour se reposer : serviettes de bain étendues sur lesquelles les humains sont assis, couchés, debout parfois, accrochés à leur île minuscule qui les protègent de l’envahissement ; maillots unis, à fleurs, rayés en longueur ou en largeur, d’autres comportant des nœuds sur les seins, sur le nombril, dans le dos (comment fait-elle pour faire un nœud aussi artistique dans son dos ?) ; bleu de l’eau couverte de têtes ; jaune de la plage que vous distinguez difficilement étant trop encombrée de corps. Un vrai cimetière urbain ! Vous admirez le maillot de Madame qui lui permet de cacher un embonpoint certain, le short serré sur les cuisses de l’adolescent qui gonfle ses pectoraux, l’élégance de l’absence de tissu sur de nombreuses parties du corps de la jeune femme. Enfin ces bouches rouges, roses, violacées de femmes commentant les faits et gestes de leur enfant, riant ne sachant pas pourquoi ou ouvertes de surprise sans émettre un son.
Bref, vous êtes au bord de l’eau… Mais cette proximité de la mer n’est-elle pas également proche de l’atmosphère parisienne, du métro, du stade, du zoo de Vincennes, de l’opéra, des berges de la Seine où passent les bateaux emplis de monde qui regardent ceux qui les regardent. Quel jeu de cache-cache ! Vous courrez en province pour vous retrouver dans la capitale, vous regardez ces gens qui vous regardent et vous n’avez rien d’autres à voir, à entendre, à toucher.
Le soir, rentré dans votre location (vous n’avez pas les moyens de vous acheter une maison que vous n’utiliserez qu’une fois l’an), soulé de bruits, de mouvements et de couleurs, vous affirmez : « L’an prochain, j’irai en montagne ! ».
07:46 Publié dans 12. Trouvailles diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, homme, femme |  Imprimer
Imprimer
05/08/2014
Vertu
Certains mots vieillissent, comme les humains. On s’en sert sans y prendre garde, et puis, un jour, quelqu’un rit : de quoi parle-t-il ? Oui, vous êtes décalé. Ce mot ne s’emploie plus, il est ringard. Ainsi en est-il de la vertu. Certes, l’expression de « femme de petite vertu » s’applique-t-elle toujours à certaines catégories de la gente féminine, mais comme ces catégories ont singulièrement augmentées ces dernières années en raison de la libération des mœurs, on ne l’utilise plus guère.
Sous les romains, la vertu était synonyme de force. Elle désignait le courage physique ou moral, la force d’âme, la vaillance. Son origine est dérivée de vir qui donna viril et virilité. D’après Caius Marius : « La vertu est la clef de voûte de l'empire (romain), faisant de chaque seconde de la vie du citoyen, une préparation minutieuse aux dures réalités de la guerre, et de chaque bataille rien d'autre qu'un sanglant entrainement ».
La vertu s’est ensuite déclinée en vertus cardinales qui sont le courage, la prudence, la tempérance et la justice, en vertus intellectuelles (la sagesse, la connaissance, l’humilité), en vertus morales (la charité, la chasteté) ou même théologales (la foi, l’espérance et la charité). Mais comme ces déclinaisons nous semblent loin.
Les Romains étaient-ils aussi vertueux que nos politiques sont obstinés ? Les premiers flottaient dans leur image et montaient au plus haut des opinions, les seconds persistent et signent pour accumuler sièges et mandats. La vertu étant devenue un mot ringard, on lui cherche des équivalents. Celui qui semble le plus proche serait sans doute l’éthique. Ce mot fait plus sérieux, plus philosophique et moins moraliste. On en parle beaucoup, on la pratique peu. Elle est l’objet de débats et de colloques, mais sa pratique reste tiède. Pourquoi s’encombrer d’un moteur de quatre chevaux alors que la puissance se situe sans conteste du côté de la pratique des amitiés politiques. Pourtant la vertu politique, disait Robespierre, est un « sentiment sublime qui suppose la préférence de l'intérêt public à tous les intérêts particuliers ; d'où il résulte que l'amour de la patrie suppose encore ou produit toutes les vertus : car sont-elles autre chose que la force de l'âme qui rend capable de ces sacrifices ? Et comment l'esclave de l'avarice et de l'ambition pourrait-il immoler son idole à la patrie ? ».
Au siècle précédent la vertu restait à l’honneur, mais de manière plus personnelle. Elle désignait une personne propre et devenait synonyme d’austérité. Les grandes figures morales devenaient des hommes ou des femmes à principes, pratiquant la chasteté, la fidélité, l’honnêteté. Mais ces façades cachaient beaucoup d’hypocrisies.
La vertu existe-t-elle encore ? Oui, certes. L’utilisation de la locution en vertu de reste un pied de nez littéraire, une culbute des artistes de la parole comme des hommes de loi. Et lorsqu’elle est employée dans la formule magique en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, on atteint le fond de l’hypocrisie politique. Cependant, la vertu républicaine est remise à la mode, mais une mode fantoche.
Le mot vieilli. Et pourtant, n’est-elle pas belle cette qualification de vertueux ? Elle me fait penser immanquablement à la personne qui s’enduit de crème transparente pour errer dans le monde et se glisser entre les colères et autres luttes sociales, au-dessus du lot et des foules.
Aussi, je m’interroge : quelle est ma vertu première ? Je n’ai pas encore trouvé.
07:34 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, modernisme |  Imprimer
Imprimer
03/08/2014
La femme, pile ou… face
Vous ne me croirez pas. Ce matin, comme à l’accoutumée, je partis courir dans les rues, le nez au vent, l’haleine fraiche, le pied léger. Mais je n’ai pas les yeux dans ma poche comme ceux qui courent en se concentrant sur eux-mêmes, sans rien voir de ce Paris qui a toujours quelque chose à montrer, voire à dévoiler. Ce fut le cas ce matin. Je m’échauffais doucement, courant en petites foulées, musardant vers une vitrine, regardant pas les fenêtres ouvertes au quatrième étage (les rez-de-chaussée ne sont jamais ouvertes (ça doit cocoter !), observant les passants de dos avant de les considérer de côté, voire de les examiner de face. Une jeune femme marchait élégamment, décontractée, allant dans la vie la tête haute. Je me préparai à la doubler, quand, en m’approchant, je constatai une certaine dissymétrie dans sa démarche. Que se passe-t-il ? me demandai-je. Elle portait une petite robe légère, à mi-cuisse, noire bien sûr, volante et luisante. Tout d’un coup, en m’approchant, je n’en crus pas mes yeux. Si à gauche elle était bien mise et élégante, à droite, sa jambe montait, montait, si haut que l’on voyait non seulement sa cuisse, ferme et galbée, mais également, chose tout de même assez rare à Paris, sa fesse droite, dévoilée, que je ne décrirai pas. Elle allait sans souci, souriant intérieurement, se racontant probablement des histoires, peut-être pensant à ce jeune homme qu’elle avait rencontré la veille dans une de ces invitations à laquelle on se rend pour voir des gens avec qui l’on parle sans savoir quoi dire. Du coup, je m’arrêtai, me demandant comment j’allais doubler une aussi charmante égérie. Etonnant même… J’arrêtai ma course, fasciné par cette vision insolite, extravagante et peu usitée. Elle poursuivait tranquillement, inconsciente de ses effets. Sa jambe longue comme un canon de fusil, blanche comme une baguette peu cuite, la chair au plus haut tremblante parfois sur un pas moins souple, me laissait béat. Ah, le feu du boulevard ! Dieu soit loué, il est au rouge. Elle n’eut pas à s’arrêter devant les autres passants. Elle traversa en toute dignité, comme si de rien n’était. Pendant ce temps, je me demandais ce que je devais faire. L’arrêter et lui dire discrètement ce qu’il en était. Continuer à courir après m’être amusé quelques instants. Rester derrière elle pour la protéger. Pendant que je m’interrogeais, elle avait traversé la rue et poursuivait sur le trottoir d’en face. Au moment où j’allais moi-même franchir l’asphalte où ne passaient que quelques rares voitures, je la vis poursuivre sa route, toujours digne, encore plus divine, car redevenue symétrique. Entretemps elle s’était aperçue de sa bévue et l’avait corrigée comme si de rien n’était.
Oui, Paris offre toujours quelque chose à voir d’insolite, de drôle, et même parfois d’extraordinaire. Ses femmes restent exemplaires, jamais troublées, l’œil sur l’horizon, jamais inquiétées par un dérangement involontaire qu’elles considèrent comme un épisode sans importance au regard de leur élégance.
07:30 Publié dans 12. Trouvailles diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, femme, mode |  Imprimer
Imprimer
02/08/2014
Message des hommes vrais au monde mutant, récit de Marlo Morgan (Albin Michel 1995)
La narratrice, car c’est une femme, une américaine, est invitée par des aborigènes à une réunion en temps qu’invitée d’honneur. Elle se pomponne, monte dans une jeep crasseuse conduite par un homme en short et T-shirt blanc crasseux. Après de nombreuses heures, elle se retrouve au milieu d’un peuple qui l’accueille, qui la purifie et qui lui dit :
– Viens, on s’en va.
– Où allons-nous ?
– Faire une marche.
– Où, une marche ?
– A travers l’Australie.
– Magnifique ! Et ça prendra combien de temps ?
– Environ trois lunes.
– Vous voulez dire trois mois ?
– Oui, environ trois mois.
L’aborigène lui dit : « Tout va bien. Celui qui a besoin de savoir saura. (…) Tu as été mise à l’épreuve et tu as été accepté. C’est un honneur que je ne peux expliquer. Tu dois faire l’expérience. C’est la chose la plus importante que tu feras dans ta vie ici-bas. C’est pour cela que tu es venue au monde. L’unité divine est à l’œuvre. C’est ton message, je ne puis t’en dire davantage. » Elle suit la tribu, pieds nus, avec un sac en guise de robe, en se sentant captive et victime.
Tout de suite, elle est importunée par les épines qui se plantent dans ses pieds. « Apprends à supporter le mal. Fixe ton attention ailleurs. » Elle subit toutes sortes d’épreuves et constate des choses extraordinaires comme, par exemple, cet homme qui se casse une jambe et qui le lendemain, marche comme vous et moi. Elle perçoit une étrange collusion entre ces hommes et la nature dans une vision d’unité non pas intellectuelle, mais d’émotions, de sentiments et d’attitudes. C’est la différence entre le Vrai Peuple, comme ils s’appellent, et le monde des Mutants, c’est-à-dire le monde dit civilisé, un monde trop rempli d’occupations pour que leurs habitants puissent devenir des êtres. Etre Mutant est une attitude. Un Mutant, c’est quelqu’un qui a perdu ou qui a occulté une très ancienne mémoire et des vérités universelles. Ooota, le seul qui parle anglais, lui explique : « Pour nous, l’Unité divine perçoit les intentions et l’émotion des êtres vivants et s’intéresse moins à ce que nous faisons qu’aux raisons de nos actes. » Il poursuit : « D’après mon peuple, ce que les Mutants appellent Dieu, ils ont du mal à le définir parce qu’ils sont des drogués de la forme. Pour nous, l’Un n’a ni taille, ni forme, ni poids. L’Un est essence, créativité, pureté, amour, énergie illimitée et sans frein. » Elle comprend que la conscience créatrice est en toute chose. Elle est dans les rochers, les plantes, les animaux l’humanité. Selon les croyances tribales, d’Un divin a d’abord créé la femelle, puis le monde a été chanté et est né. L’Unité divine n’est pas une personne, c’est Dieu, puissance suprême, positive et aimante. Il a créé le monde par expansion de l’énergie. »
Elle apprend une autre conception de la vie et de la mort : « Vers cent vingt ou cent trente ans, quand un être humain éprouve le très grand désir de rejoindre l’éternité après avoir interrogé l’Unité divine pour savoir si cette aspiration est pour son plus grand bien, il demande une cérémonie, une célébration de la vie. (…) Après celle-ci, la personne qui veut partir s’assied dans le sable, bloque ses systèmes corporels et, en moins de deux minutes, c’est fini. Il n’y a ni chagrin, ni larmes. » Elle constate également une autre vision de la vieillesse : nos sociétés sont si riches en vieillards irresponsables, amnésiques, détraqués ou séniles, tandis qu’ici, dans la brousse, plus les gens prennent de l’âge, plus ils deviennent sages, plus ils sont estimés et assument un rôle important dans les discussions. Ils sont des exemples à suivre, les véritables piliers du groupe.
Le Vraie Peuple et fait d’attente et d’accueil des dons divins. On lui explique la différence entre les prières des Mutants et la forme de communication utilisée par les aborigènes : par la prière, le Mutant parle au monde spirituel tandis qu’eux font tout le contraire, ils écoutent. Après avoir fait le vide dans leur esprit, ils attendent de recevoir.
Ne poursuivons pas. C’est un livre surprenant, attachant, qui fait penser aux livres de Castaneda ou de James Redfield (la prophétie des Andes). On se pose néanmoins la question, comme pour les deux autres auteurs : où est la vérité ? Ce qu’ils racontent est-il vrai ? Et bien sûr, nous n’avons pas la réponse. Mais… C’est dérangeant…
07:37 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, spiritualité, vie, connaissance |  Imprimer
Imprimer
01/08/2014
Une vague…
Vous êtes là, impuissant, quasiment mort, incapable d’une pensée suivie. Votre esprit erre dans des impasses enchevêtrées les unes dans les autres. Parfois vous vous reprenez : stop ! Mais vous ne faites qu’arrêter cette course sans fin pour qu’elle reprenne de plus belle. Vous vous promenez dans vos souvenirs, dans vos rêves, dans vos ambitions, dans vos déceptions, comme si vous exploriez un grenier immense sans buts, sans finalités définies. Quel maëlstrom !
Puis, en un instant la vague ! Vous ne l’avez pas sentie venir. Elle vous a surpris. Une ondulation qui vous a propulsé dans un autre paysage, plus serein. Vous avez bien perçu cette onde calme, énergique, comme un turbo qui vous fait sortir de vous-même. Vous respirez plus librement, vous regardez par la fenêtre et le jour se lève à peine.
Cette lueur balbutiante vous réjouit, enchante vos neurones, exalte vos papilles, dégage vos bronches. Le monde respire autour de vous et vous le contemplez. Il s’éveille, s’ouvre, s’épanouit, s’enchante de sa propre résurrection. Les objets prennent forme, vous ne percevez pas encore les couleurs, mais vous voyez le blanc sur le noir, la clarté sur l’ombre, la solidité sur l’éphémère. Cette onde bienfaisante n’est qu’un simple tremblement de votre sens intérieur, comme une porte qu’on ouvre doucement et qui laisse passer un filet d’air rafraichissant. Vous ne la sentez pas immédiatement, mais peu à peu elle vous fait glisser dans l’extase de l’ignorance de soi. Et plus vous vous oubliez, plus vous rencontrez le monde et sa magnificence. Vous devenez le monde, vous êtes ce moustique qui tourne autour de vous et que vous ne chassez pas, vous êtes la tourterelle qui réjouit vos oreilles, vous êtes l’arbre tordu qui se dresse vers l’aube. Quelle aération en vous. La transparence s’empare votre être. Mais… Où est-il ? Vous essayez de vous rattacher à vous-même, vous vous palpez, mais vos mains passent au travers de votre corps. Vous touchez la terre poussiéreuse, les feuillages caressants, l’étincelle de la dernière étoile. Vous aspirez à cet au-delà infini qui transforme le ciel en livre du rien et du tout. Et vous demeurez là, immobile, résonnant des bruits de l’éveil, devenu le monde.
Oui, le monde est en vous comme vous êtes en lui. Et cette découverte vous élève au loin, hors de vous et hors du monde.
07:32 Publié dans 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : spiritualité, contemplation, aurore, matin, société |  Imprimer
Imprimer
24/07/2014
La femme
Une femme, c’est le mystère du monde. Elle n’a l’air de rien, elle s’efface devant l’autre, plus fort et plus puissant. Mais elle reste la gardienne de l’ordre naturel. Nos politiques défendent la femme comme égale de l’homme. Mais la femme est bien plus que l’homme. Elle est le contenant, alors que l’homme n’est que le contenu. Elle est matrice de l’univers, un monde en soi qui ne cherche rien, qui ne veut rien, mais qui est dans toute sa splendeur de mystère et d’instantanée.
Tu es l’étrangère, inconnue même de toi-même
Enfant pleurant sur elle-même
Fille qui se découvre autre et en use
Jeune fille, réservée ou fantasque
Qui danse la nuit et sert le jour
Vierge d’un jour, dévêtue de pudeur
Douceur et chaleur recueillies
Qu’un baiser du fond d’elle-même
Amène à la vie de femme
Tu acceptes cette ambiguïté
Je suis et pourtant tu es au-delà
Hors de portée de mes mains ouvertes
De mon regard avide de ta beauté profonde
Et chaque caresse fait fondre
Ce que je croyais être moi
Et qui devient toi, unique et royale
Tu es femme maintenant, devenue forte
Et souple de soumission feinte
Tu es celle qui passe devant moi
Mais reste derrière les ombres
Et regarde nos silhouettes égarées
Alors tu redresses le chemin
Pas par là, mais prenez ici
Elle te laisse partir et t’assoiffer
Puis vient te donner la boisson de l’immortalité
Oui, je t’aime car tu es le refuge
De mon corps impatient
De mon cœur émerveillé
De mon esprit rêveur
De mon âme éclairée
Par ta lumière sacrée
© Loup Francart
07:07 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : femme, société, mystère, création, éros, agapé |  Imprimer
Imprimer
21/07/2014
Petits bouts de rien
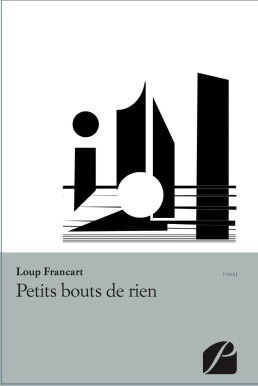

Les éditions du Panthéon vous font part de la parution du livre
Petits bouts de rien
le 21 juillet 2014
272 p. format 13x20cm
Prix de vente:
-
imprimé : 19,40 € TTC;
-
numérique : en moyenne 15 €, selon les réseaux de distribution.
Les commandes peuvent être passées :
- Sur le site internet : www.editions-pantheon.fr
- Par courriel adressé à : commande@editions-pantheon.fr
- Par courrier adressé à : Les Editions du Panthéon
12 rue Antoine Bourdelle 75015 Paris
- Par télécopie au 01 43 71 14 46
- Par téléphone au 01 43 71 14 72
- Sur Amazon : http://www.amazon.fr/
- A la FNAC : http://livre.fnac.com/
Emmenez-le en vacances, lisez un récit et laissez-vous rêver...
07:13 Publié dans 44. Livres | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, littérature, écriture, société, politique, arts, culture, peinture, femme, homme, ville, campagne |  Imprimer
Imprimer
20/07/2014
Musée Guggenheim de Bilbao
Pour une fois, nous ne parlerons pas du contenu, mais du contenant. A Bilbao, sait-on d’ailleurs ce qu’est le contenu et le contenant, l’un et l’autre étant semblables, œuvres d’art à contempler, l’une de dehors, puis de l’intérieur, les autres, extérieurs intégrées à l’intérieur.

 Le bâtiment est en soi un navire amiral, grandiose, dont la silhouette assemble le titane, le verre, la pierre et l’eau. Coins et recoins, blocs et unités, ouvertures et secrets, les oppositions sont multiples et toujours harmonieuses.
Le bâtiment est en soi un navire amiral, grandiose, dont la silhouette assemble le titane, le verre, la pierre et l’eau. Coins et recoins, blocs et unités, ouvertures et secrets, les oppositions sont multiples et toujours harmonieuses.
Quel que soit la façade dont on l’observe, il reste majestueux :

« Une fois dans le Vestibule, où convergent toutes les galeries, le visiteur accède à l'Atrium, cœur authentique du Musée et l'un des traits distinctifs de la création de Gehry. Ce grand espace libre, aux volumes courbes, connecte l'intérieur et l'extérieur de l'édifice grâce à de grands murs en rideau de verre et une grande verrière zénithale. Les trois niveaux du Musée s’organisent autour de cet Atrium central et sont reliés grâce à un système de passerelles curvilignes, d’ascenseurs en verre et en titane et de tours d’escaliers. L’Atrium, qui fonctionne aussi comme un espace d’exposition, sert d'axe autour duquel se structurent les 20 galeries du Musée, certaines ont une forme plus classique, avec des lignes orthogonales, et d’autres présentent une irrégularité singulière. Le jeu des volumes et des perspectives permet de disposer d’espaces intérieurs où, pourtant, le visiteur ne se sent à aucun moment écrasé. Cette diversité de salles et cette adaptabilité se sont révélées d’une énorme utilité entre les mains expertes des commissaires et des créateurs, qui ont trouvé l’atmosphère idéale pour la présentation d’œuvres de grand format et de supports contemporains mais aussi pour des expositions de caractère plus discret et intime. » (From : http://www.guggenheim-bilbao.es/fr/le-batiment/linterieur/)



Une merveille d’architecture, abritant des œuvres grandioses elles-mêmes, mais de purs chefs d’œuvre, c’est la question !
« La Matière du temps (The Matter of Time) permet au spectateur de suivre l’évolution des formes sculptées de l’artiste, de la relative simplicité d’une ellipse double à la complexité d’une spirale. Les deux dernières pièces de ce développement sont créées à partir de sections de tores et de sphères qui génèrent divers effets sur le mouvement et la perception du spectateur. En se transformant de façon inattendue au fur et à mesure que le visiteur les traverse et en fait le tour, elles créent une vertigineuse et inoubliable sensation d’espace en mouvement. La totalité de la salle devient partie intégrante du champ sculptural : comme avec quelques-unes de ses sculptures composées de nombreuses pièces, l’artiste organise les oeuvres avec détermination pour déplacer le spectateur à travers elles et à travers l’espace qui les entoure. La distribution des oeuvres tout le long de la galerie donne lieu à des couloirs de différentes proportions (larges, étroits, allongés, comprimés, hauts, bas) toujours imprévisibles. L’installation contient aussi une dimension de progression temporelle : d’un côté, le temps chronologique qu’il faut pour la parcourir et l’observer du début à la fin ; et de l’autre, le temps de l’expérience dans lequel les fragments du souvenir visuel et physique se figent, se recombinent et se revivent. » (From : http://www.guggenheim-bilbao.es/fr/oeuvres/la-matiere-du-temps/)


C'est vrai, n'oublions pas ! demain, 21 juillet...
07:13 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : architecture, musée, peinture, art contemporain, société |  Imprimer
Imprimer
19/07/2014
Une étape de la vie
Le passage de la cinquième à la quatrième est un des moments de la vie parmi les plus fascinants. On découvre l’autre sexe. Certes, on parle encore de filles et de garçons, mais avec une retenue qui voile le mystère de cette découverte. C’est bien sûr un des sujets de discussion, pratiquement le seul, mais toujours de façon indirecte. Ce fut un choc pour Jérôme, même si, pendant une bonne partie de cette année de quatrième, cet étonnement ne fut que d’ordre psychologique. Cela constituait un bouleversement sans précédent dans la vie du jeune garçon qui, progressivement, devenait un adolescent. En réalité, cette prise de conscience ne s’effectua pas en un jour, celui de la rentrée scolaire. Il lui fallut bien un an pour saisir consciemment les modifications dans son corps et ses pensées.
bien sûr un des sujets de discussion, pratiquement le seul, mais toujours de façon indirecte. Ce fut un choc pour Jérôme, même si, pendant une bonne partie de cette année de quatrième, cet étonnement ne fut que d’ordre psychologique. Cela constituait un bouleversement sans précédent dans la vie du jeune garçon qui, progressivement, devenait un adolescent. En réalité, cette prise de conscience ne s’effectua pas en un jour, celui de la rentrée scolaire. Il lui fallut bien un an pour saisir consciemment les modifications dans son corps et ses pensées.
Les premières semaines, assis au fond, dans la classe, il regardait ces filles qui commençaient à devenir jeunes filles, plus sérieuses, plus appliquées que les garçons, plus attentives à leur corps, à leurs attitudes, à la douce tiédeur de leurs formes découvertes dès la sortie de l’hiver : le pli du coude, le pli plus secret des aisselles, la rondeur devinée de leurs jeunes seins, la verdeur inimaginable de leurs cuisses reposant sur la chaise d’écolier. Ce fut au printemps, après six mois d’aveuglement enfantin, qu’il commença vraiment à sentir cette nouveauté en elles, puis en lui. Ce fut lent. Parfois, regardant l’une d’elles, il éprouvait comme un pincement quelque part, sans savoir exactement où, et ce pincement l’étouffait de mystère caché, incompréhensible. La promiscuité des sexes dans la salle de classe creusait un fossé incommensurable entre elles et lui, et, dans le même temps, l’histoire humaine devenait son histoire, personnelle, envoûtante, mystérieuse, grâce à la découverte de la plus grande énigme existant sur terre, celle de l’homme et de la femme qui se regardent et se voient semblables et différents. Envoûtantes, ces demoiselles faisaient semblant de ne rien voir de ces émois qu’elles provoquaient auprès des garçons. Envoûtés, ceux-ci continuaient à jouer la comédie de la virilité, celle de jeunes gars fiers d’être ce qu’ils sont, sans savoir qui ils sont. Mais tout ceci était diffus, imperceptible, comme le soupçon de lait que l’on met dans son café le matin, encore ensommeillé, et qui monte en nuages épais dans le liquide noir. La frontière restait indécise en raison de l’égalité de l’âge, tentatrice par sa nouveauté attrayante, imprécise par les différences inconnues.
Que se passait-il dans les corps et les esprits de ces jeunes adolescents qui sortaient de l’enfance par une porte dérobée ? Avant tout des images, des sensations, voire des sentiments non interprétables. De sa place, il n’écoutait plus le professeur, il regardait ces bustes de presque femmes, ces cheveux virevoltant d’abord involontairement, puis de manière plus consciente, la courbe de l’épaule dénudée à partir de mai, le tissu tendu par la naissance des seins et leurs regards, entre elles, de secrets inavouables, mais évidents. La puberté était tombée en un jour sur leur corps, alors que pour les garçons, rien n’était aussi franc. Ils ne la découvraient que progressivement, de manière plus lourde, d’abord dans une sorte de rêve, avant qu’elle ne devienne affirmée physiquement.

C'est vrai, n'oublions pas ! Le 21 juillet...
07:02 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, bonheur, affectif, relation, culture |  Imprimer
Imprimer











