27/06/2021
Enfance, entre réalité et rêve (symphonie nippone : photos Gildas de La Monneraye)

Superman atterrit !
Personne ne fait attention à lui. Il ne fait plus peur.
L’habitude conduit l’imagination à l’indifférence.
03:12 Publié dans 44. Livres | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : japon, enfance, pouvoir des images |  Imprimer
Imprimer
12/11/2020
Anniversaire
Il y a deux jours, c’était mon anniversaire. Une surprise : j’ai perdu ma jeunesse et commencé une nouvelle vie. En un instant, j’étais devenu adulte. Je n’ai plus le droit de lire Tintin, le journal des jeunes de 7 à 77 ans.
Dorénavant ne me sont autorisés que les lourds livres sérieux. Ah, j’ai quand même gagné quelque chose, j’ai maintenant le droit de jeter un œil sur les bandes dessinées olé olé. Adieu jeunesse, adieu les grasses matinées au lit en lisant le sceptre d’Ottokar ou Tintin en Amérique et en mangeant un sandwich au pâté. Je n’ose plus chanter l’opéra d’une voix cassée ni même jouer aux billes avec un petit voisin qui me regarde d’un œil nouveau.
Adulte, je m’habille sérieusement, je téléphone d’une voix assurée, je vais chercher le pain tout seul, je ne penche plus au-dessus du pont pour me regarder dans l’eau trois mètres plus bas, je ne mange plus un paquet de bonbons le soir en lisant Nietzsche.
Dieu, quel ennui cette nouvelle vie. Rendez-moi ma jeunesse !
Oui, j'ai encore le droit d'écrire n'importe quoi !
02:48 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : âge, enfance, rigolade |  Imprimer
Imprimer
31/10/2020
Le confinement
07:29 Publié dans 12. Trouvailles diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bandes dessinées, tintin, enfance |  Imprimer
Imprimer
08/01/2018
La réalité du rêve
"L’X dévoile son nouveau film de marque à l’occasion des fêtes de fin d’année. Il raconte l’histoire d’une petite fille passionnée par les sciences, qui concrétise son rêve d’enfant : poursuivre une carrière scientifique.
A l’instar des enfants, celle-ci se lance dans une série d’expériences grâce aux objets de son quotidien pour réaliser son rêve, créer une combinaison spatiale. En dessinant, en prenant des mesures et en observant les réactions de ses expériences devant sa «baignoire-laboratoire» ou une cheminée, la petite fille redouble d’efforts pour réussir à confectionner cette combinaison née de son imagination. Ce goût pour la science ne la quittera pas et c’est ce «rêve d’enfant» qu’elle décidera de réaliser en choisissant une carrière scientifique." (A lifetime of science, présentation École Polytechnique, réalisateur Fabien Ecochard, décembre 2017)
07:22 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : science, imagination, enfance, avenir |  Imprimer
Imprimer
13/02/2017
Collection
La jeunesse adore les collections. Pourquoi ? Peut-être la nostalgie d’une vie passée où l’on a accumulé de nombreuses richesses ou encore l’envie de posséder quelque chose à soi seul. La collection fait de l’enfant un personnage de rêve, un roi sans royaume, un homme plus riche de lui-même. Aucun n’y échappe : collection de gommes, de buvards, de bons points et, pour certains, de mauvais, mais pas intentionnellement. Les commerçants et industriels ont bien compris cette passion dévorante des enfants. Ils en imaginent sans cesse de nouvelles, pas chères, mais qui peuvent rapporter gros comme les Pokémons ou les soldats de plomb en plastique. Certaines collections finissent dans des musées imaginaires.
Un jour, enfant, je trouvai par terre, dans un champ, une pierre magnifique, une sorte de gros galet cassé qui renfermait une pierre bleuâtre et formée de cristaux, un monde en soi, mystérieux et attirant. Frères, sœur, cousins et cousines décidèrent de faire un musée dans une des chambres du moulin encombré machines, de roues, d'engrenages, de courroies de godets et de toutes sortes d’instruments mystérieux. Il nous fallut un mois pour atteindre une collection d’une quinzaine de pièces. Chaque découverte nous faisait pousser des cris d’extase. Nous les passions sous l’eau, les lavions avec une brosse, les séchions avec nos serviettes de toilette et même, pour certains, les cirions ou les enduisions d’une pommade luisante propre à leur donner un aspect brillant. Des pierres rutilantes, aux formes insolites ou au contraire parfaites, ou d’autres encore, cassées et recelant en leur intérieur un cristal pauvre, mais qui attirait le regard et en faisait un chef d’œuvre de la nature. Chacun fut chargé d’une tâche précise à exécuter dans un délai prescrit : trouver des étagères de présentation, balayer la chambre, décorer ses murs de photos de pierres merveilleuses arrachées de magazines au papier glacé, préparer le comptoir d’accueil des visiteurs et la tirelire devant recevoir le prix d’entrée. L’un de nous devait trouver un uniforme de gardien de musée et se tenir prêt à patrouiller au sein de la pièce pour surveiller les collections. Oui, elles étaient passées d’une collection à des collections, ces quinze pierres. Que d’effort pour arriver au jour J, celui de l’inauguration du musée. L’un de nous devait faire un discours devant les officiels représentés par les parents. Ce fut long et laborieux, plein de mots savants cherchés dans le dictionnaire et un livre consacré aux pierres du Sahara. Dans le regard de chacun des enfants on pouvait voir les espaces pierreux des déserts, le lit caillouteux de rivières, les plages douloureuses imposant un matelas pour s’y étendre ; et, au centre, dans l’œil embué, le caillou adoré, cajolé, caressé, lustré, celui des rêves les plus fous et des explorations les plus épuisantes.
C’est vrai, l’enfant a une autre vision du monde. Tout lui paraît merveilleux. Le moindre petit caillou est un mystère sans nom qui permet l’évasion d’un réel qui est pourtant à découvrir. Mais n’est-ce pas passionnant de s’inventer un monde que les parents ne peuvent comprendre, mais qu’ils doivent approuver à grands cris d’extase simulée.
Pendant longtemps, à certaines périodes, je me suis promené avec ma collection dans la poche ; une pierre parfaite, en ellipse, choisie longuement sur une plage de la Méditerranée ou de l’Atlantique. Elle me donnait confiance et sa douceur dans la main se laissait caresser chaque fois que j’allais chercher quelque chose dans les profondeurs secrètes que sont les poches pour un homme ou le sac pour une femme.
07:33 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : enfance, collection, musée, enchantement |  Imprimer
Imprimer
05/01/2017
Le marais
Derrière le bâtiment du moulin, il y avait un espace mystérieux que l'on appelait le marais. Empli de joncs et de petits arbustes rabougris, il laissait se couler dans ses flancs l'eau qui débordait de la rivière principale et formait des canaux insidieux. C'était l'Amazonie ou Venise selon l'imagination du moment. Il fallait s'équiper pour s'y rendre, c'est-à-dire revêtir un pantalon, car les culottes courtes ne protégeaient pas des petites coupures qui s'infectent ensuite à force de séjourner dans l'eau.
A la fin d'une des vacances d'été, leur mère ramena de chez leurs grands parents un canoë, vaste embarcation à fond plat, très instable, qui prenait plaisir à se renverser au milieu de la rivière, en hiver plus particulièrement. Jérôme se souvient encore d’une messe de minuit pendant les vacances de Noël où il ne portait qu’une culotte courte, ses deux pantalons étant trempés par des explorations brutales du fond de la rivière en crue, dans une Amazonie inhospitalière. Ils partaient à deux sur cette périssoire, l’un tenant son arme vers l’avant, prêt à frapper quelque ennemi qui se présenterait, l’autre pagayant sans bruit, faisant glisser l’embarcation entre les branches d’arbres, remontant ainsi le canal clôturant l’île, étroite de deux mètres maximum et encombré de racines de saules, d’aulnes ou de frênes qui s’enchevêtraient pour ne laisser qu’un étroit passage au canot. Il suffisait d’une mauvaise manœuvre de l’embarcation pour que celle-ci, déséquilibrée, laisse tomber leurs voyageurs dans une eau boueuse et froide.
De façon à pouvoir jouer à leurs jeux dans lesquels il y a toujours un personnage ou un groupe contre un autre, ils avaient découvert une grande planche de quatre mètres de long sur trente centimètres de large, qui, grâce à son épaisseur tenait sur l’eau. Un enfant tenait debout au milieu et pouvait ainsi naviguer plus ou moins à son gré. Mais quelle instabilité ! Au moindre faux mouvement, c’était la chute assurée et redoutée. Mais cette embarcation improvisée, extraordinaire de délicatesse d’utilisation, permettait de conduire de véritables batailles navales en aval du moulin, là où les flots se font plus calmes et la profondeur moindre. Ceux qui tombaient ne se mouillaient que jusqu’à la taille, donc de manière insignifiante, sauf s’ils devaient empêcher la pirogue (c’était un terme plus authentique que planche) de partir avec le courant vers l’entrée dans les marais. Alors, ils devaient courir dans l’eau pour la rattraper et remonter dessus. Il arrivait malgré tout qu’ils passaient des après-midi entiers sans avoir besoin de se changer. Miracle du sens de l’équilibre ou miracle du jeu qui, malgré un bain forcé, continuait comme si de rien n’était. Ils s’amusèrent des années avec ces deux engins jusqu’au jour où une crue plus importante les emporta. Leurs recherches restèrent vaines. Ils partirent avec leurs jeunes années, au moment de l’adolescence où les préoccupations prennent des orientations différentes. Mais Jérôme, en fermant les yeux, conserve dans sa mémoire trouée, l’odeur de marais qui imprégnait leurs vêtements en fin de journée, le bruit sourd de la pagaie contre la coque de bois du canoë, les gouttes de rosée qui coulaient dans son cou au passage d’un arbre dont il fallait soulever les branches pour poursuivre leur chemin, les battements de son cœur à l’approche de l’ennemi qui lui-même les cherchait dans leur canot pour une bataille finale et définitive. Quelle journée de cris, de fureur, de courage et d’amertume lorsqu’ils étaient perdants. Le soir, le repas se faisait en silence et aussitôt ils allaient se coucher pour s’endormir en s’imaginant toujours pirates, explorateurs ou guerriers. Une des belles images que Jérôme garde dans sa mémoire défaillante est celle d’un nid de poules d’eau déniché près d’une racine, dans lequel reposait quatre petits œufs dorés, à ne toucher sous aucun prétexte. C’était l’écologie de l’époque, qui valait bien celle de maintenant : respecter la nature et non la restaurer, comme le disent les écologistes des villes qui la détruisent pour la reconstruire à leur vision.
07:53 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : souvenir, exploration, enfance, imagination |  Imprimer
Imprimer
03/01/2017
La course de chevaux
J’avais quatre ou cinq ans, l’âge de la curiosité. Je ne sais pour quelle raison, je couchais dans la salle à manger, l’appartement ne disposant pas de suffisamment de chambres pour loger tous les enfants. Non, ce n’était pas ainsi. Les quatre enfants dormaient dans cette pièce, dans de petits lits à barreaux et nous nous chauffions en hiver autour du poêle en faïence verte dans lequel les bûches pétillaient.
Cette antiquité nous échauffait l'imagination et se transformait en voiture lorsque nous mettions quatre chaises devant, alignées par deux. L’ainée était le conducteur, ouvrant sa porte avec sérieux, faisant monter notre jeune sœur qui tenait le rôle d’une femme bien éduquée et sévère avec ses enfants. Nous étions deux enfants, assis derrière et nous chamaillant. Alors elle se retournait et faisait mine de nous donner une paire de claques, nous avertissant qu’ils allaient nous laisser sur le bord de la route. Alors nous nous tenions tranquilles deux minutes avant de reprendre nos agacements jusqu’à ce que l’un de nous pleure réellement. Pendant ce temps, notre père (en réalité l’ainé des enfants) partait en voyage en faisant exploser dans sa bouche fermée milles bruits de moteur et cent coups de frein, pris dans un embouteillage, râlant de ne pouvoir avancer à la vitesse maximum de la voiture. Notre jeune sœur nous reprochait d’avoir oublié notre valise, il fallait revenir à la maison, monter l’escalier, prendre la valise en carton, redescendre quatre à quatre et plonger le tout dans le coffre imaginaire situé derrière les deux chaises que nous occupions. Ce simulacre de la vie quotidienne pouvait durer des heures, jusqu’à ce que notre mère, la vraie, crie : « A table ! » Aussitôt les quatre enfants se précipitaient et s’asseyaient autour de la table, impatients d’avoir quelque chose à se mettre sous la dent.
Le soir notre mère nous couchait dans nos petits lits et nous permettait de lire quelques instants avant d’éteindre. Nous adorions ce moment de calme dans lequel nous laissions aller notre imagination. Elle venait alors fermer la lumière, laissant allumée la lampe dans le couloir qui nous permettait encore apercevoir les formes et objets insolites de notre chambre. La lueur éclairait particulièrement le plafond et la rosace d’où partait le lustre. C’était une belle rosace arrondie qui se terminait par des feuilles ou des branches qui avaient la forme d’un cheval, donnant l’impression d’un manège tournant autour de l’axe du lustre. Avant de m’endormir, je jouais à la course de chevaux (c’était prémonitoire !) ou au manège selon les jours. Les chevaux se courraient après, galopant à qui mieux mieux. J’entendais le bruit de leurs sabots sue le sol, sentais l’odeur de leur transpiration, les frappant d’une cravache pour qu’ils finissent épuisés, mais heureux d’être vainqueurs dans cet hippodrome merveilleux. La nuit, je rêvais alors de courses de chevaux, courbé sur l’épaule d’un pur-sang, franchissant le premier la ligne d’arrivée. Ce furent mes premiers contacts avec l’équitation, purement imaginaires.
07:24 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : souvenir, enfance, imagination, jeux |  Imprimer
Imprimer
25/12/2016
Noël
L’enfance, ce privilège ignoré
Donné à tous sans qu’ils le sachent
Et vécu différemment selon le cas
Vite oubliée par les soucis de la vie
Elle resurgit plus tard, vivace
Dans un souvenir pur de désir
D’un retour au monde perdu
Il faut s’en extraire, résolument
Pour ne pas tomber immanquablement
Et continuer à voir l’avenir
Pour vivre encore et toujours
Aujourd’hui, Noël nous rappelle
Ces jours heureux que l’on ignore
Lorsqu’on les vit et que l’on revit
Sans vouloir vraiment croire
Qu’ils furent et nous ont formés
Pour que l’on devienne
Ce que nous ne savions pas être
© Loup Francart
07:30 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature, noël, enfance |  Imprimer
Imprimer
03/05/2016
Pour un sourire
07:25 Publié dans 12. Trouvailles diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : amour, enfance, famille |  Imprimer
Imprimer
18/02/2015
La bande dessinée
Une bande dessinée, c’est un morceau de rêve dans un monde à part. Ses héros sont de pacotille, mais quel bonheur de pouvoir un moment s’évader de la vie quotidienne. Vous partez en images à la rencontre de l’imagination débordante de l’auteur. Vous la connaissez par cœur et c’est justement pour cette raison que vous aimez vous y plonger. C’est un retour à l’enfance, le plaisir de se retrouver en culotte courte, vautré sur le lit, la bande dessinée enfouie entre les cuisses, les genoux dressés. Vous ne sucez plus votre pouce, mais c’est tout juste.
Aujourd’hui vous partez en Syldavie, ce pays charmant, d’une Europe révolue aux traditions slaves. C’est le Moyen-Age, le siècle de Louis XIV, le romantisme du XIXème siècle et l’ère communiste tout à la fois. Vous vous rêvez en prince, avec un uniforme étincelant, jouant les espions, transgressant les frontières, entouré de belles femmes. Vous vivez une autre vie, enfoui dans votre lit, au chaud, en rupture avec la société et les mondanités. C’est une cure de jouvence, un clin d’œil à votre jeunesse, un retour à la famille oubliée dans les péripéties de l’existence. Vous vous revoyez dans la chambre de votre enfance, rêvant à un avenir dont vous ne voyez pas l’issue, de même qu’aujourd’hui vous ne savez pas non plus ce que vous réserve le lendemain.
Vous ne parlez pas de destin. Celui-ci est trop figé. Il vous met dans une boite qui vous conduit inéluctablement au néant. Vous ne savez vers quoi vous allez, mais l’Autre à déjà tout décidé. Mieux même, les voyantes (elles sont bien sûr féminines), qui font preuve de beaucoup de perspicacité, vous diront cet avenir implacable dont vous ne pourrez plus vous débarrasser. Votre route est-elle tracée d’avance ? Non, surement pas. Vous croyez à la liberté personnelle. Vous croyez à un avenir inconnu, même maintenant, alors que vous atteignez un âge qui ne laisse que peu d’espoir de changement de destinée. Certes, vous pourriez encore la modifier, mais cette destinée que vous avez construite et que les autres ont également façonnée, vous appartient. Elle a laissé ses racines dans votre vie présente. Votre liberté n’est pas totale, elle doit respecter la liberté des autres et surtout leur affection. Car vous avez planté votre tente dans un paysage de bonheur et d’amour que vous portez en vous grâce à eux, ceux qui vous ont construit parce que vous les avez reconnus, fait naître ou adopter par amitié. Et votre destin n’est pas ce que la société retient de vous, mais ces instants de vérité où vous choisissez votre véritable liberté : la construction d’une vie personnelle qui se mêle à celle de vos proches et fait de vous un être à part.
Retour à la bande dessinée. Vous repartez en voyage, dans ces pays imaginaires si proches de la réalité, où les bons sont les bons et les méchants les méchants. Ah, là aussi l’existence s’est figée en un imaginaire de rêve, si peu proche de la réalité. Rien d’inconnu malgré tout. C’est le contexte bon enfant d’Hergé qui déteint sur vous. Vous ne savez plus où vous êtes. C’est votre plus grande liberté, une évasion sans fin que vous offrent gratuitement les plis voluptueux de votre encéphale.
Dieu, où donc vous a conduit cette bande dessinée. Vous endossez mille destins en rêve et vous n’en vivez qu’un. Mais combien est précieuse cette vie déroulée pas après pas dans l’ignorance totale d’un avenir inconnu. Celui-ci devient vôtre progressivement, il vous colle à la peau et vous ne pouvez vous en débarrasser. Alors adoptez-le !
07:28 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : enfance, lecture, rêve, société, destin, existence |  Imprimer
Imprimer
28/01/2015
Souvenir d'enfance
Il se souvient des soirs où les perdreaux étaient présentés sur la table. Déjà, avant même qu’ils n’y arrivent, montaient de la cuisine à travers le petit escalier, des fumets de viande rôtie, au goût faisandé, préparée par sa grand-mère dans le four en permanence chauffé par les bûches courtes qu’elle glissait par une porte au cœur même de la chaleur. Malheureusement, les perdreaux étaient réservés aux grandes personnes qui se pourléchaient les doigts, rongeant les os des pattes, puis des ailes, puis le blanc velouté, parce que légèrement faisandé, du poitrail. Mais le meilleur était sans doute les morceaux de pain grillé, cuits dans la sauce dorée, qui portaient le dernier repos des cadavres. Ils étaient onctueux à souhait, fondaient dans la bouche, exhalaient les prés tendres, les haies épineuses, les grains de blé tombés de l’épi, le creux de terre dans lequel ils s’abritaient, serrés les uns contre les autres. Alors, les enfants quémandaient une patte, rien qu’une, pour partager ce délice auquel ils avaient bien droits puisqu’ils les avaient portés dans le carnier bien lourd pendant toute une après-midi. L’eau leur montait à la bouche rien que d’y songer !
Délice que cette patte dorée, fumante encore, partagée en quatre. Chaque parcelle de sa chair exhalait le retour de la chasse lorsque, fatigués, chacun d'eux se laissaient aller dans un fauteuil et fermait les yeux sur la marche dans les grands prés, sur le bruissement de l'envol d'une compagnie, sur le départ d'un coup de fusil. Non, ne pas bouger : attendre que l'on arrive à sa hauteur. Le perdreau était là, encore chaud, parfois encore vivant. Alors prenant le cou, il imprimait une torsion qui laissait l'animal sans un mouvement. Mort, ne pas le faire souffrir inutilement. Et maintenant chacun contemple son assiette et le petit morceau de chair clair à l'odeur rougeoyante et ferme. Vous pouvez y aller ! ils ne se le faisaient pas dire deux fois. Quel goût. Les enfants étaient les princes de la soirée. Ils montaient se coucher pour rêver d'herbes, d'odeur de poudre, de chaleur des après-midis d'automne et de picotement de la chair du perdreau sur le bout de la langue.
07:45 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chasse, enfance, sensation, souvenir |  Imprimer
Imprimer
10/12/2014
L’américain, récit de Frantz-Olivier Giesbert
Même à cinq ou six ans, j’étais déjà sans illusion. Autant que je m’en souviens, je n’ai jamais cru au Père Noël. On ne peut croire au Père Noël dans une maison où la femme est battue comme plâtre, plusieurs fois par semaine. (…) Ces nuits-là, je restais dans mon lit, le cœur battant, le sang glacé, en tremblant comme une feuille ? Je mourais. Je crois que l’on meurt toujours un peu quand on entend sa mère se faire battre. J’ai passé une partie de mon enfance à mourir, une partie seulement. Pendant l’autre, bien sûr, je ressuscitais.
C’est le thème du livre et il est difficilement imaginable de voir un écrivain raconter ces années d’enfance face à un être qui le révulse et pour lequel il n’a que mépris. Et pourtant, au-delà de ce mal vivre, il y a des souvenirs heureux ou malheureux, des bouts d’existence qui lui permettent d’exorciser ce passé.
Le quai d’Orival, où nous habitions, à Saint-Aubin les Elbeuf, épousait la courbure de la Seine. A la belle saison, il semblait noyé sous le flot des arbres, des buissons et des ronces qui tentaient de s’arracher de la terre pour monter au ciel avant de retomber de leurs épuisantes volées, le feuillage luisant de pluie, de rosée ou de bave d’escargot. Tout, là-bas, sentait la vase et l’amour. Même les gens. Bien plus tard, j’ai souvent retrouvé l’odeur, au fond des lits ou dans les forêts humides. L’odeur de la joie du monde.
Il nous parle de Dieu, de sa présence permanente, de l’anticléricalisme de son père, de la piété ostentatoire de sa mère. Et il ajoute, à la suite : Je me demande si je ne suis pas tombé dans le travers si souvent geignard des récits intimes. A quelques exceptions près, ils sont l’œuvre de vaniteux, de vaticinateurs ou de pleurnichards qui battent leur coulpe sur les poitrines des autres en racontant tout le mal qu’on leur a fait.
La vie s’écoule, sous les coups du père, les soupirs de la mère, la campagne et l’écoulement de la Seine. La haine le poursuit contre ce père qui devient fou trois ou quatre fois par semaine et qui bat tout ce qui lui tombe sous la main. Il ne comprend pas l’amour de sa mère pour cet homme qui, pour lui, n’en est pas un. Un de ces soirs où nous faisions la vaisselle ensemble, elle m’avoua que les raclés paternelles finissaient presque toujours au lit où, le savoir-faire de mon père aidant, ils scellaient leur réconciliation. Des années plus tard, alors qu’elle était veuve et que je tentais de la pousser dans les bras d’autres hommes, elle m’avoua n’avoir jamais éprouvé autant de bonheur qu’en faisant l’amour avec papa.
C’est un beau livre qui laisse un arrière-goût de malaise : pourquoi nous faire vivre ces moments ? Mais si l’on y regarde bien, on s’aperçoit que notre jeunesse est pour chacun un miracle dont il convient de se rappeler les détails et de les exprimer pour vraiment vivre et boucler le chemin. C’est un retour indispensable à ceux qui ont accompli le cycle. J’étais et je suis ainsi parce que mon enfance était ainsi…
07:30 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : enfance, société, haine, père, mère |  Imprimer
Imprimer
24/11/2014
Souvenir, souvenir...
Une autre carte postale, comme un éclair de souvenir, est celle d’un crapaud dans le jardin de la maison que sa famille habitait à Meudon. Son père était occupé à creuser un bout de jardin humide pour y faire un petit bassin. Il délogea un crapaud lové dans une sorte de terrier. Celui-ci était hagard, ne bougeant pas, comme endormi, levant juste des yeux alourdis sur nos regards émerveillés d’enfants. Jérôme le voit encore, tentant d’avancer une patte maladroite, clignant des paupières, puis finalement renonçant, appesanti par son sommeil. Et ses frères et lui s’exclamaient, avec un peu de peur au fond de leur voix en raison de sa taille. Il était presqu’aussi gros que leurs visages. Un animal préhistorique, pensaient les enfants, avec la peau cornue et rugueuse des rhinocéros ! « Laisse-moi voir ! » Ils se disputaient pour approcher au plus près du crapaud, tout en restant à une distance suffisante pour éviter tout geste de sa part envers leurs petites personnes. Souvenir vivace, mais qui se limite à une image et à l’odeur de l’herbe mouillée, boueuse et piétinée. Si ! Il entend encore la voix de sa mère qui les appelait à venir voir l’horreur merveilleuse : « Les enfants, venez vite voir, dépêchez-vous ! » Appel qui leur fit quitter instantanément leurs jeux et leurs disputes.
Première rencontre avec un monde animal plein de mystère. Première rencontre avec le mystère des formes de vie si variées. Et, comme l’homme, pas un de ces animaux n’est semblable à l’autre de sa propre espèce. Chacun détient des gènes spécifiques qui en font un spécimen unique, un trésor parce que seul au monde. Et il en est de même des plantes, des cailloux, des astres et des galaxies. Seule la mémoire, parce que défaillante, fait croire à l’ennui et au déjà vu. Dieu, dans sa subtile inspiration, invente pour chaque être un lieu de singularité, la chambre d’accès intime à sa magnificence. Chacun détient sa propre personnalité, physique, psychique et plus profondément encore, une âme unique. Oui, c’est la chambre des secrets qui ouvre à l’au-delà du temps, un monde où tout est épanouissement et enchantement. Les yeux ouverts sur son achèvement, chaque être contemple la réalisation des autres comme l’image de Dieu. Rien n’est jamais semblable lorsque le temps s’arrête, alors que nous imaginons au contraire un monde immobile et souverainement ennuyeux. Le paradis, c’est la rencontre des contraires, l’arrêt et la vitesse infinie d’un temps qui devient autre.
07:42 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : enfance, monde animal mystère de la vie, paradis |  Imprimer
Imprimer
11/08/2014
Voyage difficile
Un train est un lieu où la vie privée des gens s’étale au grand jour. Cette vie est le plus souvent normale et on ne la remarque pas. On relève de ci de là quelques petites anomalies, telles ce Monsieur qui discrètement se cure le nez ou cette dame dont la chair déborde du fauteuil, obligeant chaque passager empruntant le couloir à se contorsionner avec douceur. On observe parfois un couple qui, contre toute attente, est assis dans une intimité qui aurait dérangé la plupart des gens il y a encore quelques années. Mais comme dans les trains tout le monde fait comme chez soi, cela importe peu.
Les petits enfants prennent possession d’un train et ont beaucoup de mal à prendre conscience qu’ils ne sont pas seuls sur ce terrain de jeu. Les parents (de ces enfants) ont également beaucoup de mal à comprendre qu’ils sont responsables de la conduite de leur enfant et que leur liberté de faire ce que l’on veut est limitée par la liberté des autres. Les enfants ont une autre caractéristique. Ils ne savent pas parler, ils crient. Pas tous, mais un certain nombre, ceux à qui l’on n’a jamais dit de parler doucement. Il appartient aux parents de leur apprendre que leurs propos n’intéressent pas forcément l’ensemble de la population d’une voiture de chemin de fer. Enfin, il est évident que les enfants tâtent le terrain pour savoir jusqu’où ils peuvent aller. Un voyage se déroule donc sur plusieurs épisodes.
Une entrée dans la voiture peut être bruyante, mais avouons qu’elle est généralement calme. L’enfant (petit) est intimidé et tient sagement la main d’un de ses parents. Ceux-ci l’installent et s’assoient autour de lui. Il est le roi, mais on ne le montre pas. Il prend son pouce, loge sa tête entre les seins de la mère et accepte de faire semblant de dormir pendant un certain laps de temps, généralement court. Les parents devisent à voix basse d’affaires importantes (Où as-tu mis son doudou ? Il va s’endormir ! Etc…). Tout semble pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sauf que l’enfant n’a pas vraiment envie de dormir. Les yeux ouverts, il observe son environnement et son entourage. Il commence à faire quelques remarques : « Dis Papa, tu as vu, le monsieur, il a un gros ventre ! » ou encore : « Pourquoi la dame elle a un chapeau. Il pleut pas dans le wagon ! » Ces questions ne dérange pas le père qui lui raconte quelque chose dans l’oreille du style : « C’est parce qu’il mange trop ou c’est parce qu’elle n’a plus de cheveux au-dessous. » Aussitôt l’enfant reprend : Ah bon, qu’est-ce qu’il mange ? » Nouveau conciliabule, mais cette fois-ci le père a l’air gêné. Ce qui n’empêche pas l’enfant de reprendre : « Parle plus fort, j’entends rien ! ». La mère dit alors au père : « Emmène-le aux toilettes. » Le père, trop heureux de ce divertissement, se lève. Les femmes ont souvent l’art de modifier l’attention par une remarque ou une demande plus générale empêchant la conversation de s’appesantir sur des paroles un peu lourdes. Ce n’est pas forcément une remarque d’intérêt culturel du style : « Il y a une nouvelle exposition à la galerie Tartepeintre. Tu sais, l’artiste qui assemble des épingles et fait des sculptures piquantes ! » Non, généralement, lorsque la famille déjeune, c’est plutôt : « Qui reprend de ces délicieuses nouilles au beurre ? » Mais cette petite demande a l’avantage de détourner la conversation sur du plus concret ou du moins gênant.
Cette promenade au bout de la voiture est cependant un calvaire pour le père et une détente pour l’enfant. On passe au deuxième épisode. Il fait connaissance avec l’assemblée, regardant un peu partout, échappant à la main paternelle, courant dans l’allée centrale et bousculant ceux qui ont le malheur d’avoir qui un coude débordant du fauteuil (après son passage le monsieur se masse le coude longuement), qui un pied malencontreusement pas dans l’axe du corps (là c’est l’enfant qui manque de s’étaler, ce qui contraint la personne à lui faire un sourire et à s’excuser auprès du père), qui encore le fil de la souris de son ordinateur qui pendouille à l’extérieur et dans lequel l’enfant se prend les pieds (l’ordinateur est rattrapé de justesse par son propriétaire). Tout ceci se passe sur un ton badin dans la plus parfaite correction, même si les parents n’ont qu’un sourire à l’égard des personnes dérangées sans aucun mot d’excuse. C’est normal, semblent-t-ils dire. Quelle idée de s’étaler sur l’allée centrale !
Troisième épisode : retour à la place attitrée. On aurait bien voulu qu’elle soit attitrée ailleurs, mais là, il n'y a pas le choix ! La mère tente de distraire l’enfant une fois installé : « Tiens, voilà tes petites voitures ! » L’enfant considère les trois jouets, s’essaye à en faire rouler une. Elle tombe bien sûr de la table qui n’est pas faite pour cela. Le père la ramasse et lui donne. Aussitôt il recommence, elle tombe à nouveau, le père la ramasse. Troisiè… Non le père la rattrape au vol et lui dit d’arrêter. Alors l’enfant jour au stockcar. Les accidents arrivent vite au royaume des enfants. C’est beaucoup plus drôle qu’une vie sans histoire. Entre temps, les décibels commencent à monter malgré les airs attendris des spectateurs qui ne se doutent pas que cela ne fait que commencer. L’enfant, enhardi par ces signes encourageants, commencent à parler. Une vraie trompette ! Et, de plus, un moulin à paroles. Toute la voiture sait de quoi il parle et avec qui. Les parents ne semblent pas émus par ces échanges doucereux pour eux. C’est le mode de communication normal. Eux-mêmes cependant parlent de manière atone ce qui contraint l’enfant à sans cesse dire : « Quoi ? Quoi ? » Personne ne comprend personne, mais cela augmente la tension.
Vous abandonnez votre livre, abaissez légèrement votre siège et tentez de vous réfugier dans le sommeil ou, au moins, une légère somnolence qui vous fera oublier ces petits inconvénients des voyages. Le ronronnement du train, trente secondes de silence, vous font revenir à de meilleurs sentiments. Vous pensez à des choses agréables. Vous partez à la mer et pensez au bain que vous prendrez en arrivant ; vous vous rendez à la campagne et faites une promenade dans les bois à la recherche de champignons. Bref, votre vie reprend le dessus sans rien pour la faire trébucher. Erreur !
Quatrième épisode : un cri suraigu retentit dans la voiture : « Dis Maman, regarde, des vaches. », dit l’enfant en montrant le paysage. On lui pardonne cet étonnement (un enfant des villes n’en voit probablement pas suffisamment souvent). Mais on lui pardonne moins ce cri. On est cependant bien contraint de passer. On se réinstalle, on ferme à nouveau les yeux, on se réfugie dans ses pensées. Nouveau cri, on ne sait même plus pour quelle raison. Il s’accompagne d’une dégringolade des voitures que l’enfant fait tomber sans motif. Ramassage, sourire, apaisement. Mais rien vers l’enfant qui continue de plus belle. Excité, il ne parle plus, il hurle et secoue ses voitures les unes contre les autres.
Alors, excédé, vous vous levez, rassemblez vos affaires, prenez votre valise et changez de voiture. Que ne l’ai-je fait plus tôt, vous dites-vous une fois installé. Comme tous les voyageurs, vous sortez vos oreillettes, réglez votre appareil et vous vous plongez dans les délices d’une symphonie de Mozart. Vous vous endormez. Vous êtes malheureusement très vite réveillé par un arrêt à une nouvelle gare. Zut ! Une famille s’installe de l’autre côté de l’allée. Cette fois-ci, vous n’attendez pas, vous changez de place.
07:46 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : voyage, société, enfance, parents, éducation |  Imprimer
Imprimer
27/02/2014
L'enfant
L’enfant est un adulte déjanté. Avec une désarmante candeur, il vous sort quelques vérités incongrues telles que la présence d’un grain de beauté sur la joue ou le léger rebond de votre estomac. On ne peut s’empêcher d’en rire sur le moment, puis de pleurer sur le délabrement progressif du corps qui s’épuise à se renouveler et sur la personnalité élaborée avec tant de peines.
Je ne suis plus ce que je croyais être. Si je monte encore les escaliers quatre à quatre, je ne les descends plus que deux à deux. Si je lève toujours le coude, mon verre commence à trembler. Certes, j’ai toujours vingt ans, mais ces vingt ans sont devenus virtuels. De la réalité à la fiction et non l’inverse.
L’enfant voit les gens comme il les observe, sans l’ajout de l’habitude et du conformisme. Il se promène chaque jour dans des rues inconnues et considère leur nouveauté. Il s’émerveille à sa manière, par simple constat d’une réalité qu’il ne connaît pas suffisamment pour ne plus la voir. Cet émerveillement n’est pas l’extase de ce qui sort de l’ordinaire. Il est dû au contact de l’ordinaire qui est encore pour lui extraordinaire, ce qui n’est pas le cas de l’adulte. Seul le poète le rejoint dans cette extase. Chaussant ses lunettes de découvreur de la réalité, il fait lui aussi des focus sur une réalité devenue autre. Comme l’enfant, il tente de l’expliquer avec ses mots. Ceux-ci ne sont pas toujours compris parce qu’ils traduisent des images que le lecteur ou l’auditeur ne connaît plus ou ne connaît pas.
L’enfant apprend la réalité. Le poète redécouvre la réalité. Entre les deux, le monde nu, frêle et réel. Quelle plongée refroidissante avant de remonter revêtu de la couronne de laurier !
07:41 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : réalité, poète, enfance, virtuel |  Imprimer
Imprimer
03/11/2013
La sieste
La sieste, obligation enfantine qui, chaque jour, entraîne des protestations, légitimes ou non, de la part des enfants. Mais comment ravir à leurs parents cette heure qui leur permet d’échapper à l’esclavage de leur progéniture ? De ces heures de repos forcé pendant les vacances d’été, il ne retient que le vol des mouches dans la pièce. Non, n’allez pas croire que cette pièce était un taudis attirant les mouches et autres prédateurs de viande fraîche. Elle leur offrait un havre de paix qu’eux-mêmes n’appréciaient guère, mais qui était réel. Il faisait chaud en cette saison, lorsque le soleil tapait sur les tuiles. Ils étaient découverts, une simple chemise et un drap était leur seule protection.
Il ferme les yeux et se revoit, étendu sur un lit cage, l’esprit embrumé, dans le silence de l’après-midi qui permettait d’entendre les rares voitures prendre le tournant à angle droit au bout du pré. Les vaches se tenaient souvent sous un des seuls arbres à deux pas de leur fenêtre. On les entendait ruminer, faire mille bruits, discrets ou non, parfois même meugler pour on ne savait quelle raison. Il attendait que le sommeil, libérateur de son ennui, le prenne dans ses bras et le conduise au pays des rêves. Il rêvait de fraîcheur, d’eau claire, de forêt profonde, de cave froide, jusqu’au moment où il se réveillait transpirant de chaud, une soif inextinguible au fond de la gorge.
Mais ce dont il se souvient le mieux, souvenir corporel et vivant, c’est le bourdonnement des mouches qui avaient élu domicile dans la pièce. C’était supportable lorsqu’elles se contentaient de tourner en rond au dessus de leurs têtes avant de se poser sur le plafond, en défi à toute gravité. Mais il leur arrivait trop souvent d’explorer leurs propres personnes, en particulier leurs visages encore enfantins qui devaient être doux à leurs pattes velues. Alors ils faisaient un geste de la main vers la joue ou le nez pour l’obliger à reprendre son envol ou, simplement, ils bougeaient la tête d’un geste décidé et rapide, comme le font les bêtes qui savent déclencher des ondulations de la peau propres à décourager tout animal à ailes. Le bourdonnement reprenait jusqu’à une nouvelle escale qui pouvait parfois être une main sortie du drap ou un pied en quête de fraîcheur.
Il leur es t arrivé, sachant leurs parents au rez-de-chaussée, loin des cris extasiés des trois frères, de jouer au petit tailleur. « Sept d’un coup », était-ce possible ? Les mouches tourbillonnaient en une ronde inlassable et ne se posaient qu’épisodiquement sur eux. La malheureuse mouche qui s’y essayait, était alors prise immédiatement pour cible. Il s’agissait d’approcher la main en utilisant des stratagèmes dignes de Sun Zu, par derrière, au dessus ou sur le côté. Le plus souvent, c’était peine perdue. L’insecte disposait de ressources insoupçonnées dans l’accélération, décollant comme une balle de fusil, pour ensuite tourner en rond au dessus du bras impuissant. Parfois, une d’entre elles se laissaient sacrifier, comme un suicide volontaire, pour prolonger le jeu. Ils poussaient alors des cris aigus et faisaient un bâton sur une feuille de papier qui servait à compter les points. « J’en ai trois ! » Cela, bien sûr, donnait lieu à des disputes sans fin sur le nombre réel de victoires, chacun ajoutant un bâton supplémentaire lorsque les autres avaient le dos tourné. Aussi en étaient-ils venus à faire des tas, maigres il est vrai, de mouches tuées au champ d’honneur. Ce n’était jamais que trois ou quatre cadavres les pattes en l’air, les ailes défraîchies, qu’ils jetaient ensuite par la fenêtre avant l’arrivée de leur mère pour le réveil. En entendant ses pas, ils se précipitaient dans le lit et faisaient semblant de dormir, ouvrant un œil fatigué à son appel. Certes, le soir la fatigue se faisait plus lourde que d’habitude, mais peu importe, la guerre déclarée était un événement important de la journée à laquelle il était difficile de renoncer.
t arrivé, sachant leurs parents au rez-de-chaussée, loin des cris extasiés des trois frères, de jouer au petit tailleur. « Sept d’un coup », était-ce possible ? Les mouches tourbillonnaient en une ronde inlassable et ne se posaient qu’épisodiquement sur eux. La malheureuse mouche qui s’y essayait, était alors prise immédiatement pour cible. Il s’agissait d’approcher la main en utilisant des stratagèmes dignes de Sun Zu, par derrière, au dessus ou sur le côté. Le plus souvent, c’était peine perdue. L’insecte disposait de ressources insoupçonnées dans l’accélération, décollant comme une balle de fusil, pour ensuite tourner en rond au dessus du bras impuissant. Parfois, une d’entre elles se laissaient sacrifier, comme un suicide volontaire, pour prolonger le jeu. Ils poussaient alors des cris aigus et faisaient un bâton sur une feuille de papier qui servait à compter les points. « J’en ai trois ! » Cela, bien sûr, donnait lieu à des disputes sans fin sur le nombre réel de victoires, chacun ajoutant un bâton supplémentaire lorsque les autres avaient le dos tourné. Aussi en étaient-ils venus à faire des tas, maigres il est vrai, de mouches tuées au champ d’honneur. Ce n’était jamais que trois ou quatre cadavres les pattes en l’air, les ailes défraîchies, qu’ils jetaient ensuite par la fenêtre avant l’arrivée de leur mère pour le réveil. En entendant ses pas, ils se précipitaient dans le lit et faisaient semblant de dormir, ouvrant un œil fatigué à son appel. Certes, le soir la fatigue se faisait plus lourde que d’habitude, mais peu importe, la guerre déclarée était un événement important de la journée à laquelle il était difficile de renoncer.
07:04 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, enfance, famille, mouche, petit tailleur |  Imprimer
Imprimer
12/04/2013
La petite chartreuse, roman de Pierre Péju
Deux destins marchent l’un vers l’autre. Une petite fille perdue qui attend sa maman et un libraire, Etienne Vollard, ours mal léché, qui conduit sa camionnette : six cents kilos de ferraille, deux cent kilos de livres, cent dix kilos de Vollard, bref une tonne de choses mécaniques, humaines et littéraires. (…) Vollard voit successivement le petit anorak rouge, la pâleur, la terreur soudaine dans deux yeux immenses, démesurés, deux yeux incrédules plongeant dans les siens. Longtemps il restera persuadé d’avoir nettement distingué ce visage à travers le pare-brise, un visage d’enfant qui n’était séparé de sa vieille tête à lui que par l’écran transparent contre lequel il se brisait.
Vollard voit successivement le petit anorak rouge, la pâleur, la terreur soudaine dans deux yeux immenses, démesurés, deux yeux incrédules plongeant dans les siens. Longtemps il restera persuadé d’avoir nettement distingué ce visage à travers le pare-brise, un visage d’enfant qui n’était séparé de sa vieille tête à lui que par l’écran transparent contre lequel il se brisait.
Il n’est pas responsable. L’enfant s’est jeté sous ses roues. Mais il ne peut s’empêcher de penser à sa victime.
Alors il va la voir à l’hôpital, un corps environné de tuyaux, avec une mère, Thérèse, qui fuit sa fille, inefficace. Il va la prendre en charge, cette Eva qui est dans le coma. Il lui parle dans le creux de l’oreille. Il lui raconte ses histoires de livres. Il lui récite des livres entiers. Il abandonne sa librairie à son assistante et passe des jours entiers près d’elle.
Bientôt Eva put quitter l’hôpital. Habillée de neuf, elle ressemblait à n’importe quelle petite fille, yeux noirs, duvet noir. (…) Elle ne disait rien, absolument rien, mais elle ne paraissait pas en éprouver le besoin.
Thérèse fuit, une fois de plus, et signe les papiers autorisant Vollard à s’occuper de sa fille qui se trouve maintenant dans une maison de santé de la Chartreuse. Celui-ci y va et fuit lui aussi. Il n’a pas le courage d’affronter cette chose pétrifiée. Il reviendra pourtant. Ils partent dans la campagne de la Chartreuse, dans ses bois, ses massifs, ses rivières. Et il raconte ses livres. Pour Vollard, Eva devenait la petite chartreuse. Silencieuse sans en avoir fait le vœu. La très pâle moniale. L’enfant cloîtrée. L’enfant privée de voix et de joie, privée d’enfance. Mais au fil de ces errances dans la Chartreuse, bizarrement, ce n’était pas le poids écrasant et absurde de l’accident que Vollard ressentait en compagnie de la petite fille, mais un inexplicable allégement, un soulagement, un apaisement dû à ce rituel de marche lente, de silence, de contemplation de choses infimes. Comment un si petit être, émettant si peu de signes, pouvait-il lui donner cette impression de discret équilibre, de nécessité fragile, mais heureuse ?
Un beau livre, discret, réfléchi, qui parle de cet amour entre le libraire et sa victime et qui conduit malgré tout à une fin terrible des personnages, comme si inéluctablement leur destin se poursuivait jusqu’à l’anéantissement.
07:42 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, enfance |  Imprimer
Imprimer
30/01/2013
La magie d’un instant
Sur le tapis déroulé, ils dansaient tels des lutins, dans la joie de Noël. Et plus ils sautaient, plus ils devenaient invisibles aux yeux des adultes, perdus dans leur monde de rêve, de mouvements et d’exaltation.
Ils rejoignaient ainsi les rescapés de la gravitation.
07:52 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : enfance, pays des merveilles, bonheur |  Imprimer
Imprimer
07/01/2013
Le Petit Sauvage, roman d’Alexandre Jardin
Un jour, je m’aperçus avec effroi que j’étais devenu une grande personne, un empaillé de trente-trois ans. Mon enfance avait cessé de chanter en moi. Plus rien ne me révoltait. La vie et l’enjouement qui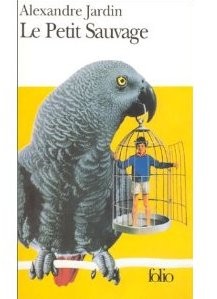 était jadis dans les veines s’étaient carapatés. Le Monsieur prévisible que j’étais désormais jouissait sans plaisir d’une situation déjà assise, ne copulait plus guère et portait sur le visage un air éteint. Je me prélassais sans honte dans la peau d’un mari domestiqué indigne du petit garçon folâtre, imprudent et rêveur que j’avais été, celui que tout le monde appelait le Petit Sauvage.
était jadis dans les veines s’étaient carapatés. Le Monsieur prévisible que j’étais désormais jouissait sans plaisir d’une situation déjà assise, ne copulait plus guère et portait sur le visage un air éteint. Je me prélassais sans honte dans la peau d’un mari domestiqué indigne du petit garçon folâtre, imprudent et rêveur que j’avais été, celui que tout le monde appelait le Petit Sauvage.
Ainsi commence ce roman dont l’objet est le retour à l’enfance bienheureuse, sans souci, sans projet, sans perspective autre que s’amuser. Ce qui signifie se débarrasser d’habitudes prises, de routines administratives, de contrefaçons mondaines. Alexandre se lance dans une fuite éperdue vers sa jeunesse, et il y réussit dans un premier temps. Il largue son entreprise, sa femme, et se retrouve dans le midi dans l’ancienne maison de famille devenue un hôtel. Il la rachète, va chercher sa grand-mère à l’hospice et s’installe comme il y a trente ans.
Ses aventures sont la surprise du livre. Les dévoiler ôterait le charme de ces pages écrites sous le feu. Reste une méditation sur la manière dont l’enfant devient adulte, se charge de poids excessifs, d’obligations infernales, et oublie peu à peu ces heures libres et belles de l’enfance au fil des heures : Le petit sauvage me mettait également en garde contre une attitude qui, à l’entendre, gâtait le sort de presque tous les adultes : ils se croient obligés. Il s’étonnait sincèrement du nombre inouï d’obligations fictives que les grands s’imposent ; comme si les contraintes réelles de la vie ne suffisaient pas ! (…) Je me souviens également de cette phrase qui me frappa : les grands n’ont pas l’air de se rendre compte qu’ils sont libres. Ils n’ont plus d’adultes sur le dos et ils n’en profitent même pas ! Toi, tu en profiteras !
A trente-huit ans, il découvre dans les bras de Manon-Fanny ce que le terme extase s’efforce d’exprimer. Il découvre par la même occasion, la joie de l’incohérence. Il comprit qu’il n’est pas de vraie vie sans incohérences. Les hommes et les femmes qui tentent de se conformer toujours à une certaine idée d’eux-mêmes, quelle qu’elle soit, sont des presque-cadavres. La cohérence mutile ; l’incohérence régénère.
07:56 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : roman, amour, littérature, enfance |  Imprimer
Imprimer
02/03/2011
Souvenir lointain
La nuit, quand je ne pouvais dormir, peut-être parce que je n’étais pas assez fatigué ou que la fatigue déclenchait irrémédiablement le souvenir de chacun des mouvements du corps que j’avais fait dans la journée, je regardais, dans la torpeur irrésistible et insuffisante que donne l’approche du sommeil, mais qui n’est pas encore celle du sommeil, le couvre-lit qui protégeait les couvertures de la poussière, irisée par le soleil du matin, que soulevait ma mère en faisant un ménage méticuleux et soigné.
Ce couvre-lit éveillait en moi le souvenir d’années lointaines où, petit garçon épris des caresses de ma mère, ou plutôt de la douce et tiède odeur que dégageait son lit le matin quand je venais l’embrasser par un besoin irrésistible qui me faisait sortir de la chaleur bienheureuse de mon lit, je venais me blottir dans ce havre de paix, essayant vainement de mettre en contact le maximum des parties de mon corps avec le grain rude et perceptible de son tissu usé par le frottement de nos ébats enfantins. Le plus souvent, ma mère s’étant levée et préparant l’instant sacré et tant attendu du petit déjeuner dont nous n’entendions pour le moment que le cliquetis des cuillères sur les soucoupes et le grincement de l’armoire où se trouvaient les tasses, nous sautions avec mes frères sur le lit pour retomber dans les plis mystérieux du couvre-lit. Alors, le nez enfoui dans le vallonnement que faisaient les côtes du tissu dont j’apercevais chacun des fils de laine qui sortaient en chevelure brouillonne de ces vallées allongées côte à côte, je regardais l’entremêlement des fils roses et blancs retenus et soudés par d’autres fils de la même couleur et qui avait pris dans le vieillissement de l’usage la couleur de ce saumon qui m’avait émerveillé le jour du mariage d’une de mes cousines quand il reposait comme un jouet tendre et coloré dans la blancheur de l’assiette entre deux demi-lunes dorées qui se rejoignaient en auréoles dans le cercle délicat et parfaitement défini de la porcelaine.
J’aurais pu rester de longues heures ainsi étendu, les mains enfouies sous le pli que faisait le couvre-lit rabattu vers les pieds pour laisser apparaître la fraicheur du drap (et l’envers du couvre-lit par sa construction moins riche en fil rose me paraissait être la couleur du saumon vivant quand on le découpe cru en filets allongés) si je n’avais pas préféré pénétrer lentement dans la chaleur des draps imprégnés du souvenir de l’odeur unique des joues de ma mère. Je m’y blottissais en fermant les yeux comme si la couverture rabattue sur la tête n’eut pas suffi à donner à mon esprit l’impression de repos que je venais chercher. J’abolissais toute notions de temps qui me semblait arrêté puisque je n’entendais plus le mouvement du réveil qui était mon ennemi quand je venais ainsi retrouver le bonheur d’encore plus jeunes années où, malade, ma mère m’avait installé dans sa chambre à côté de la cheminée du pétrin que faisait tourner jour et nuit le boulanger du rez-de-chaussée, me berçant de son ronronnement lointain transmis, me semblait-il, par le chaleur de la cheminée que je percevais au toucher du mur blanc.
06:09 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : impression, souvenir, mémoire, enfance, réveil |  Imprimer
Imprimer
25/12/2010
Passage, d'une vie à l'autre
L’enfant regardait la fleur tristement, en soupirant,
Et la fleur qui était coquette, mais qui avait bon cœur,
Demanda à l’enfant les raisons de ses gémissements :
« Ce matin, on m’a pris mon ours, petite fleur,
Dit l’enfant. C’était mon ami, il me comprenait ;
Il me regardait, je le regardais, nous étions heureux.
Maintenant, je n’aurai plus rien à regarder, jamais.
Toi aussi, tu es jolie. Tu n’es pas comme eux,
Mais je ne t’aime pas encore, alors je suis triste.
A mon ours, je pouvais tout lui dire.
Il me croyait. Je voulais être artiste
Pour lui peindre une maison, lui donner un empire.
J’aurai attrapé la lune un soir d’été
Et l’aurai mise dans son royaume, pour jouer.
Maintenant à quoi me servirait une lune détachée,
Si je n’ai personne à qui la donner ».
« Moi je la voudrai bien si tu me la donnais,
Répondit la fleur en rougissant de tous ses pétales,
Tu serais mon ami et tu me regarderais
Quand je m’épanouis dans l’aube matinale ».
Et l’enfant, quand vint l’été, attrapa la lune
Et oublia l’ours en apprenant à aimer la fleur.
19:10 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, enfance, littérature |  Imprimer
Imprimer












