23/10/2013
Avant le big bang
Avant le big bang, qu’y avait-il ?
Le néant, le vide, l’inexistant ?
Ou le Tout, la vie pleine, le créateur ?
Qui a mis cette étincelle en route ?
Cela craque une allumette
Et tout commence par une explosion
"Au commencement Dieu créa le ciel et la terre"
Rien et deux mondes, le psychique et le physique
Le ciel ne se mesure pas. Il vous prend
Et son parfum vous le fait désirer
"Que la lumière soit et la lumière fut"
Transpercé par ce coup de lance
Le monde se mit à bouger. Première nuit
Plongée dans la matière. Quel dépaysement…
© Loup Francart
07:20 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, littérature, univers, création, information |  Imprimer
Imprimer
19/10/2013
Les taches sur le mur
Les taches sur le mur
Sont l’ombre de mes pensées...
Une fenêtre recèle le ruban
Que porte un homme dans la rue...
La glace reflète l’envers des murs
Et les ombres transformées
Sont sans doute la vérité…
Qui se cache parmi les mots ?
C’est une longue énigme
Que je cherche encore
© Loup Francart
07:48 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer
Imprimer
15/10/2013
Les yeux
L’œil est le fond de l’âme
Mais celle-ci est-elle noire ou bleue ?
Le tripot ou les enfants sages ?
Trou d’épingle dans une feuille de papier
On y admire la pointe de l’humain
Source d’un rayonnement intense…
Ce peut être un soleil chaleureux
Une lune chafouine et malheureuse
Un astre inconnu et sans vie
Une étoile aiguisée et scintillante
Ou même un trou noir aspirant ton regard…
Les yeux de l’esprit sont la lampe de poche
De l’explorateur du château de verre
Ses larmes sont la seule vérité
Que la vue entraperçoit dans la brume…
Un tremblement à la surface de l’eau
Un grattement de doigts fragiles
Fuite du temps, absence d’espace…
Tu n’as plus que les yeux pour pleurer…
Il coûte les yeux de la tête !
Rien que cela ! Fait à l’œil pourtant
Par un aveugle aux mains de fée
Et la femme enceinte jusqu’aux yeux
L’achète comme un talisman précieux
Pour les beaux yeux de son amant…
L’argent, elle s’en bat l’œil
Ses rondeurs ne lui font pas froid aux yeux…
Et lorsque le regard, aux soirs d’été,
Dénote l’harmonie des sentiments
Qui est le mieux loti, l’œil de chat
Ou la larme de gazelle…
Manger des yeux vaut mieux
Même s’ils sont plus gros que le ventre
Que se manger le blanc des yeux…
L’œil de verre seul est impassible
Devant tant de provocations…
Ouvre l’œil ô mon âme
Et marche vers la lumière, impassible…
Quel coup d’œil ! Verts, les a-t-elle
Emeraudes en couple, deux phares dans la nuit…
De braise, l’autre les porte
On ne peut l’approcher, elle brûle…
De jais, ceux-ci roucoulent tendrement
Surpris de ne pas trouver la paire…
Noisettes, ils sortent des bois, tendres
Et se posent sur vous, charmeurs…
Vairons, l’âme boite dans son logement
Merlan frit ou œil de biche ?
Oui, le monde vu de l’œil de bœuf
Devient le centre du cyclone
Alors…
Ne gardez pas vos yeux dans votre poche
© Loup Francart
07:32 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature, vue, regard âme |  Imprimer
Imprimer
11/10/2013
Ton âme
Ton âme, un univers en soi…
Tu pars dans l’immensité
Et tu retournes au point de départ…
Tu en fais vite le tour…
Elle est emplie de vide
Et ce vide t’aspire, t’attire
Broie tes doutes et tes vertiges…
Ce globe précieux
Que tu chéris tendrement
Est ton talisman…
Sans lui tu n’es rien
Avec lui tu n’es plus…
Et n’être plus te mènes
Dans l’espace chaleureux
De l’absence du moi…
Garde ton âme
Et perds le reste
C’est ton seul bien
Au-delà de toi…
© Loup Francart
07:26 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, littérature, âme, éternité, univers |  Imprimer
Imprimer
07/10/2013
Merci
Quel petit mot sublime et doux
A peine glissé entre les lèvres mi-closes
Avec une ébauche de sourire gêné…
Mot pudique, petit, sans brillance
Comme le cri d’un oisillon sur l’arbre
C’est un murmure inaudible, mais réel
Qui éveille le récipiendaire…
Il chemine de l’oreille distraite
Aux neurones enchevêtrés
Et produit ce déclic enchanteur
Qui fait fuir les nuages…
Cette goutte tombée d’un mot, un seul
Provoque les ondes de la félicité
Qui s’échappe jusqu’aux tréfonds
De votre être intime et assoiffé…
Et ces lèvres qui l’ont prononcé
Connues ou inconnues
De rose vêtues et de parfum céleste
Délivrent leur message divin
Avec allégresse et insouciance
Merci… Merci… Merci…
La chaîne monte dans l’azur
Et explose à la face du monde
Pour remercier le créateur anonyme…
Ame et nature, étroitement unies
Par ce mot si petit et si simple
Qu’il passe inaperçu…
Mais quel émoi en chacun de nous…
© Loup Francart
07:01 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer
Imprimer
03/10/2013
Les ondes
Elles sont partout…
S’en préserver revient à vivre
Dans une caverne loin du monde
Elles vous traversent le corps
En laissant un parfum glacé
Et remuent en cœur vos cellules
Parfois vous vous sentez affaibli
Alors vous écoutez Mozart
Qui ravive l’harmonie des traversées
Et vous repartez guilleret
Dans la nuit opaque du matin
Qui apporte ses nuages de pessimisme
Diffusés par la boîte à bruits
N’écoutez pas ! Laissez-vous aller
A la paresse de l’esprit troublé
Ah, le téléphone… Rien ne nous épargne
Les doigts dans les oreilles
Vous répondez aux sollicitations
D’un vendeur de rêve disert…
Non, rien, je ne suis rien
Que pourrais-je acheter ?
Pourtant tout n’est qu’ondes
Ou corpuscules
Lumière des cœurs
Vous résistez aux assauts du temps
En vous étendant dans l’espace étoilé
L’onde noire du Styx ne vous est pas accessible
Vous avez encore à œuvrer sur terre
A vous laisser porter par les eaux courantes
D’une vie agitée, mais passionnante
Du plus grand au plus petit
De l’atome à l’univers
Tous traversés d’ondes de sympathie
Vous vous découvrez système d’informations
Qui échange avec d’autres
Des contenus stupides ou dérangeants
La noosphère entretient vos méninges
Les lie dans le Tout des idées
Vous êtes vous-mêmes ondes
Et voyagez dans les flots déchaînés
D’un avenir inconnu…
Mais où donc se trouve la sortie ?
© Loup Francart
07:07 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, littérature |  Imprimer
Imprimer
29/09/2013
Présence
Vous arrive-t-il parfois, dans la pesanteur des jours
De descendre au-delà de vous-même
Dans ce vide cosmique, chaud et sans visage
Que vous ne touchez que d’un doigt malhabile ?
Dans cette absence se cache la présence
Vous la cherchez, vous l’espérez,
Elle ne dit rien, elle ne se manifeste pas
Mais elle réchauffe votre nuage intemporel
Et fait pleuvoir sur vos angoisses
Le miel apaisant du néant apprivoisé
Fantôme déchue ou réalité virtuelle
Ou encore germe de vie dans la solitude du moi
Ou insufflateur de bulles d’air
Qui encombre l’espace de délires joyeux
J’attends au creux de la nuit apaisante
L’étincelle qui déforme la vision
Et donne à l’âme esseulée
Une poussée de fraicheur délirante
Lorsque vient l’aurore, les yeux clos,
Je contemple, le cœur chaud,
Ce noyau de prune agaçant
Qui s’agite en moi hoquetant
Et fait rire les voisins
Pourtant rien n’est plus extatique
Que cette perle dorée que vous portez
Dans ce château-fort aménagé
Que vous appelez Moi
Qui s’avère Soi
Et parfois Autre, mais quoi ?
07:41 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, littérature |  Imprimer
Imprimer
25/09/2013
Une femme, c'est...
Une femme, c’est une bouche
Chaude, rouge, pétillante
Que l’on embrasse un soir d’orage
En attendant la pluie bienfaisante
Et ces lèvres sublimes parlent
Dissertent, bavardent, babillent
Elles veulent dire tout ce qui leur vient
A l’esprit pour s’en débarrasser
Lui ne dit mot, médite devant ce fait
Pourquoi parler de que l’on n’a pas connu
Quel mirage prévaut sur la réalité?
Façonne ton jardin avant de l’exposer !
Mais lorsqu’elle se dénude avec pudeur
Et entrouvre ses lèvres offertes
On ne peut que tendre amoureusement
Nos oreilles à cette source légère
07:40 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer
Imprimer
24/09/2013
La Déesse des petites victoires, roman de Yannick Grannec
Un livre étrange où l’on passe de la plus haute mathématique aux soins d’une vieille dame à l’humeur inégale. Les premières pages (au moins une bonne cinquantaine) laissent le lecteur dérouté. 1980, à Princeton : première rencontre entre Anna Roth, une jeune documentaliste et Adèle Gödel, femme du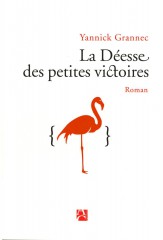 mathématicien Kurt Gödel, ami d’Einstein. La première est chargée de récupérer les archives que détient la seconde. Pour y arriver, elle devra devenir l’amie d’Adèle, petite femme coriace, au destin particulier : elle a veillé toute sa vie sur un des plus grands mathématiciens du siècle qui se comporte comme un enfant sans jugeote. Deuxième chapitre : Adèle, une jeune serveuse de bar, fait connaissance avec Kurt Gödel, un jeune homme au comportement bizarre qui réfléchit en marchant la nuit dans les rues de Vienne. Kurt et moi n’avions rien en commun, du moins si peu. J’avais sept ans de plus, je n’avais pas fait d’études ; il préparait son doctorat. (…) La promenade s’est achevée comme elle avait commencé, dans le très inconfortable silence où chacun cachait ses pensées. Même si je n’ai jamais été douée pour les mathématiques, je connais ce postulat : une toute petite inflexion de l’angle de départ fait une énorme différence à l’arrivée. Dans quelle dimension, quelle version de notre histoire, ne m’a-t-il pas raccompagnée ce soir-là ?
mathématicien Kurt Gödel, ami d’Einstein. La première est chargée de récupérer les archives que détient la seconde. Pour y arriver, elle devra devenir l’amie d’Adèle, petite femme coriace, au destin particulier : elle a veillé toute sa vie sur un des plus grands mathématiciens du siècle qui se comporte comme un enfant sans jugeote. Deuxième chapitre : Adèle, une jeune serveuse de bar, fait connaissance avec Kurt Gödel, un jeune homme au comportement bizarre qui réfléchit en marchant la nuit dans les rues de Vienne. Kurt et moi n’avions rien en commun, du moins si peu. J’avais sept ans de plus, je n’avais pas fait d’études ; il préparait son doctorat. (…) La promenade s’est achevée comme elle avait commencé, dans le très inconfortable silence où chacun cachait ses pensées. Même si je n’ai jamais été douée pour les mathématiques, je connais ce postulat : une toute petite inflexion de l’angle de départ fait une énorme différence à l’arrivée. Dans quelle dimension, quelle version de notre histoire, ne m’a-t-il pas raccompagnée ce soir-là ?
On ne comprend que plus loin que le livre s’organise entre la vraie vie d’Adèle et de Kurt (Vienne, fuite devant l’Allemagne nazie, installation aux Etats-Unis) et la vie d’Adèle devenue vieille, phagocytant la vie d’Anna, missionnée auprès d’elle pour obtenir le nachlass de Kurt (documents faisant figure d’héritage intellectuel recueillis de manière posthume). Un chapitre dans les années suivant la deuxième guerre mondiale, un chapitre dans les années 80.
Les mathématiciens sont comme des enfants qui empilent des briques de vérité les unes sur les autres pour construire le mur qui remplira le vide de l’espace. Ils se demandent si certaines sont vraiment solides, si elles ne vont pas s’écrouler ensemble. J’ai prouvé que sur une certaine partie du mur, certaines briques sont inaccessibles. On ne pourra donc jamais vérifier que tout le mur est solide. C’est ainsi que Kurt explique son travail sur le programme de Kilbert, liste de questions dont il a résolu une partie avec son théorème d’incomplétude prouvant que certaines résolutions étaient inaccessibles. Pour Kurt, les mathématiques sont la vraie beauté. Il s’interroge sur l’existence de l’infini. Il explique la théorie des ensembles à Adèle qui lui demandait si l’on invente les mathématiques ou si on les découvre. Et il ajoute : « Je cherche à établir la décidabilité de l’hypothèse du continu. (…) J’ai l’intuition, Adèle, que l’hypothèse du continu est fausse. Il nous manque des axiomes pour construire une définition correcte de l’infini. (…) Je dois savoir si cet infini que j’explore est une réalité ou une décision. Je veux témoigner de notre avancée dans un univers de plus en plus lisible. Je dois découvrir si Dieu a créé les nombres entiers et l’homme, et le reste. »
Mais Adèle est perdue devant ces réflexions : Je retournais à ma cuisine. Les larmes avaient monté malgré moi ; ils devaient me croire inquiète pour l’avenir de l’humanité, en réalité, je m’apitoyais sur mon sort. J’étais une enfant dans un monde d’adultes. (…) Je ne serais jamais d’ici ; je serais toujours une exilée au milieu de tous ces génies. J’atteignais l’âge où les hommes seraient plus charmés par ma cuisine que par mes jambes : l’âge de la résignation.
Kurt finit par mourir. Est-il décédé de malnutrition comme ils l’ont dit ? Non, plutôt d’un accident du travail : il interrogeait l’incertitude ; il était mort rongé par le doute. La vie n’est pas une science exacte ; tout y est fluctuant, indémontrable. Il ne pouvait la vérifier paramètre par paramètre. Il ne pouvait pas axiomiser l’existence. Qu’avait-il cherché qui n’était pas dans son cœur, son ventre ou son sexe ? Il avait décidé de ne pas s’impliquer ; de se placer en dehors du monde pour le comprendre. Il y a des systèmes dont on ne peut s’exclure. Albert (Einstein) le savait, lui. S’exclure de la vie, c’est mourir.
Oui, un livre qui passe des plus hautes réflexions sur l’univers aux plus ordinaires sentiments d’une vieille femme qui s’accroche à son destin. Et pourtant : Je n’existais pas pour eux. Je n’ai jamais existé.
07:27 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, mathématique, science, incertitude |  Imprimer
Imprimer
21/09/2013
Les artistes au matin
Le poète se réveille l’esprit aux aguets
Il cherche les ombres délicates
Leur attribue formes et intentions
Pour s’envoler dans la fraîcheur
Le musicien, bercé par l’angélus
Se réveille au chant des oiseaux
Préparant sa cuisine de notes grêles
Seule importe sa symphonie intérieure
Le peintre n’ouvre pas ses yeux hagards
Il contemple en solitaire la couleur
Derrière ses paupières closes
Et choisit l’assemblage de la journée
L’écrivain agite ses doigts gourds
Les échauffe au feu de son imagination
Et façonne ses phrases et galimatias
En dentelles savantes et prolixes
Le sculpteur rêve en caressant le drap
Il lui prête des formes lascives
Et ébauche l’enlacement magique
Des formes de pierre ou de terre
L’architecte a un sommeil de pierre
Il ne se réveille qu’au son troublant
Du moteur de la bétonneuse
Alors, il se fait sagace et éloquent
Le comédien au matin ne joue aucun rôle
Il lessive sa nuit au théâtre
Et se rend aux cieux de l’olympe
Pour sourire aux applaudissements
Dieu, que tous ces artistes sont beaux
Des réveils en face à face avec eux-mêmes
Et nous, innocemment, sans effort
Dormons encore sans y penser
07:26 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer
Imprimer
16/09/2013
Les mains
Elle est là, posée sur le livre, détendue
Elle ne bouge pas, au repos devant ces pages
Elle en caresse la couverture fraîche
Et semble vous dire : ne viens-tu point ?
Mais c’est une main gauche
Et la gauche reste noire
Elle ne peut converser et toucher
Ce que la droite a caressé
Ce n’est pas la guerre des sexes
Mais celle des appréhensions
Ce que la gauche fait
La droite l’ignore superbement
Et pourtant ne vous arrive-t-il pas
De souscrire à deux mains
Aux projets dithyrambiques
Exprimés par une bouche câline
Alors pour l’amour de l’art
On inventa le changement de mains
Mais où donc ai-je mis mes rechanges ?
J’en ai perdu la main
Ainsi, sans mains, ni même visage
Ai-je défié le futur en un éclair
Et regardé au fond de tes paumes
L’avenir incertain de nos passions
Oui nous sommes unis et heureux
Comme les deux doigts de la main
Et nus comme la main et beaux
Apprécions la caresse de ces tentacules
De l’amour comme de la haine
D’autres s’en lavent les mains
Ils résistent au chatouillement
Des doigts recourbés et sagaces
Elles tremblent parfois ces mains
Peuvent être de vieillards
Ou de jeunes enfants
Qui n’osent toucher le miel
Mais l’amour commence toujours
Par un échange de mains
Ou plutôt de caresse des doigts
Sur ceux de l’aimée
Alors celles-ci s’animent
Se reconnaissent mutuellement
S’ouvrent au passage du désir
Et se referment en symétrie
Les mains sur le cœur
On se jure de grands projets
On se regarde par le toucher
Jusqu’au hérissement des poils
Enfin la main devient aérienne
Elle courre dans le ciel
Comme un vol de moineaux
Et se laisse prendre au piège
Plus rien ne sera comme avant
Car ta main demandée m’appartient
Elle me guide en pression habile
Jusqu’au centre de ton être
En sous-main ou dans les poches
Les mains s’activent et s’enchevêtrent
Les mains en l’air et plus haut
Mais que les bras ne vous en tombent pas !
07:29 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, littérature |  Imprimer
Imprimer
15/09/2013
Stop ! La pensée perdue
Expérience d’un instant sans pensée. C’est arrivé subitement, sans effort, sans même penser que je ne veux pas penser. Le trou noir dans un monde de lumière environné d’objets et de pensées. Plus rien, que le silence du cerveau, sans parachute.
Je lisais un livre qui se révèle passionnant par sa simplicité et sa profondeur : le monde de tous les jours pour comprendre un monde que seuls quelques mathématiciens qui se comptent sur les doigts de la main peuvent saisir. Il s’appelle La déesse des petites victoires, écrit par Yannick Grannec et paru en 2012. Nous en reparlerons plus tard. Je réfléchissais à mon incapacité à loger une histoire inventée dans un quotidien imaginaire pour faire un roman crédible. Ecrire un livre pour exposer une nouvelle vision est simple. Il suffit de laisser aller sa logique, puis de la comprimer, de l’empêcher de fuir par les trous de ses jointures, pour finalement sortir un texte qui est une démonstration. Partir d’un point A pour aller à un point B, ou C, ou P (jamais jusqu’à Z. Le fil se rompt avant). Mais combien plus difficile est de créer un monde en soi qui ressemble à s’y méprendre au monde réel. C’est aussi laborieux qu’écrire un poème sur le balai-brosse. Le monde imaginaire est, pour moi, un monde si nouveau que seul un langage différencié du quotidien peut le traduire en paysage que le lecteur saura comprendre. Voir par l’association d’images sans rapport direct avec ce que l’on décrit (c’est le cas de la poésie) est le meilleur moyen pour atteindre l’appréhension de ce monde imaginaire et merveilleux qui vous fait décoller.
En réfléchissant sans but précis, je regardais les tableaux suspendus au mur, puis l’étagère sur laquelle trônent des bocaux de toutes couleurs. Arrivant en un lieu précis, sur l’étiquette de l’un d’eux, ma pensée se bloqua. Rien, plus rien que le grand silence. Et je ne pensais même pas à ce silence subit. La tête comme une coque de noix dans laquelle même une bille de conscience ne subsiste pas.
Combien de temps dura ce trou ? Je ne sais. Brusquement, tout revint sans à-coup, comme une machine bien huilée. Je pris lentement conscience de ce moment extraordinaire, comme un cadeau du ciel : quelques miettes de pain offertes au mendiant d’absolu. Quelle réponse à mes interrogations ! Le silence absolu, preuve d’un autre monde sans changement. Une fois de plus la jonction des contraires : le silence pour exprimer ce que l’on ne peut dire, devient une clé de la compréhension du monde.
Pour provoquer ces instants magiques, Gurdjieff avait mis au point le jeu du stop. Au milieu de tâches quotidiennes, il criait STOP ! Et chacun devait s’arrêter instantanément en moins d’une seconde, dans la position dans il se trouvait. Ce pouvait être dangereux, mais il fallait dans tous les cas tenir cette position envers et contre tout. L’exercice devait aider à prendre conscience de la mécanicité de la machine humaine. Sortir de son confort par l’arrêt subit de toute action.
05:55 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : conscience, absolu, expérience, littérature, poésie |  Imprimer
Imprimer
13/09/2013
L’ultime secret, roman de Bernard Werber
Qu’est-ce qui nous pousse à agir ? Quelle est votre motivation principale dans la vie ?
Samuel Fincher, neuropsychiatre, vient de gagner sa partie d’échec contre Deep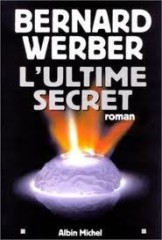 Blue IV. Il est champion du monde, devant l’ordinateur le plus puissant ; mais il meurt le soir même dans les bras de sa petite amie. Ses traits présentent tous les signes de l’extase absolue… Mort d’amour. Isidore Karzenberg, journaliste, prétend qu’il a été assassiné. Avec Lucrèce, une jeune pigiste, ils vont le prouver.
Blue IV. Il est champion du monde, devant l’ordinateur le plus puissant ; mais il meurt le soir même dans les bras de sa petite amie. Ses traits présentent tous les signes de l’extase absolue… Mort d’amour. Isidore Karzenberg, journaliste, prétend qu’il a été assassiné. Avec Lucrèce, une jeune pigiste, ils vont le prouver.
Ils font le tour de tout ce qui peut motiver un être humain : peur, sécurité, faim, plaisir. Les sept péchés capitaux y passent, même s’ils n’ont qu’un lointain rapport avec la motivation. A ceux-ci s’ajoutent le devoir, la colère, la sexualité et bien d’autres au fil de leur découverte. On vit leur aventure. Mais dans un récit parallèle, on vit le passé du docteur Fincher, sa rencontre avec un homme paralysé, Jean-Louis Martin, qui ne voit que d’un œil et n’entend que d’une oreille et qui refuse de mourir. Ils deviendront amis. Jean-Louis Martin se fait opérer par le docteur et doter d’un ordinateur qui lui permet de pensécrire : il inscrit sa pensée directement sur l’écran de l’ordinateur.
L’intrigue laisse du suspens, le thème est intéressant (un cerveau humain, aidé d’un ordinateur, accède à « l’ultime secret »), quelques réflexions de fond, scientifiques ou psychologiques, renforcent l’attractivité du livre. Celui-ci répond à la question : « Qu’est-ce qui nous motive ? La cessation de la douleur, la cessation de la peur, la satisfaction des besoins primaires de survie, la satisfaction des besoins secondaires de confort, le devoir, la colère, la sexualité, les stupéfiants, la passion personnelle, la religion, l’aventure, la promesse de l’ultime secret, l’expérience de l’ultime secret. »
Et la fin du livre ouvre à la sagesse, au rêve, voire au spirituel :
Tout à l’heure, j’ai ressenti une impression étrange, une onde pure volupté qui me transcendait. Juste après, comme le contrecoup de cette onde, j’ai été traversé d’une autre sensation. Une sensation de grande plénitude, suivie d’un vertige comme si je pouvais englober par ma pensée l’infini de l’univers. Comme si, arrivé à un nouveau point d’observation, je m’apercevais que j’avais une conscience fausse de la dimension des choses. (…) On pourrait appeler cette nouvelle motivation : l’élargissement de la conscience. Elle est peut-être plus puissante que toutes les autres motivations. C’est pour cela que nous avons réussi. C’est une notion au-delà des mots, elle est difficile à expliquer.
07:04 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, psychologie, science, cerveau, ordinateur, penser |  Imprimer
Imprimer
12/09/2013
J'ai dénoué le plomb du soleil
J’ai dénoué le plomb du soleil
Au fil des rayons qui illuminent
La terre et l’eau de ses dons
J’ai déjoué l’innommable coupable
Qui estompe en larges risées
Le théâtre des monts et des murs
J’ai rejoué la grande fantaisie
Qui s’imprime dans le temps
Sur le clavier aux touches d’ivoire
J’ai enfin renfloué mon amertume
De n’être qu’un petit d’homme
Face à l’immensité du rien
Tu n’as rien d’un surdoué...
Alors laisse-toi écrouer !
06:59 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, littérature |  Imprimer
Imprimer
08/09/2013
Dessalement matinal
La vie : chaque jour, prendre ses jambes à son cou
Et faire le tour de la terre en esprit…
Vingt-quatre heures et une révolution…
Quand la nuit vous enveloppe
Et vous fait plonger dans la piscine
Du petit matin au glacis rafraichissant
Vous sortez en entrebâillant la porte
Vous sucez le glaçon de votre haleine
Et commencez les premières foulées…
Vous flottez dans la purée de pois
Cherchant vainement un appui
Sur un sol cotonneux et fugace
Vos jambes n’ont plus la régularité
Du métronome tic-tac
Vous comptez tique et tâ-que
Vous vous efforcez d’avancer dans cette lourdeur
De l’air que la nuit enveloppe
D’un voile blanc et transparent…
Peu à peu, se dégagent les miasmes
Qui encombrent vos articulations
Les fourmis fuient cette course effrénée
Et relâchent leur pression diurne…
Vous commencez à vous élever…
Le rythme de la danse villageoise
Devient ballet d’audace vertueux...
Les nuages vous accompagnent
Enserrent vos pensées balbutiantes
Vous évacuez rêves et craintes
Et vous sentez plus léger, serein…
Vous voici à votre juste poids
Celui de la liberté retrouvée
Par la cadence allongée des foulées
Et l’absence de résonance du corps...
Quelques minutes de plus
Et vous montez au-dessus des bois
Pour flottez sur vos obsessions
Et les maîtriser pour la journée…
Vous contemplez du haut de la colline
La pâleur rougeoyante d’un demi-soleil
Serait-ce cela… le paradis ?
07:50 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer
Imprimer
04/09/2013
Suite II pour violoncelle, en ré mineur (BWV 1008)
https://www.youtube.com/watch?v=3WxnXerG4cM
Rêverie…
Qui te prend et t’étire
Quelle gymnastique elle te fait faire
La tête en bas tu es, les oreilles pendantes
Mais quel charme ces extensions !
Tu montes et descends, d’un souffle inspiré
C’est un bocal de sons, résonant et ronronnant
Et parfois un cri d’amour poignant
Coupant comme un sabre effilé
Dans le noir du corps inversé
S’élève la grande plainte des hommes
Corde vibrante des dents acérées
Comment ne pas laisser son cœur
Derrière la page écrite et jouée
Pliée elle se tient attentive
Ensorcelante, adoucie, mâchée
Elle écorche le palais, mais quel goût
En saliver de bonheur
Et pleurer à l’idée de ces caresses
Qui chatouillent l’oreille
Et la rendent câline
Tout n’est que vibration
Qui met en marche la vie
Pour un court instant
Et qui te dépossède
Des rondeurs de l’habitude
La corde du temps
T’étire dans l’espace
Tu es le Tout,
Grain énigmatique
Des poussières de l’illusion
07:45 Publié dans 42. Créations poèmes, 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, musique, littérature, bach |  Imprimer
Imprimer
31/08/2013
Loup, où es-tu ?
Loup, y es-tu ?
Mais où donc suis-je ?
Ou cours-je sans jambes ni cervelle ?
Un petit pois seul me maintient
Dans la droite ligne des farceurs…
Meurs donc saltimbanque
Que tes os déchus
Fatigués de tant de nuits inutiles
Brulent sans vergogne dans l’âtre
Loup, où vas-tu ?
Au pays des rêves sans pied
Qui tiennent debout par volonté
Comme la chèvre à son piquet
Ils me conduisent mollement
Dans le substrat fumeux des tavernes
Et m’enferment dans ma solitude
Loup, entends-tu ?
Oui, les cris des oiseaux
La haine des volontaires
Qui applaudissent en chœur
A la déchéance humaine
Tels des poules caquetantes
Sans daigner jeter un œil
Aux beautés hors nature
Loup, meurs-tu ?
Toujours vivant
J’émerge de ma coquille
Et m’épanche sans difficulté
Vers les cimes vertueuses
De la création
Je m’empare du balai
Et chevauche mes rêves
Sans parvenir à dissocier
Ce qui est de terre
De ce qui est du drapé
D’une imagination défaillante
Loup, vis-tu ?
La vie comme la mort nous prend tout entier
Tiens-nous fermes dans notre délire de vivre
Et fais peser sur nous ton regard impitoyable
La pensée ne finit pas et poursuit sa ronde
Au-delà de la corporalité grasse des repus
C’est bon… J’arrive… J’arrive…
03:53 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer
Imprimer
28/08/2013
La quatrième main, roman de John Irving
Elle n’existe pas cette quatrième main, mais elle ressent ce qu’elle devrait toucher au point que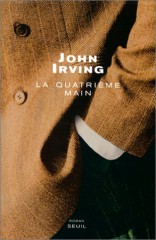 l’ombre du désir devient réel.
l’ombre du désir devient réel.
La troisième main fut perdue sans que le chirurgien sache pourquoi. Devenue bleue, elle fut jetée.
La deuxième main fut mangée par un lion au cours d’une interview dans un cirque indien.
Dieu soit loué, le micro était dans l’autre main, celle qui sert à tout dorénavant.
Mais les mains des femmes préfèrent caresser la main manquante comme en hommage au martyre vécu par le journaliste Patrick Wallingford, dit Pat, l’ami des dames. Elles veulent un enfant de lui. Pourquoi ? Allez savoir.
La main d’Otto était grosse, celle de sa femme, Mrs Clausen, Doris de son prénom, caresse sans vergogne le corps de Pat et finit pas le séduire. Il se fait renvoyer, difficilement, et va désormais commencer la vraie vie :
Lorsque Wallingford, nu lui aussi, sortit de la salle de bain, Mrs Clausen avait déjà éteint la télévision et elle l’attendait dans le grand lit. Il éteignit la lampe et se glissa auprès d’elle. Dans les bras l’un de l’autre, ils écoutèrent le vent : il soufflait fort, en rafales, mais ils cessèrent bientôt de l’entendre ?
– Donne-moi ta main, dit Doris.
Il savait de laquelle elle parlait.
Il prit d’abord sa nuque au creux de son bras ; de sa main droite, il s’accrocha à l’un de ses seins. Elle se mit à serrer son moignon entre ses cuisses, où il sentit les doigts perdus de sa quatrième main la caresser.
S’il faisait bon dans leur hôtel, au dehors, la bise annonçait l’hiver qui arrivait ; mais ils n’entendaient plus que leur souffle rauque – oublieux comme tous les amants du vent qui tourbillonnait, et soufflait sans fin dans la nuit âpre et indifférente du Wisconsin.
Ainsi se termine ce roman fou qui, comme le précédent, laisse un goût curieux dans une bouche anesthésiée. On ne sait si on aime ou s’il faut le jeter avant la fin. On saute de nombreux passages, on les relit quelques pages plus tard, mais sans que cela apporte quelque chose. Quand on ferme le livre, on se sent soulagé. Et pourtant, peu de temps après, on le rouvre pour y chercher ce qu’on n’a pas trouvé : le goût amer des sentiments cachés.
07:58 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, etats-unis, journalisme |  Imprimer
Imprimer
23/08/2013
Le flûtiste invisible, roman de Philippe Labro
Un roman qui n’en est pas un, puisqu’il est constitué de trois nouvelles, et qui mentionne en liminaire : « Tout est déterminé par des forces sur lesquelles nous n’exerçons aucun contrôle. Ceci vaut pour l’insecte autant que pour l’étoile. Les êtres humains, les légumes, la poussière cosmique – nous dansons tous au son d’une musique mystérieuse jouée à distance par un flûtiste invisible (Albert Einstein) ». Et l’auteur ajoute : Comme Schindler, je crois qu’il n’y a qu’une seule chose dont nous devrions être certains : la sensation qu’autour de nous, avant ou après, en dedans ou en dehors, il y a un élément inconnu sur lequel n’avons aucune prise, aucun contrôle, mais dont nous pouvons imaginer qu’il en exerce un sur nous. C’est l’élément inconnu qui m’intéresse.
Les êtres humains, les légumes, la poussière cosmique – nous dansons tous au son d’une musique mystérieuse jouée à distance par un flûtiste invisible (Albert Einstein) ». Et l’auteur ajoute : Comme Schindler, je crois qu’il n’y a qu’une seule chose dont nous devrions être certains : la sensation qu’autour de nous, avant ou après, en dedans ou en dehors, il y a un élément inconnu sur lequel n’avons aucune prise, aucun contrôle, mais dont nous pouvons imaginer qu’il en exerce un sur nous. C’est l’élément inconnu qui m’intéresse.
Seule la première nouvelle m’a paru digne d’intérêt. Pourquoi ? Elle semblait vécue, alors que les deux suivantes m’ont paru plus compassées. Elle se dénomme « Bye bye Blacbkbird ». Blackbird est une jeune américaine qui voyage sur un transatlantique et que rencontre un jeune garçon qui se rend aux Etats-Unis pour étudier. Ce n’est d’ailleurs pas vraiment une rencontre, mais le fruit d’un pari fait avec ses camarades : Qui serait assez culotté pour aller faire un compliment à cette jeune femme si belle, là-bas, à la table de gauche ? Ses cheveux étaient d’un jaune éclatant, comme des fleurs de tournesol, un jaune qui aurait pu virer à l’orange. Elle lui donne rendez-vous le soir même, mais n’y vient pas. Le troisième soir, elle ouvre en pyjama sa porte. Ils parlent. Elle lui demande : « qu’attendez-vous de moi, au juste ? ». Devant son absence de mobile, elle éclate de rire : « Seriez-vous trop bien élevé ? Vous ne voyez pas qu’il se voit votre désir ? Vous croyez qu’un homme peut dissimuler son envie d’une femme ? Vous avez faim d’amour, c’est cela, pourquoi ne pas le dire ? » Elle avait une capacité unique et déconcertante à passer de l’ironie à la langueur, de l’intime à la distance. Elle met le disque de la chanson Bye bye Blackbird et lui dit à la fin : « On ne choisit rien. Et rien n’est impossible, sauf de refuser la mort. Et tout est possible, mais rien n’est important. Tout est fatal. » Lorsqu’il va partir, elle lui demande de l’embrasser. Je pouvais sentir son corps sous la soie, touchant le mien sans bouger : « Eh bien, dites-moi, quelle vigueur dans le pantalon ! Mais dans quel émoi êtes-vous tombé ? ».
Il en devient fou, ne pensant qu’à elle, la cherchant partout et elle, se dérobant, l’évitant jusqu’à l’arrivée à New-York. Là, contrairement à toute attente, elle se donne à lui subrepticement. Puis, immédiatement après : « Rhabillez-vous. Allez, vous avez eu ce que vous vouliez ». Je l’ai regardé. Elle avait une expression voilée, hantée, une cernure mauve avait creusé sa peau sous chacune de ses paupières. On ne pouvait lire aucune satisfaction nu aucun plaisir sur ce visage auquel, en vérité, je ne comprenais rien. Quelque chose de mortel est passée dans ses yeux.
En épilogue, l’auteur philosophe : « Tout est mouvement, écrit Balzac, la pensée est mouvement. La nature est établie sur le mouvement. Balzac continue et se dévoile enfin. Il ose, enfin !, (sic) écrire les quatre lettres DIEU : « Dieu est le mouvement, peut-être. Voilà pourquoi le mouvement est inexplicable comme lui et, comme lui, profond, sans bornes, incompréhensible, tangible. »
07:58 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, livre, écriture |  Imprimer
Imprimer
22/08/2013
Le chien
C’était bien un chien…
Une grosse boule de poils
Mal léchée et sale…
Il marchait en vieillard
Une patte après l’autre,
Tirant sa carcasse
Et s’arrêtant pour souffler…
Les enfants en avaient peur…
Il s’approchait doucement
Sans bruit, sans un coup de queue
De sa langue râpeuse
Il caressait patiemment la main
Celle qui traînait ici ou là
Et l’enfant poussait un cri
Lui, il ne bougeait pas
Il le regardait de ses yeux doux
Ne comprenant pas sa réaction
Il se couchait à ses pieds
Mais l’enfant changeait de chaise
Se réfugiait dans les bras de sa mère
En disant « Je n’aime pas les chiens »
Et lui ne disait rien
Il fermait les yeux et rêvait
Du temps où il courrait avec les enfants…
Aujourd’hui seuls les souvenirs
Lui font remuer la queue
D’un contentement timide…
07:43 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer
Imprimer
20/08/2013
Le monde selon Garp, roman de John Irving
Le livre était lourd et volumineux (650 pages d’une écriture serrée), ce qui n’est pas encourageant pour en commencer la lecture. De plus, la quatrième de couverture était peu engageante, contrairement à ce qu’a voulu l’éditeur. Elle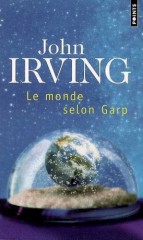 évoquait le féminisme, la violence des hommes, la peur des femmes, cette opposition des sexes qui fit pendant un temps les premières pages des médias d’outre-manche. Bref, les clichés d’une Amérique éternelle peuplée de machos texans. Et je continuais à le penser au bout d’une cinquantaine de pages, malgré quelques bons mots : Jenny avait l’impression que ses études n’étaient rien d’autre qu’une façon polie de gagner du temps, comme si elle avait été une vache mise en condition pour recevoir la canule de l’insémination artificielle.
évoquait le féminisme, la violence des hommes, la peur des femmes, cette opposition des sexes qui fit pendant un temps les premières pages des médias d’outre-manche. Bref, les clichés d’une Amérique éternelle peuplée de machos texans. Et je continuais à le penser au bout d’une cinquantaine de pages, malgré quelques bons mots : Jenny avait l’impression que ses études n’étaient rien d’autre qu’une façon polie de gagner du temps, comme si elle avait été une vache mise en condition pour recevoir la canule de l’insémination artificielle.
Je finis par me détendre et lus avec curiosité les cinquante pages suivantes. Enfin, je fus pris par le récit, non pas à la manière d’un triller à l’intrigue palpitante, mais en raison de la personnalité du personnage principal, S.T. Garp, fils de Jenny, une jeune fille de bonne famille devenue infirmière, qui se fait faire un enfant par un malade, le Sergent Technicien Garp, mitrailleur de queue d’un avion atteint par les balles au cours de la seconde guerre mondiale. Huit jours plus tard, je fermais le livre en me se disant que j’aurais bien poursuivi la lecture de cette saga délirante, bien qu’apparemment anodine : Garp luttant contre la concupiscence des hommes, rejetant la violence de l’environnement quotidien et assurant la protection des enfants. Tel est le sujet du livre, les peurs d’un père dans un monde fou, mais habituel. Et souvent je me suis dit : ces descriptions sont trop longues, ces sentiments sont trop étalés, je les saute. Mais je revenais par la suite sur ces métaphores pour ne rien perdre de l’ensemble.
Le livre est ambigu. Cela tient au mélange entre le récit parfois trop lent et la rapidité des événements clés qui ne sont qu’évoqués, puis repris de manière indirecte. Ainsi l’accident entre l’auto de Garp et celle de l’amant de sa femme, dont les dégâts sur la famille ont été considérables, n’est abordé qu’à travers ses conséquences. Pierre-Yves Petillon, qui présente le livre dans sa version française, nous dit : « On les compte sur les doigts d’une main, finalement, les livres où l’on rit à voix haute, où l’on s’esclaffe comme autrefois, lorsqu’on avait dix ans et qu’on allait voir un Laurel et Hardy dans un petit cinoche de quartier. » Je pense plutôt à une espèce de nostalgie difficilement interprétable que donne le roman, comme un arrière-goût d’entente entre l’auteur et le lecteur, mais qu’on n’ose pas avouer, n’y même reconnaître. On est gêné, mais heureux de l’être. On y prend plaisir sans savoir pourquoi. C’est ce qui fait la qualité du récit : inattendu, tant dans les événements que dans les émotions de Garp. Il en reste un sentiment curieux qui vous contraint à achever le livre sans comprendre son intérêt.
Quelques descriptions font rire : « Aaa, fit Garp (le père), comme Jenny l’attirait en elle et s’accroupissait en pesant de tout son poids. – Garp ? demanda-t-elle. ça va ? Est-ce que c’est bon, Garp ? – Bon, approuva-t-il, très distinctement. (…) A mesure qu’il se recroquevillait et que sa semence suintait sous Jenny, il se retrouva une fois de plus réduit aux « Aaa » ; il ferma les yeux et pleura. Quand Jenny lui offrit le sein, il n’avait pas faim. (…) Elle se sentait plus féconde qu’une glèbe bien préparée – la terre nourricière – et elle avait senti Garp lâcher en elle un jet aussi généreux que celui d’un tuyau d’arrosage en été (à croire qu’il voulait inonder une pelouse).
D’autres épisodes sont quasi sordides : Le mouvement des Hellen-Jamesiennes appartient à un monde inconnu dans lequel des jeunes femmes se font couper la langue pour lutter contre la violence faite aux femmes en souvenir d’Hellen James, violée à l’âge de douze ans.
Il est impossible de raconter en quelques phrases le livre, trop long, trop imaginatif et, apparemment, banal. Il s’achève sur les enfants de Garp : « Dans le monde selon son père, comme le savait Jenny Garp (sa fille), il faut avoir de l’énergie. Sa célèbre grand-mère, Jenny Fields, nous voyait naguère comme appartenant à diverses catégories, les Externes (les hommes qui avaient été brûlés), les Organes vitaux (les hommes blessés qui souffraient en dedans), les Absents (des hommes qui avaient cessé d’être là) et les Foutus (absents souffrant de maux propres aux externes ou aux organes vitaux). Mais dans le monde selon Garp, nous sommes tous des incurables (de la concupiscence).
07:42 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, amérique, violence, féminisme |  Imprimer
Imprimer
18/08/2013
Absurde, j'ai retrouvé le goût salé
Absurde, j’ai retrouvé le goût salé
Des embruns pleurés aux grottes de l’océan
La pluie
Comme la bise sur l’arbre
Égraine de gouttes
La rêverie de l’œil sur le toit
Le carillon des larmes de la gouttière
Enchante ma cathédrale de zinc
Au regard de l’arbre qui, de ses bras tendus
Protège son corps d’écailles
Grisâtre, l’épiderme nuageux
Caresse les cheminées luisantes
06:55 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, littérature |  Imprimer
Imprimer
16/08/2013
Des cornichons au chocolat, roman de Philippe Labro
Livre culte, nous dit la quatrième de couverture : Toute une génération s’est reconnue dans le journal de cette adolescente de treize ans, sa solitude, sa révolte, son regard dérangeant sur les adultes, l’école, le travail et son goût indiscutable pour les sandwichs aux cornichons et au chocolat.
La préoccupation principale de Stéphanie : attendre ses règles qui ne viennent pas alors que les autres filles les ont eu : « Pour bien énerver Stéphanie, on va toutes se mettre en jupe ou en kilt pour bien lui montrer qu’on est des femmes et qu’on a nos règles et que c’est beaucoup mieux de porter des jupes quand on a des règles parce que quand même on est moins serrées, ça fait moins mal, on est sûr de ne pas tacher ses jeans, ça va drôlement humilier Stéphanie. »
Stéphanie découvre la musique classique avec Nicole, sa prof de musique. Elle avait dit : Ne vous préoccupez pas de tout ça, ce que la musique évoque n’a rien à voir avec le sens qu’un professeur ou un critique ou un parent peuvent lui donner. Et Stéphanie écrit dans son cahier : Les gens qui ont ce don-là, c’est comme Mutti (le chef d’orchestre) et Beethoven, ils peuvent se donner du bonheur quand ils veulent, à n’importe quel moment de la journée. C’est des privilégiés, voilà.
A la fin du livre, elle les a : Elle a réfléchi que ça y était donc maintenant, et que toute sa vie, trois ou quatre ou cinq ou six jours par mois, Elle serait obligée d’avoir cette gêne en Elle et avec Elle, et Elle s’est demandée pourquoi Elle avait tellement mais tellement désiré que ça lui arrive. Du coup, elle arrête son cahier. Fin !
Certes, certains mots, réflexions, idées sont drôles, sensibles, presque beaux. Mais sans doute ne suis-je plus attentif aux passions de l’adolescence et à ses questionnements. Ou peut-être les adolescents d’aujourd’hui ont d’autres préoccupations. Ou encore Stéphanie passe trop de temps aux toilettes, ce qui manque de charme.
Mais malgré tout ce n’est pas non plus un mauvais livre. Je ne suis tout simplement pas entré en osmose avec lui.
07:55 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, adolescence, roman, littérature |  Imprimer
Imprimer
14/08/2013
La chaleur
La chaleur écrase de sa pesanteur
La paupière alourdie de nos corps
Le vent même dévore d’un souffle chaud
La poitrine blanche des hommes
Les lèvres collées de sécheresse
Le pied lourd de mille soucis
Ils attendent, impassibles
La relève qui ne veut pas venir
Collés à la terre desséchée
Ils grignotent à pleine dents
L’ombre imprimé sur le sol
Par le soleil ardent de leurs espoirs
Et rien ne vient. Rien.
Le matin, peut-être, la quiétude
Gagne les corps endormis de rêves
L’eau bienfaisante réveille
Les espoirs de la veille et du lendemain
L’eau maintenant, la boue
Les pleurs de chaque motte de terre
Engourdissent d’impuissance raideur
L’extrémité des membres terreux
Et nous nous retranchons en boule
Dans la moiteur de nos corps
07:44 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer
Imprimer
10/08/2013
Je ne suis plus qu'un morceau d'être
Je ne suis plus qu’un morceau d’être
Qui vit encore, pour vivre,
Ne connaissant pas les frontières de la mort.
Un morceau d’être encore vivant.
Loin de toi, je ne suis rien.
Je me regarde, je m’interroge,
Nu, dévêtu de ta chaleur,
Pauvre, démuni de toute richesse.
Mon âme devenue désert
Guette dans l’ombre ta présence.
J’erre dans la nuit des jours,
Attendant patiemment ton retour.
07:32 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, littérature |  Imprimer
Imprimer
04/08/2013
L’âme s’expose
Quand l’âme ouvre sa fenêtre au monde
Et montre au vent sa blancheur lessivée
Les yeux des hommes se révulsent
Les oiseaux eux-mêmes cessent de planer
Pour s’emprisonner dans l’espace
Une goutte d’éternité ravive l’œil
Et lui donne un regard vierge
Penchée au-dessus de l’allège
Elle s’édifie de sa contemplation
Et respire l’air pur de la bonté
Sa blessure volontaire, divine
Lui rend sa légèreté d’antan
Lorsqu’à peine née, elle offrait
La transparence de sa vision
Aux parents accaparés de soins
Cette ouverture, l’âme au chaud
Les mains froides tendues au dehors
Fait du postulant un capitaine
De bateau ivre dans la tempête
La vie enserre l’histoire, même si
Les oiseaux entrent dans la pièce
Et se repaissent d’or et de myrte
Ils s’envolent lourds de trésors
Pour poursuivre leur chasse
D’autres huis ouverts sur le monde
Jusqu’au jour où, d'une bouche âpre
Un dernier souffle, rare
Exhale un rire rauque
Dans l’air empesé du matin
Et se tait… définitivement
La fenêtre sur le monde se ferme
Le dehors n’ouvre plus sur le dedans
Le dedans ne donne plus son trésor
Au regard des hommes seuls
Dieu est bien là, derrière la vitre
Ronronnant près de l’âtre
Attendant la fin des jours
07:17 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer
Imprimer
03/08/2013
Un début à Paris, récit de Philippe Labro
On aime ce livre parce qu’il nous livre les impressions, déboires, passions, bévues, sentiments d’un jeune homme des années 60 qui commence son apprentissage dans la vie de journaliste. Celle-ci débute comme assistant de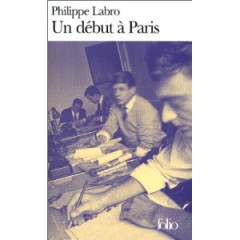 relations publiques d’une compagnie maritime américaine, ce qui consiste à publier un court portrait de personnalités arrivant en France.
relations publiques d’une compagnie maritime américaine, ce qui consiste à publier un court portrait de personnalités arrivant en France.
– C’est de toi, çà ? C’est pas mal. Si tu as une idée, quelque chose d’un peu plus étoffé, amène-le-moi. Je suis toujours preneur d’un bon portrait.
C’est bien sûr sa jeunesse que raconte l’auteur. Est-ce arrangé, probablement un peu, mais pas trop. On est vite pris par le récit. Ce n’est pas une histoire au vrai sens du terme, mais plutôt une série de portraits successifs dont chacun est un petit chef d’œuvre. Et cela commence dès le chapitre 2 avec l’interview de Blaise Cendras, haut en couleurs et empli de conseils de l’interviewé : – Soyez optimiste. Faites vite. Restez près de la vie.
Philippe Labro s’explique dans le prologue sur cette période : – Il n’y a pas de chiffre étalon pour mesurer la durée d’un apprentissage. Deux ans, dix ans, vingt ans ? A partir de quand peut-on affirmer que l’apprentissage est terminé, que l’on domine son métier ? Les sages vous répondent que cela n’a pas de fin et vous les écoutez en souriant devant une telle platitude.
Il y a la rencontre avec Wence, journaliste, puis écrivain : Il était élancé, mince, avec de longues jambes sur un corps souple. Il avait un petit nez court et pointu, une bouche délicate aux lèvres fines, des lèvres troublantes pour un homme, presque trop sensuelles. D’une description physique du personnage, il passe imperceptiblement à un portrait moral : – Il était le seul à posséder cette sorte de lunettes. C’eût été un détail si cette monture et ces verres n’avaient pas fait ressortir l’éclat singulier des yeux de Wenceslas, son regard enjôleur et presque câlin lorsqu’il décochait son interrogation favorite, empruntée, selon lui, à Mozart : – M’aimez-vous ? M’aimez-vous vraiment ? La question revenait comme une antienne, une véritable litanie. C’était la phrase clé de Wence. Ce portrait se poursuit sur plusieurs pages, entrecoupées d’anecdotes plus ou moins longues, de diversions sur d’autres personnages tout aussi hauts en couleurs.
La baronne avait les seins nus sous sa blouse. Cela m’épatait, j’en restais ahuri quelques instants ; ce qui m’étonnait le plus, c’est que j’étais le seul à avoir repéré ce charmant, cet affolant, cet extraordinaire détail. C’est ainsi qu’il fait la connaissance avec Béatrice de Sorges, la trentaine. Il en tombe amoureux comme on peut l’être à cet âge : Béatrice de Sorges suscitait chez moi une brusque poussée de désir physique, alliée à l’intuition d’un danger. Mais ce danger ne me faisait nullement peur. (…) – Madame, la mouche dont vous parlez n’est pas une mouche. C’est le plus beau des papillons. C’est vous ! C’est vous qui me mettez dans cet état-là.
Il fait connaissance avec une très jeune fille, extraordinaire, dont la beauté constitue une insulte faite aux femmes autour d’elle. Lumière de Moralès, une sorte de voyante, d’une sagesse bien au-dessus de son âge, au comportement étonnant. Et puis, que voulez-vous, je vais vous dire, je suis un peu devin. Je devine les choses. Je vous regarde, je vois votre façon de conduire. (…) Vous voulez tout, mais vous ne savez pas ce que vous voulez, ni dans quel ordre. Elle lui vole un baiser. Ils s’écrivent, échangent leurs pensées. Elle disparaîtra de sa vie, mais il la reverra plus tard, plus vieille, plus mûre encore.
Festival d’étincelles, de personnages mythiques tel ce petit homme, patron de presse, lors d’un déjeuner au Berkeley, de rencontres insolites, telle cette vieille dame, mère d’un meurtrier, qu’il serre dans ces bras avant de la quitter. Un livre que l’on quitte avec regret, non pour le récit, mais pour le charme des descriptions, l’acidité des peintures, l’envoûtement du détail, l’humilité du narrateur. Un livre à relire dans le désordre, au fil des personnages, en comparant l’art et la manière d’en faire l’effigie.
07:30 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, récit, journalisme, portrait |  Imprimer
Imprimer
31/07/2013
Le regard du poète
Dans la certitude des jours, passe le regard
Assuré, empli de lui-même, qui contemple
Le vaste monde en conquérant démesuré
Incapable de voir au-delà de sa sphère trouble
Pourtant un battement d’ailes, un baiser
Une épine dans la peau, un chat renifleur
Une lune empesée, le cri d’une mouette
Créent le retournement recherché, attendu
Il a chaussé les lunettes de poète
Le regard se parebrise sous le vent
Qui s’engouffre le long de la colonne vertébrale
Et descend jusqu’au ventre chaud
Là où le lait devient étoile ou chemin
Et se perd dans la solitude de l’espace
Le poète au regard clair ne voit plus
Il s’ouvre et sort ses ailes de papillon
Il s’envole dans un ciel pur et transparent
Pour rebondir sur le souffle délétère
Qu’il est seul à domestiquer
Il tangente à la circonférence de l’impossible
Aux aguets, à l’écoute, à la fragrance, à la caresse,
Du peuple invisible des mots qui s’enchaînent
Sans se connaître, en grappes volages
Et c’est ce vide sidéral qui libère les toxines
Et fait monter au cerveau ces explosions
Qui créent le mythe du poète inspiré
Un voyage dans un ciel immaculé
Grand corps nu à l’enveloppe diaphane
Qui ne résiste pas à la douche enfiévrée
Des zigzags chaotiques de la sensation
Monte sur le vaisseau incontrôlable
Et crie de toutes tes forces
Train 10819 pour l’évasion, départ 03h23
Les voyageurs montent sans bagage
Nus devant l’éclair de lucidité,
Qui transperce leur regard
Et leur donne l’amour de l’univers
07:31 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer
Imprimer
29/07/2013
Aux fruits de la passion, roman de Daniel Pennac
Une famille de fous et des amis encore plus fêlés ! Yasmina, Clément Clément, Loussa de Casamance, Théo, Clara, Gervaise, etc… La tribu Malaussène est complexe, embrouillée, vivante, prodigue, un sac de nœuds plutôt que de vipères, envoûtante, drôle aussi. Le charme de l’indémêlable. Thérèse est amoureuse et rien ne l’empêchera d’aimer, ce que le vieil Amar traduit par : « Inch Allah, mon fils, ce femme veut, Dieu le veut. Yasmina m’a voulu parce que Dieu a voulu que je veille Yasmina. Tu comprends ? Il faut avoir l’esprit aussi large que le cœur de Dieu. »
vipères, envoûtante, drôle aussi. Le charme de l’indémêlable. Thérèse est amoureuse et rien ne l’empêchera d’aimer, ce que le vieil Amar traduit par : « Inch Allah, mon fils, ce femme veut, Dieu le veut. Yasmina m’a voulu parce que Dieu a voulu que je veille Yasmina. Tu comprends ? Il faut avoir l’esprit aussi large que le cœur de Dieu. »
Et qui Thérèse aime-t-elle ? Un conseiller à la Cour des comptes, au costume trois pièces, dit Marie-Colbert de Roberval, plus exactement Conseiller référendaire de première classe. Marie-Colbert était un type si grand, si droit et si bien élevé que le pan de son veston rebiquerait toujours au-dessus de ses fesses rebondies. Glabre, bien en chair, d’une pâleur idéale, il posait sur le monde un regard qui voulait se porter loin. Sa poigne était ferme et je l’imaginais volontiers mélomane, ce genre à jouer du Bach à heure fixe, avec une obstination de métronome.
Malgré toutes les tentatives de la famille Malaussène, Thérèse, la cartomancienne, finit par épouser Marie-Colbert. Le lendemain matin, elle réveille Benjamin, son frère : « Je peux avoir mon lit ? » et : « On parlera plus tard. » La suite rocambolesque est laissée à votre lecture. Jusqu’à la dernière page rebondissements, incompréhensions, rêves et bébé à l’appui : les fruits de la passion s’enrichissent.
Oui, c’est un drôle de livre et un livre drôle, plein d’humour déjanté, de surprises offensées, de méli-mélo entre une vieille France devenue mafieuse et Belleville devenue prude.
06:33 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, littérature, société |  Imprimer
Imprimer
27/07/2013
Le portrait
Faire un portrait… Non point en image…
Mais en quelques mots bien affilés
Décrire au-delà des apparences
Les foncières qualités et insuffisances d’un être
Lui montrer que l’on a pensé à lui...
Seul dans la nuit de la foule atone
Faire jaillir une étincelle vivante
De ces lignes malhabiles, mais véridiques
Pour qu’il se reconnaisse et les autres aussi...
Oui, c’est un métier au pinceau acerbe
C’est un don au bout de la langue
Qui expose la pensée en musique des lettres
Et imprime dans l’air du temps
Cet instant imprévisible où apparut
Derrière l’être de chair l’ombre divine
Qui fait que les mots sortent, un à un
Sans peine ni repos, espacés parfois
Mais toujours incisifs, appropriés
Hauts en couleurs, sonorité brillante
Comme un arrière-goût d’inventaire...
Nez, bouche, oreilles, quel mélange
Chaque morceau d’être à sa particularité
Sa couleur unique, sa musique spécifique
Et tous se rassemblent en une danse
Qui en fait un tableau vivant
Vibrant de sentences alertes
Oui, un portrait est plus qu’une image
C’est un monde en soi, insolite
Sortant du cerveau bouillonnant
D’un observateur impartial
06:36 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer
Imprimer











