25/06/2012
La mort est un nouveau soleil, d’Elisabeth Kübler-Ross, Edition du Rocher, 1988 (suite et fin)
La troisième partie du livre est assez complète et se suffit à elle- même. Voici ce qu’en dit Elisabeth Ross : « Chaque jour des hommes meurent partout. Et néanmoins dans notre société qui a réussi à envoyer un homme sur la lune et à le faire revenir sain et sauf, aucun effort n’est entrepris pour étudier la mort et arriver à une définition actualisée et universelle de la mort humaine. N’est-ce pas étrange ? »
même. Voici ce qu’en dit Elisabeth Ross : « Chaque jour des hommes meurent partout. Et néanmoins dans notre société qui a réussi à envoyer un homme sur la lune et à le faire revenir sain et sauf, aucun effort n’est entrepris pour étudier la mort et arriver à une définition actualisée et universelle de la mort humaine. N’est-ce pas étrange ? »
Alors elle nous raconte comment dans son équipe médicale, les expériences au seuil de la mort se multiplient. Elle constate même qu’au cours des dix dernières années on a rapporté dans le monde entier plus de vingt-cinq mille cas. Qu’on-t-il vécu ?
Au moment de la mort, nous vivons tous la séparation du vrai moi immortel de sa maison temporelle, c’est-à-dire du corps physique. On se voit mort physiquement et on se sait entité intégrale malgré tout. (…) On perçoit la présence de nos guides spirituels, généralement un être mort que nous avons particulièrement aimé. (…) On passa alors par une transition symbolique qui est le plus souvent décrite comme une sorte de tunnel et on approche d’une source lumineuse dans laquelle nous réalisons ce que nous aurions pu être, la vie que nous aurions pu mener. (…) Nous devons juger nos pensées, nos paroles et nos actes.
Elisabeth Ross fait alors part de sa propre expérience. Cette expérience a changé sa vie. Alors ne jouons pas les sceptiques à priori. Interrogeons-nous sur ces expériences qui furent suffisamment nombreuses pour qu’elles disposent d’une certaine légitimité. Nous ne trouverons pas la réponse tout de suite, mais cette méditation ne sera pas inutile.
C’est un beau défi, ne trouvez-vous pas ?
07:27 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, spiritualité, société, livre |  Imprimer
Imprimer
22/06/2012
Labyrinthe
Quel dédale de pierres froides et grises !
Avance, te dis-je, ou l’on n’en verra pas le bout !
Et vous marchez, marchez sans cesse
Le nez levé, sans voir rien d’autres
Que ces murs qui tournent et passent
Toujours les mêmes, ronds à force de tourner
Pris dans les volutes de l’illusion
Partant en fumée dans votre imagination
Serais-tu perdu, homme sans horizon ?
Ces corridors, escaliers, chambres, galeries
Salons de brocart, couloirs de la mort
Ne t’ont-ils pas aguerri, élevé l’âme ?
Tu cherches sans trêve dans la solitude
Ton double dont tu perçois les ombres
Là, il est là ! Et tu cours derrière lui
Sans savoir qui tu vois réellement
Vous connaissez bien sûr le labyrinthe des mots
Celui de la chicane et de la jurisprudence
Et vous vous laissez noyer de lettres
Comme le mathématicien de chiffres
Il n’y a pas de nombres premiers
Dans les lois sans cesse faites et défaites
Il n’y a pas de nombre d’or, mais des rideaux
De papier, d’abjuration, de supplication
Et lorsqu’on les ferme, sous les applaudissements
De vieux relents d’incompréhension
Vous pilonnent de leur aigre rancœur
Les labyrinthes de la passion, de cœur ou de corps
Sont plus excitants. Vous vous heurtez
A la sensibilité d’autrui, en reflet
Et votre ombre devient mirage, multiple
Et vous courrez derrière, là aussi
Mais ce n’est qu’impression, engouement
Et vous courrez, exalté, fiévreux, ivre
De ces baisers de chair qui se laissent
Goûter derrière les orangers
Quel fruit délicieux que ceux-ci, n’est-ce pas ?
Un labyrinthe, qu’est-ce ?
Une machine à laver brassant le cerveau
Un coup à l’endroit, un tour à l’envers
Jusqu’au tournis conceptuel
Avec perte de la rose des vents
Vous marchez sur la tête
Vous courrez au plafond des visions
Et tombez raide, sans fard
Aux pieds de la bien nommée
Belle dans sa robe de taffetas
Souriant au benêt qui court
Croyant palper la vie
Alors qu’il n’embrasse que le vent
07:19 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, poésie, écriture, littérature |  Imprimer
Imprimer
18/06/2012
A cette heure où plus rien ne bouge
A cette heure où plus rien ne bouge
Quand encore la lourdeur des paupières
Et le froid des draps écartés
Vient vous frapper d’un coup
Et réveille en vous le souvenir
De la vie et de la mobilité des choses
Quand l’esprit englué,
Tourne en rond, en ratée
Et le corps recroquevillé
Se serre contre celle, amour
A qui l’on doit la vie et les pensées
Lorsqu’enfin ouvrant un œil
On ne voit que le noir sans fond
Et l’on se demande, éperdu
Où se trouve notre corps
A défaut de savoir
D’où notre esprit divague
Rupture ! Plus rien n’est comme avant
Assis au bord de l’océan
De draps et de couvertures
Je tends les bras vers l’oubli
Tente de me relever, hagard
Puis retombe, inerte
Et me rendors en toute innocence
Devant les spectres de la nuit
Et les fantômes silencieux
Puis vient le temps des rêves
Partir sur son nuage
Et laisser errer sa pensée
Sans odeur ni caresse
Pour le seul plaisir virtuel
D’un refuge chaleureux
En rond autour d’une chimère
Qui vous embrase un temps
Le temps d’un nouveau sommeil
Et, à nouveau, embarqué
Sur le navire de vos incertitudes
Vous laissez votre être
Partir à la dérive, en pluie
Inondant la chambre d’illusions
Pour, encore, le rassembler plus tard
Quelques heures… Encore
Comme le naufragé qui cogne
Sur la coque du bateau
Pour alerter les ondes
De l’absence de l’humain
Enfin, lorsque le matin vient
Que le feston amarante apparaît
Que l’oiseau malhabile crie sa douleur
Que l’enfant pleure le ventre vide
Vous émergez des brumes adoucies
D’une veille nocturne, engourdi
Le cœur encore enfermé
Dans ce brouillard fragile
De l’imprécision des gestes
Vous remettez en route
La machine à survivre
A moudre des impressions,
A concocter des sentiments,
A modeler des intentions,
A sculpter l’entendement
Merci mon Dieu,
Encore une fois
J’exerce de plein droit
La faveur d’entamer
Une nouvelle journée de bonheur
07:57 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, poème, littérature, écriture |  Imprimer
Imprimer
17/06/2012
Nos vies désaccordées, roman de Gaëlle Josse
On met du temps pour entrer dans ce roman. Il traîne en longueur au départ et ne finit pas réellement. Sophie, l’héroïne involontaire de l’histoire, ne prends pas de décision. On ne sait si elle retournera avec son pianiste ou non.
l’histoire, ne prends pas de décision. On ne sait si elle retournera avec son pianiste ou non.
L’écriture est parfois banale, mais la forme du roman implique pour chaque chapitre un final en italique qui devient une méditation, avec des réflexions intéressantes sur ce qui s’est passé. C’est à la fois impersonnel et très intérieur, à la surface de l’âme. Ces récitatifs, à la manière d’un opéra, sauvent le livre, car l’histoire en elle-même manque d’intérêt.
François Vallier, pianiste célèbre, part retrouver Sophie, celle qu’il a aimée, qu’il aime toujours et qui est internée dans un service psychiatrique. Elle ne parle pas et ne fait que peindre en noir un immense tableau blanc, puis en blanc l’immense tableau noir. Et pourtant, elle était vive, drôle, inattendue, imprévisible. Mais un jour, elle fut enceinte. Elle en fut heureuse, jusqu’au moment où elle apprit qu’elle attendait un enfant trisomique. Ils décident d’interrompre la grossesse.
Nous sommes entrés costumés dans le bloc opératoire où nous attendaient médecin, anesthésiste et infirmières. Oui, nous étions sûrs de notre décision. Un appareil relié au ventre de Sophie par deux électrodes faisait entendre le cœur de l’enfant. Un staccato léger, rapide. Sophie accoucha d’une pauvre vie que l’on déroba à notre vue derrière le champ opératoire. Le staccato ralentit. Cessa. Il y eut un silence. (…) Quelques jours plus tard, Sophie sortit dans la rue, entièrement nue, couverte de peinture rouge, en hurlant qu’on lui rende son enfant. Il fallut l’interner d’urgence.
L’histoire, les péripéties, l’après cet incident, tout cela est dit de manière intimiste, mais détachée, dans la musique des mots qui traduit la musique des notes.
Hier, pour la première fois depuis mon départ, j’ai eu envie de jouer. Pas seulement dans ma tête, ou en feuilletant une partition. Envie de jouer avec les doigts, les bras, avec le souffle qui s’applique à suivre chaque phrase. Mes doigts ont recommencé à chercher quelque chose. (…) Qu’as-tu fait de ton talent ? J’ai joué, Seigneur, j’ai joué. Je voudrais aussi pouvoir répondre que j’ai aimé, et au-delà de moi-même, lorsque la question me sera posée, le jour de la pesée des âmes.
On ne sait si Sophie est revenue à la vie, à l’amour. On ne sait ce que devient ce couple qui n’en est plus un.
C’est une femme qui a écrit ce livre et qui fait parler un homme. Cela commence difficilement. Cela finit difficilement. Entre les deux, il y a la musique et c’est sans doute pour cela que le livre et la romancière finissent par toucher le lecteur.
14:30 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, roman |  Imprimer
Imprimer
14/06/2012
Un mot, qu'est-ce ?
Un mot, qu’est-ce dans le temps ?
Chaque mot dit compte, même dans le sommeil
Chaque mot pensé, même bien caché
A son mot à dire au jugement dernier
Et pourtant un mot n’est qu’un son
Certes il possède un sens
Que chaque son ne peut s’arroger
Mais ce sens est-il toujours conforme
A ce que l’on voulait dire ?
Parfois un bon mot devient un habit
Qui permet de cacher sa déconfiture
Certes, il existe des mots vides de sens
Lorsque l’auteur n’a rien à dire
Mais veut pourtant tenir la scène
L’on peut aussi parler à demi-mot
Comme le souffle dans le vent
Des oreilles emmitouflées
Que comprendre alors ?
Au bas mot, pas grand-chose !
Les grands mots de célébrités
Ne sont pas forcément les meilleurs
Ils écrasent sans convaincre
Et laissent coi l’interlocuteur
Qui, sans mot, ne peut rien dire.
Certains l’écorchent, ce mot recherché
Et provoquent l’hilarité
Comme l’inculte qui lit mot à mot
D’autres disposent de mots de passe
Ingrédient très cher au faussaire
Qui doit acquérir des contre-mots
Le mot pour rire
Est le mot drolatique et fugace
D’un funambule sur le fil
D’un rasoir électrique
Pas un traitre-mot, dites-vous ?
Certes, ma belle, je le sais
Mais l’homme muet
Ne sait jongler avec les mots
C’est mon dernier mot !
S’exclame le mourant
Puis en un soupir
Il laisse partir le mot
Les gros mots ne sont pas les plus visibles
Ils s’étalent aux portes des oreilles
Et font rire les enfants, motivés
Par toutes sortes de mots de la fin
Quel est donc le fin mot de l’histoire
Le savez-vous, jeune homme ?
Je l’appris dans le dictionnaire
Où l’on trouve toutes espèces de mots
Même ceux qu’on ne connaît pas
Une définition est un discours
Qui dit ce que signifie un mot
Et si vous le prenez au mot
Que vous restera-t-il ?
Un mot cassé, sans orthographe
Et encore moins de sens
Pour finir, de ces divagations,
Quel est le mot d’ordre ?
Pensez-vous un mot de ce que vous dites ?
Celui qui ne pipe mot
N’a plus de mots dans la tête
Transmis par radio-Londres :
Les mots-clés sont fermés
Je répète :
Les mots-clés sont fermés
06:51 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, poème, littérature, écriture |  Imprimer
Imprimer
12/06/2012
La mort est un nouveau soleil, d’Elisabeth Kübler-Ross, Edition du Rocher, 1988
« Beaucoup de gens disent : « Le Dr. Ross a vu trop de mourants. Maintenant elle commence à devenir bizarre. » L’opinion que les gens ont de vous est leur problème et non pas le vôtre. Il est très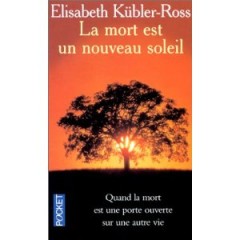 important de le savoir. Si vous avez bonne conscience et que vous faites votre travail avec amour, on vous crachera dessus, on vous rendra la vie difficile. Et dix ans plus tard, on vous donnera dix-huit titres de docteur honoris causa pour le même travail. » Ainsi commence le livre d’Elizabeth Kübler-Ross et cela me plaît : l’indépendance d’esprit est le seul moyen d’innover réellement. Et elle a réellement innové dans un milieu où les préjugés scientifiques sont aussi, sinon plus forts que dans les autres milieux. Un médecin qui sort de la science médicale, laquelle se résume à la vie physique, c’est inconcevable, même si ses recherches se font de la manière la plus scientifique possible.
important de le savoir. Si vous avez bonne conscience et que vous faites votre travail avec amour, on vous crachera dessus, on vous rendra la vie difficile. Et dix ans plus tard, on vous donnera dix-huit titres de docteur honoris causa pour le même travail. » Ainsi commence le livre d’Elizabeth Kübler-Ross et cela me plaît : l’indépendance d’esprit est le seul moyen d’innover réellement. Et elle a réellement innové dans un milieu où les préjugés scientifiques sont aussi, sinon plus forts que dans les autres milieux. Un médecin qui sort de la science médicale, laquelle se résume à la vie physique, c’est inconcevable, même si ses recherches se font de la manière la plus scientifique possible.
Le livre est composé de trois conférences qui se font suite de manière logique : vivre et mourir ; la mort n’existe pas ; la vie, la mort et la vie après la mort.
L’homme vit dans un cocon, son corps. Il utilise pour cela l’énergie physique. Mais il dispose également de l’énergie psychique, et il peut les utiliser de manière positive ou négative. L’énergie psychique s’utilise au moment de la mort, lorsque l’homme sort de son cocon avec son corps éthérique comme le fait le papillon. Lorsqu’on lui pose la question de la mort des enfants, elle explique que ceux-ci ont appris ce qu’ils avaient à apprendre et que cette vie lui suffit. La mort permet de faire la synthèse de sa vie, de voir en quoi nous avons réussi ou non ce pourquoi nous sommes venus sur terre. Et ce pourquoi est différent d’une personne à l’autre.
La mort n’existe pas, dit le Dr. Ross. Elle n’est qu’un passage. Elle le tire de ses constatations de Near Death Experience. Alors il faut prendre la vie comme un défi. Nous sommes là, sur terre, pour découvrir quelque chose de personnel qui importe pour notre être tout entier. Alors mettons-nous au travail ! Peu importe si nous sommes connus ou inconnus, si ce que l’on a à découvrir apportera quelque chose à l’humanité ou sera insignifiant. L’essentiel est de le faire avec amour, sans jamais se décourager, sans recherche de profit personnel.
07:57 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, spiritualité, société, livre |  Imprimer
Imprimer
10/06/2012
Laisse résonner en toi le monde
Laisse résonner en toi le monde
Laisse venir du fond de tes entrailles
Les bruits délicieux de l’immensité
Inquiétante du grouillement de la vie
Ecoute, les yeux fermés et les oreilles closes
Les paroles de la nuit ouverte
Qui danse comme les serpents
Sur l’antre des échos vibrant en toi
Entend ces chants silencieux et fuyants
Qui entretiennent en toi
Cette humanité rougeoyante
Et ces épanchements écarlates
Que monte vers toi les flammes
De l’inconnue extasiée
Qui crie sa douleur d’être seule
Marche sur les chemins de silex
Soulage tes pieds de misère
Et continue à avancer, toujours
Vers l’obscur point qui se trouve en toi
Et que tu cherches inlassablement
Sous la peau que tu revêts
Derrière les apparences de l’homme
Mais dans un cœur d’enfant
Et une âme divine se tient
L’aboutissement de ta destinée
Ce point ultime qui est ton but
Que tu peines à connaître
Et encore plus à décrire
Alors, oublie-toi,
Et qu’avance le vaisseau
De tes éclaircies divines !
06:41 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, poème, littérature, écriture |  Imprimer
Imprimer
07/06/2012
Cadeau
A cheval donné, on ne regarde pas la bride
Pourtant ils sont bien là, tous ceux qui
Regardent derrière le papier grenat
Enveloppant le mystère du don
Il ne fallait pas ! Susurrez-vous au donateur
Etes-vous heureux d’un tel privilège ?
Certes se fendre d’une offrande
Est mieux que demander un bakchich
Il est incontournable, dit la précieuse
Oui, il se tient au doigt, visible et précis
Comme une pomme de pin sur une branche
Ou un hanneton sur la fleur violette
Il est royal, osez-vous dire à votre bienfaiteur
Ce n’est pas un couscous, ni un festin
Ce n’est qu’un présent à l’image du cœur
Comme une bulle d’air montant dans l’eau
Il est tombé du ciel, un coup de tonnerre
Qui éclate au matin, à peine réveillé
Il vous touche le troisième œil
Et vous retourne sur le dos, tortue
Plus rien ne sera comme avant
Me voici transformé, vibrant
De surprise, d’attente satisfaite
J’embrasse la donatrice aux lèvres charnues
07:35 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, littérature, poème, écriture |  Imprimer
Imprimer
04/06/2012
Menus abîmes, poèmes d’Emily Dickinson, traduit par Antoine de Vial (2ème partie)
« Le rivage est plus sûr, mais j’aime me battre avec les flots
Un mot peut vous inonder quand il vient de la mer »

Emily Dickinson est une femme restée adolescente dans l’esprit, spirituellement toujours en mouvement. Mais ses interrogations ne se disent pas ouvertement, elles se laissent deviner au fil des vers. En cela, elle se laisse laver chaque matin par son inspiration et peut alors déclamer fortement sa vision du monde.
Les mots prolongent sa pensée, la rythment au fil du jour et s’éteignent le soir après les avoir couchés sur le papier. Et chaque jour est un émerveillement de tout, bien qu’elle n’ait jamais que vécue dans sa maison familiale. Vide de toute pensée utilitaire et personnelle, elle se laisse griser par la toute-puissance de la nature, s’enivre du soleil, du vent et des couleurs de l’univers.
N’en disons pas plus et laissons-nous porter par ce poème :
Ce fut un chemin de silence –
Il demanda si j’étais sienne –
Je répondis sans mots –
Mais du regard –
Alors – il m’emporta si haut
Avant même ce bruit mortel
De la fougue d’un Char –
Loin – comme le ferait des roues –
Notre monde avait disparu –
Comme les champs au pied
De qui se penche d’un ballon
Pour scruter une rue d’éther –
Le gouffre – derrière nous – n’était plus –
Les continents étaient nouveaux
C’était l’éternité avant –
L’éternité prévue –
Plus de saisons pour nous –
Ni nuits et ni matins –
Mais un soleil – qui en ce lieu –
S’était fixé en son aurore –
Merci, Emily, pour cette bouffée de fraicheur et votre délicate espérance.
06:20 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, amérique |  Imprimer
Imprimer
02/06/2012
Chapeau...
Plus généralement partie supérieure d’un appareil…
Chapeau bas, Monsieur, qui d’autres l’aurait fait ?
Ainsi s’esclaffe le quidam sur la pirouette des mots
Mais ce couvre-chef a d’autres vertus
Telles que le salut des grands aux petits
Ou encore l’élongation des silhouettes
Ne parlons pas de ce galimatias éclairé
Qui défie les juristes tout en les rassurant
Indéniablement, ces résumés sommaires
Interdisent le sommeil aux néophytes du droit
Pourtant il leur faut bien, un jour ou l’autre
Faire porter le chapeau à un coupable
Sous peine de ne pouvoir survivre
A de telles manipulations en prétoire
Et finir derrière la grille du confessionnal
Certains travaillent du chapeau, encombrés
De rumeurs, de chaleurs, de torpeurs
Ils se laissent guider, obscures victimes
Par les cris entendus en écho des pensées
Mais ont-ils réellement des pensées plutôt
Que des images qui les guettent le soir ?
Quel est donc cet objet que l’on met sur le crâne
Qui nous conduit à tant de détours ?
Certes il porte d’autres noms :
Coiffe du boit-sans-soif, bonnet du benêt
Panama du skipper trois-mâts,
Casquette des coquettes, turban des forbans
Bicorne des bornes, galurin de Tartarin
Ainsi, chaque jour enturbannés s’en vont les têtus
Ceux qui pour rien au monde ne sortiraient têtes nues
Ils se voilent la face d’un haut de (ou sans) forme
Et s’en vont droit devant eux en saluant
D’un coup de chapeau bien maîtrisé
Le maître du district ou le menu peuple
Pour le simple plaisir de tirer son chapeau
Et montrer ainsi son crâne dénudé et aigri
07:52 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écriture, poésie, poème, littérature |  Imprimer
Imprimer
30/05/2012
Menus abîmes, poèmes d’Emily Dickinson, traduit par Antoine de Vial (1ère partie)
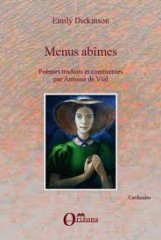 Emily Dickinson a écrit près de mille huit cent poèmes, dont seuls moins de dix furent publiés. Née en 1830, elle est morte à 55 ans.
Emily Dickinson a écrit près de mille huit cent poèmes, dont seuls moins de dix furent publiés. Née en 1830, elle est morte à 55 ans.
A sa demande son « cercueil ne fut pas conduit, mais porté à travers un champ de renoncules ». Elle ne s’éloigna d’Amherst, sa maison natale, où elle disait tant se plaire, que pour passer une année au collège de Mount Holyoke à South Hadley ou lors de rares séjours, à Washington ou à Boston. Elle n’a guère quitté le cercle de cette petite communauté puritaine de Nouvelle-Angleterre. Elle a vécu entre son père juriste et homme politique, admiré et craint, et sa mère plus effacée ; entre sa sœur Lavinia, qui ne partit jamais non plus et son frère Austin, installé dans la maison voisine avec sa femme Susan, amie de cœur de la poétesse.

On se plonge dans la poésie et l’on en sort transformé. C’est un grand bol d’air frais qui vous descend dans la gorge et vous fait voir le monde autrement. Emily vit de sa poésie, elle est poésie. Chaque instant est l’occasion d’un poème, mais sa faveur va à la nature, chantée, dite, criée, sans jamais se lasser. Et son monde de vers est bouleversant d’humanité, non de sentimentalité, de sensibilité sociale, mais de viril abord de la grandeur de la vie.
Mon cocon me serre –
Les couleurs m’agacent –
Je ressens – avec un besoin d’air –
Une obscure aptitude à voler –
Que mon habit entrave –
----
Je donne à entendre et déconcerte –
Je déchiffre jusqu’au signe –
Mais de bévues en bévues – enfin –
Je pressens l’indice du divin –
Elle utilise le tiret et non la ponctuation habituelle. Il lui permet de donner une résonance nouvelle aux mots, de les isoler de leur contexte et mettre en valeur telle ou telle idée. Il donne également l’eurythmie du poème, fait d’élans et de pauses dans la cadence pointilliste de l’anglais.
J’ai plongé et nous y replongerons bientôt. C’est tellement enchanteur !
Merci à Alice de m’avoir donné ce livre qui renferme de tels trésors de l’âme.
08:29 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, poème |  Imprimer
Imprimer
29/05/2012
Partir en sautant dans une voiture
Partir en sautant dans une voiture,
Sans savoir où l’on va
Uniquement pour le plaisir, pour
Quitter ce que l’on connaît trop et
Aller sur ce chemin désiré parce qu’inconnu !
L’excellence des détours afin d’atteindre
Le but inconnu, insoupçonné et désirable
Alors on part à l’aventure, sans savoir
On cherche l’impression, le vide, l’absence
Et chaque départ se fait sans désir de retour
Oui. Elle est partie, cheveux au vent
Enveloppée dans sa robe fuchsia
La main levée, les yeux baissés
Sans bagage, sans souvenir
Pour voir ce qu’il y a, au-delà
Elle a laissé l’odeur de sa délicatesse
Le parfum de ses remords et de ses désirs
Plus rien de tout cela ne lui appartient
Même son cahier reste en souffrance
D’une écriture hâtive et malhabile
Elle n’est plus qu’un point noir
Sur le feston de l’horizon
Un point que l’on regrette, chaud
Comme le sang du mouton
Que l’on égorge pour l’Aïd al-Adha
07:46 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écriture, poème, poésie, littérature |  Imprimer
Imprimer
26/05/2012
L’après-guerre 1945-1950, vu par Stick caricaturiste, écrit par Jeanne de Gérin-Ricard
Voici ce que dit l’auteur de S’tick caricaturiste :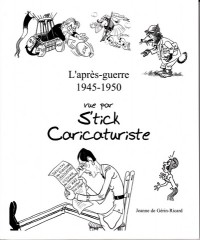
Le dictionnaire des Marseillais nous apprend que S’Tick se nommait Raoul Garcin… On peut dire qu’il était un dessinateur de grand talent. Il avait une solide connaissance de l’actualité, s’intéressant au monde dans lequel il vivait… Il avait aussi une bonne culture classique… S’Tick dessine sur des bouts de papier, à l’encre de Chine, après un dégrossi à la mine de plomb… Vivant à Marseille, il n’a probablement pas eu l’occasion d’avoir une audience méritée.
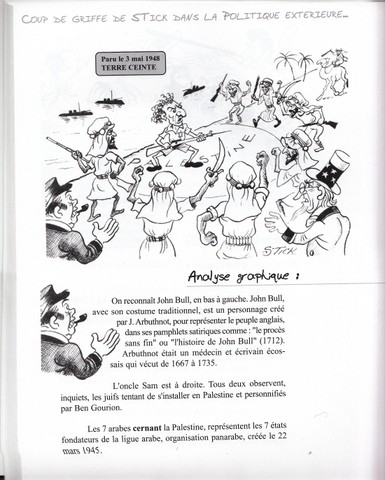
Au premier abord, le texte semble brouillon. Cela tient d’une part à la forme du livre, les titres étant en police cursive, c’est-à-dire proche de l’écriture manuscrite, et aux explications historiques qui ne sont que des résumés des événements de cette période.
Cependant, si l’on convient d’aller au-delà de cette première impression, il apparaît que le livre, alternant dessins et textes, est bien fait. Son objectif n’est pas de faire un livre d’histoire, mais de mettre en valeur les moments historiques saisis par un dessinateur de talent. Les grands personnages du moment sont caricaturés et une petite biographie accompagne l’image, donnant du relief à l’explication de l’événement. De plus, si l’on fait l’effort d’analyser de plus près l’organisation du livre, on se rend compte que chaque période de ces cinq années est découpée en un zoom sur l’histoire qui en donne les grands événements, une analyse graphique du ou des dessins de S’Tick sur le ou les évènements du moment, et enfin les biographies des personnages politiques clés. C’est, au final, une bonne approche des faits et des personnages de ces années d’après-guerre, ainsi que de l’ambiance qui régnait à cette époque : politique des prix, problèmes de ravitaillement, marché noir et scandales à répétition.
mettre en valeur les moments historiques saisis par un dessinateur de talent. Les grands personnages du moment sont caricaturés et une petite biographie accompagne l’image, donnant du relief à l’explication de l’événement. De plus, si l’on fait l’effort d’analyser de plus près l’organisation du livre, on se rend compte que chaque période de ces cinq années est découpée en un zoom sur l’histoire qui en donne les grands événements, une analyse graphique du ou des dessins de S’Tick sur le ou les évènements du moment, et enfin les biographies des personnages politiques clés. C’est, au final, une bonne approche des faits et des personnages de ces années d’après-guerre, ainsi que de l’ambiance qui régnait à cette époque : politique des prix, problèmes de ravitaillement, marché noir et scandales à répétition.
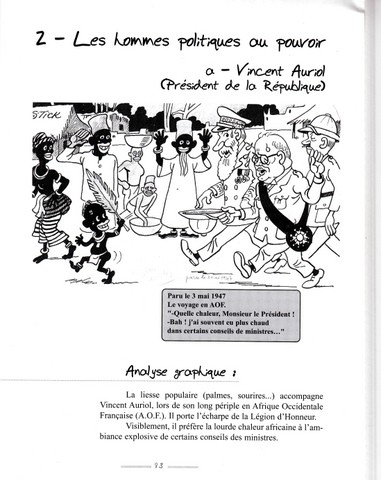
Sous des dehors assez anodins, ce petit livre met en évidence l’intelligence du dessinateur caricaturiste, sa compréhension des épisodes successifs de ces cinq années, sa truculence et son humour au service de l’histoire.
L’auteur écrit : Pour conclure, merci à mon père qui m’avait demandé d’effectuer ce travail. Nous pouvons de même lui dire merci pour l’avoir bien effectué.
06:42 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, société, dessin, écriture, littérature |  Imprimer
Imprimer
21/05/2012
Jour du peintre
Jour du peintre, le soleil dort
Bordé de plumes, il se cotonne
Emergence sereine, sans contours
Il délivre sa myopie de cyclope
Terre de verre teintée, molle
Araignée laiteuse et géométrique
Je m’englue dans ta toile déployée
Jusqu’à cet œil pâle et soyeux
Mes pas étouffés par ta chair
Ne peuvent pas monter jusqu’à moi
07:47 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écriture, poésie, poème, littérature |  Imprimer
Imprimer
17/05/2012
Il était revenu aux lieux de son enfance
Il était revenu aux lieux de son enfance,
Il se revit, petit, sautant sur ses gambettes,
Plus rien ne sera comme hier, et ta prestance,
Retrouvée, anoblie, te dispense de courbettes.
Merci à vous tous, pour votre soutien esseulé,
J’imagine l’être solitaire, empressé,
Revenir vers ses souvenirs et les caresser
Pour qu’ils reprennent une existence froissée.
L’eau coule, sereine, lavant tes désirs obscurs,
Et les transforme en pesante sinécure.
Tu aimes la pétrir de tes doigts malhabiles.
Rien, les souvenirs refusent leur présence.
Le temps a filé et consacré ton absence.
Rien ne rebranchera le passé immobile.
07:35 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écriture, poésie, poème, littérature |  Imprimer
Imprimer
13/05/2012
Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran
Pour poursuivre sur l'Islam et y puiser de la sagesse, malgré l'ambiance actuelle, ou peut-être à cause d'elle :
Parce que son père pense qu’il lui vole de l’argent, Moïse, dit Momo, jeune juif, casse sa tirelire et décide de devenir un homme en se payant une fille, rue de Paradis, à côté de chez lui. Peu après, il fait la connaissance de Monsieur Ibrahim, épicier musulman ouvert de huit heures du matin au milieu de la nuit. Le commerçant sait celui-ci malheureux. Il lui apprend en premier lieu à sourire, sourire de tout et à tous. C’est bête, mais ça marche. Ils s’apprécient et après le départ et le suicide de son père, Momo devient le fils adoptif d’Ibrahim. Pour fêter cela, ils décident de partir dans le Croissant d’Or, en Méditerranée. Ils achètent une voiture et Momo prend le volant. Tout au long du voyage, Ibrahim l’initie à la vie, la vraie vie, celle des sentiments, de l’amour et de la spiritualité. Il lui apprend comment distinguer les riches des pauvres. « Lorsque tu veux savoir si tu es dans un endroit riche ou pauvre, tu regardes les poubelles. Si tu vois ni ordures ni poubelles, c’est très riche. Si tu vois des poubelles et pas d’ordures, c’est riche. Si tu vois des ordures à côté des poubelles, c’est ni riche ni pauvre ; c’est touristique. Si tu vois les ordures sans les poubelles, c’est pauvre. Et si les gens habitent dans les ordures, c’est très très pauvre. »
En Turquie, ils s’arrête dans un village de montagne et Ibrahim emmène Momo danser. C’est la danse des soufis. Comme le lui explique Monsieur Ibrahim, ils tournent sur eux-mêmes, ils tournent autour de leur cœur qui est le lieu de la présence de Dieu. C’est comme une prière. Essaie, Momo, essaie.
Quant aux filles, lorsque Momo demande s’il sera assez beau pour leur plaire sans payer, Monsieur Ibrahim répond :
- Dans quelques années ce seront-elles qui paieront pour toi ! »
Et il poursuit :
- Tu les fixes en ayant l’air de dire : « Vous avez vu comme je suis beau. » Alors, forcément, elles rigolent. Il faut que tu les regardes en ayant l’air de dire : « Je n’ai jamais vu plus belle que vous »… Ta beauté, c’est celle que tu trouves à la femme.
Mais Monsieur Ibrahim a un accident. Il meurt tranquillement, heureux d’avoir si bien vécu. Momo médite un poème du soufi Rumi : Ce qui n’existe pas, produis-le : c’est l’intention.
Et il tourne. Je tourne une main vers le ciel, et je tourne. Je tourne une main vers le sol, et je tourne. Le ciel tourne au-dessus de moi. La terre tourne au-dessous de moi. Je ne suis plus moi mais un de ces atomes qui tournent autour du vide qui est tout.
Le livre se termine ainsi :
Voilà, maintenant je suis Momo, celui qui tient l’épicerie de la rue Bleue, la rue Bleue qui n’est pas bleue.
Pour tout le monde, je suis l’arabe du coin.
Arabe, ça veut dire ouvert la nuit et le dimanche, dans l’épicerie.
Oui, il faut le dire, Eric-Emmanuel Schmitt est un grand romancier. Sous des dehors d’une petite littérature pour midinette, il enseigne la vie à ceux qui ne peuvent entendre le langage savant. Et ses récits sont plein d’humour, les dialogues délicats, les personnages fantasmagoriques, hauts en couleur, inhabituels malgré leur extrême manque de connaissances intellectuelles. Alors on referme le livre avec un rien de regret qu’il soit lu si vite, et l’on rouvre les pages en cherchant les plus belles, mais toutes vous font vibrer et vous enrichissent d’une pointe d’humanité et de spiritualité.
07:22 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, roman, spiritualité, islam |  Imprimer
Imprimer
12/05/2012
J’ai cinq doigts
J’ai cinq doigts et tu en as cinq
Si je les entrelace, j’ai dix doigts.
Nous sommes alors comme les marins
Qui tirent ensemble sur leur corde de bois.
Tu as les doigts les plus fins
Cela semble aller de soi.
Ce sont de petits verres de rien
Aux ongles rouges de désarroi.
Tu as aussi de petits plis
Qui forment de grands rires
Sur ta paume encore assoupie
Par les grands yeux qui l’admirent.
07:06 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, poème, littérature, écriture |  Imprimer
Imprimer
08/05/2012
Tuer le père, roman d'Amélie Nothomb
D’emblée, Amélie Nothomb introduit au cœur de l’intrigue, un duel entre deux visions éthiques de la vie. L’un, Joe Whip, joueur invétéré, très doué de ses mains, l’autre, Norman Terence, hippie bon enfant, qui ne triche pas.
Le premier rencontre le second par l’intermédiaire d’un homme, un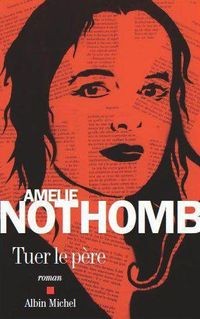 belge, sans que l’on sache ce qu’ils se sont dits. Joe s’introduit dans le couple Norman-Christina et devient pratiquement leur fils, malgré un manque évident de différence d’âge. Norman lui enseigne les tours de cartes et lui apprend, contre son gré, à tricher. Le récit développe ensuite le combat entre les deux hommes, le second voulant faire du premier son fils adoptif, malgré les tricheries, l’absence de reconnaissance, les attaques de son couple, l’indifférence de Joe.
belge, sans que l’on sache ce qu’ils se sont dits. Joe s’introduit dans le couple Norman-Christina et devient pratiquement leur fils, malgré un manque évident de différence d’âge. Norman lui enseigne les tours de cartes et lui apprend, contre son gré, à tricher. Le récit développe ensuite le combat entre les deux hommes, le second voulant faire du premier son fils adoptif, malgré les tricheries, l’absence de reconnaissance, les attaques de son couple, l’indifférence de Joe.
Qu’en retenir ? Eh bien, je ne sais. Le récit est assez inhabituel chez l’auteur. Le ton également. On était habitué à plus d’humour et plus de verve. Ce n’est pas que le récit s’éteint par manque de vigueur. Non. Mais en fermant le livre, quel arrière-goût ! Un rien nous gène pour dire qu’il s’agit d’un bon roman. Le manque d’explication sur l’attitude de Joe ? L’incompréhensible pari entre Joe et le belge au détriment de Norman ? Tout cela laisse un goût amer malgré la nouveauté de l’écriture et de l’ambiance générale du livre.
Au fond, un bon livre est celui qui apporte un plus à notre manière de voir le monde. Là, on reste perplexe, que signifie tout ceci ?
06:36 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman |  Imprimer
Imprimer
05/05/2012
C’est votre univers
C’est votre univers, ce bureau délavé.
Et, présent, vous laissez partir votre esprit ;
Absent, sans vergogne, vous y revenez.
Apparition, disparition, tromperie !
Environné de fantômes, muselé,
Vous vous condamnez en imagination
A devenir sec et pâteux, dépoilé,
Dans cette enceinte de distanciation.
Votre transparence devenue réelle,
Vous errez dans les couloirs solitaires,
Trainant derrière vous vos péchés véniels,
Jusqu’à cette résidence balnéaire.
Et vous vous ébattez, le cœur en fête,
Là où aucune envie ne vous attend.
Vous vous délestez d’une âme inquiète
Jusqu’à baigner dans le vide dilatant.
05:02 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écriture, poésie, poème, littérature |  Imprimer
Imprimer
03/05/2012
Le Zubial, roman d’Alexandre Jardin (Gallimard, 1997)
Le Zubial n’est ni un oiseau, ni même un animal, c’est un humain, le père du narrateur. Il est mort à quarante-six ans, mais son souvenir est si vivant qu’il transcende la tristesse et fait régner une joie intérieure à défaut des farces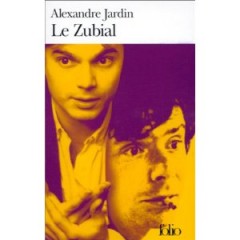 extérieures. La joie communicative qui émanait du Zubial était faite d’un étrange parfum d’irréalité, lequel tenait à la façon de tout revisiter à l’aune de ses fantasmes et son goût pour les situations invraisemblables.
extérieures. La joie communicative qui émanait du Zubial était faite d’un étrange parfum d’irréalité, lequel tenait à la façon de tout revisiter à l’aune de ses fantasmes et son goût pour les situations invraisemblables.
Le thème principal du livre : le Zubial, bien sûr. Imaginez que vous êtes lui. Imaginez que vous vous donnez soudain le droit d’être furieusement heureux. Oui, imaginez une seconde que vous n’êtes plus l’otage de vos peurs, que vous acceptez les vertiges de vos contradictions… Imaginez que vous êtes résolument libre, que vous ayez rompu avec le rôle asphyxiant que vous croyez devoir vous imposer en société. Vous avez quitté toute crainte d’être jugé… Imaginez que la traversée de vos gouffres ne vous inspire plus que de la joie.
Le deuxième thème : les femmes, toutes les femmes, extasiées, envoûtées, amoureuses, tant, qu’elles commémorent une fois par an sa mémoire en l’église Sainte Clothilde. A l’insu de leur mari ou amant, quittant leurs jalousies d’antan, elles se réunissaient en secret depuis seize ans pour le remercier d’avoir existé, ou du moins poursuivre le dialogue qu’elles avaient entamé avec ce grand vivant quand il l’était encore.
C’est un livre d’anecdotes, parfois nostalgiques, celui d’un encore enfant qui se réjouissait, s’envolait aux côtés d’un père qui était bien plus qu’un père, un clown, un ange et un diable. Car je savais que ce récit ne serait pas un recueil de souvenirs, mais un livre de retrouvailles. Ce n’est pas une nuance, c’est une différence qui me remplit de vie à mesure que j’écris ces lignes. Et s’il m’arrive de pleurer en l’écrivant, ce sera de joie. Mon père est mort, vive le Zubial !
C’est une France espiègle, drôle, ludique, abracadabrantesque, que nous décrit la plume d’Alexandre Jardin, laissant trainer un brin de romantisme et de mélancolie avant de rebondir dans une nouvelle aventure tout aussi folle. Etre Jardin, c’est être fou jusqu’à la ruine. Je demandais à mon père ce qu’allait coûter notre périple. Il me répondis que cela n’avait pas d’importance, ou plutôt qu’il était important que j’apprenne à consacrer l’essentiel de mes revenus ou ceux des autres pour conquérir les femmes que j’aimais ; le reste ne pouvait être qu’un mauvais placement, immoral de surcroît. Telles étaient les règles du Zubial, toujours à cheval sur certains principes. (…) Chez les Jardin, devenir soi passe par d’exténuantes exigences. Ce que nous sommes ne nous suffit pas, jamais. Vivre signifie enfourcher un destin, aimer est pour nous synonyme de se projeter dans des amours vertigineux. Le normal est notre hantise, l’exorbitant notre mesure et notre ridicule vanité.
Dernière pirouette du narrateur : Je crois tenir de lui le sentiment que mes volontés, même invalidées par les contingences, finiront toujours par dessiner les contours du réel. Fondamentalement pessimistes l’un et l’autre, nous restons convaincus que le bonheur est la seule issue, que le mal est un affreux malentendu et que les désirs irrépressibles peuvent tout dynamiser.
07:49 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, société |  Imprimer
Imprimer
01/05/2012
Inexorablement, se déversent du ciel
Inexorablement, se déversent du ciel
Les gouttes d’une froide solitude
Le temps s’est divisé, recroquevillé
En nuages noirs et denses
Comme les bourres de poussière
Sous les meubles de votre passivité
Autour de vous, au pied de votre île
L’eau monte en écume blanchâtre
Et file sous vos yeux inquiets
Elle atteint sa côte d’alerte
Et envahit votre esprit occupé
Jusqu’à faire dériver vos pensées
Les gouttes sont devenues flots
Les flots deviennent fleuves
Les fleuves emplissent l’immensité
Des eaux des mers bordant la terre
Observons cet étrange ballet
Une goutte tombe, se perd
Se fraye un chemin dans la végétation
Ruisselle avec ses compagnes
Vers d’étranges récipients
Qui déversent leur bouillonnement
En vomissures permanentes
Dans des canalisations saturées
Jusqu’aux rives des ondes courantes
Là s’arrête son aventure
Elle meurt de trop de gouttes
Elle laisse la place à plus épais qu’elle
Adieu goutte fraîche et caressante
Qui m’honora de sa présence
Avant de finir engloutie
Dans les affres de la nature débordante
07:49 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écriture, littérature, poésie, poème |  Imprimer
Imprimer
27/04/2012
J'ai pressenti ce matin
J’ai pressenti ce matin la reprise des vagues noires.
Elles courraient au galop sur le plafond de la chambre,
Puis revenaient à la charge des ombres du miroir
Qui fuyaient la transparence du regard de ces chimères d’ambre.
Mais le sommeil envahissait les limbes de mon sarcophage,
Le noyant de l’obscurité de l’aurore qui se méconnaît.
Assis, je sentais mieux les attaques de l’hydre anthropophage
Qui semblait s’éloigner pour rire sous la voûte du dais.
Les vertus du val disgracié des antipodes marines
Excellaient à périr sur le toit de la grâce immolée,
La couvrant de longs corps brunis par la soif de perdre Aphrodite
Qui frôlait de son rire leurs faces épanouies du périple enchaîné.
Fermés sur l’ombre des autels de leurs ailes affamées
Les princes des châteaux du miroir étalaient leur infamie
Pour tenter d’échapper aux fantômes des lueurs embuées
Qui gardaient leur ignorance du pouvoir des parvis.
08:00 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, poésie, poème |  Imprimer
Imprimer
24/04/2012
L’éclaircie, roman de Philippe Sollers
Le livre est intitulé roman. Mais s’agit-il d’un roman ?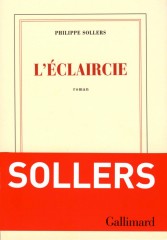 Si l’on en prend la définition, le roman serait une œuvre d'imagination en prose, assez longue, qui fait vivre des personnages présentés comme réels. Or que fait vivre ce livre ? Je ou moi (le narrateur), ma sœur Anne (Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?), Lucie, mon amour de l’après-midi, qui se met nue avant de parler avec moi. Sont-ce des personnages inventés ou les reflets de ma réalité ? On ne le sait ! Autour de ceux-ci des personnages bien réels ou plutôt des spectres, principalement Manet et Picasso, et leurs femmes et enfin ceux qu’ils ont côtoyé au long de leur vie. Et tout ceci fait un roman ? Cela rappelle Kundera, mais en moins beau, une écriture plus déliée certes, mais moins imaginative, plus moqueuse, moins profonde.
Si l’on en prend la définition, le roman serait une œuvre d'imagination en prose, assez longue, qui fait vivre des personnages présentés comme réels. Or que fait vivre ce livre ? Je ou moi (le narrateur), ma sœur Anne (Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?), Lucie, mon amour de l’après-midi, qui se met nue avant de parler avec moi. Sont-ce des personnages inventés ou les reflets de ma réalité ? On ne le sait ! Autour de ceux-ci des personnages bien réels ou plutôt des spectres, principalement Manet et Picasso, et leurs femmes et enfin ceux qu’ils ont côtoyé au long de leur vie. Et tout ceci fait un roman ? Cela rappelle Kundera, mais en moins beau, une écriture plus déliée certes, mais moins imaginative, plus moqueuse, moins profonde.
Certes, le terme de roman ou latin vulgaire, s’adresse, à l’origine, à toute la littérature narrative, mais très vite la narration ne concerna que des personnages inventés vivant un récit fictif. Philippe Sollers aurait pu sous titrer « L’éclaircie » du terme de journal littéraire ou journal intime, voire de méditation. Il est vrai que le roman d’aujourd’hui remet en cause la forme romanesque. S’agit-il d’une biographie, dans laquelle l’auteur raconte la vie d’un personnage ayant existé, ou d’une autobiographie, car le narrateur du livre est bien « je », « moi », c’est-à-dire lui, l’auteur, Philippe Sollers ? Bref, il se met en scène et raconte sa vie, qu’elle soit fictive ou réelle ou à la fois l’une et l’autre. Il médite sur le siècle qu’il vit, mais cette méditation est un récit d’événements intimes qui permettent de se raccrocher à ce qu’il aime : la peinture, les femmes, le tout enrobé de littérature, de musique (peu), de sœurs et de mères.
Il y a les femmes qu’on connaît, celles qu’on croit connaître, celles que l’on ne connaît pas en les connaissant, les variantes et les variables sont nombreuses, mais pas innombrables. Etre explorateur de ce tourbillon en mutation demande des dons particuliers, pinceau et stylo intérieurs, dessin, couleurs, oreilles. Victorine n’est pas Berthe (Morizot), qui n’est pas Méry, qui n’est pas Suzon. Albertine n’est pas Albertine, Molly Bloom est, et n’est pas, Nora Joyce, Frieda, dans le Château, est plus Kafka qu’on ne croit. (p.224)
Si une belle femme est morte, on dira qu’elle était l’orgueil du soleil, les délices du vent. A une jeune fille en fleur, on conseillera de jouir vite, du cou, du front, des lèvres, des cheveux. (p.216).
Les vraies fleurs sont chez Manet, les enfin vraies femmes chez Picasso. Parfaites, imprévues, elles s’offrent à leurs expériences. Elles s’épanouissent, éblouissent, vieillissent, périssent, ce sont elles qui balisent le fleuve du temps. (p.232)
Finalement, il s’agit bien de lui, Philippe Sollers, puisqu’à la fin il écrit : « J’apprends en même temps (voyez le roman) que Trésor d’Amour (roman de Philippe Sollers, 2011) va être traduit par une nouvelles maison d’édition créée en février 2010 à Pékin. C’est le moment exact de ma rencontre avec Lucie et de l’arrivée du manuscrit de Casanova à Paris. On se la joue mégalo sur plus de deux siècles. Pari. » (p.236)
J’ai d’abord détesté : trop nombriliste, voire intimiste dans les révélations, et, au-delà, trop brouillon, sautant d’une idée à l’autre sans transition ni fil directeur. Puis, reprenant la lecture une seconde fois, j’ai aimé cette évocation des deux peintres, la connaissance réelle qu’il avait de leurs vies et des rapports entre leurs peintures et leurs femmes. C’est bien une méditation qui ne dit pas son nom, comme le parfum d’un siècle qui est encore présent, mais qui est déjà en train de passer pour laisser place à l’arrogance de la communication, d’une jeunesse sans culture (Tout ce qui s’annonce comme culture est faux, vide, bavard. Les animateurs sont là, vous pas), d’une photographie remplaçant la peinture qui, devenue moderne, est hideuse. Les embarrassés du sexe et du sentiment vont beaucoup au cinéma… (p.183)
07:52 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, société, femme |  Imprimer
Imprimer
23/04/2012
Lumière
Lumière,
Un trou blanc dans la vague des choses
Un gouffre, cimetière de couleurs
Et l’eau, brillance horizontale
Comme une nappe ou un glacier
La Loire,
Cristallisation des échos du soleil
Largement étale, délibérément ouverte
Entre les pans de matière forestière
Achevée de repos et de grâce
Ombre,
Aux lagunes encloses de sable noir
Baignées des dorures de la rive
Où l’œil s’enfonce indéfiniment
Comme au travers des brumes matinales
Loire, amie de mes rêves
Consolatrice de mes tristesses
Épuisant la joie de tes épanchements
Entre les berges de l’espérance
Soleil aux rayons verticaux
Détendant l’air de ses inquiétudes
Source de gaité séculaire
Lié au fleuve comme une broche d’or
Enfin les bois reposant sur la rive
Comme des bras tendus vers la lumière
Impénétrables et pondérés
Dans une sagesse faite d’immobilité
06:59 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, poésie, poème |  Imprimer
Imprimer
21/04/2012
J’apprends l’hébreu, roman de Denis Lachaud
Il apprend l’hébreu à sa manière, seul, sans professeur, et il en profite pour raconter sa découverte de Tel Aviv et du monde juif. Il est l’enfant d’un banquier français, il a une mère, une sœur et un autre frère. Il déteste ce dernier qui le lui rend bien. On ne sait s’il est sain d’esprit. On découvre sa manière de voir, de sentir, d’aimer Israël. « Un jour, la vérité s’est révélée à moi dans son âpre nudité : je comprends de moins en moins ce que les autres me disent… J’ai cherché une solution et quand on cherche on trouve… J’ai acheté le dictaphone qui me permet de transformer les mots dits en mots écrits… Je me sers aussi du dictaphone pour entendre ce que je n’aurai pas dû entendre, tel un espion. »
Il découvre que Tel Aviv est construit sur le sable. Il ne sait pas comment on fait pour vivre sur le sable. Et il voit quelqu’un qui le regarde, caché sous le sable. Après qu’il ait fait connaissance avec deux voisins : Madame Lev et Monsieur et Madame Masri, il découvre qui le regarde. Cette nuit pendant que j’étais couché, Benjamin est venu me parler. Il s’est glissé jusqu’à ma chambre sans un bruit. Moi je lisais… « C’est moi sous le sable, a-t-il dit, c’est moi que tu devines. »
Il va souvent à la plage : J’étale ma serviette sur le sable dans la cacophonie générale. Je m’allonge et peu à peu le monde se tait. Soudain, je m’aperçois que j’entends les vagues. Me voilà revenu à moi. A la fin de ma vie, j’irai mourir sur une plage, dans la rumeur des vagues qui lie le présent à ses deux voisins imaginaires, le passé et le futur. Je n’aurai pas peur. Je disparaîtrai peu à peu à la vue des hommes et des femmes qui marchent sur le sable. Tout ira bien et le soleil plongera dans l’eau.
Il progresse en hébreu : Leçon après leçon, je découvre la structure de la langue, j’apprends ce qui structure la nation qui la parle. Aujourd’hui, le livre me révèle qu’en hébreu, le verbe être ne se conjugue pas au présent. Etre au présent, ça n’existe pas, non. On peut être au passé, on peut être au futur, mais pas au présent… Désormais, je ne suis pas. J’étais et je serai. Au présent, je me contenterai de devenir. Ça change toutes les perspectives. Apprendre une langue m’a toujours permis de découvrir comment je dois regarder le monde dans lequel je vis.
Le jour de ses dix-huit ans, il décide de quitter sa famille et de s’installer en Israël. Pourtant Madame Lev lui dit : « Je sais que tu veux partir et tu as raison. Il faut partir… Il te faut trahir ceux que tu n’as pas choisis pour l’ouvrir à ceux que tu choisiras. Ça m’a pris une vie pour comprendre ça, Frédéric. Je te le dis. Tu feras ce que tu voudras. »
Et ce jour-là, il prend le train pour Jérusalem. Il va voir le tombeau de Benjamin Ze’ev Herlz, le créateur de l’Etat d’Israël. Il se prend pour lui. « Je suis revenu dans l’autre sens, la marge est à droite, la page s’ouvre à la gauche de ma plume. » Et il devient juif au point de devenir fou, ou presque.
Un beau livre, écrit de manière un peu folle, autant dans l’écriture (on va à la ligne après presque toutes les phrases) que dans le récit, rationnel mais décousu. On ne comprend pas où il va ni ce qu’il veut faire, mais on le vit. C’est parfois difficile à suivre, mais on persiste et c’est nécessaire. On va jusqu’au bout dans sa folie, et, finalement, on est content d’avoir découvert Israël à travers la folie du jeune homme. Il s’est construit son territoire, ce territoire qui est un peu son obsession. Mon corps est mon territoire. On me l’a dit, je me souviens. J’aime cette idée. J’aime la caresser. Malheureusement, je ne connais pas en toutes circonstances les limites de mon corps…Je ne peux pas me confier à ma connaissance parcellaire de ses frontières. ‘Mon corps est mon territoire » fuit devant moi en tant que phrase insaisissable. J’essaie de m’en emparer, en vain.
07:20 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, israël, psychologie |  Imprimer
Imprimer
19/04/2012
Inconsistante cassure mentale
Inconsistante cassure mentale
Comme un caillou qui vient frapper
L’occiput et le désoriente
Jusqu’au moment où l’être
Ne vit plus sa routine
Et se vide de toute richesse
Pour recevoir en échange l’absence
Qui est plein de l’univers
Noir, encore, rien que soi
Et la nuit qui vous encercle
Pas un bruit, pas un mouvement
Vous écoutez votre pensée
Qui déroule imperturbable
Ses images connues et inconnues
Vous tentez de les chasser
Sans succès, même faible
La bobine tourne, à vide
Avec un murmure discret
Qui chatouille votre cerveau
Sans cependant l’atteindre
En profondeur. Elle surfe
Elle poursuit seule sa course
Folie et déraison,
Voilà votre sort envié
Soudain la rencontre avec vous-même
Au bord des lèvres, discrète
Vous vous regardez, étonné
Qui suis-je ? L’immensité
La pointe de l’aiguille
Le tout et le rien, sans condition
Vous baignez dans votre absence
En bienheureux extasié !
07:51 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, poésie, poème |  Imprimer
Imprimer
17/04/2012
Le sumo qui ne pouvait pas grossir, roman d'Eric-Emmanuel Schmitt
Il est maigre, long, plat et il vend des produits de contrebande sur le trottoir. En passant devant lui, shomintsu s'exclame : "Je vois un gros en toi." Chaque jour, il le lui répète. Il finit même par lui offrir un billet pour assister à un combat de sumo. La première fois, il le déchire. La seconde, il y va, pour voir. Et il est conquis : "Je ne pouvais pas mépriser des individus qui dévouent leur vie au combat, qui sculptent leur corps, qui prouvent autant d'ingénuité que de force ?" Il entre dans l'école de Shomintsu, une des meilleures.
Il y rencontre la soeur de son champion qui, un jour, bondit sur lui et lui annonce : "Un jour je me marierai avec toi! Il l'oublie, préoccupé à grossir, ce qui n'arrive pas.Alors il va voir son maître et lui annonce sa démission. Celui-ci le fait parler. Il raconte sa vie, sa mère qui ne l'aime pas, son père qui s'est suicidé.Plus tard, son maître lui explique :
- Tu dois être là et pas là en même temps. Toi et pas toi. Tu dois te hisser au dessus de toi et ton adversaire pour englober la situation en ayant l'intuition de l'acte adéquat.
- Comment parvient-on à cela ?
- Par la méditation. En obtenant le vide en soi.
- Désespérant: avant il n'y avait pas de gros en moi; maintenant que le gros arrive, il n'y a plus de vide.
Comme il n'arrive pas à méditer, son maître l'emmène dans un jardin zen. "C'est alors que l'expérience se produisit... ça tournait en moi... Une force s'introduisit, me gonfla, me porta, me souleva. Mon corps éclata avec volupté, abandonna ses limites et ma peau qui se déchirait partit flotter, en plusieurs morceaux épars, disjoints, au dessus du jardin... Le jardin avait cédé la place à un jardin invisible qui dégageait une énergie bienfaisante... Je m'étais quitté, j'étais le vide au dessus de moi, le vide, ce vide qui est le vrai centre du monde."
Il a maintenant confiance en lui. Il sort avec la soeur du champion, mais lui annonce qu'il ne veut pas d'enfant. Comme elle insiste, il la quitte. Il gagne la plupart de ses compétitions. Il retourne voir son maître et lui donne à nouveau sa démission. Celui-ci lui explique qu'il fait parti de sa famille et qu'il s'est donné pour mission de veiller sur lui. Il lui apprend la maladie de sa mère, une malformation cardiaque qui la rend trop gentille, trop optimiste :
-Alors c'est normal qu'elle ne soit pas normale? - Voilà. - Donc moi je suis normal de trouver ça anormal? - Voilà - Finalement il est normal qu'elle ait une conduite anormale, et normal que moi je ne le supporte pas ? - Voilà. - Donc quoique anormaux tous les deux à cause de la situation, nous sommes normaux tous les deux.
Rassuré, il se précipite chez sa petite amie et, posant sa main sur son beau ventre plat, il lui dit, les yeux dans les yeux : "Je vois la grosse en toi."
Eric-Emmanuel Schmitt possède l'art de donner une leçon de vie à partir d'une situation de rien. Le récit n'est que le support de ce qui se cache derrière, une compréhension de la vie et la recherche d'un accomplissement que ses héros finissent par trouver en eux-mêmes, simplement. Il nous conduit à une compréhension profonde des mécanismes du vrai bonheur, au delà des fatras habituels, au plus profond de l'être. Dans cette histoire de sumo, c'est la méditation zen qui est l'épicentre du récit. Dans chacun de ses livres, il explore la sagesse d'autres religions, pour mettre en évidence les points communs, très simples, que sont les rapports entre l'homme et le cosmos, au delà de toute religion.
Merci à l'auteur, pour ces plongées dans la finalité de l'homme d'une manière insolite, simple et humaine.
07:11 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, écriture |  Imprimer
Imprimer
15/04/2012
Comment cesser de voir
Comment cesser de voir à travers l’écran des eaux
Dans l’arbre effeuillé, l’enfant malhabile, l’oiseau grelottant
La forme de tes mains aux caresses apaisantes
Comment cesser de voir quand l’âme se dénude
Ce qui rend l’air léger et d’autres fois plus lourd
Ce qui fait au soleil une robe de deuil
Ou à l’horizon une ceinture d’argent
Un regard encore et l’enfant joue
Une pensée peut-être pour réchauffer l’oiseau
Un geste de la main pour pouvoir sourire
Est-il possible de perdre cette joie enivrante
D’ignorer à nouveau l’intuition de ton existence
Qui se décuple au-delà de ta présence passive
Jusqu’à éclairer le paysage de mon écriture
07:50 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, poésie, poème |  Imprimer
Imprimer
13/04/2012
Deuxième méditation sur la beauté, de François Cheng
François Cheng pose la question importante : « L’univers n’est pas obligé d’être beau, mais il est beau ; cela signifierait-il quelque chose pour nous ? »
Oui, l’univers et les êtres qui l’habitent sont beaux. Alors se pose la question suivante : « Cette beauté naturelle que nous observons, est-elle une qualité originelle, intrinsèque à l’univers qui se fait, ou résulte-t-elle d’un hasard, d’un accident ? »
Ne cherchons pas à trancher entre la thèse du hasard et de la nécessité et une thèse plus inspirante. Observons simplement que notre sens du sacré ne vient pas seulement du vrai, mais également du beau, c’est-à-dire de quelque chose qui frappe par son énigmatique splendeur, qui éblouit et subjugue. L’univers est plus qu’une donnée, il se révèle un don invitant à la reconnaissance et la célébration.
La beauté est quelque chose de virtuellement là, depuis toujours là, un désir qui jaillit de l’intérieur des êtres ou de l’Etre, telle une fontaine inépuisable qui, plus que figure anonyme et isolée, se manifeste comme présence rayonnante et reliante, laquelle incite à l’acquiescement, à l’interaction, à la transfiguration.
La beauté appelle à une autre vie que l’on peut vivre pleinement dès ici-bas. Consacrons du temps à côtoyer la beauté, quelle qu’elle soit. Laissons-nous nous emplir de beauté, cela nous aidera à vivre sans pour autant nous voiler la face devant le malheur.
07:07 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, méditation, sagesse, accomplissement |  Imprimer
Imprimer
12/04/2012
Le fait du prince, roman d’Amélie Nothomb
Panne informatique hier, plus rien sur la machine. Quelle engeance ! Mais dans le même temps, cela a du bon, car je prends du recul. Mais le recul est-il une preuve de sagesse ? Alors entre recul et réponse d'urgence, agissons du mieux possible !
Si un invité meurt inopinément chez vous, ne prévenez pas la police. Appelez un taxi et dites-lui de vous conduire à l’hôpital avec cet ami qui a un malaise. Le décès sera constaté en arrivant aux urgences et pourrez assurer, témoin à l’appui, que l’individu a trépassé en chemin. Moyennant quoi, on vous fichera la paix.
Amélie Nothomb a le don en un paragraphe au début de chacun de ses livres de dresser l’identité de celui-ci. Là, il s’agit de la prise de personnalité de quelqu’un qui est venu mourir chez le narrateur. Il passe ainsi de Monsieur Baptiste Bordave à Monsieur Olaf Sildur et il va progressivement s’installer chez lui où loge déjà une jeune femme. Et l’histoire conte cette prise de possession jusqu’au moment où Sigrid, c’est le nom de la jeune femme, comprend et participe à cette prise de possession, elle devient la femme de Bordave-Sildur.
Le livre se finit ainsi :
Certains matins d’hiver, Sigrid me demandait de la conduire jusqu’au cercle polaire. Il fallait rouler plus d’un jour et traverser la frontière norvégienne jusqu’à la côte. Parfois la mer avait gelé, les îles n’étaient plus des îles, on les gagnait à pied sec.
Sigrid contemplait interminablement la blancheur et je croyais savoir à quoi elle pensait. Pour moi, ce blanc était celui de la page vierge que j’avais conquise.
Comme il s’agit d’une romancière d’un certain renom, on entame le livre avec appétit, puis l’on poursuit en se disant que cela va démarrer, jusqu’à ce que l’on arrive au trois quart du roman, alors on plonge vers la fin, sans grand espoir d’un meilleur que ce que nous avons déjà lu. Du début à la fin, on erre dans un désert inhumain de rencontre d’êtres humains qui se jouent une comédie sans intérêt. Quel ennui et quelle perte de temps. Certes, l’auteur est toujours aussi diserte dans ses dialogues, parfois pince sans rire, mais beaucoup plus rarement que dans ses livres concernant sa jeunesse. En conclusion, le livre pourrait se résumer à leur première rencontre :
– Elle but d’un trait. Quand elle eut fini sa flûte, je crus que ses yeux avaient doublé de volume.
– Le champagne est si froid que les bulles ont durci, dit-elle. On a l’impression de boire de la poussière de diamants.
Malheureusement, ce n’est que de la poussière et non de véritables diamants !
14:15 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, nothomb |  Imprimer
Imprimer











