11/06/2019
Locédia, éphémère (1)
Chapitre 1
Je marche. Rythme apaisant des pas, remède unique. Un, deux, un, deux, deux, deux. Je me prends au jeu des pas et tu me vois passer, occupé à ne pas fouler la jointure des dalles, tantôt allongeant exagérément un pas, tantôt plaçant un pied ridiculement trop près de l’autre. Lorsque le rythme du balancement des pas avec l’écoulement des lignes se détraque, je dois m’arrêter et réfléchir d’où il me faut repartir pour reprendre ce monotone pari. Certaines dalles sonnent plus claires que d’autres et faussent l’écho de la rue obscure. Ce n’est déjà plus un jeu ; cela devient un rite magique qui prend autant d’importance que le square. Je croise un passant, deux yeux fixes qui me regardent trébucher à la recherche d’un équilibre imaginaire. Je mêle un instant mes pas aux siens, puis tout se perd dans l’écho et le rite reprend. Certains disent que c’est une idée fixe. Ils sont même allés jusqu'à dire que j'étais fou. Qui n'est pas fou aujourd'hui ?
Je fais souvent le même chemin. Je me dirige d’abord vers le square entouré de planches. La rue est obscure et je dois compter les pas qui me rapprochent de la palissade. Soulagé par le toucher rugueux des planches de sapin, je promène les doigts sur les interstices comme le prisonnier gratte du bout des ongles la jointure des pierres. Suivant la rampe imaginaire de la palissade, je cherche la brèche qui me permettra de pénétrer dans le jardin.
Est-ce vraiment un jardin ? Ce n'est pas non plus un terrain vague, ni un de ces bouts de terre abandonnés, que l'architecte façonne à son esprit avant de commencer l'équilibre méticuleux de matériaux disparates. Peut-être l'avait-on prévu pour cet usage, mais le projet a dû sombrer dans les difficultés bureaucratiques. Ce n'est plus qu’un amas de terre où la nature a repris ses privilèges, ordonnée par un esprit charitable qui a délivré à chaque plante un permis de pousser sur une concession bien précise.
Pas à pas, je compte les planches jaunâtres entrevues dans l'obscurité et j’en perçois la jointure mal ajustée entre le contact rugueux et monotone du bois, Un nœud m’arrête parfois. Je palpe le trou qui, sur la trajectoire de mon doigt ressemble à la jointure de deux planches bien que je sente qu’elle fait partie intégrante d'un même bois, cavité indivisible de ce qui l’entoure. Remontant alors d'une impulsion inquiète le doigt sur une trajectoire verticale, le contact du rebord arrondi du trou me procure un indicible sentiment de soulagement comme si cet évidement prévu par la nature du bois était une ouverture naturelle vers le calme du jardin.
Je continue lentement, plus posément jusqu’à ce que le rythme des intervalles entre les planches, par un curieux effet d'impatience ou d’accélération du temps, imprime au balancement des pas une oscillation supérieure. De même, en comptant mentalement les secondes, nous accélérons inconsciemment l’écoulement mathématique du temps, comme si, par le fait de vouloir être réglée volontairement, sa somnolente progression se détraquait.
07:26 Publié dans 44. Livres | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, roman, amour, recherche de soi |  Imprimer
Imprimer
04/02/2019
Félix et la source invisible, d’Eric-Emmanuel Schmitt
– Tu ne remarques pas que ta mère est morte ?
Ainsi commence l’épopée d’un gamin de douze ans qui veut retrouver sa mère. Il ne l’a pas perdu, elle est morte, c’est-à-dire en dépression. En bref, elle n’a plus goût à la vie. Alors Félix demande à l’oncle :
– Peut-on la soigner ?
– on guérit les vivants, pas les défunts.
– Alors, que fait-on ? Rien ?
– On la ressuscite !
(...) Pendant des années, Maman avait été vive, pétillante, curieuse, rayonnante, explosive, elle gazouillait d’une voix soyeuse, charnue, verte… Elle tenait le café de la rue Ramponneau, à Belleville, intitulé « Au boulot ». (…) Maman m’élevait seul, car elle m’avait conçu avec le Saint-Esprit. (…) Félicien Saint Esprit, mon géniteur, antillais, capitaine de bateau commercial, avait séjourné une semaine à Paris il y a treize ans…
Ainsi commence sur une trentaine de pages, le drame de Félix dont la verve et la gouaille introduisent le récit. Cela se poursuivra jusqu’à la fin du livre. Une multitude de personnages plus ou moins loufoques s’introduisent dans l’histoire : Madame Simone, une pute et un homme ou plutôt non, précise Félix, un homme et une pute, dans l’ordre chronologique ; Mademoiselle Tran, qui jouait le rôle d’une grande sœur au sourire constant ; Philippe Larousse, un timide de première, qui ne cherchait qu’une chose : connaître le dictionnaire par cœur ; note philosophe, Monsieur Sofronidès ; Monsieur Tchombé, le cancéreux guéri.
Des problèmes d’immobilier lui causant de profonds soucis, Maman allait mal. L’arrivée de l’oncle Bamba, averti par les occupants du café de la situation de Maman, bouleversa la donne : recherche de marabouts d’abord, puis, carrément, voyage au Sénégal et rencontre de Papa Loum, le féticheur. Elle guérit, seule ou avec l’aide de tous. Elle rentre à Paris, joyeuse, retrouve son café aux soins de Madame Simone, se laisse courtiser par le Saint Esprit. Chaque jour, elle pratique avec Félix l’« exercice d’Afrique » exigé par Papa Loum, car le monde se donne à ceux qui le contemplent, disait le féticheur. L’apparence n’est pas l’apparence de rien, plutôt l’apparence d’un univers dérobé. Ce soir-là, elle est comblée : Paris a l’apparence de l’Afrique. Papa Loum les avait avertis : L’Afrique c’est l’imagination sur Terre. L’Europe, c’est la raison sur Terre ; tu ne connaîtras le bonheur qu’en important les qualités de l’une dans l’autre.
On aime les récits d’Éric-Emmanuel Schmitt qui, sous des dehors simples, parfois simplistes, sait donner aux mystères humains l’apparence du quotidien, tel qu’il l’a déjà fait dans Oscar et la dame en rose, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran.
07:20 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, afrique, paris, dépression, marabouts, animisme |  Imprimer
Imprimer
21/01/2019
Sérotonine, de Michel Houellebecq
Quels éloges ! On ouvre internet et l'on est abreuvé des qualités du roman et de l’auteur. Mieux même, on publie un « dossier de lecture » pour mieux apprécier le livre qui ne se suffit plus à lui-même. Clair et pratique, ce dossier de lecture a été spécialement conçu à l’adresse des collégiens, lycéens, étudiants, journalistes, artistes, politiques et hommes d’affaires, ainsi que de tous les lecteurs désireux d’accéder rapidement au contenu de l’œuvre de Michel Houellebecq (https://www.amazon.fr/S%C3%A9rotonine-Michel-Houellebecq-... ).
Il a quarante-six ans, il s’appelle Florent-Claude Labrouste et déteste ses prénoms. Il est dépressif et l’histoire commence en Espagne où il rencontre deux filles qui tentent de regonfler les pneumatiques d’une Coccinelle. Il fantasme bien sûr, mais nous étions dans la réalité, de ce fait je suis rentré chez moi. J’étais atteint par une érection, ce qui n’était guère surprenant vu le déroulement de l’après-midi. Je la traitai par les moyens habituels. Plus tard, dans ses rêves, l’une d’entre elles revient sauver d’un seul mouvement sa bite, son être et son âme et dans sa maison, librement et hardiment, pénètre en maîtresse.
Mais dans l’immédiat, il va à l’aéroport chercher Yuzu dont il veut se débarrasser parce que cela fait des mois qu’il n’a pas couché avec elle. Là commence l’histoire, là finit ma curiosité pour Houellebecq. Le livre est une longue errance sans motivations autour de pensées sans queue ni tête, enfin, si, avec la première jusqu’au ras le bol en raison de l’absence du moindre sentiment vis-à-vis du corps des femmes, et avec la seconde en raison de l’absence de pensées sur leur sociabilité. Enfin, n’exagérons pas. Il y a quelques belles pages concernant ces êtres aux cheveux longs : les femmes comprennent mal ce qu’est l’amour chez les hommes, elles sont constamment déconcertées par leur attitude et leurs comportements et en arrivent quelquefois à cette conclusion erronée que les hommes sont incapables d’aimer(…) Peu à peu, l’immense plaisir donné par la femme modifie l’homme, il en conçoit reconnaissance et admiration, sa vision du monde s’en voit transformée, de manière à ses yeux imprévue il accède à la dimension kantienne du respect, et peu à peu, il en vient à envisager le monde d’une autre manière, la vie sans femme (et même, précisément, sans cette femme qui lui donne tant de plaisir devient véritablement impossible, et comme la caricature d’une vie ; à ce moment, l’homme se met véritablement à aimer. (…)
Bref, à force de bavardage on en arrive à la presque fin du livre (aux alentours de la page 230/347). C’est la partie qu’ont retenue les critiques et médias pour s’étendre en louanges sur le roman. Avant, dépression et misère sexuelle et maintenant désertification des campagnes et désespoir du monde rural face à la mondialisation. Michel Houellebecq se trouve à la pointe du combat des gilets jaunes et anticipe leur révolte grâce à un aristocrate agriculteur. Les médias en font des gorges chaudes. Le Point : Malgré les scènes pornographiques [...], le roman de Michel Houellebecq est éminemment romantique. On sort de sa lecture bouleversé. Le devoir : Récit implacable d’une déchéance programmée, Sérotonine apparaît surtout comme une nouvelle variation au cœur d’une œuvre à la cohérence exemplaire. Libération : Dans «Sérotonine», son septième roman qui paraît le 4 janvier, l’écrivain endosse un nouvel avatar du mâle occidental, homophobe à la libido en berne et sous antidépresseur. Une dérive émouvante autour de la perte du désir, sur fond de révolte des agriculteurs. Paris Match : Un vrai rêve dans la littérature française actuelle.
Ne poursuivons pas, c’est un livre désespérant. Si nous n’avions que ce genre de lecture, nous aussi, nous nous suiciderions.
07:22 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, société |  Imprimer
Imprimer
02/12/2017
L’annulaire, un roman de Yoko Ogawa
Le livre pourrait s’appeler le mystère du laboratoire de spécimens. La jeune fil le qui y travaille a eu un accident dans la société qui l’employait auparavant. Elle a perdu le bout d’un doigt dans un engrenage. Ici le travail est plus simple, mais sait-elle réellement à quoi il sert ? Son propriétaire recueille des spécimens qu’amènent les gens et les conserve avec une préparation en laboratoire auquel elle n’a pas accès. Ils sont ensuite étiquetés et placés sur des étagères dans diverses salles. A quoi servent ces spécimens ? Il est difficile de leur trouver un but commun. Les raisons qui poussent à souhaiter un spécimen sont différentes pour chacun. Il s’agit d’’un problème personnel. Cela n’a rien à voir avec la politique, l’économie ou l’art. En préparant les spécimens, nous apportons un réponse à ces problèmes personnels. Vous comprenez ? explique M. Deshimaru, le propriétaire du magasin laboratoire. Un visiteur arrive avec l’objet qu’il veut faire naturaliser. Après les formalités d’usage, vous le prenez et j’en fais un spécimen.
le qui y travaille a eu un accident dans la société qui l’employait auparavant. Elle a perdu le bout d’un doigt dans un engrenage. Ici le travail est plus simple, mais sait-elle réellement à quoi il sert ? Son propriétaire recueille des spécimens qu’amènent les gens et les conserve avec une préparation en laboratoire auquel elle n’a pas accès. Ils sont ensuite étiquetés et placés sur des étagères dans diverses salles. A quoi servent ces spécimens ? Il est difficile de leur trouver un but commun. Les raisons qui poussent à souhaiter un spécimen sont différentes pour chacun. Il s’agit d’’un problème personnel. Cela n’a rien à voir avec la politique, l’économie ou l’art. En préparant les spécimens, nous apportons un réponse à ces problèmes personnels. Vous comprenez ? explique M. Deshimaru, le propriétaire du magasin laboratoire. Un visiteur arrive avec l’objet qu’il veut faire naturaliser. Après les formalités d’usage, vous le prenez et j’en fais un spécimen.
C’est ainsi qu’un jour, une jeune fille vient faire naturaliser un morceau de musique. Pas la partition, la musique elle-même. Pour cela, M. Deshimaru fait appel à une vieille demoiselle qui jouera la partition et le tout sera enfermé dans un tube de verre fermé par un bouchon de liège. Le même jour, M. Deshimaru lui offre une magnifique paire de chaussures qui s’ajuste parfaitement à ses pieds et les lui met aux pieds avec des mains caressantes. Elle doit les garder et il détruit les anciennes chaussures. Ils prennent l’habitude de se retrouver dans la salle de bain du magasin pour discuter, puis pour s’aimer étroitement dans la baignoire. Une autre jeune fille débarque un matin. Elle veut conserver un spécimen de sa brûlure sur une joue. Elle passe dans le laboratoire avec le propriétaire, mais ne ressort jamais. Qu’est-elle devenue ?
D’autres péripéties s’échelonnent au long des pages. Laissons-les là pour que vous les découvriez. La fin est-elle une fin ? L'assistante veut aussi son spécimen, c’est-à-dire le bout de son doigt. Elle prépare le tube, les étiquettes et va frapper à la porte du laboratoire. C’est ensuite à votre imagination de finir le roman selon votre personnalité.
Une atmosphère pleine de mystère au travers de descriptions très matérielles et pratiques. C’est une sorte de rêve éveillée, une histoire simple, si simple que l’on se demande ce qui transforme le récit en un conte énigmatique dont le déroulement vous envoûte.
08:08 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, japon, littérature fantastique |  Imprimer
Imprimer
21/11/2017
Détruire, dit-elle, de Marguerite Duras (2)
Alissa n’est pas encore allée au-delà de la folie, de cette folie apparente engendrée par la destruction. Elle est la destruction (détruire, dit-elle) et en fait elle qui déclenche le drame, car rien ne serait arrivé ans elle. Alissa sait, dit Max Thor, mais que sait-elle, se demande-t-il. Sans doute, ne le sait-elle pas elle-même, n’est pas capable de le formuler. Seul Stein pourrait le faire, mais Stein ne répond pas. Alissa comprend Stein d’instinct, intuitivement. Elle le sent fémininement et Stein la comprend, c’est pourquoi l’amour naît aussitôt entre eux, ontologiquement pourrait-on dire.
Max thor n’est pas encore du même camp. Il cherche. Il s’interroge, il regarde de la même manière dont regarde Elisabeth Alione. « Quelque chose le fascine et le bouleverse dont il n’arrive pas à connaître la nature », aussi bien chez Elisabeth que chez Alissa. Il ne connaît pas Alissa, sa femme. Il la cherche, car il sait que c’est en elle que doit être la réponse ; et ce problème, le seul qui le touche vraiment, s’effacera de lui-même, sans qu’il ait besoin d’en avoir la réponse, au cours du troisième temps du livre, au cours de l’affrontement. Alors il saura ce qu’est Alissa et Stein. Elisabeth Alione le fascine également. Il l’aime d’un amour différent de celui qu’il éprouve pour Alissa (amour inquiet et interrogateur, tourné vers l’avenir), d’un amour tourné vers le passé qu’il ne peut encore quitter tout à fait, ne connaissant pas l’avenir.
Enfin, il y a Elisabeth Alione, qui, en fait, n’existe pas en elle-même, c’est-à-dire en tant qu’être propre, individuel et personnel. Elle croît à ce que les autres disent d’elle. « Elle est à celui qui la veut, elle éprouve ce que l’autre éprouve. Elisabeth Alione, c’est le passé. Tout n’existe pour elle que par le passé et l’avenir lui fait peur car aucun passé ne s’y rattache. Aussi a-t-elle peur des trois autres et surtout d’Alissa, peur d’eux qu’elle ne comprend pas parce qu’elle ne sait rien d’eux alors qu’eux savent tout d’elle. Une fois dans sa vie, Elisabeth aurait pu être en tant qu’être véritable, mais elle a eu peur de cette lettre du médecin qu’elle a montré à son mari parce que, là encore, elle avait peur d’un avenir différent du passé, inconnu. Puis elle a regretté son geste parce que quelque chose en elle disait oui à la lettre. Sa maladie véritable venait en fait de cette contradiction entre ce qu’elle croyait être et ce qu’elle était réellement, intérieurement. La destruction de l’ancienne Elisabeth commence le jour où elle rencontre Alissa, puis Stein. Elle découvre par l’intermédiaire d’Alissa la véritable cause de sa maladie. Elle ne peut plus redevenir ce qu’elle était auparavant, bien qu’elle ne s’en rende pas compte, et au-delà de la peur qu’elle a éprouvée, elle découvre le dégoût (ces nausées… Ce n’est qu’un début, dit Mas Thor. Bien… Bien… dit Stein).
« Il y a eu un commencement de… comme un frisson… non... un craquement de… du corps », dit Stein.
« Ce sera terrible, ce sera épouvantable, et déjà, elle le sait un peu ».
La destruction a fonctionné comme cette musique, cette fugue de Bach qui s’arrête, reprend, s’arrête à nouveau, repart jusqu’à ce qu’elle passe la forêt, fracasse les arbres, foudroie les murs.
07:30 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, littérature, duras, philosophie, vie |  Imprimer
Imprimer
20/11/2017
Détruire, dit-elle, de Marguerite Duras (1)
Le décor : un périmètre dans la forêt où les gens viennent s’isoler, s’apprendre à vivre eux-mêmes dans le repos. Ici les livres, qu’ils soient à lui, Max Thor, ou à elle, Elisabeth Alione, ne servent à rien. Ils font partis du décor. Rien ne se passe dans cet hôtel, tout commence et rien ne s’achève, car aujourd’hui n’a plus de rapport avec hier. Le temps ne soule plus, ou coule sans souvenirs, sans souvenirs d’impressions durables, sauf, peut-être, le souvenir de ce qui est et non pas de ce qui arrive.
C’est dans ce monde où rien ne compte qu’être, que fonctionne la destruction comme cette musique des dernières pages, cette fugue de Bach, qui s’arrête, reprend, s’arrête à nouveau, repart, jusqu’à ce qu’elle fracasse les arbres, foudroie les murs. Elle arrive en trois temps, trois actes du livre. Sans un premier temps, il n’y a rien, rien ne se passe, on regarde, Marguerite Duras pose le décor et ses personnages, puis arrive Alissa qui est la destruction à l’œuvre et cette destruction plante ses racines et les enfonce dans le décor, imperceptiblement. Enfin, dans un troisième temps, les deux forces opposées, l’avenir avec le groupe d’Alissa de Stein et Max Thor et le passé avec Bernard et Elisabeth Alione, s’affrontent et se déchirent, enracinant la destruction chez Elisabeth Alione sans même qu’elle s’en soit rendu compte, sans toutefois aller jusqu’au bout de l’acte, jusqu’à ce qu’il y a au bout de la destruction, c’est-à-dire la folie. La folie, c’est Alissa, l’inacceptation de tout état de fait, la destruction de tout le passé, c’est-à-dire de toutes les habitudes.
Les personnages maintenant : qui sont-ils ? Il y a en fait deux forces en action, deux clans qui s’opposent, ceux qui sont tournés vers l’avenir, qui savent ce que les autres ne savent pas, qui ne savent même pas qu’il y a à savoir, qui sont leurs habitudes.
Stein sait. Il sait au-delà de la folie, vers ce vide qui est au-delà. C’est un sage, une sorte de moine, pourrait-on dire. Il se refuse à tout, à tout ce qui semble constituer la vie de chacun, le mariage, un métier, des projets. Il peut se permettre de faire des choses que les autres ne feraient pas, qu’ils appelleraient indiscrètes. Les autres ne l’intéressent pas vraiment. Il les regarde comme on regarde un troupeau. Lui-même ne l’intéresse pas, il se regarde comme il regarde les autres, sans retenue aucune (quelques fois j’entends ma voix, dit-il).
07:25 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, littérature, duras, philosophie, vie |  Imprimer
Imprimer
08/11/2017
L’éruption du Krakatoa, de Simone Jacquemard
L'éruption du Krakatoa ou des chambres inconnues dans la maison, tel est le titre exact du roman de Simone Jacquemard, paru en 1969.
Ces chambres, ce sont toutes les pièces que nous ignorons nous-mêmes, toutes ces chambres qui n’ont pas encore été explorées et que Simone Jacquemard fouille comme on fouille un grenier, au hasard, d’un objet à l’autre.
Exploration d’une conscience, celle d’Anne, sensibilisée à l’extrême par la souffrance. Nous pénétrons dans le monde extraordinaire de l’imagination et du rêve. Tout se déroule pêle-mêle, le passé le plus proche et le plus personnel, un passé collectif et lointain, la réalité et l’imagination aiguisée par la connaissance, la perception de l’intimité de l’être dans sa construction microscopique, tout cela tournant, s’enroulant en spirales autour d’une idée fixe, faire face à la mort, tenir aux limites mêmes de la mort, vivre encore dans cette zone d’inconscience qui la précède.
Il s’agit bien d’une éruption, d’un éclatement de toutes les couches superposées de la conscience qui fait remonter à la surface le magma primaire d’une conscience collective que nous portons en nous et qui contient le vieux rêve de l’homme, celui de l’immortalité et de la fusion de l’être dans la matrice nourricière de l’univers.
« Tout d’abord l’image s’est imposée d’une bouche, d’un certain cratère de volcan par quoi est déversée sur le monde une certaine sève possiblement mortelle, mais limpide, faite de force et de conscience. Et cette bouche, j’ai compris qu’elle était celle des voyants, des sages, des prophètes dont le rôle d’intermédiaires est d’autant mieux rempli qu’ils sont indemnes de tout désir, de tout égocentrisme (et ce n’est pas le désir, le plaisir qui sont condamnables, mais le temps, l’énergie et la transparence qu’ils font perdre). L’unique fonction de certains vivants serait d’être traversés par la lumière qu’ils attirent comme le paratonnerre la foudre, puis de divulguer vaille que vaille les détails de ce formidable assaut. En laissant couler d’eux sans en rien garder ce qu’ils ont reçu. Car la lumière cesse d’affluer s’ils ne se départent pas aussitôt, eux devenus ne chenal d’une eau clairvoyante. »
07:55 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, psychologie, étrange, conscience |  Imprimer
Imprimer
03/09/2017
Le planétarium, de Nathalie Sarraute
Le planétarium, c’est cette immense grotte de la conscience où les mots des autres viennent raisonner avec une force incroyable, ébranlant la juste répartition des astres, l’équilibre méticuleusement échafaudé des orbites qui oblige à bien des concessions, à beaucoup de revirements. En avançant dans ces pages pleines d’ombres contradictoires, on découvre que c’est dans la nature même du planétarium d’être aussi fluctuant, aussi soumis à n’importe quel événement, à un mot, à un geste, un regard qui bouleverse entièrement l’équilibre qui venait à peine d’être rétabli.
Nathalie Sarraute, dans cette histoire qui n’en est pas une, dans cet épisode de la vie d’un jeune couple mi- bourgeois, mi- intellectuel et de ceux qui l’entourent (des parents snobs, une tante maniaque, un écrivain qui n’est qu’une femme comme les autres, mais dont la notoriété leur fait peur) n’a pas cherché à décrire directement un certain milieu, une certaine manière de vivre, mais plutôt la manière d’être intime de chaque personnage et, en particulier, sa manière d’être en face d’un autre. Elle traite de cet affrontement perpétuel dans la rencontre de deux êtres, des pensées brèves provoquées par cette rencontre et de leur camouflage en paroles, adoucies, amadouées, domptées, convenables et raisonnables.
L’analyse et excellente, mais l’homme ne serait-il qu’un spéculateur perpétuel dans ces rapports avec autrui ? Pas une ombre de spontanéité, et c’est pourtant elle seule qui fait le plaisir des rapports humains.
07:04 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, littérature, société, psychologie |  Imprimer
Imprimer
03/07/2017
Les choses, roman de Georges Perec (1965)
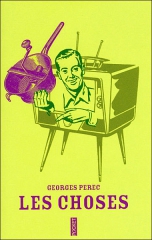
Sans doute fruit d’une longue enquête sociologique, ce roman est celui du mal moderne, c’est-à-dire de cette absurde quête actuelle du bonheur dans « les choses », tout ce qui s’étale sur les affiches, qui fait envie, qui se vend, qui s’achète enfin si l’on possède de l’argent. Telle est la course au bonheur de ce jeune couple, semblable à des milliers d’autres. Et cette course demeure vaine, faite d’envies aussitôt épuisées ou jamais soulagées.
Roman insipide, car il fait un étalage abusif de ces choses qui seront le bonheur, un bonheur dans lequel rien ne vient éclairer cette vaine recherche d’un bien-être matériel.
07:38 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, vie, but de la vie |  Imprimer
Imprimer
10/04/2017
L’état du ciel, de Pierre Péju
Est-ce l’histoire d’un ange déjà déchu ou d’un couple en perdition ? Les deux sans doute sans que l’on sache au début qui fait quoi. Histoire bizarre que celle de l’ange, histoire banale que celle du couple.
L’histoire de l’ange : Aujourd’hui Dieu est mort, ou peut-être hier, je ne sais pas. (…) Nous, ses anges, sommes donc livrés à nous-mêmes. Sans emploi, sans mission. (…) Nous pouvons fouiller dans vos boites crâniennes, essuyer du doigt vos pensées sur les parois de verre de vos âmes comme sur un pot de confiture. Accoudés à nos balcons dorés, nous nous penchons encore un peu au-dessus de vos existences afin de tromper notre ennui. (…) Et pourtant, moi, Raphaël, j’aimerais beaucoup faire un dernier petit tour chez vous, malheureux mortels. Suis-je encore capable d’accomplir ne serait-ce qu’un minuscule miracle ? Le ciel s’ouvre. Le hasard fait – mais est-ce le hasard ? – que là-bas, tout en bas, dans une maison construite à flanc de montagne, surplombant un lac dont les reflets font paraître le ciel plus beau j’aperçois une femme endormie. Le jour se lève. Le coton de sa chemise de nuit fait une vive tache blanche au centre de ma vision angélique. Elle est seule dans son lit. Allongée dans son désespoir et ses draps froissés. Je me dis que je pourrais peut-être faire quelque chose pour elle… Mais quoi ?
Là commence l’histoire du couple : Elle, elle peint. Ou plutôt, elle peignait. A présent, elle est devenue une sorte de femme des bois et se sert de branches, de mousses et de roches pour confectionner des monstres dont on ne sait s’ils sortent de sa tête ou de la nuit des temps, mais l’accablement et la douleur n‘avaient pas eu raison de cet appétit d’ogresse. Rien ne va plus depuis l’accident et son mari n’en peut plus. Après avoir lui-même frôlé la mort, il décide de partir et de la laisser.
C’est un récit quelque peu bateau de par ses rebondissements, un récit presque midinette. Mais il est mené tambour battant, avec l’allant et la vigueur de Pierre Péju. L’ange y joue son rôle, la femme également ainsi que l’homme. L’ange s’enchante de réconcilier les deux, mais des grains de sable enraille la mécanique. L’ange sera déchu, le couple se réconciliera après l’irruption de nouveaux personnages. Mais il ne faut pas dévoiler ces deux histoires…
07:15 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, littérature, péju, histoire |  Imprimer
Imprimer
18/07/2016
Le roman ou la vie
Il est quatre heures. La première partie de la nuit est finie. La fenêtre ouverte m’envoie les premières lueurs du jour, ténues, mais réelles. Je descends l’escalier, prépare la cafetière, y verse l’eau, mets un filtre que je saupoudre de farine de café. Je finis un roman, Après l’équateur, de Baptiste Fillon. Je ne sais qu’en penser. Il y a une qualité de l’écriture et des descriptions rudes, en bourrasques. On discerne l’évolution du style lorsqu’on avance dans les pages. Première partie : la mer, le long cours, la vie de l’équipage. Deuxième partie, comme un prélude : quelques jours chez sa maîtresse, au Brésil avec laquelle il a eu un enfant. Il ne sait s’il veut rester auprès d’elle ou rejoindre sa famille officielle. Troisième partie : le retour au foyer, où la colère du marin vis-à-vis de l’inutilité de cette vie bourgeoise éclate. Je ferme le livre.
Un sentiment de vide, d’inexistence, de tromperie permanente quel que soit le lieu, le moment, les interlocuteurs et les circonstances. C’est à l’image de l’actualité. Aucune certitude, aucune raison d’être, la vie au jour le jour, sans aspiration, sans guide, sans espoir. Depuis quelques mois, j’ai ce sentiment devant les livres que j’ouvre. Ils ne m’enrichissent pas, ne me font pas rêver, ne me permettent plus de sortir de moi-même et d’errer dans le monde avec un but précis. Oui, le livre est fini. Je n’ai rien appris sur la vie, c’est toujours le même rabâchage d’existences ratées en relents d’aventure qui sentent l’amertume et la capitulation. Et la fin est à l’image du fil des pages. Il part pour son dernier embarquement. Il rejoint sa deuxième femme, la non-régulière. Mais en est-on sûr et qu’y trouvera-t-il ?
Je n’écris cela qu’après coup. Je n’ai pas immédiatement ces réflexions toutes empaquetées. Je suis assis dans la cuisine et je regarde les étagères emplies de bocaux et poteries. Mes yeux s’éclaircissent, l’éclat des verres s’accentue, mon cerveau se vide, une énorme bulle d’air m’emplit le cœur, elle monte vers la surface du moi et explose. La cuisine s’illumine, se nettoie de ses scories et je suis là, vierge de toutes sensations, éveillé et dégrisé du quotidien. Je regarde chaque bocal, chaque objet avec un œil nouveau, propre et aiguisé. Assis, ici et maintenant, je vis hors du remue-ménage quotidien des sensations, émotions, sentiments et réflexions. Oui, cela, on ne trouve pas dans un livre !
07:19 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, vie, existence, réalité, rêve |  Imprimer
Imprimer
01/03/2016
La souille, de Franz-Olivier Giesbert
Au commencement était le Verbe. Je suis là pour le prouver. Depuis toujours, j’ai quelque chose qui parle en moi. C’est comme un murmure de l’autre monde, avec un fond musical. Je ne sais pas d’où cela vient, mais je suis sûr que cela vient de loin.
Ainsi commence ce beau roman de Franz-Olivier Giesberg qui finit sur ces lignes :
Aujourd’hui, rien ne m’accroche plus au monde, pas même Epiphanie qui n’est plus que l’ombre d’elle-même avec ses épaules tombantes et sa beauté bridée. Je suis en train de me détacher de moi-même pour retrouver le cours de l’univers qui s’avance sans fin ni commencement, en écrasant tout sur son passage, les grands comme les petits, les coupables comme les innocents, pour réaliser son destin. Ainsi est le Verbe.
C’est un roman à la Giono, truculent, mélancolique, vivant comme le serpent dans l’herbe sauvage. Il est raconté par Jésus, un garçon de ferme qui vit en communion avec le monde des bêtes, de la forêt et du vent. A la mort de son patron, débarque par l’autocar une étrange demoiselle qui dit s’appeler Epiphanie et qui prétend ne vouloir jamais rien perdre de sa vie. Il décida qu’il serait son ange gardien et se demanda si elle ne deviendrait pas aussi le sien. Il y a des gens d’une telle beauté qu’on se sent protégé rien que de les regarder. Elle arrive à la ferme, demande Maxime, le fils du patron, et est envoyée par une agence matrimoniale. Madame Ducastel, sa mère, la veuve du patron, interroge « Vous allez vous marier quand ? ».
sauvage. Il est raconté par Jésus, un garçon de ferme qui vit en communion avec le monde des bêtes, de la forêt et du vent. A la mort de son patron, débarque par l’autocar une étrange demoiselle qui dit s’appeler Epiphanie et qui prétend ne vouloir jamais rien perdre de sa vie. Il décida qu’il serait son ange gardien et se demanda si elle ne deviendrait pas aussi le sien. Il y a des gens d’une telle beauté qu’on se sent protégé rien que de les regarder. Elle arrive à la ferme, demande Maxime, le fils du patron, et est envoyée par une agence matrimoniale. Madame Ducastel, sa mère, la veuve du patron, interroge « Vous allez vous marier quand ? ».
Ce roman est l’histoire d’Epiphanie, adulée, puis battue et rejetée par Maxime, remplacée par Mademoiselle Avisse, Astrid de son prénom, la fille du château dont la mère a été sauvagement tuée et dont on recherche le coupable. Il y a d’autres personnages, dont Monsieur l’Abbé d’Hauteville qui sent tout, voit tout et qui combat le mal. Nous ne le raconterons pas, ce serait dévoiler ce qui fait la beauté du livre.
Chaque épisode de cette triste aventure est entrecoupé de la vie de la forêt et de ses animaux, dont le sanglier Baptiste qui rêve de sa souille et finit en cuissot : un jour, il faudra chanter l’excrément. C’est du rebut de vie, l’excrément, mais c’est aussi du germe de vie. (…) La nature recycle tout, la vie comme la mort. Elle ne fait pas la différence. Il suffit parfois d’une bouse sans un clos pour qu’enfin le monde renaisse. C’est pourquoi on aime tant le fumier, à la campagne. Tout ressuscite en lui.
Un roman où la mort est comme la vie, un paysage où l’on chemine sans y penser jusqu’au jour où plus rien ne vous y attache. C’est ce jour-là que l’on comprend la vie et qu’on accepte la mort.
07:13 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, littérature, nature, beau, passion, amour |  Imprimer
Imprimer
05/12/2015
La nuit de feu, d’Éric-Emmanuel Schmitt
« A vingt-huit ans, Éric-Emmanuel Schmitt entreprend une randonnée dans le grand sud algérien. Au cours de l’expédition, il perd de vue ses compagnons et s’égare dans l’immensité du Hoggar. Sans eau ni vivres durant la nuit glaciale du désert, il n’éprouve nulle peur mais sent au contraire se soulever en lui une force brulante. Poussière d’étoiles dans l’infini, le philosophe rationaliste voit s’ébranler toutes ses certitudes. Un sentiment de paix, de bonheur, d’éternité l’envahit. Ce feu, pourquoi ne pas le nommer Dieu ? » (Quatrième de couverture)
Un très beau livre qui révèle l’irruption de l’inconnu totalement autre à l’homme moderne qui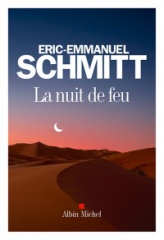 ne croit qu’en ce qu’il voit. L’auteur découvre l’infini en une impression plus forte que toutes les pensées apprises. En Europe, les intellectuels tolèrent la foi, mais la méprisent. La religion passe pour une résurgence du passé ; nier, c’est devenir moderne. (…) Un préjugé chasse l’autre. Jadis les gens croyaient parce qu’on les y incitait ; aujourd’hui ils doutent pour le même motif. Dans les deux cas, ils s’imaginent penser alors qu’ils répètent, qu’ils mâchouillent des opinions, des doctrines de masse, des convictions qui ne seraient peut-être pas les leurs s’ils réfléchissaient.
ne croit qu’en ce qu’il voit. L’auteur découvre l’infini en une impression plus forte que toutes les pensées apprises. En Europe, les intellectuels tolèrent la foi, mais la méprisent. La religion passe pour une résurgence du passé ; nier, c’est devenir moderne. (…) Un préjugé chasse l’autre. Jadis les gens croyaient parce qu’on les y incitait ; aujourd’hui ils doutent pour le même motif. Dans les deux cas, ils s’imaginent penser alors qu’ils répètent, qu’ils mâchouillent des opinions, des doctrines de masse, des convictions qui ne seraient peut-être pas les leurs s’ils réfléchissaient.
Au cours de ce voyage initiatique, il rencontre d’abord Abayghur, un touareg beau, élancé, magistralement vêtu de lin indigo, la tête ceinte d’un chèche blanc. Ses traits avaient été dessinés avec précision et distinction par la main inspirée de la nature, profil d’aigle, lèvres nettes, iris perçants, l’ensemble gravé sur une peau d’un brun calciné. Cet homme du désert n’est pas pressé à l’image de l’occidental. Il a le temps, le temps de l’éternité et de l’amour. Il passe devant celle qu’il aime sans un mot ni un regard sur elle. Et pourtant, tu es plus belle qu’un dattier chargé de fruits sucrés, plus touchante qu’une promesse de pluie, plus rayonnante que les cristaux de glace au cœur de l’hiver. Tous les hommes t’admirent. Tu es ma rose du Hoggar, la lune blanche, la fille de l’étoile, l’incomparable, l’uni que, ma montagne rose, mon amphore brune. Tu es la fille bleue.
Celui-ci, plus par son attitude que par un comportement ouvert, va le préparer à cette rencontre avec l’inconnu. Il passe en une nuit de l’angoisse, cette obsession de la pensée moderne, à la béatitude. Cette angoisse m’avait condamné à la solitude et l’arrogance, me propulsant comme seul pendant au milieu d’un univers qui ne pensait pas. A l’inverse de l’angoisse, la joie m’avait intégré au monde et mis en face de Dieu. La joie me conduisait à l’humilité. Grâce à elle, je ne me sentais plus isolé, étranger, mais fécondé, uni. La force qui tenait le Tout grouillait également en moi, j’incarnais l’un des maillons provisoires. Si l’angoisse m’avait fait trop grand, la joie m’avait ramené à de justes proportions : pas grand par moi-même, plutôt grand par la grandeur qui s’était déposée en moi. L’infini constituait le fond de mon esprit fini, comme un bol qui aurait contenu mon âme.
Et maintenant, il s’intéresse à la question de Dieu plutôt qu’à la réponse des hommes. Il ne veut pas être croyant ou athée, car ceux-ci se cramponnent à des solutions simples, croire, ne pas croire, montrant un appétit suspect d’opinions catégoriques. Ni l’un l’autre ne supportent le cheminement, le doute, l’interrogation. En affirmant leur choix, il ne voulait pas penser, mais en finir avec la pensée. Ils ne désiraient qu’une chose : se délivrer du questionnement. Un souffle de mort figeait leur esprit.
Sa conclusion : lorsqu’on a rencontré la sollicitation de l’invisible, on se débrouille avec ce cadeau. Le surprenant, dans une révélation, c’est que, malgré l’évidence éprouvée, on continue à être libre. Livre de ne pas voir ce qui s’est passé. Libre d’en produire une lecture réductrice. Libre de s’en détourner. Libre de l’oublier.
07:07 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, littérature, sahara, mysticisme, charles de foucault |  Imprimer
Imprimer
21/10/2015
Le goût des femmes laides, de Richard Millet, Gallimard, 2015
Le cœur de l’homme change le visage et le rend ou bon ou mauvais.
Ecclésiastique, XIII, 31
Je suis laid, ai-je dit à ma sœur. Elle a haussé les épaules. C’était le jour du romanichel. J’étais allé la trouver, non dans sa chambre où, pas plus que dans celle de la mère ; je n’avais le droit de pénétrer, ayant très tôt compris (avant même que me soit révélée la vérité sur mon visage) qu’il y a le domaine des femmes et le reste du monde, et que le reste du monde est encore le domaine des femmes, celles-ci n’ayant pas seulement la moitié du monde mais, d’une certaine façon, une terre inconnue où les hommes tentent d’établir un campement, un plus ou moins heureux bivouac, malgré les apparences qui leur donnent l’illusion d’être les maîtres.
Un livre où la laideur occupe tout l’espace et s’y roule avec délice. Et malgré tout un beau livre, écrit d’une plume distinguée, dans un français du XIXème siècle, presqu’à la manière de Marcel Proust.
Je suis laid, ai-je répété devant ma sœur, immobile sur le seuil de sa chambre (…). Tu sais, on ne doit pas se fier aux apparences, même si les évidences semblent contre toi, m’a dit ma sœur. (…) Non, je ne savais rien, je ne comprenais rien, encore moins pourquoi elle ne me disait pas non pas que j’étais beau, mais que je n’étais pas laid.
Que dire ? J’étais dans la certitude du pire. Je venais d’avoir la révélation d’une vérité que j’étais désormais obligé de faire mienne ; une sorte de puberté précoce. Ma sœur était trop honnête pour me mentir, même pieusement, et trop soucieuse, elle aussi, de cette vérité sur soi qu’à dix-huit ans elle cherchait en silence, à sa façon, dans la langue, « dans ces maudits livres » disait ma mère, et dans ce qu’elle appelait l’usage de la vie, ce qui la rendait aussi incapable de me mentir que de me consoler, ou de me souffler de ces demi-vérités par lesquelles on tente de laisser les choses en suspens.
Alors ce jeune homme, puis cet homme va passer sa vie à hanter les femmes laides, ou, du moins, le disait-il au début. Puis ce furent celles dont la beauté était dérangée par un défaut visible, puis, plus tard, invisible. Enfin les femmes belles, reconnues comme telles par le commun des mortels, mais dont toujours il s’efforçait de trouver un lieu de laideur pour être contenté de se trouver laid.
Un jour, une sorte de jeune premier lui dit :
– Personne n’est beau. Il n’y a que les femmes qui peuvent être belles.
– Les femmes, seulement ?
– Oui, elles sont toutes belles.
– Toutes les femmes, Jean ?
– Toutes, même celles qui ne sont pas bien belles.
Et le livre conte toutes les conquêtes de cet homme laid, très laid. Il raconte également celles-ci à sa sœur pour y découvrir ce qu’il recherche. Et elle lui répond :
Une femme est toujours une femme, quels que soit son âge, sa beauté, son absence de beauté, incapable elle aussi de sortir vraiment d’elle-même, quoi qu’on dise à ce sujet.
Elle ajouta, en refermant les persiennes de son salon sur une nuit claire et chaude, qu’il me fallait en finir, me mettre à un livre, peut-être, non pour devenir écrivain, sur le tard, mais parce que j’étais le seul à pouvoir écrire sur la beauté. (…) Un récit, pourquoi pas, c’est-à-dire une sorte de conte, la fin de quelque chose et le commencement d’une autre.
Et il attend qu’une femme très belle vienne enfin à moi pour démentir ma laideur, le réduisant en cendres, le faisant oublier ce que je suis et me donnant mon vrai visage, celui qui était le mien avant que je ne rencontre le regard de ma mère, bien que je sache que rien ne changera pour moi, que tout recommence et finit de la même façon, pour les laids comme pour les autres, dans la défaite, l’absence ou l’impossibilité de l’amour qui aura été notre seule manière d’aimer ici-bas.
07:30 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, femme, beauté, laideur, société |  Imprimer
Imprimer
02/09/2015
Coup-de-fouet, roman de Bernard du Boucheron
Est-ce un roman ou une biographie, l’histoire d’un homme ou d’un affrontement entre deux hommes, le lieutenant et le piqueux, la fin d’une société qui n’a plus sa place dans le monde moderne ? C’est sans doute un peu tout et cela complique quelque peu la compréhension du livre.
L’auteur connaît bien le monde de la vénerie. Il s’en régale, la décrivant de courtes phrases, rapides comme le galop du cheval favori du lieutenant Hugo de Waligny, Diamant Noir. On s’y parle courtoisement, mais avec sécheresse. C’est un peu forcé, mais c’est assez proche de la vérité. Un monde d’une autre époque, mais qui existe encore, comme un reflet dans une vitre. Le lieutenant ne brille que par exagération, dans sa manière de chasser, de monter, de parler aux femmes, d’affronter le peuple. C’est une caricature, mais cela existe.
courtes phrases, rapides comme le galop du cheval favori du lieutenant Hugo de Waligny, Diamant Noir. On s’y parle courtoisement, mais avec sécheresse. C’est un peu forcé, mais c’est assez proche de la vérité. Un monde d’une autre époque, mais qui existe encore, comme un reflet dans une vitre. Le lieutenant ne brille que par exagération, dans sa manière de chasser, de monter, de parler aux femmes, d’affronter le peuple. C’est une caricature, mais cela existe.
L’auteur connaît moins bien le monde de la vraie l’équitation, sinon de manière mondaine. Le chapitre 10, compte-rendu de diverses courses montées par le vicomte, fait plus amateur que professionnel. C’était le monde des gentlemen riders d’autrefois. Depuis, ils sont devenus des quasi professionnels.
L’auteur parle de la guerre, mais une guerre à cheval, de la première année de la première guerre mondiale. Elle semble irréelle, comme un rêve qui passe dans l’affrontement titanesque entre le maître et le piqueux Jérôme Hardouin, dit Coup-de-Fouet. Ils se valent, se regardent et chacun veut en faire plus que l’autre. Cela se termine par un drame, le sacrifice d’un escadron de deux pelotons et la survie d’un seul, le capitaine de Waligny. Mais celui-ci est fou ou considéré comme tel.
La vie décline progressivement dans le corps de ce militaire dont la femme, la belle reine des amazones, rivalise avec lui d’échanges amères. Triste fin que celle de ce cavalier. Méritait-il celle-ci ?
C’est un beau livre, un peu pédant, un peu envoûtant à la manière du Grand Meaulnes, mais plus incisif et masculin. Dans toutes ces actions, on a du mal à s’y retrouver.
La vie s’en va, mais qu’est-elle ? On ne sait. C’est un théâtre auquel se confronte l’homme. La femme n’y est que décor, ce qui semble passé de mode.
07:20 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, littérature, vénerie, équitation, armée |  Imprimer
Imprimer
26/07/2015
La vie tranquille, de Marguerite Duras
Il ne se passe rien, ou plutôt pas grand-chose dans ce livre. L’histoire en elle-même ne présente pas d’intérêt. La vie d’une femme de vingt-cinq ans dans la ferme d’une famille pauvre. Et pourtant ils ont des émotions, des sentiments et des réflexions élevés dans l’écoulement monotone, et pourtant mouvementé, d’une vie sans divertissement.
Du mal à entrer dans le livre, puis du mal à en sortir. Au commencement, on y revient, même avec l’envie de tout laisser tomber. Puis on y revient pour un je ne sais quoi qui vous fait dire : « Que de beaux passages… Je retiens telle description, tel portrait, telle vision… » Enfin on prend conscience de la puissance de ce livre au fil des pages, jusqu’à lire, puis relire la plupart d’entre elles pour leurs évocations et leurs tendres descriptions.
Cela commence à la page 54 :
« Ça va être prêt, disait Luce Barragues, un peu de patience les garçons. » Et elle riait. Son manteau noir enlevé, elle est apparue dans une robe d’été. Pas très grande, mince, des épaules rondes, douces, ensoleillées. Elles avaient les cheveux noirs qui caressaient son cou et qui remuaient, remuaient sans cesse, des yeux bleus, un visage très beau, très précis qui se défaisait continuellement dans un rire silencieux. On croyait la connaître. (…)
Et toujours Luce :
Je l’ai embrassée dans ses petites rides, sur ses paupières fanées et le long de son front, au bord de ses cheveux, là où elle ne sait pas qu’existe l’odeur d’une fleur. Elle s’est éloignée, puis j’ai entendu qu’elle parlait à papa de la bonne soirée qu’ils avaient passée. J’ai pensé que nous avions des parents pour nous permettre seulement de pouvoir les embrasser et sentir leur odeur, pour le plaisir.
La narratrice :
Il fait frais, la nuit est noire. Des bandes jeunes gens passent en rafales rieuses dans les rues. J’entends la mer. Je l’ai déjà entendu quelque part ce bruit, il me rappelle un bruit connu. ( …) Les pieds devant moi, sous moi, derrière moi, ce sont les miens, les mains à mes côtés qui sortent de l’ombre et y retournent suivant la succession des réverbères, je souris… Comment ne pas sourire ? Je suis en vacances, je suis venue voir la mer. Dans les rues, c’est bien moi, je me sens très nettement enfermée dans mon ombre que je vois s’allonger, basculer, revenir autour de moi. Je me sens de la tendresse et de la reconnaissance pour moi qui viens de me faire aller à la mer. (…)
L’air sent le fard et la peau brûlée de soleil. Sur la banquette il y a de beaux bras nus, des seins tendus sous des écharpes rouges, jaunes, blanches. Ils rient. Ils rient de tout. Ils essaient chaque fois de rire davantage de tout. Derrière leurs rires inégaux on entend le bruit bleu et râpeux de la mer.
Ailleurs dans sa chambre, seule :
J’ai regardé ma robe jetée sue le lit de la chambre. Mes seins lui on fait deux seins, mes bras, deux bras, au coude pointu, à l’emmanchure béante. Je n’avais jamais remarqué que j’usais mes affaires. Je les use. La robe luit au bas du dos, à la taille. Sous les aisselles, elle est déteinte par la sueur. J’ai eu envie de m’en aller, de laisser cette robe à ma place. Disparaître, m’enlever.
Et plus intimement :
Il m’arrive de me regarder (…) et de me trouver belle. Je me sens émue devant la régularité de mon corps. Ce corps est vrai, il est vrai. Je suis une personne véritable, je peux servir à un homme pour être une femme. Je veux porter des enfants et les mettre au monde, car dans mon ventre, il y a aussi cette place faite exprès pour les faire. Je suis forte, grande et lourde. (…) Ma chaleur m’entoure et se mêle à l’odeur de mes cheveux. Je n’en reviens pas de ma peau nue, fraîche, bonne à toucher, de cette préparation parfaite faite pour accueillir les richesses ordinaires. Je me plais. Je m’étonne de ne pas plaire aux autres autant que je me plais. Il me semble que cette grâce que je me trouve est d’une espèce que l’on ne peut pas aussi bien voir, qu’on n’entend pas aussi facile.
Les phrases coulent, seules, dans une sécheresse doucereuse, évoquant peu de choses, comme un souvenir lointain derrière la brume du matin, une ombre de réminiscence dans la crudité des choses. On se sent immergé dans le bonheur de vivre, d’aimer, de méditer. Autour de soi, rien ne se passe, rien d’intéressant. Et pourtant. On ne donnerait sa place pour rien au monde.
Il est rare, très rare, d’aimer un livre non pour l’histoire qu’il raconte, mais pour son style envoûtant, si évocateur d’une vie pleine et pourtant sans action. Et la narratrice poursuit sa vie tranquille en épousant celui qu’elle aimait, le sachant sans le savoir.
Lorsqu’il est revenu, je lui ai demandé d’arrêter là notre visite. J’étais fatiguée. Je voulais dîner et que nous montions ensemble dans ma chambre. Je voulais dormir avec lui. Il est venu auprès de moi et il m’a pris ma tête contre son cou, il m’a serrée très fort, il m’a fait mal. Je ne lui ai rien demandé. Il m’a dit qu’il n’avait même pas pu toucher Luce Barragues parce que c’était de moi qu’il avait envie.
Il faisait noir, une nuit d’octobre, fraîche d’orage.
08:19 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, solitude, vie quotidienne |  Imprimer
Imprimer
07/04/2015
Entretiens de François Cheng avec Françoise Siri (Albin Michel, 2015)
François Cheng, poète, essayiste et sage venu de l’autre bout du monde, est devenu l’une des figures les plus appréciées du public.
Au fil de cinq entretiens sur France Culture (À voix nue), Françoise Siri, journaliste, « passeuse » de poésie et créatrice d’événements littéraires, a voulu en savoir plus sur son parcours. De son enfance chinoise à l’Académie française, François Cheng raconte la misère de ses premières années en France et son apprentissage de la langue. Sur un ton très personnel, il dévoile ses sources d’inspiration et sa pensée intime, évoquant la beauté, la mort, le mal – ses thèmes de prédilection – mais aussi la méditation telle qu’il la pratique, l’amitié, l’amour… et même la pâtisserie française dont il se délecte !
Ces entretiens passionnants sont suivis de douze poèmes inédits. Autant de moments de simple et subtile profondeur.
(4ème de couverture)
En premier lieu, il est beau, cet homme. Bien qu’il ait 86 ans, o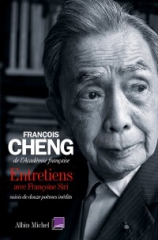 n dirait un poupon espiègle. On a envie de le serrer dans nos bras pour le remercier de tout ce qu’il nous donne à travers ses écrits.
n dirait un poupon espiègle. On a envie de le serrer dans nos bras pour le remercier de tout ce qu’il nous donne à travers ses écrits.
En deuxième lieu, il a un regard de bonté. Bien qu’il ait traversé de nombreuses épreuves, il espère toujours de la vie et nous aide à comprendre l’infinie aventure de chaque existence humaine.
En troisième lieu, il est universel. Il n’est pas Chinois, il n’est pas Français, il est l’homme accompli qui a transgressé la matrice originelle et s’est réalisé non pas entre l’Orient et l’Occident, mais dans les deux traditions montrant ainsi l’universalité de la culture.
La mort n’est point notre issue,
Car plus grand que nous
Est notre désir, lequel rejoint
Celui du Commencement,
Désir de vie.
C’est ce qu’il appelle la voie christique : « Pour moi, dans la voie christique, nos désirs et nos espérances, nos épreuves et nos souffrances ne sont pas seulement des données objectives ; ils sont incarnés et pris en charge. Ils trouvent leur réponse dans l’amour absolu. (…) Si l’on ne croit pas à une transcendance, on ne peut pas pardonner. »
Il nous parle des différences entre la poésie chinoise et la poésie française. La première fondée sur les idéogrammes : chaque caractère comptant pour une syllabe, on peut les combiner de façon très libre : deux caractères, trois, quatre… dix, douze… Cet art combinatoire est très développé. Je l’ai un peu introduit en française, en variant la longueur des vers. La seconde fondée sur l’être des mots : je pense par exemple à l’un de mes poèmes qui joue sur la différence entre brisure et brise, la brisure se transforme en brise. Je songe à d’autres exemples comme violette violentée, rouge-gorge égorgé, j’aime combiner les images à partir des sons. (…) Il dit alors un poème consacré à la nuit, par rapport au mot jour :
Nuit qui réunit
Nuit qui désunit
Qui diminue
Qui démunit
Rien qui ne soit jamais aux abois
Aux abois ceux qui s’éveillant se souviennent
Car la nuit avait beau tendre sa toile
Sur l’océan s’est égarée une voile
Nuit qui essuie
Nuit qui guérit
Qui déconseille
Qui désemplit
Rien qui en soit désormais à l’abri
A l’abri ceux qui se souvenant reviennent
Car la nuit s’est déchiré le voile
Une seule flamme unit toutes les étoiles.
Enfin, François Cheng nous parle de la méditation, de la beauté, du mal, de la mort : La beauté procure du sens au plein sens du mot, c’est-à-dire « sensation, direction, signification ». Sensation : la beauté s’éprouve d’abord par la sensation. Direction : attiré par la beauté, on se dirige d’instinct en sa direction. Signification : quand on se dirige dans une direction, notre vie n’est plus une existence absurde, insignifiante, sans but ; elle entre dans la signification, c’est-à-dire qu’elle fait signe au monde et à la transcendance. De fait, c’est la beauté qui nous apprend à aimer.
07:05 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, interview, poésie, roman, langue française, chine |  Imprimer
Imprimer
04/02/2015
Soumission, roman de Michel Houellebecq
Autant que la littérature, la musique peut déterminer un bouleversement, un renversement émotif, une tristesse ou une extase absolues ; autant que la littérature, ma peinture peut générer un émerveillement, un regard neuf posé sur le monde. Mais seule la littérature peut vous donner cette sensation de contact avec un autre esprit humain, avec l’intégralité de cet esprit, ses faiblesses et ses grandeurs, ses limitations, ses petitesses, ses idées fixes, ses croyances, avec tout ce qui l’émeut, l’intéresse, l’excite ou lui répugne. Seule la littérature peut vous permettre d’entrer en contact avec n’esprit d’un mort, de manière plus directe, plus complète et plus profonde qui ne le ferait même la conversation avec un ami – aussi profonde, aussi durable que soit une amitié, jamais on ne se livre, dans une conversation, aussi complètement qu’on ne le fait devant une feuille vide, s’adressant à un destinataire inconnu. Alors bien entendu, lorsqu’il est question de littérature, la beauté du style, la musicalité des phrases ont leur importance ; la profondeur de la réflexion de l’auteur, l’originalité de ses pensées ne sont pas à dédaigner ; mais un auteur c’est avant tout un être humain, présent dans ses livres, qu’il écrive très bien ou très mal en définitive importe peu, l’essentiel et qu’il écrive et qu’il soit, effectivement, présent dans ses livres. (p. 10 et 11)
 Ce roman de Michel Houellebecq est à l’image de son auteur ce que Huysmans est à l’image de François, le héros du livre. Un étrange parallèle, mais qui est bien présent tout au long du livre sans que jamais il n’apparaisse clairement. Par exemple, le naturalisme prôné par Huysmans consiste à donner de la réalité une image précise, même si celle-ci est vulgaire ou immorale. C’est une méthode littéraire proche des méthodes des sciences naturelles puisque, d’après Auguste Comte, l’art obéit aux mêmes lois que la science. Ainsi, Taine s’efforce de découvrir les lois qui régissent la littérature. Il soutient que le contexte de l’œuvre littéraire, c’est-à-dire la race, le milieu naturel, social et politique et même sa date de création en font sa caractéristique et ses traits spécifiques. C’est également la pratique de Houellebecq dans ce roman où le héros, qui n’a rien d’un héros, disons l’habitant du livre, passe, comme dans un rêve, d’une société française supposée décadente à une société réglée et relancée par les lois de l’Islam. L’auteur se pose la question de la foi, bien petitement il faut le dire, sans grande conviction, mais avec sincérité, du moins dans les faits. Il fait preuve du même cynisme que Huysmans. Il soulève les questions et les laisse sans réponse. Ainsi François va dans la vie sans jamais provoquer son destin, le laissant aller où bon lui semble, en spectateur plutôt qu’en acteur. Il en vient à se convertir à l’Islam à l’image de la conversion facile qui consiste à ne dire que les mots suivants : « Je témoigne qu’il n’y a d’autre divinité que Dieu et que Mahomet est l’envoyé de Dieu ».
Ce roman de Michel Houellebecq est à l’image de son auteur ce que Huysmans est à l’image de François, le héros du livre. Un étrange parallèle, mais qui est bien présent tout au long du livre sans que jamais il n’apparaisse clairement. Par exemple, le naturalisme prôné par Huysmans consiste à donner de la réalité une image précise, même si celle-ci est vulgaire ou immorale. C’est une méthode littéraire proche des méthodes des sciences naturelles puisque, d’après Auguste Comte, l’art obéit aux mêmes lois que la science. Ainsi, Taine s’efforce de découvrir les lois qui régissent la littérature. Il soutient que le contexte de l’œuvre littéraire, c’est-à-dire la race, le milieu naturel, social et politique et même sa date de création en font sa caractéristique et ses traits spécifiques. C’est également la pratique de Houellebecq dans ce roman où le héros, qui n’a rien d’un héros, disons l’habitant du livre, passe, comme dans un rêve, d’une société française supposée décadente à une société réglée et relancée par les lois de l’Islam. L’auteur se pose la question de la foi, bien petitement il faut le dire, sans grande conviction, mais avec sincérité, du moins dans les faits. Il fait preuve du même cynisme que Huysmans. Il soulève les questions et les laisse sans réponse. Ainsi François va dans la vie sans jamais provoquer son destin, le laissant aller où bon lui semble, en spectateur plutôt qu’en acteur. Il en vient à se convertir à l’Islam à l’image de la conversion facile qui consiste à ne dire que les mots suivants : « Je témoigne qu’il n’y a d’autre divinité que Dieu et que Mahomet est l’envoyé de Dieu ».
Au-delà de ce lien personnel entre l’auteur et le narrateur du roman, on peut aussi considérer les aspects sociologiques de cette fable qui se déroule dans les années 2020 : l’image d’une France aux hommes politiques décadents et sans consistance, l'image de l'acceptation d'une réalité qui n’est en rien française, l'image d’une Education nationale sans volonté, oublieuse de la civilisation occidentale qui la fit. Au travers des réflexions de François, on perçoit la déliquescence d’une nation par manque d’affirmation de soi. Un endormissement face au volontarisme machiavélique du nouveau pouvoir. Les changements culturels se déroulent sans objection de la part des élites intellectuelles et politiques : à Dieu va, semble dire la nation, sans s’en émouvoir.
Le titre « Soumission » du roman est bien vu. C’est bien de cela qu’il s’agit : la modération devenue le maître mot des politiques se retourne contre leurs promoteurs. L’Islam engloutit le peu de considération que le pays a encore sur lui-même. Cette politique fiction, très personnelle, et romancée à la manière Houellebecq, pleine de réflexions, de morgue, de sexe et dans le même temps d’innocence et de regard neuf, laisse un goût amer, celui d’une société à la fois peu imaginable, mais réaliste, dont l’aveuglement est compensé par la poursuite d’une vie qui semble normale aux élites qui s’adaptent et maintiennent leurs pouvoirs au prix de multiples contorsions. Et les Français dans tout cela, que deviennent-ils ?
07:05 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, livre, soumission, avenir, société, occident |  Imprimer
Imprimer
30/12/2014
Le liseur du 6h27, roman de Jean-Paul Didierlaurent
Guilain Vignolles prend chaque jour le RER pour se rendre au travail. Et chaque jour, il devient le liseur, ce type étrange qui, tous les jours de la semaine, parcourait à haute et intelligible voix les quelques pages tirés de sa serviette. (…). Et à chaque fois, la magie s’opérait. Les mots en quittant ses lèvres emportaient avec eux un peu de cet écœurement qui l’étouffait à l’approche de l’usine.
Guilain est en charge d’une broyeuse de livres invendus, la Zerstor Fünf Hundert 500, un redoutable engin qui transforme sans pitié les pages en boue gluante. Il lui arrive de récupérer quelques feuilles volantes, jamais un livre complet, ni même un chapitre. Et il les lit dans le RER. Tous attendent cet instant qu’ils passent en rêvant. Arrivé à l’usine, Guilain rencontre le gardien à l’entrée, Yvon Grimbert, un "alexandrophile", qui lui déclame deux vers de sa composition :
« L’averse se précipite, soudaine et mystérieuse,
Cognant sur ma guérite en une grêle nerveuse. »
Pour se distraire et échapper à l’atmosphère pesante, il va voir fréquemment son ami Giuseppe qui s’est fait broyer les jambes par la machine. C’est lui qui le délivrera de cette vie ratée en trouvant le centre commercial où une jeune fille est dame pipi. L’épousera-t-elle ? On ne sait, mais cela semble bien parti.
Il est un jour invité par une vieille dame charmante à faire la lecture dans une pension appelée les Glycines, face à des vieillards qui se délectent de cet instant de plaisir. Jusqu’au jour où il amène avec lui Yvon, rasé de près, l’air plus guilleret que jamais, qui emporte l’adhésion et le relègue dans un rôle de valet de pied. Yvon séduit en un tour de main l’assemblée par quelques vers bien sentis :
« Dieu que ce hall est grand, comme il est imposant.
Nulle entrée ne peut être plus proche du firmament.
Heureux ses occupants, qu’ils savourent leur chance,
D’avoir si bel endroit pour terminer leur danse. »
Un livre à l’histoire loufoque, avec des personnages truculents. On se lasse cependant du récit qui traîne un peu en longueur. Il faut bien faire un roman. L’existence maussade et quelque peu solitaire du personnage principal déteint sur le lecteur. Mais le livre fait malgré tout rêver. Sa cocasserie est exemplaire et parfaitement réaliste. On a l’impression de passer entre les deux feuilles d’un livre à détruire et d’y laisser un peu de soi-même.
07:09 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, roman, société, poésie |  Imprimer
Imprimer
17/12/2014
La lenteur, roman de Milan Kundera
Le premier chapitre résume toute la thèse du livre et son cadre : L’envie nous a pris de passer la soirée et la nuit dans un château. (…) Je conduis et, dans le rétroviseur, j’observe une voiture derrière moi. La petite lumière à gauche clignote et toute la voiture émet des ondes d’impatience. Le chauffeur attend l’occasion pour me doubler. (…)
clignote et toute la voiture émet des ondes d’impatience. Le chauffeur attend l’occasion pour me doubler. (…)
L’homme ne peut se concentrer que sur la seconde présente de son vol ; il s’accroche à un fragment de temps coupé et du passé et de l’avenir ; il est arraché à la continuité du temps ; il est en dehors du temps ; autrement dit, il est dans un état d’extase ; dans cet état il ne sait rien de son âge, rien de sa femme, rien de ses enfants, rien de ses soucis et, partant, il n’a pas peur, car la source de la peur est dans l’avenir, et qui est libéré de l’avenir n’a rien à craindre. (…)
Quand l’homme délègue la faculté de vitesse à une machine tout change : dès lors, son propre corps se trouve hors du jeu et il s’donne à une vitesse pure, vitesse en elle-même, vitesse extase.
Pourquoi le plaisir de la lenteur a-t-il disparu ? (…) Un proverbe tchèque définit la douce oisiveté par une métaphore : ils contemplent les fenêtres du bon Dieu. Celui qui contemple les fenêtres du bon Dieu ne s’ennuie pas, il est heureux. Dans notre monde, l’oisiveté s’est transformée en désœuvrement, ce qui est tout autre chose : le désœuvré est frustré, s’ennuie, est à la recherche constante du mouvement qui lui manque.
Notre monde a certes gagné en vitesse, mais il a perdu sa capacité de bonheur, de plaisir. Il est froid et fait apparaître l’insignifiance et la lâcheté de l’homme moderne. Il s’appauvrit politiquement et culturellement et le paraître est devenu plus important que l’être. L’homme est dorénavant un « danseur » prêt à tout pour monter dans les sondages et ce faisant il n’existe plus, n’a plus ni morale, ni conscience, car quand les choses se passent trop vite, personne ne peut être sûr de rien, de rien du tout, même pas de soi-même.
Il faut cependant avouer que cette lenteur dont il fait l’éloge ne nous aide pas à comprendre le livre. Il m’a fallu de nombreux allers et retours pour commencer à entrevoir où il voulait en venir et je n’ai certes pas tout découvert et encore moins compris. La lenteur se déroule comme l’expiration d’un accordéon, un millefeuille de pliures qui cache de nombreux récits qui ne se relient pas forcément entre eux de manière explicite. Alors on a besoin de reprendre de l’air comme l’accordéon a besoin d’aspirer pour poursuivre sa complainte.
07:10 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, roman, thèse, lenteur, vitesse, oubli |  Imprimer
Imprimer
02/12/2014
Le petit garçon, roman de Philippe Labro
Le sujet du livre : le temps ! Il s’écoule à intervalles irréguliers, selon les souvenirs des événements qui le marquent. Petit garçon, je ne comprenais pas qu’il pût y avoir un ordre, un mouvement et que l’action des hommes fût conduite par ce qu’on appelle, commodément, la force des choses. (…) L’usine à Fabriquer le Temps ! J’en ferai la description dès le lendemain, au plus proche de mes frères ; il l’acceptera, comme je sais recevoir ses propres affabulations. A mesure que je lui parle, je me sens capable de la dessiner. S’élevant un milieu des champs du Tescou, ruisselante et luisante, on dirait une immense construction de pierres couleur de nuit, sans porte ni fenêtre. A l’intérieur, des hommes sans visage, habillés comme des minotiers, surveillent une structure compliquée faite de roues, courroies et pistons, qui tourne dans fin sur elle-même.
– Qu’est-ce qu’ils font ? demande mon frère.
Catégorique, je réponds :
– Ils font du temps. Si tu n’en as pas, tu peux aller en acheter. Les grandes personnes n’en ont jamais assez, elles y vont.
– Combien ça coûte ?
Je réponds que j’en ignore le prix.
Que d’aventures pour ce petit garçon dans la tourmente des secrets des grandes personnes pendant l’occupation dans le sud-ouest de la France. Le fil directeur du récit, même s’il n’est que peu évoqué, c’est son père, le pilier de la famille, en espadrilles, au comportement irréprochable, dans une ambiance délétère où les juifs en recherche de passeurs vers l’Espagne et les allemands en recherche des juifs se côtoient. Il vit tout cela à la hauteur de ses quatre ans et décrit avec faconde les personnages rocambolesques qui ont peuplés son enfance : l’Homme Sombre, possesseur d’une juvaquatre, Monsieur Germain, Madame Blèze qui fait naître des sourires sur les lèvres des hommes, Sam, oiseau incongru au nez pointu, la petite Murielle qui cherche on ne sait quoi dans l’obscur chemin des Amoureux, le général allemand qui vient loger chez eux dans la chambre des filles.
Tout est secret pour le petit garçon. Tout est énigme, merveille. Dans cette province tranquille, sans âge, des jardins, aujourd’hui ordinaires, étaient forêts de Brocéliande ; des routes, aujourd’hui banales, promettaient un danger palpitant et les demeures les plus modestes semblaient receler autant de situations rocambolesques, personnages farfelus, drames et trésors cachés.
La villa renfermait la famille et ses secrets bien gardés. Ils étaient consignés dans l’Album qu’ils remplissaient en cachette jusqu’au jour où ils montèrent à Paris. Son père estimait avoir légué à ses enfants suffisamment d’armes, c’est-à-dire suffisamment d’âme. Il les avait fait « monter à Paris » pour parfaire leurs connaissances ; peut-être avaient-ils été trop protégés au sein du paradis aujourd’hui perdu de la ville de province ; il apercevait, désormais, qu’ils trouveraient ici de quoi mettre à l’épreuve ce qui, en fin de compte, importait le plus : le caractère.
Il acheva la lettre par sa formule traditionnelle : « Adieu, petit, je te serre la main ».
Dehors, le taxi s’était éloigné et la rue n’exprimait rien, rien d’autre que son propre bruit, factice et neutre, comme la lumière du bec de gaz municipal.
07:55 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, livre, souvenirs d'enfance, temps, occupation, sentiments |  Imprimer
Imprimer
03/11/2014
Un homme effacé, roman d’Alexandre Postel
Toute société reposait sur un ensemble de fictions – notamment juridiques – destinées à introduire de la cohérence et de la continuité dans un monde qui en était cruellement dépourvu. (…) Ce n’était d’ailleurs pas un problème, à condition de se souvenir que ces fictions ne sont que des fictions. Car l’oubli de ce principe était la cause de toutes les erreurs judiciaires. Chaque fois que l’on condamnait un innocent, on ne faisait jamais que sélectionner la plus cohérente, la plus vraisemblable, en d’autres termes la plus fictive des hypothèses envisageables. (…) Il suffisait de choisir un homme effacé, timide, peu sociable ; de s’arranger pour glisser quelques images infâmes sur son disque dur ; et de laisser s’abattre sur lui les pulsions fictionnelles de la société toute entière.
Tiré de l’épilogue du roman, ce résumé exprime les réflexions que l’auteur a cherché à introduire : nul n’est à l’abri du système de cohérence de la société. Ce jour-là, où tout commença, Damien North n’arrive plus à connecter son ordinateur sur le réseau de la faculté. Résigné, il part vers le campus sans son ordinateur. Il croise Hugo Grimm et ne sachant quoi lui dire, lui demande : « Dites-moi, Hugo, vous aussi vous avez des problèmes avec internet en ce moment ? » Sans le savoir Damien vient de croiser celui qui sera à l’origine de tous ces ennuis. Arrivé à son bureau, l’attend Sophie, une étudiante, qui vient l’interroger sur les commentaires mis en note des corrections d’un devoir. Tentant de lui expliquer en quoi sa copie ne correspondait pas à son attente, il conclut : « Lire votre commentaire, c’est comme écouter une chorale qui ne chante pas juste. On applaudit par politesse, mais au fond, on pourrait tout aussi bien siffler. Je vous ai donné une notre…moyenne, mais rien ne m’aurait empêché d’être plus sévère ». Plus tard, il croise Macha Pavlik, dite Machette, qui le contraint à signer une pétition contre le fichier Télémaque, constitué par le gouvernement pour examiner leur mode de vie, leurs fréquentations et leurs croyances.
Toute est en place pour l’erreur judiciaire. Le jour même, un inspecteur vient saisir son ordinateur, l’arrête pour consultation et détention d’images à caractère pédopornographique. Il est incarcéré et son martyre commence. Condamné à cinq ans de prison, il se retrouve en prison. Ce n’est qu’au bout d’un temps infini pour lui que son avocat arrive un matin, le sort de prison et lui dit qu’Hugo a avoué dans une lettre être à l’origine de sa condamnation. Il avait copié ces images à l’insu de Damien sur l’ordinateur de celui-ci pour ensuite les mettre sur une clé USB. Il lui faut beaucoup de temps pour se remettre de cette aventure. Mais le pire reste à venir. Ces voisins l’épie et, peu à peu, lui découvrent de véritables sentiments de dépravé : il regarde les enfants bizarrement. Il souffre alors d’une asociabilité aigüe, se réfugie chez lui et passe son temps dans un arbre dans son jardin. Dénoncé par une voisine (il y avait des enfants qui baignaient dans une piscine à proximité), le voisinage se dit que ce n’est pas parce qu’il a été innocenté qu’il est à tout jamais innocent. Et le commissaire reprend son enquête. Damien alors abat l’arbre à la tronçonneuse et pleure assis sur son tronc. Le commissaire comprend toute la perversité de la société qui continue à accuser un innocent. Il s’efface et laisse vivre Damien qui reprend peu à peu une vie effacé et tranquille.
Un beau livre qui décrit l’hypocrisie des conventions sociales et des soupçons qui se transforment en preuve. Tous accusent Damien d’un crime qu’il n’a pas commis et la rumeur persiste, enfle jusqu’à l’absurde. Il y a toujours une part de vérité dans les accusations, même s’il est prouvé qu’elles sont fausses, n’est-ce pas ?
07:18 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, roman, judiciaire, tribunal, accusation, innocence |  Imprimer
Imprimer
08/10/2014
Dans le jardin de l’ogre, roman de Leïla Slimani
Elle veut être une poupée dans le jardin de l’ogre. Elle ne réveille personne. Elle s’habille dans le noir et ne dit pas au revoir. Elle est trop nerveuse pour sourire à qui que ce soit, pour entamer une conversation amicale. Adèle sort de chez elle et marche dans les rues vides. (…) Elle ramasse sur le siège en face d’elle un journal daté d’hier. Elle tourne les pages. Les titres se mélangent, elle n’arrive  pas à fixer son attention. Elle le repose, excédée. Elle ne peut pas rester là. Son cœur cogne dans sa poitrine, elle étouffe. Elle desserre son écharpe, la fait glisser le long de son cou trempé de sueur et la pose sur un siège vide. Elle se lève, ouvre son manteau. Debout, la main sur la poignée de la porte, la jambe secouée de tremblements, elle est prête à sauter. (…) « Adèle… » Adam sourit, les yeux gonflés de sommeil. Il est nu. « Ne parle pas. » Adèle enlève son manteau et se jette sur lui. « S’il te plaît. »
pas à fixer son attention. Elle le repose, excédée. Elle ne peut pas rester là. Son cœur cogne dans sa poitrine, elle étouffe. Elle desserre son écharpe, la fait glisser le long de son cou trempé de sueur et la pose sur un siège vide. Elle se lève, ouvre son manteau. Debout, la main sur la poignée de la porte, la jambe secouée de tremblements, elle est prête à sauter. (…) « Adèle… » Adam sourit, les yeux gonflés de sommeil. Il est nu. « Ne parle pas. » Adèle enlève son manteau et se jette sur lui. « S’il te plaît. »
Adèle se rhabille et lui tourne le dos. Elle a honte qu’il la voie nue. « Je suis en retard pour le travail. Je t’appellerai. » Comme tu veux, répond Adam.
Pourtant Adèle est mariée à Richard, médecin, et a un petit garçon de trois ans, Lucien. Ils semblent heureux. Elle aime son mari, son mari gagne bien sa vie, mais il n’est pas porté sur la chose. De plus, Adèle n’aime pas son métier. Elle hait l’idée de devoir travailler pour vivre. Elle n’a jamais eu d’autre ambition que d’être regardée. Alors elle cherche les hommes et, en premier, son patron. Elle a passé ses lèvres sur sa langue, très vite, comme un petit lézard. Il en a été bouleversé. La salle de rédaction s’est vidée, et pendant que les autres rangeaient les gobelets et les mégots éparpillés, ils ont disparu dans la salle de réunion, à l’étage. (…) Elle l’avait désiré pourtant. Elle se réveillait tôt chaque matin, pour se faire belle, pour choisir une nouvelle robe, dans l’espoir que Cyril la regarde et fasse même, dans ses bons jours, un discret compliment. (…) A quoi servait de travailler maintenant qu’elle l’avait eu ?
Mais un jour, Richard apprend cette double vie. Que va-t-il faire ? La répudier, continuer comme si de rien n’était ? Faire une scène mémorable ?
Malgré tous les efforts de Richard, elle dérive, elle plane dans son addiction. Il a attendu sur le quai. Elle n’était pas dans le train de quinze heures vingt-cinq. (…) Richard quitte la gare. Il est en apnée, affolé par l’absence d’Adèle, rien ne parvient à le détourner de son angoisse. (…)
Ça n’en finit pas, Adèle. Non, ça n’en finit pas. L’amour, ça n’est que de la patience. Une patience dévote, forcenée, tyrannique. Une patience déraisonnablement optimiste.
Nous n’avons pas fini.
Reviendra-t-elle ? Nul ne le sait. Le roman se termine ainsi, dans l’incertitude d’une guérison d’Adèle. Malgré les efforts de Richard, malgré l’amour qu’elle porte à son fils. Mais les aime-t-elle réellement ? Ne joue-t-elle pas la comédie d’une femme belle et heureuse ? Ne préfère-t-elle pas cette brutale montée de sang dans son corps qui l’emmène loin de toute raison ?
Non, ce roman n’est pas un beau roman. Dans un style froid, impersonnel, il raconte une histoire crédible jusqu’à un certain point. Oui, elle est crédible cette femme qui ne sait comment vivre. Mais dans le même temps vouloir nous faire croire qu’elle est normale, qu’elle aime son fils et même son mari, cela devient inacceptable. Le récit s’empêtre dans des contradictions et jusqu’au bout on ne sait où il va. La porte ouverte sur l’inconnu, le roman sombre dans une disparition qui a un arrière-goût d’affaire de mœurs.
07:32 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, roman, société, moeurs |  Imprimer
Imprimer
01/10/2014
Mort d’un berger, roman de Franz-Olivier Giesbert
Un roman à la Pagnol ou Giono, qui enchante l’air vif du matin et redonne à la nuit l’odeur des contes. La montagne dans toute sa splendeur unique qui accueille le troupeau des hommes, petit, lent, coléreux et chaque individu si singulier, unique qui tente de se prendre pour Dieu. Le curé est ivrogne, mais si près du ciel qu’il ne peut en redescendre. Le berger, un vieillard de 80 ans, mène son troupeau avec Mohamed VI, un muet bien guilleret qui très vite Juliette Bénichou, tout cela sur fond de mort d’un furieux, Fuchs, qui se fait tuer dans sa maison. La gendarmerie est là, bien sûr, avec un capitaine interrogateur et un berger muet. Tout cela se passe dans l’odeur de la lavande, le son des grelots du troupeau, la vue de la plaine, en bas, immense vu d’en haut, dans l’herbe jaune et fraiche des hauteurs où les moutons vivent le meilleur de leur temps.
berger muet. Tout cela se passe dans l’odeur de la lavande, le son des grelots du troupeau, la vue de la plaine, en bas, immense vu d’en haut, dans l’herbe jaune et fraiche des hauteurs où les moutons vivent le meilleur de leur temps.
Cela commence par la mort de son fils. Un papillon s’était posé sur son front mort. Le vieil homme commença à parler au papillon. Il causait toujours beaucoup aux bêtes. Aux ombles chevaliers, surtout, qu’il allait retrouver de temps en temps au lac d’Allos, après la pêche, certains jours de canicule. Dans son genre s’était une attraction, Marcel Parpaillon. Les ombles chevaliers venaient, de tous les coins du las, l’écouter glouglouter en agitant les bras. Il leur disait des tas de choses qui ne peuvent s’écrire, parce qu’elles sont au-delà des mots.
Quelques jours plus tard un autre malheur. Un matin, quand il arriva à la bergerie, Marcel Parpaillon roula de grands yeux stupéfaits, avec une expression d’horreur, et il lui fallut s’agripper à Mohammed VI pour ne pas tomber, avant de laisser choir son derrière sur une souche de pin. Ses lèvres se mirent à trembler comme des feuilles, et il sanglota, mais sans pleure, car il n’avait plus de larmes depuis la mort de son fils. Il resta un long moment, la bouche en O, tandis que Mohammed VI s’agitait dans le parc à moutons. C’était comme une forêt après la tempête du siècle. Des tas de brebis couchées les unes sur les autres ? Dans un mouvement de panique, elles s’étaient jetées, par vagues, contre un muret de bois, pour y crever. La moitié du troupeau était morte ainsi de peur, de bêtise et d’étouffement.
Et le berger part en guerre contre le loup, contre le maire qui ne veut pas que l’on parle du loup, contre les gendarmes qui cherche maintenant l’assassin de Fuchs. Ils partent en montaison, le berger, Mohammed VI et Juliette. Il se réfugie dans l’air libre des hauteurs. On aurait dit que le temps s’était arrêté. Ça arrive souvent, l’été, dans la patantare. Il suffit que le vent faiblisse et c’est comme si le monde entier retenait son souffle. Ça peut durer toute une journée. Il était dans les deux heures de l’après-midi, mais il aurait pu être tôt le matin ou tard le soir, c’eût été pareil. Le même silence. La même langueur. Une sorte d’éternité.
Le loup est tué, mais le berger est blessé. Il mourra quelques jours plus tard après être redescendu de la montaison. Marcel Parpaillon a rejoint le mouvement perpétuel qui va et vient, en emportant tout, un jour ou l’autre, dans ses ténèbres vivantes. Il est l’eau, le feu, l’air qu’on respire, le sommeil des siens, ou le bonheur qui danse dans leurs yeux. Il est les étoiles aussi. Nous sommes tous des poussières d’étoiles. On prend toutes sortes de formes, des airs importants et des chemins vairés, mais on reste un petits tas d’acides aminés qui pantelle, longtemps après que la flamme a été soufflée.
Quand elle ne s’éteint jamais, c’est un berger.
07:18 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, livre, roman, mort, vie, société |  Imprimer
Imprimer
26/09/2014
L’incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage, un roman d’Haruki Murakami
Haruki Murakami nous avait habitués à des livres à lire d’une seule traite. Là, c’est en dents de scie que s’effectue la lecture. Lassitude et ennui au cours des 75 premières pages. On ne sait quand cela va démarrer. On attend. Cela ne démarre pas. Cela s’enlise dans un magma d’histoires d’amitié et l’on se dit à tout moment que l’on va définitivement fermer le livre. Il ne prend de l’intérêt que lorsque Tsukuru décide de mettre au clair l’épisode de sa vie qui l’a marqué au point de quasiment mourir de désintérêt pour le monde.
Tsukuru décide de mettre au clair l’épisode de sa vie qui l’a marqué au point de quasiment mourir de désintérêt pour le monde.
Appartenant à un groupe d’amis très fortement soudés, trois garçons et deux filles, il en avait été chassé du jour au lendemain sans savoir pourquoi. Nous ne voulons plus te voir lui avaient-ils dit sans aucune explication. Il vécut tout ce temps tel un somnambule, ou comme un mort qui n’a pas encore compris qu’il était mort. (…) Tsukuru était tombé dans l’estomac de la mort, un vide stagnant et obscur dans lequel il avait passé des jours sans date.
Un jour, il rencontre Sara Kimoto avec laquelle il se lit d’abord d’amitié, puis d'intimité. Très psychologue, elle sent la difficulté de Tsukuru à se comprendre lui-même. Il y avait un endroit spécial sur le corps de Tsukuru, dont il n’avait en général pas conscience, une toute petite zone extrêmement sensible. Quelque part dans son dos. Une partie tendre et délicate, le plus souvent couverte, cachée, invisible de l’extérieur, que sa main n’arrivait pas à atteindre. (…) Los de leur première rencontre, il avait eu la sensation qu’un doigt anonyme avait clairement appuyé sur l’interrupteur. Ce jour-là ils avaient beaucoup parlé, mais il ne se souvenait pas de quoi. Puis, il fait connaissance à la piscine (il y a toujours une histoire de piscine dans les livres de Murakami) avec un jeune homme, Haida. Ils deviennent amis, se rencontrent souvent, discutent tard le soir. Mais Haida disparait à nouveau de sa vie, on ne sait pourquoi.
Sara suggère à Tsukuru de chercher à savoir pourquoi ses amis l’avaient rejeté. Le livre prend alors une autre tournure. C’est presqu’une sorte de roman policier : pourquoi Tsukuru fut-il abandonné aussi brutalement par ses amis. Il va interroger d’abord les deux autres garçons du groupe, puis finalement la seule fille encore vivante dont la rencontre en Finlande est assez émouvante. Il apprend les raisons de son rejet du groupe. Est-il guéri de son sentiment d’être autre, sans consistance ? Non, il réfléchit, s’accroche à Sara. Mais progressivement le livre s’enlise à nouveau, il ne sait ce qu’il est et on ne saisit pas non plus ce qu’il va devenir. Derrière les mots se cache le vrai Tsukuru, un homme de trente-cinq ans qui n’arrive pas à saisir le sens de sa vie. Va-t-il réellement nouer sa vie avec Sara comme il semble en avoir envie, ou va-t-il poursuivre son errance sans aucun but. On ne le saura jamais. Le lecteur reste sur sa faim, sans comprendre pourquoi.
Le livre est bien écrit, il s’étire, s’étire au point que le récit semble céder. Il se resserre avant, à nouveau, de se relâcher et s’étirer sans cependant se rompre. Tsukuru choisit-il Sara ? Celle-ci choisit-elle l’autre homme qu’un jour Tsukuru avait aperçu avec elle ? Quoi qu’il arrive, si Sara ne me choisit pas demain, j’en mourrai vraiment, songea Tsukuru. Que ce soit une mort réelle ou métaphysique, cela ne changera pas grand-chose. Mais peut-être que, cette fois, je rendrai pour de bon mon dernier souffle.
07:10 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, roman, japonais, histoire |  Imprimer
Imprimer
06/09/2014
Pétronille, roman d’Amélie Nothomb
Ce roman débute de manière majestueuse et finit assez lamentablement. Il est vrai que tenir le lecteur en haleine pendant 169 pages sur la manière de prendre une cuite est déjà un exploit. Mais faire tant d’effort pour rendre parfaitement réaliste les rencontres entre l’auteur et Pétronille et terminer par une pirouette si bizarre qu’elle peut sembler drôle, fait du roman un chaud-froid difficile à digérer.
« Pétronille, c’est mon roman exotique ». Elle s’explique : « le grand thème de Pétronille c'est la France (...), qui est l'exotisme absolu. Pour découvrir un pays, il faut aller à la rencontre de l'indigène et Pétronille joue le rôle de l'indigène. Cette "quête picaresque" est celle de la rencontre entre une amoureuse du champagne -qui refuse de le boire seule- et sa compagne de beuverie. »
Chaque chapitre est une aventure de beuverie, une découverte de la France profonde, non pas des campagnes, mais des banlieues. Pétronille se révèle fantasque, intelligente (elle écrit des romans, elle aussi, et ils sont acceptables et acceptées), égoïste et imprévisible, à l’égal de la population française. Amélie, belge, peine à la suivre dans ses élucubrations. Mais le couple fait une bonne paire de beuverie, pleine de bulles de champagne, car on ne boit que du champagne millésimé. Il erre d’une librairie, pour le premier roman de Pétronille, aux rues de Soho à Londres, en passant par les sports d’hiver. Amélie tente de se consoler du départ de Pétronille pour le Sahara en trouvant une autre buveuse, mais cela ne passe pas. Elle retrouve Pétronille à l’hôpital Cochin, l’héberge, ne la supporte plus. Nouvelle rencontre quelques années plus tard. Pétronille joue à la roulette russe. Elle finit par tuer Amélie, propose le manuscrit d’Amélie à un éditeur et le livre finit sur une conclusion à la manière de La Fontaine : Quand à moi, en bon macchabée, je médite et tire de cette affaire des leçons qui ne me serviront pas. J’ai beau savoir qu’écrire est dangereux et qu’on y risque sa vie, je m’y laisse toujours prendre.
Les trois premiers chapitres sont un régal littéraire. Il faut les lire plusieurs fois, en goûter chaque page comme on lèche une glace devant la devanture d’un magasin aux mannequins nus :
« Pourquoi du champagne ? Parce que son ivresse ne ressemble à nulle autre. Chaque alcool possède une force de frappe particulière ; le champagne et l’un des seuls à ne pas susciter de métaphore grossière. Il élève l’âme cers de que dut être la condition de gentilhomme à l’époque où ce bon mot avait du sens. Il rend gracieux, à la fois léger et profond, désintéressé, il exalte l’amour et confère de l’élégance à la perte de celui-ci. (…) J’ai continué courageusement à boire et, à mesure que je vidais la bouteille, j’ai senti que l’expérience changeait de nature : ce que j’atteignais méritait moins le nom d’ivresse que ce que l’on appelle, dans la pompe scientifique d’aujourd’hui, un état augmenté de conscience. Un chaman aurait qualifié cela de transe, un toxicomane aurait parlé de trip. (…) J’ai titubé jusqu’au lit et je m’y suis effondré.
Cette dépossession était un délice. J'ai compris que l’esprit du champagne approuvait ma conduite : je l’avais accueilli en moi comme un hôte de marque, je l’avais reçu avec une déférence extrême, en échange de quoi il me prodiguait des bienfaits à foison ; il n’était pas jusqu’à ce naufrage final qui ne soit une grâce.
07:30 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, littérature, ivresse, société, écrivain |  Imprimer
Imprimer
25/08/2014
Un été pour mémoire, de Philippe Delerme
Un livre poétique qui égraine des souvenirs d’enfance doux comme le miel au bord de la Garonne dans la chaleur des étés. Mais est-ce réellement un roman ? Non, pas d’intrigue ou presque rien, des senteurs, des images, des goûts, des conversations, des impressions et, parfois, des réflexions, d’une écriture séduisante qui envoûte l’esprit et lui donne des ailes.
Chaleur… Temps arrêté… C’est l’amertume du café sur le début de l’après-midi, le grand soleil en creux des maisons fraîches, et je revois… Les routes de l’été, si blanches de soleil. La pédale qui grince, et cette côte de Saint Paul n’en finit pas, le délicieux virage à l’ombre du bois sec, plus loin la route tremble et fond. C’est l’heure de la sieste, il fait si chaud sur les étés d’enfance à petits coups de pédale envolés vers les fontaines de Saint-Paul. Odeurs mêlées de cambouis, de goudron, rêves croisés de filles et Tour de France…
Et dans ces souvenirs, le rire léger de Marine, une petite fille d’une dizaine d’années, déjà presque adulte dans ces réflexions et simagrées. Elle l’envoûte gentiment, tantôt se poquant de lui, tantôt s’appuyant sur lui. Il fait connaissance d’un autre monde, inconnu, puis quitte tout à la fin de l’été, y compris Marine.
Ce n’est pas une histoire, ce sont des rêves d’enfance, imagés, souriant comme un voile à l’arrière-goût de bonheur, qui charment l’esprit et emprisonnent la mélancolie.
07:03 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, roman, mémoire, souvenir, impression, société |  Imprimer
Imprimer
13/08/2014
La déclaration, l’histoire d’Anna, de Gemma Malley (2007)
Mon nom est Anna. Mon nom est Anna et je ne devrais pas être là. Je ne devrais pas exister. Pourtant j’existe. Ce n’est pas ma faute si je suis là. Je n’ai jamais demandé à naître. Même si ça n’excuse pas le fait que je sois née.
Anna est un Surplus : excédentaire, en trop. Dans d’autres pays, on les éradique. Ici, en Grande-Bretagne, on les élève dans un Foyer de Surplus. Ils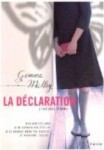 servent de main d’œuvre bon marché et ils doivent travailler dur, très dur, pour prouver leur gratitude. Elle a de la chance, elle a fait un stage dans une maison avec moquette et canapé, chez Mrs Sharpe. Elle était gentille et lui avait même proposé un jour de mettre du rouge à lèvres. Elle aurait aimé rester sa servante. Elle ne l’a pas frappée une seule fois. Les Surplus n’ont pas droit aux objets personnels ; rien ne peut décemment leur appartenir dans un monde auquel ils imposent déjà leur présence, comme dit Mrs Pincent, l’intendante. Et pourtant Anna tient un journal personnel qu’elle cache dans une des salles de bain de l’établissement.
servent de main d’œuvre bon marché et ils doivent travailler dur, très dur, pour prouver leur gratitude. Elle a de la chance, elle a fait un stage dans une maison avec moquette et canapé, chez Mrs Sharpe. Elle était gentille et lui avait même proposé un jour de mettre du rouge à lèvres. Elle aurait aimé rester sa servante. Elle ne l’a pas frappée une seule fois. Les Surplus n’ont pas droit aux objets personnels ; rien ne peut décemment leur appartenir dans un monde auquel ils imposent déjà leur présence, comme dit Mrs Pincent, l’intendante. Et pourtant Anna tient un journal personnel qu’elle cache dans une des salles de bain de l’établissement.
Qu’est-ce qu’un surplus ? On le découvre peu à peu. C’est la surprise dans un monde figé par la longévité, remède contre la vieillesse, grâce au Renouvellement qui permet d’obtenir des cellules flambant neuves pour remplacer les anciennes et rectifier le reste de vos cellules en plus. De plus le Renouvellement permet de ne plus vieillir. Si au début les Autorités étaient contre ce traitement, elles l’adoptèrent et les gens cessèrent de mourir. La population ne tombait jamais malade et cela générait des économies substantielles. L’inconvénient fut que la terre devint vite surpeuplée. Aussi la Déclaration de 2065 a limité le nombre d’enfants à un seul par famille. Puis, comme elle croissait malgré tout, les naissances furent interdites, sauf si l’un des deux parents s’Affranchissait de la Longévité. Une vie pour une autre, préconisait la Déclaration.
L’arrivée de Peter, un nouveau Surplus, va changer la vie d’Anna. « C’est toi Anna Covey ? Je connais tes parents. » Peter progressivement fait naître en Anna le désir d’une autre vie. Ils finissent par s’enfuir et sont poursuivis par la brigade des Rabatteurs. N’en dévoilons pas plus. Il faut laisser au lecteur la joie de la découverte.
C’est un roman qui n’a aucune prétention littéraire. Il est cependant raconté avec brio, dévoilant progressivement ce monde stupéfiant, figé et protectionniste. Certes, il est un peu éculé de choisir deux adolescents pour révolutionner ce monde. Mais ce n’est pas qu’à la fin du livre que l’on prend conscience qu’il s’agit bien de faire la révolution dans cette société égoïste. Le fil conducteur est l’apprentissage de la liberté pour Anna, qu’elle refuse tout d’abord, puis qu’elle finit par entrevoir et à laquelle elle adhère. Comment ne pas se demander s’il n’en est pas de même dans notre société : des règles, pas de sentiments qui n’amènent que des ennuis, le travail magnifié, une vie discrète et disciplinée laissée aux autorités qui font les choix. Alors on se réfugie dans son monde, différent pour chacun, un monde où la créativité est le seul moyen de sortir debout et fier comme ces Surplus qui deviennent finalement Légaux en tant qu’Affranchis.
07:57 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, roman, littérature, société, aventure |  Imprimer
Imprimer
07/08/2014
Pluie, roman de Kirsty Gunn (Christian Bourgois éditeur, 1996)
L’eau avant tout, l’eau d’un lac qui dans ce coin a une odeur de rivière, puis la solitude de deux enfants, l’absence des parents, fêtards et négligents, la maturité de la fillette, l’amour qu’elle porte à son petit frère dont elle  est la vraie mère. Ce n’est pas une histoire avec un commencement, des épisodes et un dénouement. Non, c’est un étirement de la surface du lac, quelques rides à sa surface, une pierre lancée par Jim Little, et le retour au calme comme ces nuits où ils se réfugient près du lac sans que le moindre adulte s’en soucie. Le roman coule comme de l’eau, au rythme poétique des sensations et des descriptions de Janey, la fillette, qui observe, constate, juge parfois, tout cela avec impartialité, sans référence morale. Maman est belle, d’une beauté remarquable et remarquée. Papa est à ses genoux, esclave et heureux de l’être. Les invités, tous les soirs, s’amusent, jouent aux cartes, dansent, boivent beaucoup.
est la vraie mère. Ce n’est pas une histoire avec un commencement, des épisodes et un dénouement. Non, c’est un étirement de la surface du lac, quelques rides à sa surface, une pierre lancée par Jim Little, et le retour au calme comme ces nuits où ils se réfugient près du lac sans que le moindre adulte s’en soucie. Le roman coule comme de l’eau, au rythme poétique des sensations et des descriptions de Janey, la fillette, qui observe, constate, juge parfois, tout cela avec impartialité, sans référence morale. Maman est belle, d’une beauté remarquable et remarquée. Papa est à ses genoux, esclave et heureux de l’être. Les invités, tous les soirs, s’amusent, jouent aux cartes, dansent, boivent beaucoup.
Nuit après nuit, les mêmes gens se mêlent et s’entremêlent dans les remous ; il s’agit là de leur version du temps. Ils discutent et ils dansent, ils vont et viennent parmi leurs congénères, s’imaginant, à chacun de leurs déplacements qu’il y a quelque chose dans cette soirée qui va les transformer. Les femmes se maquillent, s’appliquent des touches de parfum en des endroits mystérieux. Les hommes assistent à cela comme de jeunes animaux et le disque, sensuel, tourne et brûle dans son sillon. (C’mon, baby… You know I love you…). J’imagine les frotti-frotta qu’ils doivent pratiquer ensemble ces maris et ces femmes, tant d’espoirs évaporés dans la nuit.
Maman tarde à aller se coucher. Elle respire la nuit, puis, enfin, se couche pour ne se réveiller que très tard. C’était bizarre, mes parents se satisfaisaient de leur pelouse jaune, de leurs fauteuils tachés. Mon petit frère et moi avions un lac entier en guise de terrain de jeux, mais eux ne bougeaient, ils restaient là, près de la maison, allongés comme des cadavres sur leurs lits de repos cassés. Un drôle de spectacle à offrir à des enfants, à la fois splendide et décadent ! Il y avait le corps de notre mère, tout luisant d’huile, bronzé absolument de partout, magnifique d’élégance à côté de notre pauvre père, tout couvert de croûtes. Il n’avait jamais supporté le soleil.
Alors les enfants vivent leur vie. Janey chérie son frère. C’était toujours moi qu’il réclamait à grands cris, mais c’était la soie de ses cheveux à elle qui lui effleurait le visage quand elle s’inclinait au-dessus de son lit la nuit. « Chhh… » Légère comme un souffle, elle l’embrassait pour lui dire bonne nuit, sa propre mère. « Chhh… » Qui étais-je à côté d’elle ? Qui étais-je pour encourager si pleinement cet enfant dans sa conviction que je pouvais le protéger, quand je n’étais moi-même qu’une gamine au ventre bombé ?
Et le rêve tourne au cauchemar. On ne sait exactement ce qui se passe, on ne fait que deviner qu’il s’agit de Jim. Le récit se concentre sur la tentative que fait Janey d’une respiration artificielle. Que deviennent-ils ? Vont-ils au bout de leur rêve ou de leur cauchemar ? Nul ne le sait. Ils s’évanouissent de ce rêve éveillé et se perdent dans l’histoire du monde. Je me souviens comme, il y a longtemps, mon petit frère et moi sortions toujours dans la pluie d’été. Nous disparaissions ou nous revenions, je ne sais plus. Nous entrions dans l’eau. Là-bas au lac, la pluie était tellement douce. C’était une étoffe légère, un rideau transparent de gris et d’argent, pareil aux voiles des vaisseaux fantômes, arachnéen. Il y avait des nuages dans la pluie, des brumes blanches qui s’élevaient du lac si bien que l’eau s’amalgamait à l’air comme si elle y vivait. (…)
Rien d’autre n’existait à cette époque que ces deux enfants. Regardez-les. Ils sont deux et ils ont toute la plage pour eux, la blancheur des nuages et de l’eau qui tourbillonne à leurs pieds tandis qu’ils dansent en rond à l’infini… A chaque tour qu’ils font ils rapetissent, ils s’éloignent, ils rapetissent de plus en plus dans le lointain jusqu’à ce qu’on ne puisse plus les voir du tout.
07:26 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, usa, romantisme, natation |  Imprimer
Imprimer
27/07/2014
Onze minutes, roman de Paulo Coelho
Un très beau livre, mais qui traite d’un sujet scabreux, le sens de la sexualité. Qu’est-ce : besoin, plaisir véniel, violence à la manière du marquis de Sade, amour éros ou amour agapé ?
Le sujet est abordé à travers la vie de Maria, jeune brésilienne qui, à Rio de Janeiro, se voit proposer de devenir danseuse à Genève. Rêvant de gloire, elle se retrouve prostituée. Parcours fréquent, mais ce qui compte ce n’est pas ce parcours sociale hélas assez habituel, mais le parcours quasi spirituel que va découvrir progressivement Maria. Elle s’interroge, elle ne se laisse pas faire, elle s’en sort.
retrouve prostituée. Parcours fréquent, mais ce qui compte ce n’est pas ce parcours sociale hélas assez habituel, mais le parcours quasi spirituel que va découvrir progressivement Maria. Elle s’interroge, elle ne se laisse pas faire, elle s’en sort.
Elle apprend à dissocier l’âme du corps, à ne pas juger et elle s’interdit de tomber amoureuse. Elle pratique son métier en professionnelle avertie. Elle accumule de quoi rentrer au Brésil et acheter une ferme pour ses parents. Elle découvre différent types de clients, mais elle rêve d’un véritable amour et écrit : Le désir profond, le désir le plus réel, c’est celui de s’approcher de quelqu’un. A partir de là, les réactions s’expriment, l’homme et la femme entrent en jeu, mais l’attirance qui les a réuni est inexplicable. C’est le désir à l’état pur. Quand le désir est encore en cet état de pureté, l’homme et la femme se passionnent pour l’existence, vivent chaque instant avec vénération, consciemment, attendant toujours le moment opportun pour célébrer la bénédiction prochaine.
Deux clients dont elle fait la connaissance sont très opposés. Mais ils sont tous les deux patients. Ils ne se précipitent pas.
Le premier lui enseigne la souffrance comme un stimulateur du plaisir. Pour la première fois, elle va au bout de sa sexualité et éprouve un plaisir qu’elle n’avait jamais goûté. Maria sentit qu’elle entrait dans un trou noir au plus profond de son âme, où la douleur et la peur se mêlaient au plaisir absolu, l’entraînant au-delà de toutes les limites qu’elle avait connues. (…) L’art du sexe est l’art de contrôler la perte de contrôle. Elle note dans son journal intime : La rencontre d’une femme avec elle-même est un jeu qui comporte des risques sérieux. Une danse divine. Quand nous nous rencontrons, nous sommes deux énergies divines, deux univers qui s’entrechoquent. S’il manque à cette rencontre la déférence nécessaire, un univers détruit l’autre.
Le second va lui apprendre tout autre chose : la puissance spirituelle de la sexualité transcendée. « J’ai rencontré un homme, et je suis éprise de lui. Je me suis permis de tomber amoureuse pour la simple raison que je n’attends rien… Il me suffit de l’aimer, d’être avec lui en pensée, et que ses pas, ses mots, sa tendresse donnent des couleurs à cette ville si belle. (…) Tout le monde sait aimer, c’est inné. Quelques-uns le pratiquent naturellement, mais la plupart doivent réapprendre, se rappeler comment on aime et tous sans exception doivent brûler dans le feu de leurs émotions passées, revivre des joies et des douleurs, des chutes et des rétablissements, jusqu’à ce qu’ils parviennent à distinguer le fil directeur qui existe derrière chaque rencontre. Alors les corps apprennent à parler le langage de l’âme : cela s’appelle le sexe, c’est cela que je peux donner à l’homme qui m’a rendu mon âme, même s’il ignore totalement à quel point il compte dans ma vie. C’est cela qu’il m’a demandé, et il l’aura ; je veux qu’il soit heureux. »
N’en disons pas plus. Maria finira par se réconcilier avec elle-même : Je savais que c’était le moment. Tout mon corps se relâcha, je n’étais plus moi-même - je n’entendais plus, ne voyais plus, ne sentais plus le goût de rien – je n’étais que sensation… Ce n’était pas onze minutes, mais une éternité, c’était comme si tous les deux nous sortions de nos corps et nous promenions, dans une joie, une compréhension et une amitié profondes, dans les jardins du paradis. J’étais femme et homme, il était homme et femme. Je ne sais combien de temps cela a duré, mais tout paraissait silencieux, en prière, comme si l’univers et la vie étaient devenus sacrés, sans nom, hors du temps.
07:05 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, spiritualité, éros, femme |  Imprimer
Imprimer











