12/07/2013
Attentat, roman d’Amélie Nothomb
« La première fois que je me vis dans un miroir, je ris : je ne croyais pas que c’était moi. A présent, quand le regarde mon reflet, je ris : je sais que c’est moi. Et tant de hideur a quelque chose de drôle.
Et tant de hideur a quelque chose de drôle.
Epiphane Otos serait-il condamné par sa laideur à vivre exclu de la société des hommes et interdit d’amour ?
Devenu star – paradoxale – d’une agence de top models, Epiphane sera tour à tour martyr et bourreau, ambassadeur de la monstruosité internationale… et amoureux de la divine Ethel, une jeune comédienne émue par sa hideur ? » (4ème de couverture)
Apologie d’un livre dont le résumé semble suffisant pour comprendre de suoi il s'agit. A force de vouloir être originale, Amélie Nothomb tombe dans le grotesque. L’histoire manque de profondeur, voire d’intérêt. Le personnage se moque trop volontiers de lui-même et sa star n’a que la bêtise des étoiles. Certes, la verve de l'auteur reste intacte ainsi que ses bons mots.
Ainsi :
Je me confortai en pensant que l’érotisme était nécessairement grotesque : pas de désir sans transgression – et quelle transgression plus délectable que celle du bon goût ?
Ou encore :
– Dire à une femme qu’elle est belle, c’est lui dire qu’elle est bête. Je restai un instant bouche bée avant de rétorquer : – C’est donc vrai que vous êtes bête, et vous le confirmer. Je reçus une gifle.
Ce livre est une réflexion sur l’idée de norme dans la société. La norme constitue à la fois un modèle à imiter (donc un extrême de beauté, laideur ou autre) et un impératif psychologique à adopter. Nos avis sur chaque être ou chaque chose nous sont-ils imposés par la société ou viennent de nous-mêmes ? Mais le ton de persiflage permanent finit par lasser. Au bout d’un moment, le jeu n’en vaut pas la chandelle. Alors s’éteint le charme et la magie habituelle de l’auteur et ne reste qu’une histoire sur laquelle on ferme le livre en se disant : « Je ne le rouvrirai pas ! »
07:09 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, esthétisme |  Imprimer
Imprimer
27/06/2013
Le rire de l’ogre, roman de Pierre Péju
Beaucoup y ont vu un roman sur la guerre, d’autres un roman d’amour impossible entre Paul Marleau et Clara, d’autres enfin une méditation sur le mal à travers ses différentes formes. Histoire d’un siècle au travers de la vie d’un homme et de ceux qu’il côtoie. Comme dans La petite chartreuse, on entre difficilement dans le récit et l’on s’ennuie. Mais progressivement on prend conscience de l’intérêt du livre. Pour ma part, je n’en retiens que l’aspect lié à Paul Marleau en tant que sculpteur et à la sculpture. De très belles pages sur cet art difficile, physique et sensuel :
d’un homme et de ceux qu’il côtoie. Comme dans La petite chartreuse, on entre difficilement dans le récit et l’on s’ennuie. Mais progressivement on prend conscience de l’intérêt du livre. Pour ma part, je n’en retiens que l’aspect lié à Paul Marleau en tant que sculpteur et à la sculpture. De très belles pages sur cet art difficile, physique et sensuel :
Dodds glisse ses mains dans les fentes qu’il a pratiquées dans le ventre et le torse de ses statuts. – Tu vois, mon truc, ça consiste à saisir la réalité par ses trous ! (…) Je m’écarte, je prends du recul, et ce que je vois, c’est l’espace que ça fait apparaître autour… Une sculpture, bien lourde, bien dure, c’est aussi à ça que ça sert : à révéler du vide. Tu vois l’espace entre les formes, c’est aussi une forme. (...)
Je comprends comment on peut sculpter une ombre, l’ombre du soir, la nudité, la souffrance et même… la pensée. Je comprends que ce n’est pas l’artiste fiévreux qui fabrique une femme de pierre. C’est une femme accroupie, une femme en pleurs, une femme damnée ou une femme-cuiller qui s’arrache elle-même à la matière, qui s’accouche elle-même à l’aide des mains du type qui se prend pour le maître des formes. (...)
… je ne peux alors que cogner, trouer, dégrossir et faire éclater de gros morceaux de matière, priant en même temps cette matière de me résister le plus possible. Car je ne désire ni victoire ni défaite. Les éclats giclent dans mes lunettes de protection, m’écorchent le front. Mes reins me brûlent. Mes omoplates vont se briser, comme mon coude, comme ma mâchoire. Mon pouce et mon poignet me font mal à gueuler. Je deviens à la fois la force et la roche. Je deviens le point d’impact et le vide ricaneur. Je gueule, mais au moins, tant que je cogne, je disparais !
Il est rare de lire des romans qui entrent dans le processus de création d'une œuvre. Pourtant quoi de plus beau de décortiquer ce travail, d’en saisir les subtilités, les hésitations, les joies et les douleurs. Et lorsque cette création est un acte physique autant que conceptuel, l’homme s’accomplit de lui-même dans l’effort et l’ignorance du résultat.
06:49 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, littérature, guerre, amour, art, sculpture |  Imprimer
Imprimer
22/06/2013
Frantz et Clara, roman de Philippe Labro
Chaque jour, elle vient prendre son déjeuner au bord du lac, sur un banc. Elle fait partie d’un orchestre. Elle tente d’oublier un amour qui a mal fini. Elle se sent seule, triste, presque déprimée. Elle est en attente, mais elle ne sait de quoi. Ce jour-là, le banc est occupé. Elle hésite, mais s’assied néanmoins.
– Ça ne vous dérange pas, j’espère, si je partage votre espace. Je suis bien conscient d’être arrivé ici avant vous aujourd’hui, mais je sais parfaitement que ce banc vous appartient.
Cette interpellation l’intrigue, venant d’un enfant de huit ans parlant comme un adulte. Ils parlent. Ils se retrouvent le lendemain, puis les jours suivants. Elle lui raconte en partie sa vie : la mort de son père, la découverte de l’amour avec un homme plus âgé, sa déconvenue lorsqu’il l’abandonne. Il lui parle du vide :
– Moi, quand je vais mal, j’essaie de tout éliminer. Je concentre ma pensée sur une seule chose, pour tout nettoyer et pour arriver à un océan pacifié.
– un quoi ?
–Une eau calme. Moi, mon idée, c’est d’arrêter ma pensée sur une seule chose et de ne plus l’abandonner un instant : un oiseau, une fougère, une pierre, un visage aussi, mais une seule chose ! et on s’enfonce dans le calme. Pour parvenir au vide. C’est possible…
Un jour, il lui déclare son amour. Elle rit. Il est trop petit. Elle lui répond :
– Frantz, oui, je me suis prise d’affection pour toi et tu es précieux dans ma vie, tu es devenu un ami, nous sommes deux amis, sans aucun doute. Les amis s’aiment, il n’y a pas de grande différence entre l’amitié et l’amour. (…) Il existe entre toi et moi une barrière que tu n’as pas encore franchie. Ne m’en veut pas de te le dire. Je peux difficilement l’exprimer d’une autre manière. Ne m’y oblige pas.
Elle a repris des forces, plus ou moins oublié l’abandon de son amant et pense maintenant à se donner une carrière de soliste. Elle quitte Lucerne et dit adieu à Frantz.
Dix ans plus tard, à Boston, elle retrouve, un grand jeune homme, fort et toujours aussi beau parleur. Ils se parlent, elle renonce à un diner avec les autres musiciens. Il la raccompagne à son hôtel. Ils entrent. Ils se sont trouvés.
– On ne peut pas savoir s’ils vont faire l’amour. Et s’ils le font, on ne pourra dire si cela se renouvellera plusieurs fois dans la nuit. Il se pourrait qu’il ne se passe rien entre eux. Mais il est permis d’en douter.
Oui, c’est vrai, l’histoire est un peu fleur bleu et même un peu simplette. Mais l’histoire seule compte-t-elle dans un livre ? La manière dont elle est comptée, les réflexions qui l’accompagnent sont en réalité le vrai sel du récit. C’est donc un livre plaisant, bien écrit, parfois amusant, pourvu de réflexions intéressantes. Il ne faut cependant rien en attendre de plus.
07:17 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, littérature |  Imprimer
Imprimer
10/06/2013
Le voyage d'hiver, roman d'Amélie Nothomb
C’est une histoire abracadabranque. Un jeune homme, Zoïle, rencontre dans son travail deux femmes dont une écrivain. L’une, Aliénore, est attardée,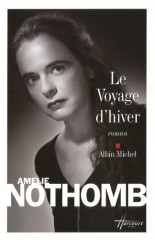 l’autre, Astrolabe, est jolie, si jolie qu’il en tombe amoureux. Il découvre que l’écrivain n’est pas celle qu’il croyait. Qu’à cela ne tienne, il fait des visites assidues, mais arrive tout juste à embrasser sa bien-aimée, rien au-delà. Pour la voir nue, il distribue en guise de repas des pilules. Celles-ci contiennent un gramme de psilocybes guatémaltèques. Peine perdue. Elle est de marbre. Alors, pour se venger, il décide de détourner un avion et de l'envoyer percuter la tour Eiffel.
l’autre, Astrolabe, est jolie, si jolie qu’il en tombe amoureux. Il découvre que l’écrivain n’est pas celle qu’il croyait. Qu’à cela ne tienne, il fait des visites assidues, mais arrive tout juste à embrasser sa bien-aimée, rien au-delà. Pour la voir nue, il distribue en guise de repas des pilules. Celles-ci contiennent un gramme de psilocybes guatémaltèques. Peine perdue. Elle est de marbre. Alors, pour se venger, il décide de détourner un avion et de l'envoyer percuter la tour Eiffel.
Bien que le titre soit emprunté à des lieder de Schubert, son chant ne m’a pas séduit. L’histoire manque d’intérêt, ne comporte aucun rebondissement et traîne en longueur. Certes, Amélie Nothomb reste parfois acide, percutante et éventuellement drôle. Ainsi lorsqu'elle décrit les traductions de Zoïle :
Quand un vers me dérobait sa signification, je le scandais au rythme de mes pieds, de mes genoux et de la main gauche. Ne s’ensuivait aucun résultat. Je chantonnais alors et élevais la voix. Aucun résultat. De guerre lasse, j’allais soulager un besoin aux toilettes. De retour le vers se traduisait tout seul. La première fois, j’écarquillais les yeux. Fallait-il faire pipi pour comprendre ? Combien de litres d’eau devrais-je boire pour traduire de tels pavés ? Puis je réalisai que la miction n’y était pour rien. Ce qui avait fonctionné, c’était les quelques pas pour me rendre aux cabinets. J’avais appelé les jambes à la rescousse ; encore fallait-il les activer pour trouver la solution. L’expression « ça marche » n’a sans doute pas d’autres explications.
Mais cela suffit-il ? Non, cette fois-ci, ça manque de chair, de finesse et de délicatesse. L’année 2009 est vraiment un mauvais cru pour Amélie Nothomb.
07:24 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, amou, société |  Imprimer
Imprimer
27/05/2013
La mort est mon métier, de Robert Merle
Ce n’est pas un roman, plutôt un récit : la vie de Rudolf Hoess, le commandant d’Auschwitz, racontée sous le pseudonyme de Rudolf Lang. Ecrit en 1952, Robert Merle a utilisé les notes du psychologue américain Gilbert. Le plus curieux est l’absence presque totale d’impression et de sentiments du narrateur Rudolf. Il n’a qu’un seul leitmotiv : les Allemands sont des soldats et les soldats obéissent sans discuter, ni même réfléchir.
Son enfance pourrait expliquer cette vie sans pensée propre. Il est complètement dominé par son père qui est lui-même excessif dans tous ses actes, dont sa pratique religieuse. – Rudolf, depuis que tu es en âge de commettre des fautes, je les ai prises, l’une après l’autre, sur mes épaules. J’ai demandé pardon à Dieu, pour toi, comme si c’était moi qui était coupable, et je continuerai à agir ainsi tant que tu seras mineur. Je fis un mouvement, et il cria : – Ne m’interromps pas !
Après un drame à l’école et devant l’attitude de son père, il tombe malade. Allant mieux, il prend un premier repas avec sa famille et son père dit : – Et maintenant on va faire la prière. Père entama un Pater. Je me mis à imiter le mouvement de ses lèvres et sans émettre un seul son. Il me fixa, ses yeux creux étaient tristes et fatigués, il s’interrompit et dit d’une voix sourde : – Rudolf, prie à haute voix. Tous les yeux se tournèrent vers moi. Je regardai Père un long moment, puis articulai avec effort : – Je ne peux pas.
Il perd la foi. Mais il devient brancardier et fait connaissance avec un Rittmeister (capitaine). Il finit par s’engager. Se bat, est blessé et découvre l’amour avec une infirmière. Rendu à la vie civile, il fait de nombreux petits boulots. Il découvre les S.A. et prête serment au führer pour sauver l’Allemagne.
Il est engagé par un colonel pour s’occuper de ses chevaux. Il se marie. Il poursuit ses activités chez les SS. Désormais, par conséquent, tout était parfaitement simple et clair. On n’avait plus de cas de conscience à se poser. Il suffisait seulement d’être fidèle, c’est-à-dire d’obéir. Et grâce à cette obéissance absolue, consentie dans le véritable esprit du Corps noir, nous étions sûr de ne plus jamais nous tromper, d’être toujours dans le droit chemin. Il s’installe à Dachau avec sa famille, puis est muté à Auschwitz : Je vous ai choisi, vous, à cause de votre talent d’organisation… et de vos rares qualités de conscience. (…) Dans quatre semaines exactement, vous me ferez tenir un plan précis à l’échelle de la tâche historique qui vous incombe. (…) Pour les six premiers mois, vous devez prendre vos dispositions pour un chiffre global d’arrivages se montant environ à 500 000 unités.
Rudolf Lang se pose la question le plus rationnellement possible : comment faire pour éliminer des milliers d’unités ? Il trouve des solutions sans penser un seul instant qu’il s’agit d’êtres humains. Vint la fin de la guerre. Il apprend qu’ils ont arrêté Himmler et qu’il s’est suicidé au cyanure. La douleur et la rage m’aveuglaient. Je sentis Georg me secouer vivement le bras et je dis d’une voix éteinte : – Il m’a trahi. Je vis les yeux pleins de reproches de Georg fixés sur moi et je criai : – Tu ne comprends pas ! Il a donné des ordres terribles, et maintenant, il nous laisse seuls affronter le blâme… au lieu de se dresser… au lieu de dire : « C’est moi le responsable ! » (…) Il s’est défilé, lui que je respectais comme un père. (…) Il aurait dit : « C’est moi qui ai donné à Lang l’ordre de traiter les juifs. Et personne n’aurait eu rien à dire !
Il est finalement arrêté et trainé de prison en prison. Je pensais quelquefois à ma vie passée. Chose curieuse, seule mon enfance me paraissait réelle. Sur tout ce qui s’était passé ensuite, j’avais des souvenirs très précis, mais c’était plutôt le genre de souvenirs qu’on garde d’un film qui vous a frappé. Je me voyais moi-même agir et parler dans ce film, mais je n’avais pas l’impression que c’était à moi que tout cela était arrivé.
Un lieutenant- colonel l’interroge : – Êtes-vous toujours aussi convaincu qu’il fallait exterminer les juifs ? – Non, je n’en suis plus convaincu. – Pourquoi ? – Parce qu’Himmler s’est suicidé. (…)– Par conséquent, si c’était à refaire, vous ne le referiez pas ? – Je le referais, si on m’en donnait l’ordre. (…) – Vous n’éprouvez donc aucun remord ? – Je n’ai pas à avoir de remord. L’extermination était peut-être une erreur. Mais ce n’est pas moi qui l’ai ordonnée. – Depuis votre arrestation, il vous est bien arrivé de penser à ses milliers de pauvres gens que vous avez envoyés à la mort ? – Oui quelquefois. – Eh bien, quand vous y pensez, qu’éprouvez-vous ? – Je n’éprouve rien de particulier.
Histoire d’un homme ordinaire, d’un Allemand qui croyait en son pays et à l’obéissance. Devenu bourreau sans s’en rendre compte, il a exterminé des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants sans prendre conscience de ce qu’il faisait. Et ce n’était même pas l’idéologie qui le conduisait, mais la simple bonne conscience d’obéir.
Les militaires français ont maintenant l’obligation légale de désobéir à des ordres illicites concernant des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre, des actes qui constituent des crimes et délits contre la sûreté de l’Etat la constitution ou la paix publique, ou encore des actes portant atteinte à la vie, l’intégrité, la liberté des personnes, ou au droit de propriété, quand il ne sont pas justifiés par l’application de la loi.
05:09 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, récit, allemagne, nazisme |  Imprimer
Imprimer
25/05/2013
L'écume des jours, film de Michel Gondry
Boris Vian comme si on y était. Tous les gadgets y passent : le piano cocktail d’abord, la souris, la danse "biglemoi" et bien d’autres encore. On s’amuse de retrouver l’esprit inventif et farfelu de Boris Vian. On aime sa tendresse sauvage, son romantisme délicat.
retrouver l’esprit inventif et farfelu de Boris Vian. On aime sa tendresse sauvage, son romantisme délicat.
Les critiques n’ont pas aimé : trop d’effets spéciaux. Et pourtant, c’est bien cette première partie du film que j’ai appréciée plutôt que la seconde au contraire des critiques. Certes, la poésie passe après la trouvaille inédite, mais le sérieux de la seconde partie rend le temps long (le film dure deux heures cinq). L’appartement se dégrade, se couvre de toiles d’araignée, le cœur n’y est plus. Le nénuphar n’en finit plus d’envahir le poumon de Chloé.
Malgré le mauvais avis des critiques, le film est à voir pour ceux qui ont lu le roman. Cela leur rappellera les rêveries et les fumées d’un livre d’avant-garde à une époque révolue.
10:55 Publié dans 13. Cinéma et théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, romantisme, suréalisme, roman |  Imprimer
Imprimer
14/05/2013
L’étudiant étranger, roman de Philippe Labro
Mais pourquoi ai-je éprouvé le besoin de commencer par Buck Kuschnik ? se demande Philippe Labro au début de ce roman autobiographique. Qu’est-ce que ça voulait dire, ce corps de dix-huit ans, vêtu seulement d’un long p antalon de pyjama à rayures classiques, les chevilles attachés aux barres de métal des deux extrémités du lit de sa chambre dans le freshmen dorm, aile ouest du dortoir, rez-de-chaussée, à droite quand on entrait dans la cour ?
antalon de pyjama à rayures classiques, les chevilles attachés aux barres de métal des deux extrémités du lit de sa chambre dans le freshmen dorm, aile ouest du dortoir, rez-de-chaussée, à droite quand on entrait dans la cour ?
Français, il découvre, grâce à une bourse, un collège américain très classique en même temps qu’il fait, adolescent, l'expérience de la vie. C’est un tourbillon d’incertitudes, d’affirmations de soi, d’épreuves nouvelles, d’apprentissage des « date ». C’est un verbe, c’est aussi un mot, ça veut dire un rendez-vous avec une fille, mais ça désigne la fille elle-même ; je vais boire un verre avec une date. Une fille vous accorde une date et elle devient votre date régulière si vous sortez plus d’une fois avec elle. (…) C’est un rite, et je me suis aperçu ici, sans le formuler de façon aussi claire, que tout est rite, tout est cérémonie, signe, étape d’un immense apprentissage. Il y a un Jeu et des jeux à l’intérieur de ce grand Jeu de la vie américaine et tout mon être aspire à les jouer.
Invité à Noël chez un ami américain, il fait connaissance avec une noire, April : Les Américains ont du mal à regarder une Noire en face, surtout si elle est belle, vous n’avez pas remarqué cela ? Il se découvre sensuel. L’enfant ne redonnait pas tout simplement aux sens le rôle qui leur avait été partiellement confisqué, et se libérait donc et se délivrait et se révélait avec toute la violence d’une seconde venue au monde. Il fait l’amour avec elle, dans sa voiture. Elle avait ôté le pantalon de son survêtement, m’offrant la peau brune et velours de ses jambes et ce qu’elle m’avait offert m’avait paru plus beau que ce dont j’avais pu rêver.
Il tombe amoureux d’Elisabeth, d’abord entrevue dans toute sa splendeur attirante d’une héritière de Boston, puis découverte au travers de ses humeurs fantasques. Les conseils de Vieux Zach, doyen de son collège, le détourneront de cette merveille. Vieux Zach est dur, mais il lui enseigne que les choses n’arrivent pas comme ça, simplement parce qu’on les énonce. Agir ! L’Amérique lui avait enseigné qu’il est naturel et facile d’agir, alors que le continent d’où il était arrivé, lourd d’une éducation ancienne, privilégiait l’acte de compréhension. Et il avait appris ceci : que la compréhension et l’action ne doivent pas être posés comme irréductibles l’un à l’autre.
Un livre initiatique. Il met en évidence les joies, les difficultés, les erreurs et le bonheur d’être adolescent. Ce fut bien un passage rituel de l’enfance à l’âge adulte, période aléatoire où la personne se construit, heureusement protégée par un entourage attentif.
07:41 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, société, femme |  Imprimer
Imprimer
01/05/2013
Chaque femme est un roman, roman d’Alexandre Jardin
Extrait du prologue :
Parfois, il me semble que les femmes sont des tremplins vers le fabuleux. Ecrivaines pour la plupart non pratiquantes, elles produisent de la prose intérieure destinée à tromper leurs déceptions et à soigner leurs rêves. Changent-elles de métier, d'amant ou d'opinion ? C'est d'abord une césure, un rebond de style, un chapitre qui se tourne. Adressent-elles une œillade à un passant ? C'est un best-seller qui débute. Depuis mon plus jeune âge, je sais que chaque femme est un roman. Voici en quelque sorte mes études littéraires, blondes et brunes.
Alexandre Jardin se penche sur les femmes par l’intermédiaire de scénettes croustillantes d’imagination et de verve. Chacune d’elle se termine par une sorte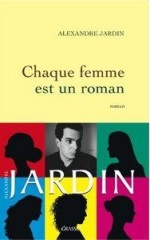 de leçon de chose. Ainsi une erreur sur la personne (féminine bien sûr) fait conclure : Je dois à cette voisine du dessous, avide de cajoleries plurielles, de m’avoir fait sentir combien je suis l’auteur de mes sentiments. Aimons-nous des êtres réels ou l’opinion que nous faisons d’eux ? Ou encore : Alexandre, sommes-nous ce que nous paraissons ? Poser la question, c’était y répondre. Eperonnée d’un vif appétit de vérité, elle aspirait alors, je le suppose, à plus d’authenticité et à redescendre des sommets où je l’avais placée. Miner la perfection, ça use. Notre histoire, asphyxiée de pétrarquisme, ne pouvait plus durer.
de leçon de chose. Ainsi une erreur sur la personne (féminine bien sûr) fait conclure : Je dois à cette voisine du dessous, avide de cajoleries plurielles, de m’avoir fait sentir combien je suis l’auteur de mes sentiments. Aimons-nous des êtres réels ou l’opinion que nous faisons d’eux ? Ou encore : Alexandre, sommes-nous ce que nous paraissons ? Poser la question, c’était y répondre. Eperonnée d’un vif appétit de vérité, elle aspirait alors, je le suppose, à plus d’authenticité et à redescendre des sommets où je l’avais placée. Miner la perfection, ça use. Notre histoire, asphyxiée de pétrarquisme, ne pouvait plus durer.
Les croquis de personnages insolites sont drôles et acidulés. Il décrit ainsi son producteur : J’aime qu’en lui se combattent mille singularités incompatibles et je raffole de l’obstination qu’il met à paraître ce qu’il n’est pas. Romanesque à l’excès, cet animal hors-série s’affiche raisonnable. Suraffectif, il se présente volontiers froid ou blasé en public. Doté d’une curiosité omnidirectionnelle, il raille volontiers les éparpillés et s’il s’installe dans le brillant de l’actualité je l’ai toujours vu passer très au large des modes. Pourquoi pavoise-t-il dans les atours de la réussite alors qu’il n’est qu’aventure ?
Alexandre Jardin campe chaque personnage dans des situations baroques. C’est ainsi qu’il va séjourner dans un hôtel où il est interdit de parler. Et il en tire une conclusion saugrenue : Pendant onze jours, allégé de tout babil, j’ai pu observer qu’on favorise mieux la communication en l’interdisant qu’en la prônant ; car s’obliger à ne pas parler n’a que peu de choses à voir avec le vide. Et encore moins avec le dessèchement de l’indifférence. Vidangé de son trop-plein de mots, le monde devient alors transparent. Comme si la parole empêchait les dialogues de grande amplitude. Jamais je n’ai eu autant le sentiment d’échanger avec celle que j’aime. Dans le vacarme de notre mutisme, au bord du grand soupir de l’océan, chaque regard de Liberté (sa femme) se mit à compter. Tout gémissement avait valeur de discours incandescent. Le moindre devenait colossal. C’est là-bas, épargné par la dérobade du langage, dans cet ermitage des tempêtes tropicales, que j’ai appris ma femme. En la dessinant bouche cousue, je l’ai mieux sue.
Les hommes ont toujours à apprendre des femmes. De plus, ils aiment se laisser surprendre pour se retrouver dans l’inconnu imprévisible, l’univers féminin. Madame Equal, professeur de maths, a adopté un système éducatif radical, elle vire les bons élèves. La semaine suivante, je savais mes cours par cœur avant d’entrer en classe : pour pouvoir sortir au plus vite et jouer au foot avec vacarme. Et nous fîmes tous de même, nous les « virés » afin de ne pas moisir parmi les « inclus » condamnés à végéter devant un pupitre. Mme Equal est la seule prof de maths qui ait jamais su me motiver indirectement, comme si elle avait compris que le plus court chemin entre deux points reste le zigzag. (..) Mais à la fin de l’année, c’est elle qui fut virée !
Alexandre Jardin ne manque pas d’imagination et d’observation. En observant les femmes, il se construit lui-même. La plupart d’entre nous ne tirent que peu de conclusions à nos habitudes de penser. Lui, d’un coup d’œil, croque le comportement féminin et lui rend sa puissance imaginative. Alors le regard sur les femmes change l’homme et ouvre en lui la porte de l’amour. Peut-être sommes-nous essoufflés dans la dernière partie du livre. Trop, c’est trop ! La verve devient lassante. Il termine sur un pied de nez : A ma montre, celle de papa, il est exactement huit heures vingt du matin à l’instant où je tape ces mots ; l’heure où j’ai aperçu Liberté pour la première fois il y a sept ans, d’un coup d’œil dilaté. Parviendrai-je à épouser cette femme qui, déjà, m’apprend à mourir en dansant sur les tables ? Elle sait si bien me mettre en demeure de rencontrer l’inattendu ; à son bras, je consens à vieillir.
07:23 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, femme, récit |  Imprimer
Imprimer
27/04/2013
Lorsque j’étais une œuvre d’art, roman d’Eric-Emmanuel Schmitt
Tazio non seulement a raté sa vie, mais rate également ses  suicides. Il est laid et inintelligent au contraire de ses deux frères, les plus beaux hommes du monde. Il trouve enfin le lieu idéal pour en finir, la falaise de Palomba Sol. Au moment où il va prendre son appel, une voix lui demande vingt-quatre heures. L’artiste Zeus-Peter Lama lui propose de changer de vie en lui abandonnant sa volonté pour qu’il devienne une sculpture vivante dénommé Adam bis.
suicides. Il est laid et inintelligent au contraire de ses deux frères, les plus beaux hommes du monde. Il trouve enfin le lieu idéal pour en finir, la falaise de Palomba Sol. Au moment où il va prendre son appel, une voix lui demande vingt-quatre heures. L’artiste Zeus-Peter Lama lui propose de changer de vie en lui abandonnant sa volonté pour qu’il devienne une sculpture vivante dénommé Adam bis.
Zeus-Peter est un artiste contemporain très médiatique, qui manipule les gens et dispose d’une grande autorité. Opéré, Adam devient une sculpture que tous s’arrachent.
– Suis-je beau demande-t-il à Zeus-Peter.
– Je t’ai créé pour embellir le monde.
– Suis-je beau ? Cesse ces banalités.
– Je n’ai pas voulu que tu sois beau, je t’en avais prévenu, j’ai voulu que tu sois unique, bizarre, singulier, différent ! Quelle réussite grisante.
Tazio a interdiction de se regarder dans une glace et de parler. Il se soumet. Tous veulent le voir et particulièrement les femmes, car l’artiste a transformé son sexe en sonomégaphore, la plus réussie des métaphores, prototype unique. Mélinda s’essaye, le démaillote et s’exclame :
– Incroyable !
Elle s’approcha, le contempla et le manipula avec légèreté.
– Une idée de génie !
Ses paupières et sa bouche en restèrent grandes ouvertes. (…)
Au troisième moment de repos, alors que nous reprenions notre souffle en fixant le plafond, Mélinda bondit à califourchon sur moi pour recommencer.
– Ah non, ça suffit ! Je n’en peux plus !
Les mots avaient jailli de ma bouche sans que je m’en rendre compte. (…) Elle me regarda avec effroi et poussa un cri de bête.
– Qui a-t-il Mélinda ?
Elle courut au fond de la pièce et se réfugia derrière un fauteuil, épouvantée. (…)
– Tu parles ?
– Naturellement je parle.
– C’est horrible. Je ne le savais pas.
Il se met à boire. Il fuit Zeus et se retrouve sur la plage et voit un groupe de silhouettes. Devant lui, un homme et une femme. Lui, assis. Elle debout. Ils regardaient le monde – ciel, mer, nuages, oiseaux – à travers la fenêtre du tableau. Inconscients de constituer eux-mêmes un tableau par la noblesse de leur attitude, attentifs, immobiles, elle se tenant derrière lui en appuyant ses mains sur ses épaules, ils fixaient le carré de toile dans lequel l’univers tout entier accourait pour se figer et s’organiser. Ils semblaient attendre devant le cadre que le tableau se fît.
Et cette rencontre va transformer Tazio. Zeus le vendra comme une œuvre d’art, de nombreux péripéties lui arriveront, mais tout se joue à cet instant, la rencontre d’un homme avec la beauté naturelle et la beauté artistique, si loin des beautés artificielles des femmes et de l’art médiatique de Zeus : Sa carrière ; il ne la fait pas dans son atelier, il la fait dans les médias ; ses pigments, ce sont les journalistes, et là, il est, sinon un grand artiste, un grand manipulateur. Avec cette sculpture, sa dernière, il se poursuit et en même temps il se dépasse, il franchit une frontière, il s’installe dans le terrorisme, il devient criminel.
Histoire de Faust qui conclut un pacte avec Méphistophélès, inspirée à l’auteur par un homme qui se faisait opérer sans cesse pour devenir plus beau. Histoire drôle, inquiétante et malgré tout romantique grâce à Fiona, la femme rencontrée sur la plage.
07:47 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, art, média, femme |  Imprimer
Imprimer
19/04/2013
La valse aux adieux, de Milan Kundera
Les cinq derniers jours de la vie d’une femme : Ruzena, belle, désirable et désirée. A tel point qu’elle passe une nuit avec un trompettiste de renom, Klima, venu donner un concert dans la ville d’eau où elle est employée aux bains. Elle est enceinte, sans exactement savoir de qui, du trompettiste ou de son amant Frantisek. Frantisek est plus jeune que Ruzena, il est donc, malheureusement pour lui, très jeune. Quand il sera plus mûr il découvrira la fugacité des choses et il saura que, derrière l’horizon d’une femme, s’ouvre encore l’horizon d’autres femmes. Seulement Frantisek ignore ce que c’est que le temps. Il vit depuis l’enfance dans un monde qui dure et qui ne change pas, il vit dans une sorte d’éternité immobile, il a toujours le même père et la même mère aussi, et Ruzena, qui a fait de lui un homme, est au-dessus de lui comme le couvercle du firmament, du seul firmament possible.
est enceinte, sans exactement savoir de qui, du trompettiste ou de son amant Frantisek. Frantisek est plus jeune que Ruzena, il est donc, malheureusement pour lui, très jeune. Quand il sera plus mûr il découvrira la fugacité des choses et il saura que, derrière l’horizon d’une femme, s’ouvre encore l’horizon d’autres femmes. Seulement Frantisek ignore ce que c’est que le temps. Il vit depuis l’enfance dans un monde qui dure et qui ne change pas, il vit dans une sorte d’éternité immobile, il a toujours le même père et la même mère aussi, et Ruzena, qui a fait de lui un homme, est au-dessus de lui comme le couvercle du firmament, du seul firmament possible.
Klima est marié avec une très belle femme, Kalima. Mais sa jalousie lui gâche la vie. Elle mit trop de sel. Elle faisait toujours la cuisine avec plaisir et fort bien et Klima savait que si ,ce soir-là, le repas n’était pas réussi, c’était uniquement parce qu’elle se tourmentait. Il la voyait en pensée verser dans les aliments, d’un geste douloureux, violent, une dose excessive de sel, et son cœur se serrait. Il lui semblait, dans les bouchées trop salées, reconnaître la saveur des larmes de Kalima, et c’était sa propre culpabilité qu’il avalait.
Comme dans tous les romans de Kundera, d’autres personnages se mêlent à l’intrigue principale. Olga d’abord, une collègue de travail de Ruzena. Olga était une de ces femmes modernes qui se dédoublent volontiers en une personne qui vit et une personne qui observe. Jakub, père adoptif d’Olga parce que son ami, le père d’Olga, avait été condamné ses pairs dont lui-même. Je vais te dire la plus triste découverte de ma vie : les persécutés ne valent pas mieux que les persécuteurs. Je peux fort bien imaginer les rôles inversés. Toi, tu peux voir dans ce raisonnement le désir d’effacer sa Uoiresponsabilité et de la faire endosser au créateur qui a fait l’homme tel qu’il est. Et c’est peut-être bien que tu voies les choses comme ça. Parce que, parvenir à la conclusion qu’il n’y a pas de différence entre le coupable et la victime, c’est laisser toute espérance. Et c’est ça qu’on appelle l’enfer, ma petite. Enfin, il y a Bertlef, l’américain, amoureux de Ruzena, riche, piquant des colères plus ou moins légitimes : je voudrais en trinquant marier le passé et le présent et le soleil de 1922 au soleil de cet instant. Elle est, sur la toile de fond de cette ville d’eaux, comme un diamant sur l’habit du mendiant. Elle et comme un croissant de lune oublié sur le ciel pâli du jour. Elle est comme un papillon qui voltige sur la neige. Le caméraman rit d’un rire forcé : « Vous l’exagérez pas, directeur ? » « Non, je n’exagère pas. Vous en avez l’impression parce que vous n’habitez que le sous-sol de l’être, vous, vinaigre anthropomorphisé ! Vous débordez d’acides qui bouillonnent en vous comme dans la marmite d’un alchimiste !. Vous donneriez votre vie pour découvrir autour de vous la laideur que vous portez à l’intérieur de vous-même.
Quelques autres personnages : le docteur Skreta, les épouses des deux derniers. Mais le décor est planté, le drame peut survenir, imprévisible dans ses causes et ses conséquences, jusqu’à la mort.
Une fois encore, ce qui intéresse Kundera, ce sont les femmes, leur personnalité, leur originalité. Les hommes ne sont là que pour les dévoiler. Ainsi de Klima et Lalima : Elle était allongée sur le dos, la tête enfoncée dans l’oreiller, le menton légèrement levé et les yeux fixés au plafond et, dans cette extrême tension de son corps (elle le faisait toujours songer à la corde d’un instrument de musique, il lui disait qu’elle avait l’âme d’une corde), il vit soudain, en un seul instant, toute son essence. Oui, il lui arrivait parfois (c’étaient des moments miraculeux) de saisir soudain, dans un seul de ses gestes ou de ses mouvements, toute l’histoire de son corps et de son âme. Ou encore, d’Olga et de Jakub : Et elle fut soudain nue devant lui et il se disait que son visage était noble et doux. Mais c’était une piètre consolation quand il voyait le visage d’un seul tenant avec le corps qui ressemblait à une longue et mince tige à l’extrémité de laquelle était plantée, démesurément grosse, une fleur chevelue.
Cependant, on se lasse de cette histoire de ville d’eaux, d’amantes et de jalousie, et même du devenir de Ruzena qui n’est qu’un pion balloté par les opinions des autres. La langue est belle, les analyses des personnalités intéressantes, le style de Kundera toujours aussi mordant, mais l’intrigue est au fond mortellement ennuyeuse.
05:17 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, littérature |  Imprimer
Imprimer
13/04/2013
Judith Albarès, roman de Simone Jacquemard
Etrange figure de femme apparemment que cette Judith qui, dans sa ma ison d’Arvelinghen, dans les dunes au bord de la mer, garde comme une proie le jeune Nicolas Servain à peine sorti de l’adolescence et qu’elle a arraché par la ruse à sa jeune amie. Judith a plus de quarante ans. Qu’a été sa vie pour la rendre ainsi « amoureuse de l’amour dans le trouble de ses commencements » ? Et où la conduira cette quête forcenée ?
ison d’Arvelinghen, dans les dunes au bord de la mer, garde comme une proie le jeune Nicolas Servain à peine sorti de l’adolescence et qu’elle a arraché par la ruse à sa jeune amie. Judith a plus de quarante ans. Qu’a été sa vie pour la rendre ainsi « amoureuse de l’amour dans le trouble de ses commencements » ? Et où la conduira cette quête forcenée ?
Pas à pas, à travers la mémoire de Judith, nous parcourons le chemin qu’elle a suivi depuis ce jour où, adolescente elle-même, elle a fait sur la place la rencontre d’un garçon de son âge, ce Romain Brienne, qui l’a révélée à elle-même et dont le souvenir, aussi profondément enfoui qu’il soit, ne cessera de la brûler. Philippe Estavayé, Claude Gombert, Ugo Scharfenberg et tant de jeunes inconnus poursuivis à grand risque, à travers le scandale toujours prêt à éclore et la honte pressentie et l’émerveillement renouvelé, autant d’étapes vers l’abîme où lucidement elle va se jeter.
« Simonne Jacquemart est née à Paris en 1924. Elle a passé son enfance dans la baie de Somme. Elle suit des études de grec à la Sorbonne, études qu’elle reprendra au fil des années. Très tôt elle se passionne pour les arts : le piano, dès l’âge de 5 ans, la guitare classique, la danse indienne, le flamenco. Elle donnera des spectacles à Paris, Bordeaux, Sens, Chinon et à Cordes (Tarn) pour les fêtes médiévales de 1982 à 2000.
Elle s’intéresse également au tissage, dont elle a une longue pratique, et à l’ornithologie au quotidien. Elle élève des chevaux arabes et anglo-arabes depuis 1968, ainsi que des chèvres alpines chamoisées. Pendant dix ans, elle vit en intimité avec vingt-cinq renards, souvent nés à la maison, pour l’étude scientifique et l’apprivoisement. Elle cultive la marche à pied en solitaire, sac au dos, à travers toute la France.
En marge de toutes ces activités, elle a publié depuis 1945 une cinquantaine d’ouvrages : romans, nouvelles, récits, essais, poésie, traductions. Elle a obtenu différents prix littéraires dont le prix Renaudot, en 1962.
Elle vit, depuis près de vingt ans, dans le Périgord, avec l'écrivain, peintre et naturaliste Jacques Brosse, décédé le 3 janvier 2008. »
(source : http://www.arfuyen.fr/html/ficheauteur.asp?id_aut=1197)
07:46 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, écrivain |  Imprimer
Imprimer
12/04/2013
La petite chartreuse, roman de Pierre Péju
Deux destins marchent l’un vers l’autre. Une petite fille perdue qui attend sa maman et un libraire, Etienne Vollard, ours mal léché, qui conduit sa camionnette : six cents kilos de ferraille, deux cent kilos de livres, cent dix kilos de Vollard, bref une tonne de choses mécaniques, humaines et littéraires. (…) Vollard voit successivement le petit anorak rouge, la pâleur, la terreur soudaine dans deux yeux immenses, démesurés, deux yeux incrédules plongeant dans les siens. Longtemps il restera persuadé d’avoir nettement distingué ce visage à travers le pare-brise, un visage d’enfant qui n’était séparé de sa vieille tête à lui que par l’écran transparent contre lequel il se brisait.
Vollard voit successivement le petit anorak rouge, la pâleur, la terreur soudaine dans deux yeux immenses, démesurés, deux yeux incrédules plongeant dans les siens. Longtemps il restera persuadé d’avoir nettement distingué ce visage à travers le pare-brise, un visage d’enfant qui n’était séparé de sa vieille tête à lui que par l’écran transparent contre lequel il se brisait.
Il n’est pas responsable. L’enfant s’est jeté sous ses roues. Mais il ne peut s’empêcher de penser à sa victime.
Alors il va la voir à l’hôpital, un corps environné de tuyaux, avec une mère, Thérèse, qui fuit sa fille, inefficace. Il va la prendre en charge, cette Eva qui est dans le coma. Il lui parle dans le creux de l’oreille. Il lui raconte ses histoires de livres. Il lui récite des livres entiers. Il abandonne sa librairie à son assistante et passe des jours entiers près d’elle.
Bientôt Eva put quitter l’hôpital. Habillée de neuf, elle ressemblait à n’importe quelle petite fille, yeux noirs, duvet noir. (…) Elle ne disait rien, absolument rien, mais elle ne paraissait pas en éprouver le besoin.
Thérèse fuit, une fois de plus, et signe les papiers autorisant Vollard à s’occuper de sa fille qui se trouve maintenant dans une maison de santé de la Chartreuse. Celui-ci y va et fuit lui aussi. Il n’a pas le courage d’affronter cette chose pétrifiée. Il reviendra pourtant. Ils partent dans la campagne de la Chartreuse, dans ses bois, ses massifs, ses rivières. Et il raconte ses livres. Pour Vollard, Eva devenait la petite chartreuse. Silencieuse sans en avoir fait le vœu. La très pâle moniale. L’enfant cloîtrée. L’enfant privée de voix et de joie, privée d’enfance. Mais au fil de ces errances dans la Chartreuse, bizarrement, ce n’était pas le poids écrasant et absurde de l’accident que Vollard ressentait en compagnie de la petite fille, mais un inexplicable allégement, un soulagement, un apaisement dû à ce rituel de marche lente, de silence, de contemplation de choses infimes. Comment un si petit être, émettant si peu de signes, pouvait-il lui donner cette impression de discret équilibre, de nécessité fragile, mais heureuse ?
Un beau livre, discret, réfléchi, qui parle de cet amour entre le libraire et sa victime et qui conduit malgré tout à une fin terrible des personnages, comme si inéluctablement leur destin se poursuivait jusqu’à l’anéantissement.
07:42 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, enfance |  Imprimer
Imprimer
05/04/2013
Un garçon en l’air, roman de Didier Martin
Raphaël, le narrateur, vole. Non ce n’est pas un voleur. Il vole réellement comme un oiseau, mais sans battre des ailes. On pourrait dire qu’il lévite, mais la lévitation ne permet pas de se déplacer dans les airs. Il le peut. Il le fait depuis sa tendre enfance.
les airs. Il le peut. Il le fait depuis sa tendre enfance.
A l’école, il rencontre François qui vole également. Et il vole mieux, de manière plus décontracté, comme si cela était naturel chez lui. François envisageait le vol d’une tout autre façon que moi. A vrai dire, il avait des idées sur la question. Il en regorgeait même, fussent-elles négatives, tandis que j’en étais entièrement dépourvu, du moins jusqu’à son apparition au-dessus de la cour de l’école. Mais tout ce qu’il me disait depuis ce jour-là me trouvait réticent : je volais par plaisir et lui par habitude ; je tenais le vol pour une sorte de supériorité, et lui pour un mauvais tour que le sort lui avait joué ; je croyais de tout mon cœur à une raison profonde et encore secrète d’être pourvu d’un don qu’il regardait comme une absurdité de la nature.
Un jour, François lui donne rendez-vous pour le lendemain. Il va voler devant quelqu’un qui ne vole pas et qui ne peut pas le voir. Et il explique les raisons : disons qu’ils ne peuvent pas en croire leurs yeux. C’est trop fort pour eux, tellement fort que cela n’existe pas. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, Dieu n’existe pas. Et ils volent devant la mère de François sans que celle-ci s’en rende compte. Plus tard, ils constatent dans les jardins du champ de Mars qu’il y a d’autres êtres volants qui les environnaient.
François lui présente Catherine, l’amie d’une amie et Raphaël en tombe amoureux. Mais il ne lui dévoile pas son secret. Bientôt, c’est l’alternative : Catherine ou le vol. Après bien des péripéties, il lui préfère le vol et Catherine repart. Elle épousera un homme normal. Et lui : Je volerai tous les jours. Je peux voler n’importe où et n’importe quand désormais : cela n’a aucune importance et ne présente aucun risque, plus aucun risque. Dès demain…
Quel beau roman dans lequel le fantastique côtoie la réalité sans que jamais on ressente un instant de gêne.
07:48 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman |  Imprimer
Imprimer
01/04/2013
Quelques pas dans les pas d’un ange, récits de David Mc Neil
L’auteur raconte ses premiers pas aux côtés de son père, le peintre Marc Chagall. Ce sont des souvenirs brefs, mais accompagnés de l’amour filial qui éduque et met du sel dans les aventures d’un enfant. Il s’émerveille :
Il trouvait fastidieux de couvrir de peinture deux bons mètres carrés alors il m’a demandé de préparer le fond. Je commençais à comprendre que n’importe qui aurait payé pour avoir ma place, alors j’ai mis presque une journée à le peindre, travaillant lentement, sensuellement, m’imprégnant de l’odeur enivrante de la térébenthine, je soupçonne les peintres de s’asperger le soir de térébenthine comme d(‘autres d’un after-shave, ça attire les jeunes filles que fascinent les artistes. Une journée de bonheur. Le matin arriva où la couleur fut sèche. Alors il a préparé des fusains, les tenant dans son poing comme un petit bouquet, il s’est assis dans un large fauteuil en paille et a regardé longuement la tache bleue en plissant les yeux et se pinçant les lèvres comme il le faisait souvent quand il se concentrait. Il attendait l’idée. Picasso disait, peut-être avec humour : « Je ne cherche pas, je trouve », « Moi j’attends » répondait mon père très faux-modestement. Je l’ai souvent vu qui fixait une toile blanche, un carton, une feuille vierge, il prenait un de ses fusains et le cassait en deux, le tenant dans sa main, parallèle à son pouce. Alors il commençait et tout allait très vite.
Autre histoire, dans un bistrot populaire rue Saint Louis en l’Ile :
On ne dépareillait pas du tout dans le restaurant où, très vite, on avait trouvé à s’assoir. Les deux ouvriers à la table à côté ont regardé les mains de papa, tachées de couleurs diverses, ces mains dont il disait souvent qu’elles étaient imprégnés jusqu’à l’os. Il avait plus de soixante-dix ans, mais avec son allure énergique et l’impression de puissance qui émanait de lui, il pouvait très bien passer pour un peintre en bâtiment.
« Vous avez un chantier dans le coin ? demanda l’un d’eux.
Je refais un plafond à l’Opéra, répondit mon père en attaquant son œuf dur mayonnaise.
C’est un livre sans prétention. En prologue, il est écrit :
Ce livre est court, beaucoup trop court. Il raconte les rares moments que j’ai pu passer avec celui qu’autour de moi tout le monde appelait « maître » et que moi j’appelais simplement papa…
07:42 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, littérature, souvenir, biographie |  Imprimer
Imprimer
26/03/2013
Quinze ans, roman de Philippe Labro
A quinze ans, le narrateur sait qu’il va lui arriver quelque chose de prodigieux : désigné par le destin pour connaître une émotion unique, qui me délivrerait de la gêne qui prend au piège la première jeunesse.
En trois parties, Philippe Labro conte l’histoire, mettant d’abord l’accent sur Alexandre Vichnievsky-Louveciennes, un camarade de classe arrivé au milieu du premier trimestre. Il ne parle pas directement aux personnes qui sont devant lui. Il utilise des circonvolutions : – le type est doué ! Il a de la réplique ! Excellent ! Le type veut rencontrer Madame Ku. Mais Madame Ku se mérite, figurez-vous ! Le type sait-il seulement ce que signifie son nom ? Je voulus frapper fort et dis sur un ton averti : – Bien sûr, c’est comme un cul. Alexandre éclata d’un rire extasié et bruyant, qui fit se retourner quelques têtes autour de nous. – Vous êtes une âme vulgaire.
L’approche de cet être exceptionnel fut longue et difficile. Le narrateur accepte toutes les moqueries et facéties d’Alexandre. Celui-ci finit par l’emmener chez Madame Ku, qui s’appelle en réalité Kudlinska, une charmante petite vieille, effluve d’un passé russe. C’est ma babouchka. Un jour, la sœur d’Alexandre, Anna, débarque dans la petite maison : Et je vois debout, droite dans un manteau d’homme de couleur beige, une écharpe multicolore lui barrant la poitrine, une grande jeune fille aux longs cheveux noirs, au teint pâle et aux lèvres rouges. On dirait qu’une sorte de lumière entoure sa silhouette. (…) Elle ne m’a pas une fois adressé parole ou regard (…) et je pense à la phrase de Victor Hugo : « Le jour où une femme qui passe devant vous dégage de la lumière en marchant, vous êtes perdu, vous aimez. »
La seconde partie traite d’Anna, la jeune fille dont il est amoureux. Sa rencontre a lieu dans la chambre d’Alexandre :
– C’est mon ami. Tu l’as déjà rencontré chez Ku.
Anna se détache d’Alexandre, se lève et remet d’un geste des mains un peu d’équilibre dans sa coiffure.
– Ah oui, dit-elle, peut-être en effet, oui. Et quel âge avez-vous ?
Surpris qu’Anna se soit enfin décidée à me parler, je bredouille
– Euh… le même âge qu’Alexandre.
J’entends rire Alexandre. Anna accompagne son frère dans ce léger accès de moquerie et me dit sans méchanceté, mais sur un ton dans lequel je crois discerner la condescendance des grandes personnes à l’égard des enfants :
– Le même âge sans doute, mais vous me paraissez un peu plus niais que lui.
C’est un coup qui me perce. Anna s’en aperçoit et s’approche de moi tend ses doigts vers ma joue, comme pour une rapide et impalpable caresse.
– Ne prenez pas cela mal, dit-elle. J’ai plutôt voulu dire innocent, pas niais. Il y a une nuance.
– Merci, dis-je.
Quelques instants plus tard, dans sa chambre, elle lui dit :
– Vous êtes sans doute amoureux de moi. Mais faisons un accord, voulez-vous ? Décidons que nous le savons tous les deux et restons-en là. Je ne vous empêche pas de m’aimer, mais je vous ordonne de ne m’encombrer jamais avec ce sentiment ou même avec une seule manifestation extérieure de ce sentiment, jamais ! A ce prix peut-être deviendrons-nous des amis.
(…) Avec autorité, elle fit basculer ma tête entre ses deux mains, me forçant à me courber vers elle au-dessus du plateau et de la théière et elle déposa sur mon front un baiser fragile, sans équivoque. Mais ses mains avaient touché les tempes, j’avais respiré son parfum, odeur de santal, de poivre et de bruyère, et cela m’avait secoué, comme un courant électrique. Je n’avais pas pensé plus avant. Un événement nouveau, avec sa marque indélébile, venait de m’arriver dans cette chambre.
Il gagne un concours organisé par un journal : écrire un papier. Et ce papier a plu. L’œil d’Alexandre et d’Anna sur lui changea. Il entra dans leur intimité.
Ne dévoilons pas le reste, ce serait dommage. Cette histoire m’a rappelé le roman "Le grand Meaulnes" d'Alain Fournier : même adolescent, même jeune fille, même mystère. C’est fou ce que la jeunesse a d’innocence et d’illusion. Elle conduit à des situations difficiles. Mais sans doute leurs participants ne voudraient pas en être absents. Merci à Philippe Labro dont le ton de sincérité ouvre la porte au rêve.
18:05 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman |  Imprimer
Imprimer
27/02/2013
Qu’ai-je donc fait, de Jean d’Ormesson
J'ai tenté de lire d’Ormesson il y a longtemps, si longtemps que je ne me souviens plus de quel ouvrage il s’agissait. Je m’étais ennuyé, le trouvant pédant. J’ai acheté ce livre dans un vide grenier et en ai commencé la lecture. Miracle, les 70 premières pages m’ont passionné. Je l’ai trouvé drôle, cultivé, au fait des questions éternelles sur l’homme, sur ce que chacun d’entre nous est et sur ce qu’il est lui-même. « C’est moi » est son leitmotiv des premiers chapitres : Bonjour. Bonsoir. C’est encore moi. Ne me dites pas que j’exagère... C’est vrai, j’ai du mal à me quitter.
Miracle, les 70 premières pages m’ont passionné. Je l’ai trouvé drôle, cultivé, au fait des questions éternelles sur l’homme, sur ce que chacun d’entre nous est et sur ce qu’il est lui-même. « C’est moi » est son leitmotiv des premiers chapitres : Bonjour. Bonsoir. C’est encore moi. Ne me dites pas que j’exagère... C’est vrai, j’ai du mal à me quitter.
Mais immédiatement après, il constate que moi, c’est vous : Chacune des créatures conquérantes et voués au néant qui sont passées sur cette planète a le droit de se lever et de dire : « Moi » comme moi. Je suis moi. Chacun de vous est un moi comme moi. Je – mon Dieu – est un autre. Aussi finit-il ce chapitre par cette supplique : Ne m’accusez pas, je vous prie, de ne m’occuper que de moi ; En parlant de moi, je parle de vous. Quel beau pied-de-nez !
Bien qu’il ne parle que de lui – et du temps – il reste primesautier. Progressivement, il commence à faire étalage de sa culture. Pris sous l’angle de l’humour, cela passe. Il parle de sa paresse : Tout m’amusait. Rien ne me retenait. Tout me plaisait. Rien ne m’attirait. Il avoue même qu’il écrit toujours la même chose. Il aimait apprendre. Il était curieux. Puis il entre dans son côté plus « Regarde-moi » alors qu’il dit dans le même temps « Je ne cherche pas à plaire… Je vise à mieux : à me plaire. Le succès me paraît être un résultat et non un but. » C’est sûrement vrai, mais faut-il le dire ? Tous le proclament un fois le but atteint. Le livre change donc de portée. Il parle de sa famille, de ses ancêtres, de ses châteaux, de leurs rapports avec Dieu, de leur manière de table. Et cela perd le livre qui jusqu’ici nous charmait malgré certains dérapages. Il parle également de son Ecole, de ses professeurs, des trotskistes. C’est long et ennuyeux, malgré quelques beaux effets de style. Ce contraste entre la rue d’Ulm et sa famille lui permet de constater que tout s’écroule, sauf l’argent : l’argent hier, était, sinon une force de l’ombre, elle ne l’a jamais été, du moins un outil subalterne, un instrument au service du pouvoir. Tout, désormais, tourne autour de lui. Il est devenu le pouvoir.
Il reprend alors sa méditation sur Dieu et ses liens avec les hommes dans la troisième partie du livre, mais de manière indirecte. L’homme est le seul être capable de penser le tout. Il est remonté au big bang, il peut prédire comment les étoiles finiront. La vie et, au-delà de la vie, l’univers sont des machines à transformer l’avenir en passé. L’avenir ne se transforme pas directement en passé : il passe par le présent. Le monde est un paradoxe et un mystère parce que l’homme est dans le temps. Jean d’Ormesson tente alors de faire coïncider la physique et la métaphysique dans des évocations brèves de l’espace, de la lumière, de l’eau, de la pensée, de la parole. Et toujours, il revient au temps. Il me semble que le temps n’est pas fermé sur lui-même et qu’il renvoie à autre chose. A quoi ? A l’éternité. (…) Dans ce monde, le temps est tout, mais, au regard de l’idée que nous sommes capables de nous faire de l’infini, il est une limite, une servitude, une imperfection. Il est la marque de notre condition misérable. A l’origine de l’univers, il naît avec le tout qu’il accompagne de bout en bout. Il est signe d’autre chose, vers quoi nous nous précipitons. De quoi est-il donc le signe ?
Dieu est caché, nous dit l’auteur. On ne peut ni prouver son existence, ni son inexistence. La science s’arrête à l’existence de l’univers, au-delà qu’y a-t-il ? La science est là. Dieu est ailleurs. Hors de ce monde. Hors du temps. A l’écart de nos lois que déchiffre la science. La science parle. Dieu se tait. La science est présente sur tous nos fronts. Dieu est absence.
Qu’a-t-il donc fait, finalement ?
Il a essayé d’être libre. Et ce qui l’intéresse, c’est l’avenir. Il s’obstine à lui faire confiance. Qu’ai-je donc fait ? Rien, bien entendu. Je le dis sans affectation et avec un peu d’orgueil. Rien, dans ce monde et dans le temps, ce n’est déjà pas si mal. Je suis entré dans le temps. J’ai fait partie de ce monde. C’est une chance inouïe, un bonheur et un triomphe. (…) Je me retourne encore une fois sur ce temps perdu et gagné et je me dis, je me trompe peut-être, qu’il m’a donné – comme ça, pour rien, avec beaucoup de grâce et de bonne volonté – ce qu’il y a eu de meilleur de toute éternité : la vie d’un homme parmi les autres.
Oui, on peut le dire, à côté de ses fièvres aristocratiques agaçantes, en dépit de son côté satisfait d’être ce qu’il est, Jean d’Ormesson sait nous faire lire l’histoire d’une autre manière, englobant ce qui préoccupe les hommes depuis des temps immémoriaux : d’où je viens et où vais-je ? Et celui qui dit moi, c’est nous.
07:32 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, société, écrivain, philosophie |  Imprimer
Imprimer
22/02/2013
Bille en tête, roman d’Alexandre Jardin
Chaque famille a son vilain petit canard. A la maison, ce rôle me revenait de droit. J’y voyais une distinction. En contrepartie de cet avantage, je fus expédié à Evreux en pension. Evreux, ville où l’on est sûr de n’avoir aucun destin. Véritable banlieue de l’histoire, les réussites y sont lentes. La province a toujours fait de l’ombre aux ambitieux.
Décidé à lutter contre la tyrannie de son père, Virgile, le narrateur, ne demande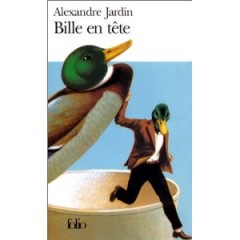 pas la permission de grandir. Il se sacre adulte lui-même. Son premier essai est malheureux : fuir la pension en prenant le train pour Paris avec un camarade et se retrouver au commissariat. Heureusement, l’Arquebuse, grand-mère et personnage de poids, vient l’en délivrer.
pas la permission de grandir. Il se sacre adulte lui-même. Son premier essai est malheureux : fuir la pension en prenant le train pour Paris avec un camarade et se retrouver au commissariat. Heureusement, l’Arquebuse, grand-mère et personnage de poids, vient l’en délivrer.
Il fait connaissance avec Clara, une femme mariée, lors d’un diner auquel son père l’emmène. Il ose lui dire : « Clara, j’ai quelque chose à vous demander. A table, je voudrais être assis à votre droite, pas à la table des enfants. » Puis il lui donne rendez-vous à la sortie de son collège. Et elle y est : « Clara s’est avancé vers moi. Elle m’a regardé. Je lui ai pris la main. Nous étions seuls. Les oiseaux chantaient pour nous. Le soleil aussi brillait pour nous. Dieu qu’elle était belle dans sa robe qui laissait voir ses jolies jambes. » Tout alla très vite. Le soir même, il est à l’hôtel guidé par Clara pour ses premiers pas dans l’amour. Le lendemain, se promenant avec sa conquête sur la plage de Deauville, il rencontre son père et lui annonce : « Je suis venu avec Clara, je l’aime. » Elle éclate de rire, tentant de faire croire à une mauvaise plaisanterie.
Virgile fait la connaissance de Jean, le mari de Clara. Avec Clara et Jean notre vie à trois dura encore quelques mois. Il l’emmène chez sa grand-mère. Ils font de la barque sur l’étang. Ils redeviennent enfants. Mais son père à nouveau les rattrape.
Exilé à Rome, dans une pension prison, il trouve le moyen de faire venir Clara. L’apprenant par une photo sur un magazine, son père finit par le mettre à la porte : « Virgile, je ne te jette pas hors de chez toi. Tu es déjà parti. » Il devient coursier dans un journal.
La mort de l’Arquebuse met fin à cette errance d’adolescent. Virgile prend conscience de ses avancés dans la vie. De retour à Paris, après l’enterrement, il se précipite chez Clara : « Clara, il m’arrive quelque chose de formidable. Je vais quitter mon enfance. Je vais te quitter. » En la quittant, je rompais le dernier lien qui me rattachait à ces longues années de souffrances ; je mettais fin à mon infinie tristesse d’être petit. Haut les cœurs !
Vous me direz que tous les livres d’Alexandre Jardin sont semblables. Oui, c’est vrai. Mais quelle fraicheur d’invention pour fêter l’amour, la jeunesse, la liberté. C’est une bouffée d’oxygène dans un monde asphyxiant, un remède à la mélancolie, voire à la dépression. « Chaque fois que tu vis, que tu écris ou que tu dis avec légèreté quelque chose de grave, tu gagnes en grandeur », dit l’Arquebuse à Virgile.
07:07 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, femme |  Imprimer
Imprimer
18/02/2013
Le grand exterminateur, roman de Virgil Gheorghiu
Bucarest signifie « ville de la joie ». C’est un nom prétentieux. Une ville où la joie est permanente n’existe pas sur terre. Ainsi commence ce roman dans un monde fou, celui de la dictature roumaine. Son objet est une chasse à l’homme. Celui-ci, Trajan Roman, est sauvé par une enfant de douze ans, Dragomirna,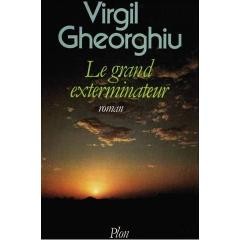 fille du directeur de la police. Trajan n’arrive pas à situer et à comprendre la fillette qui est devant lui. Quelquefois, Dragomirna parle et agit comme une toute petite fille. Comme les enfants. Une minute après, elle s’exprime comme les adultes. Dans la personne de Dragomirna tous les âges sont mélangés. Elle est semblable au grenadier. Lui, n’est qu’un paysan, fils d’un curé de campagne, mort d’épuisement provoqué par l’archevêque Isidor, à la solde du pouvoir. Il eut la chance de rencontrer le professeur Cicérone Trifan qui dirigeait la commission pour la préparation du saint et grand concile, et surtout sa fille qu’il finit par épouser. Mais des documents ont été subtilisés et sont recherchés par la police.
fille du directeur de la police. Trajan n’arrive pas à situer et à comprendre la fillette qui est devant lui. Quelquefois, Dragomirna parle et agit comme une toute petite fille. Comme les enfants. Une minute après, elle s’exprime comme les adultes. Dans la personne de Dragomirna tous les âges sont mélangés. Elle est semblable au grenadier. Lui, n’est qu’un paysan, fils d’un curé de campagne, mort d’épuisement provoqué par l’archevêque Isidor, à la solde du pouvoir. Il eut la chance de rencontrer le professeur Cicérone Trifan qui dirigeait la commission pour la préparation du saint et grand concile, et surtout sa fille qu’il finit par épouser. Mais des documents ont été subtilisés et sont recherchés par la police.
Le cœur du subtil complot est expliqué au chapitre VI. Staline découvre que l’énergie dépensée par l’eau bénite n’est pas moindre que l’énergie atomique. (…) Les soviets, sans l’arme atomique, ne pourront jamais réaliser le communisme. Staline n’oublia pas, non plus, qu’il y a quelque chose qui est aussi minuscule que l’atome et que la société communiste ignorait jusqu’à cette date. C’est l’individu. Dans un Etat communiste, l’individu est nul. Il n’a aucune valeur. La personne humaine équivaut à zéro. (…) Staline découvrit de la sorte que l’individu est aussi important que l’atome. Ces deux découvertes durent presque simultanées. L’individu, l’être humain est une plante qui a ses racines dans le ciel. (…) En matière sociale, on a découvert l’énergie de l’insignifiant, du tout petit, et l’individu. Il possède une énergie égale à celle de l’atome : voilà la base de la nouvelle sociologie.
Alors Staline tente d’utiliser cette énergie spirituelle que l’église détient par l’intermédiaire d’un Concile. Pour gagner le ciel, il faut d’abord détruire la société capitaliste et instaurer la fraternité communiste sur la terre. L’Eglise est comme un bateau. Au lieu de diriger le navire de l’Eglise vers le ciel, on le dirigera vers le paradis communiste. C’est quelque chose de plus certain et de plus concret que l’éternité.
La découverte des documents volés compromet la géniale idée de l’organisation d’un Concile destiné à affirmer cette nouvelle orientation de l’Eglise. Alors toutes les ressources de l’Etat sont mises en branle pour retrouver ces documents.
La candeur de Trajan sera la source de son malheur. Il se lie d’amitié avec Taky Tsèp, un espion envoyé par le président de Roumanie pour lui faire dire le nom de celui qui a livré le document signé de sa main. Ce que Trajan se refuse à dire, jusqu’au jour où il apprend la mort de Dragomirna.
Une véritable machination est ensuite montée pour mettre à mort Trajan. Un exterminateur, Baxan, est nommé. Il finit par gagner. Trajan « se suicide » au jour et à l’heure prévus. L’Etat gagne contre l’individu. L’énergie collective a été plus forte que l’énergie spirituelle. Le paradis communiste peut continuer à exister.
Et pourtant il est tombé tout seul, se prenant les pieds dans le tapis !
07:02 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, livre, littérature, société |  Imprimer
Imprimer
06/02/2013
Bélard et Loïse, roman de Jean Guerreschi
Un roman, un récit de mœurs, un livre érotique ? On ne sait comment qualifier ce livre de Jean Guerreschi et, de plus, on ne sait comment le lire. Doit-il être lu vite, en impatience de nouveaux incidents palpitants, ou doit-il être savouré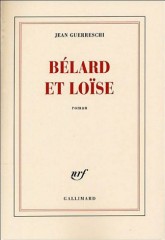 lentement, avec toute l’attention qu’il réclame, en raison de la qualité du style et de la narration ? Ce fut selon les moments. Mais plus l’on avance, plus on tente de profiter de cette lecture, s’intéressant plus à l’écriture de l’auteur qu’à l’histoire qui s’allonge, sans doute un peu trop.
lentement, avec toute l’attention qu’il réclame, en raison de la qualité du style et de la narration ? Ce fut selon les moments. Mais plus l’on avance, plus on tente de profiter de cette lecture, s’intéressant plus à l’écriture de l’auteur qu’à l’histoire qui s’allonge, sans doute un peu trop.
C’est une histoire qui pourrait être banale. L’amour d’une étudiante pour son professeur qui pourrait être son père. Elle a choqué certains critiques : « Jean Guerreschi a beaucoup d'imagination. On ne saurait le lui reprocher. On ne peut pas non plus lui reprocher de nous livrer ses frustrations en décrivant ses fantasmes. » (François Jardin, Pour les amateurs de mélo, A-lire.info)
Mais les prémices de cet amour sont enchanteresses : e-mail à double-sens, messages codés, et le désir qui monte intensément : Ils se trouvèrent soudainement tout près, trop proches l’un de l’autre. Loïse l’éprouva la première. Je suis trop près de lui, se dit-elle, je sens la rétraction de sa zone intime, mais je ne peux faire autrement que de rester là. Elle ne bougea donc pas. (…) Il était si près d’elle qu’il voyait le duvet de ses phalanges. Elle était si proche de lui qu’elle serra la main sur l’étagère pour ne pas verser. S’il me touche, je crie, pensa Loïse. S’il ne me touche pas, je hurle, pensa-t-elle l’instant d’après. Si je la touchais, songeait Bélard, elle ne me repousserait pas. De cela il était sûr. Puis il pensa au futur simple. Si je la touche, je l’aurai dans les bras toute la vie.
La narration de leurs aventures amoureuses est hors du commun : tendre, extatique, mais aussi érotique, sinon pornographique. Mais écrit avec une langue merveilleuse, pleine de justesse, de délicatesse également : Bélard vit Loïse nue. Il oublia son âge. Bélard oublia son âge. Il s’étonna de sa jeune faim. Loïse goûta au corps de Bélard. Elle le trouva bon. Son appétit d’elle surprit Loïse. Son appétit de lui la troubla. Bélard s’étonna de sa jeune faim. Que si jeune faim eût appétit de lui le surprit.
Lorsqu’il se retrouve seul, Bélard s’extasie : Je suis comme un bœuf amoureux… Elle répondit qu’elle serait volontiers sa génisse. Il protesta qu’ils étaient au milieu du carrefour, que la morale publique les écraserait plus vite et plus certainement qu’un semi-remorque. (Il pensait : m’écrasera moi, mais il ne l’écrivit pas.) Elle répondit que, sous lui, elle ne sentirait pas le semi-remorque.
Ne poursuivons pas ce récit. Laissons au futur lecteur le soin de le découvrir. Il se tire un peu en longueur, en étrangeté (mêler l’actualité du 11 septembre à cette histoire forte). Le livre ne vaut en fait que par la langue, le style, la justesse des comparaisons. La crudité du compte-rendu des ébats des deux amants pourra choquer, mais c'est écrit avec une telle délicatesse.
Le livre fait penser à « Belle du Seigneur » d’Albert Cohen. Même art de la narration juste, même hymne à la femme, même délectation de ces rencontres, étreintes, tensions et détentes amoureuses. Mais : Le plus étrange, c’est qu’un tel roman fasse aujourd’hui scandale — au point qu’une œuvre constamment maîtrisée, souvent admirablement écrite, soit boycottée par des journalistes plus pressés de rendre compte des pauvretés nothombiennes ou houelbecquiennes, écrit Jean-Paul Brighelli sur le site de Marianne.
07:27 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, littérature, femme |  Imprimer
Imprimer
18/01/2013
Effroyables jardins, roman de Michel Quint (éditions Joelle Losfeld, 2000)
Un petit livre, petit roman. Tel il apparaît au début. D’ailleurs même pas un roman, un récit, une badinerie. Le style est celui d’une conversation au bord du zinc. L’image du père que garde le gamin est celle d’un instituteur qui joue les clowns dès qu’il a un instant de libre : C’est que mon père traquait et prenait aux cheveux toutes les occasions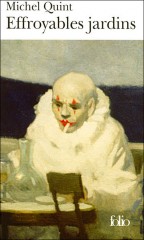 de s’exhiber en auguste amateur. Larges tatanes, pif rouge et tout un fourbi bricolé de ses vieux costumes, des ustensiles de cuisine mis au rencard. Faut-il le dire, quelques dentelles aussi, abandonnées par ma mère, lui donnaient une couleur trouble. Ainsi armé et affublé de la sorte, casqué d’une passoire à l’émail écaillé, cuirassé d’un corset rose à baleines, presse-purée nucléaire à la hanche, casse-noix supersonique au poing, c’était un guerrier hagard, un samouraï de fer-blanc qui sauvait l’humanité intergalactique et aussi la nôtre, toute bête, dans un numéro pathétique de niais solitaire contraint de s’infliger tout seul des baffes et des coups de pied au cul. Et il a honte, honte de son père, de sa vieille Dyna Panhard : un long crapaud au mufle rond, jaune canari, à la banquette de skaï imitation zèbre et au bruit de casserole. Une bagnole de clown.
de s’exhiber en auguste amateur. Larges tatanes, pif rouge et tout un fourbi bricolé de ses vieux costumes, des ustensiles de cuisine mis au rencard. Faut-il le dire, quelques dentelles aussi, abandonnées par ma mère, lui donnaient une couleur trouble. Ainsi armé et affublé de la sorte, casqué d’une passoire à l’émail écaillé, cuirassé d’un corset rose à baleines, presse-purée nucléaire à la hanche, casse-noix supersonique au poing, c’était un guerrier hagard, un samouraï de fer-blanc qui sauvait l’humanité intergalactique et aussi la nôtre, toute bête, dans un numéro pathétique de niais solitaire contraint de s’infliger tout seul des baffes et des coups de pied au cul. Et il a honte, honte de son père, de sa vieille Dyna Panhard : un long crapaud au mufle rond, jaune canari, à la banquette de skaï imitation zèbre et au bruit de casserole. Une bagnole de clown.
Et un jour, Gaston, cousin de son père, le délivre de la malédiction de l’auguste, en racontant ce qui s’était passé début 43, à Douai. Le cousin Gaston parlait patois. Un patois que je comprenais parfaitement mais quand il m’a raconté, là, sur ce formica tout fendillé, le pourquoi des fêlures de mon père, il s’est appliqué. (…) Et sauf des expressions, des passages que j’ai encore dans l’oreille, j’ai fini par oublier la chair de cette langue que Gaston ne faisait pas semblant, que ses mots étaient pas l’ombre des choses et des moments inhumains, mais qu’il m’ouvrait sa vie et m’offrait humblement tout ce qu’il avait, d’effroyables jardins, dévastés, sanglants, cruels.
Il raconte leur arrestation, à lui et son père, dans la cave de leur maison. Comment ils se sont retrouvés au fond d’un ravin plein d’eau, avec deux autres types, otages des allemands, gardés par un schleu qui parlait français, humain, gentil, mais allemand malgré tout. Pris comme otages anonymes, ils étaient en fait les coupables de l’attentat en gare de Douai, ce que les allemands ne savaient pas, ni les deux autres hommes. De fil en aiguille, ils se voient contraints de désigner un premier exécuté. Choisiront-ils ou non ? Consentir à autrui le pouvoir de vie et de mort sur soi, ou se croire au-dessus de tout qu’on puisse décider du prix de telle ou telle vie, c’est quitter toute dignité et laisser le mal devenir une valeur.
Le soir, culotte de cheval, l’Herr Oberst qui avait laissé le choix, revient et commence à combler le trou avec de la terre, comme pour les ensevelir. Mais Bernd, le gardien parlant français, leur crie : « Vous êtes sauvé les gars, vous êtes sauvés ! Ils font seulement tomber un peu de terre parce qu’on n’a pas de cordes sous la main. » Et Bernd leur apprend qu’il est clown, Auguste, avec une perruque rouge et un gros nez.
Ils surent plus tard qu’une femme avait dénoncé son mari à leur place. Il était mourant, il a confirmé et a été fusillé. A la libération, ils sont allés la remercier. Et Gaston a fini par l’épouser.
Avec sa perruque carotte, mon père a donc vécu chapeau bas. Dans les deux sens de l’expression puisqu’il n’a jamais porté de couvre-chef. Et la dame noire l’a pris un jour de frimas, peut-être par erreur, parce qu’il arborait, pour m’attendre à Lille dans une gare à courants d’air, une caquette neuve.
Quel contraste, ce père clown qui fait honte à son fils et, dans le même temps, ce père résistant, qui révèle des instants tragiques par l’intermédiaire de son cousin. Si cette histoire dévoile la véritable personnalité du père à l’auteur, elle révèle également la dure réalité vécue par les Français dénoncés par d’autres Français et envoyés à la mort par une administration complaisante et anonyme. Désigner des otages, quelle petite action, mais quelles conséquences !
07:30 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, littérature |  Imprimer
Imprimer
07/01/2013
Le Petit Sauvage, roman d’Alexandre Jardin
Un jour, je m’aperçus avec effroi que j’étais devenu une grande personne, un empaillé de trente-trois ans. Mon enfance avait cessé de chanter en moi. Plus rien ne me révoltait. La vie et l’enjouement qui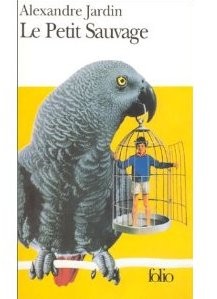 était jadis dans les veines s’étaient carapatés. Le Monsieur prévisible que j’étais désormais jouissait sans plaisir d’une situation déjà assise, ne copulait plus guère et portait sur le visage un air éteint. Je me prélassais sans honte dans la peau d’un mari domestiqué indigne du petit garçon folâtre, imprudent et rêveur que j’avais été, celui que tout le monde appelait le Petit Sauvage.
était jadis dans les veines s’étaient carapatés. Le Monsieur prévisible que j’étais désormais jouissait sans plaisir d’une situation déjà assise, ne copulait plus guère et portait sur le visage un air éteint. Je me prélassais sans honte dans la peau d’un mari domestiqué indigne du petit garçon folâtre, imprudent et rêveur que j’avais été, celui que tout le monde appelait le Petit Sauvage.
Ainsi commence ce roman dont l’objet est le retour à l’enfance bienheureuse, sans souci, sans projet, sans perspective autre que s’amuser. Ce qui signifie se débarrasser d’habitudes prises, de routines administratives, de contrefaçons mondaines. Alexandre se lance dans une fuite éperdue vers sa jeunesse, et il y réussit dans un premier temps. Il largue son entreprise, sa femme, et se retrouve dans le midi dans l’ancienne maison de famille devenue un hôtel. Il la rachète, va chercher sa grand-mère à l’hospice et s’installe comme il y a trente ans.
Ses aventures sont la surprise du livre. Les dévoiler ôterait le charme de ces pages écrites sous le feu. Reste une méditation sur la manière dont l’enfant devient adulte, se charge de poids excessifs, d’obligations infernales, et oublie peu à peu ces heures libres et belles de l’enfance au fil des heures : Le petit sauvage me mettait également en garde contre une attitude qui, à l’entendre, gâtait le sort de presque tous les adultes : ils se croient obligés. Il s’étonnait sincèrement du nombre inouï d’obligations fictives que les grands s’imposent ; comme si les contraintes réelles de la vie ne suffisaient pas ! (…) Je me souviens également de cette phrase qui me frappa : les grands n’ont pas l’air de se rendre compte qu’ils sont libres. Ils n’ont plus d’adultes sur le dos et ils n’en profitent même pas ! Toi, tu en profiteras !
A trente-huit ans, il découvre dans les bras de Manon-Fanny ce que le terme extase s’efforce d’exprimer. Il découvre par la même occasion, la joie de l’incohérence. Il comprit qu’il n’est pas de vraie vie sans incohérences. Les hommes et les femmes qui tentent de se conformer toujours à une certaine idée d’eux-mêmes, quelle qu’elle soit, sont des presque-cadavres. La cohérence mutile ; l’incohérence régénère.
07:56 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : roman, amour, littérature, enfance |  Imprimer
Imprimer
04/01/2013
Les heures souterraines, roman de Delphine de Vigan
La journée du 20 mai pour deux êtres, homme et femme, à qui l’on veut faire croire, par l’intermédiaire du lecteur, qu’ils sont faits pour s’entendre. Et pourtant, leurs situations sont tellement différentes. L’un, Thibault, ne sait s’il aime ou non sa compagne qui, elle-même, ne  semble pas l’aimer. L’autre, Mathilde, veuve, deux enfants, est en butte au harcèlement moral de son patron qui, pour une faute insignifiante, l’écarte progressivement de toute activité. Si la situation paraît convaincante pour la seconde, elle frise le ridicule pour le premier. Quel remplissage.
semble pas l’aimer. L’autre, Mathilde, veuve, deux enfants, est en butte au harcèlement moral de son patron qui, pour une faute insignifiante, l’écarte progressivement de toute activité. Si la situation paraît convaincante pour la seconde, elle frise le ridicule pour le premier. Quel remplissage.
Il est néanmoins intéressant de suivre la lente décomposition de cette femme qui avait tout pour réussir et qui se trouve, d’abord de manière insignifiante, puis outrancière, écartée de tout pouvoir et même de toute relation dans l’entreprise. La démarche est bien décrite, ses doutes, ses interrogations, ses craintes, sa torpeur et, finalement, son impuissance. Elle résiste pourtant, elle tient envers et contre tout. Mais elle finit par donner sa démission, sans aucune contrepartie.
En parallèle, on vit avec Thibault, ou plutôt, on erre avec Thibault de patient en patient, car il est médecin. Ses réflexions sont maigres, ses maladresses fréquentes, rien qui ne vaille la peine de s’y attarder.
Ils se rencontrent à la fin du livre. On est impatient de savoir ce qui va se passer. Mais la fin est sans relief, comme un œuf au plat mangé sur la table de la cuisine au retour du travail. Que deviendront-ils ? On ne le sait. Ils errent dans ce désert d’une vie urbaine où les sentiments, espoirs et raisons de vivre se sont évaporés. Quelle vision de la vie, plus proche de la mort que de la résistance.
Face au harcèlement moral d’une personne, son supérieur bien sûr, le seul moyen est de tenir sur un projet que l’on sait valable et de démontrer son intérêt en contournant l’objecteur, c’est-à-dire en le faisant approuver par une entité supérieure. Lorsqu’il est reconnu et approuvé par des gens très variés, alors il est possible d’affronter le harceleur qui, même s’il ne veut pas reconnaître ses torts, est bien contraint d’accepter votre projet. Cela demande persévérance, aucun découragement, des vérifications permanentes (il ne s’agit pas de se tromper) et l’entretien de relations avec vos anciens subordonnés.
Ne comptez pas sur les autres pour prendre votre défense et protester contre votre harceleur. Ils se retrouveraient dans votre cas. Dans tous les cas, vous serez éjecté. Mais vous trouverez autre chose, gagnant. In fine, il croira avoir eu votre peau, mais vous en sortirez grandi.
Donnez-vous un projet, croyez-y, travaillez, établissez de nouveaux réseaux qui contournent l’obstacle. Vous en trouverez un bien, immanquablement.
06:26 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, société, psychologie |  Imprimer
Imprimer
31/12/2012
La femme qui attendait, roman d’Andreï Makine
Une femme si intensément destinée au bonheur (ne serait-ce qu’à un bonheur purement physique, oui, à un banal bien-être charnel) et qui choisit, on dirait avec insouciance, la solitude, la fidélité envers un absent, le refus d’aimer…
Ainsi commence ce roman qui tourne autour du corps de la femme, une femme qui refuse de croire à la mort de son fiancé plus de trente ans plus tard. Et ce refus est parfois synonyme de mort. Il se traduit par le froid des paysages, les changements de temps, le bruit de la glace qui tombe des toits. Et d’autres fois, il devient pleine vie, au-delà des apparences, grâce au soleil d’un printemps qui met du temps à venir, à une fleur ramassée dans la campagne.
Et c’est bien à une retraite que nous convie l’auteur, retraite au-delà de la vie, dans cette après-vie, avec de vieilles personnes près de la mort : Elle dort dans une sorte de mort anticipée, au lieu du temps qu’elle a suspendu à l’âge de seize ans, marchant en somnambule parmi ces vieilles qui lui rappellent la guerre et le départ de son soldat… Elle vit un après-vie, les morts doivent voir ce qu’elle voit…
Peu à peu, il apprivoise cette femme, avec douceur, mais désir de son corps. Elle est belle malgré son âge. Elle semble pleine de désirs cachés. Il apprend ses rêves : J’ai attendu le train de Moscou… Cela m’arrive de temps en temps. Toujours presque le même rêve : la nuit, le quai, il descend, se dirige vers moi… Cette fois, c’était peut-être encore plus réel qu’avant. J’étais sûre qu’il viendrait. J’y suis allée, j’ai attendu. Tout cela est déraisonnable, je sais. Mais si je n’y étais pas allée, un lien se serait rompu… Et ce ne serait plus la peine d’attendre… Il apprend à la connaître doucement : Ses paupières battaient lentement, elle leva sur moi un regard, vague et attendri, qui ne me voyait pas, qui allait me voir après le passage des ombres qui étaient en train de traverser. Je devinais que durant cette cécité, je pouvais tout me permettre. Je pouvais lui prendre la main, je touchais déjà cette main, mes doigts remontaient sans peser sur son avant-bras. Nous étions assis côte à côte et la sensation d’avoir cette femme en ma possession était d’une force et d’une tendresse extrêmes.
Elle finit par se donner à lui, égarée, enfantine en amour, fière de sa condition féminine : Cette femme sûre disparut dès les premières étreintes. Elle ne savait pas qui elle était en amour. Grand corps féminin aux inexpériences adolescentes. Puis une véhémence musculeuse, combative, imposant sa cadence au plaisir. Et de nouveau, presque l’absence, la résignation d’une dormeuse, la tête renversée, les yeux clos, la lèvre fortement mordue. Un éloignement si complet, celui d’une morte, qu’à un moment, me détachant d’elle, je lui empoignais les épaules, la secouait, trompé par sa fixité. Elle entrouvrit les yeux, teintés de larmes, me sourit et ce sourire se mua, respectant notre jeu, en un rictus trouble de femme ivre. Son corps remua.
C’est un roman poétique, empli de la féérie des saisons de glace, des forêts immenses, des villages sans âme. Et progressivement se déroule l’histoire, dans laquelle l’imagination a autant d’importance que le réel vécu. Un rêve que l’auteur vit de manière très concrète, attaché à de petits riens qui sont autant de construction de la réalité. Il se prépare à repartir, sortir de cette après-vie qui semble la vie normale de ce village de vieilles femmes sur laquelle veille une femme plus jeune, encore désirable. Oui, c’est un beau roman !
07:10 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, femme, vie, féminité, solitude, philosophie |  Imprimer
Imprimer
20/12/2012
Du domaine des murmures, roman de Carole Martinez
« On gagne le château des Murmures par le nord. Il faut connaître le pays pour s’engager dans le chemin qui perce la forêt épaisse depuis le pré de la Dame Verte. (…) Nous passons l’énorme huis de chêne et de fer, aujourd’hui disparu, et foulons l’herbe haute du parc en friche qui s’étend devant la façade nord du château. (…) La forteresse entière vacille sous nos yeux. Car ce château n’est pas seulement de pierres blanches entassées sagement les unes sur les autres, ni même de mots écrits quelque part en un livre, ou de feuilles volantes disséminées de–ci de-là (…) Non, ce lieu est tissé de murmures, de filets de voix entrelacées et si vieilles qu’il faut tendre l’oreille pour les percevoir. De mots jamais inscrits, mais noués les uns aux autres et voir qui s’étirent en un chuintement doux. »
Prologue du livre, il en donne le ton : un voyage au XIIème siècle dans un monde de folie, hanté par l’urgence de la vie courte et le fait de Dieu qui domine les vies et les prend dès leur naissance. La première page poursuit :
« Je suis l’ombre qui cause. Je suis celle qui s’est volontairement clôturée pour tenter d’exister. Je suis la vierge des Murmures. A toi qui peux entendre, je veux parler la première, dire mon siècle, dire mes rêves, dire l’espoir des emmurées.
En cet an 1187, Esclarmonde, Damoiselle des Murmures, prend le party de vivre en recluse à Hautepierre, enfermée jusqu’à sa mort dans la petite cellule scellée aménagée pour elle par le père contre les murs de la Chapelle qu’il a bâtie sur ses terres en l’honneur de sainte Agnès, morte en martyre à treize ans de n’avoir pas accepté d’autres époux que le Christ.
(…) Je suis Esclarmonde, la sacrifiée, la colombe, la chair offerte à Dieu, sa part. J’étais belle, tu n’imagines pas, aussi belle qu’une fille peut l’être à quinze ans, si belle et si fine que mon père, ne se lassant pas de me contempler, ne parvenait pas à se décider à me céder à un autre. (…) Mais les seigneurs voisins guettaient leur proie. J’étais l’unique fille et j’aurais belle dot. »
Mais elle dit non devant l’ensemble des invités de la noce et se coupe l’oreille pour montrer sa détermination.
Avant de se laisser enfermer, elle se fait violer et se retrouve enceinte dans son réduit. Elle met au monde un garçon, Elzéar. Elle est recluse, mais en fait elle vit ce siècle avec toute la puissance de son imagination et la vigueur de la réalité.
Etait-elle sainte ou était-elle une fille perdue malgré elle ? A vous de juger, de marcher sur ce fil où l’on tombe d’un côté ou de l’autre en un rien de temps, sur une impression, un murmure qui fait pencher la balance.
Un siècle où également on passe du réel aux contes :
« Le monde en mon temps était poreux, pénétrable au merveilleux. Vous avez coupé les voies, réduite les fables à rien, niant ce qui vous échappait, oubliant la force des vieux récits. Vous avez étouffé la magie, le spirituel et la contemplation dans le vacarme de vos villes, et rares sont ceux qui, prenant le temps de tendre l’oreille, peuvent encore entendre le murmure des temps anciens ou le bruit du vent dans les branches. Mais n’imaginez pas que ce massacre des contes a chassé la peur ! Non, vous tremblez toujours ans avoir pourquoi. »
Un livre lent, méditatif, et, dans le même temps, violent, hurlant les conventions, la mort et, enfin, le mystère de la vie. A lire, mais surtout à relire, car c’est en le relisant, par bribes, que l’on y prend goût. On le ferme en rêvant d’un monde où l’on n’aurait probablement pas aimé vivre. Mais l’imagination permet d’oser ce que l’on ne ferait probablement pas dans la réalité.
07:49 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, littérature, femme, poésie, mariage |  Imprimer
Imprimer
16/12/2012
La délicatesse, roman de David Foenkinos (Gallimard, 2009)
Ce n’est pas un roman de haute tenue intellectuelle, mais, ne serait-ce que par son titre, il se laisse facilement lire et s'émaille de quelques bons mots.
Nathalie était plutôt discrète (une sorte de féminité suisse). Elle avait traversé l’adolescence sans heurt, respectant les passages piétons. Elle aimait rire, elle aimait lire. Elle rencontre François dans la rue et ce fut comme dans un roman. Un soir, il construit un puzzle devant elle. Elle y lit : « Veux-tu devenir ma femme ? »
sans heurt, respectant les passages piétons. Elle aimait rire, elle aimait lire. Elle rencontre François dans la rue et ce fut comme dans un roman. Un soir, il construit un puzzle devant elle. Elle y lit : « Veux-tu devenir ma femme ? »
C’est l’amour parfait. Mais François se fait écrasé en courant dans la rue. Errance de l’esprit et du cœur, pendant plusieurs mois avant de reprendre le travail.
Son patron, Charles est amoureux d’elle, mais elle ne le supporte qu'en tant que patron. Markus, un suédois engagé par la société, entre dans sa vie par la petite porte, sans effraction, imperceptiblement. Il était doté d’un physique plutôt désagréable, mais on ne pouvait pas dire non plus qu’il était laid. Il avait toujours une façon de s’habiller un peu particulière : on ne savait pas s’il avait récupéré ses affaires chez son grand-père, à Emmaüs, ou dans une friperie à la mode. (…) Elle décida alors de marcher vers lui, de marcher lentement, vraiment lentement. On aurait presque eu le temps de lire un roman pendant cette avancée. Elle ne semblait pas vouloir s’arrêter, si bien qu’elle se retrouva tout près du visage de Markus, si proche que leurs nez se touchèrent. Le Suédois ne respirait plus. Que lui voulait-elle ? Il n’eut pas le temps de formuler plus longuement cette question dans sa tête, car elle se mit à l’embrasser vigoureusement. Un long baiser intense, de cette intensité adolescente.
Malgré ce baiser, c’est un lent apprivoisement qu’ils devront faire tous les deux, l’un envers l’autre, avant de se découvrir. L’insolite est la délicatesse de ces rencontres, l’étonnement de Nathalie devant la maladresse de Markus. Il est hésitant, gauche, mais délicat. Et cette délicatesse devient pour lui un atout. Progressivement Nathalie se laisse enfermer dans ce charme discret. Elle comprenait qu’elle avait voulu cela plus que tout, retrouver les hommes par un homme qui ne soit pas forcément un habitué des femmes. Qu’ils redécouvrent ensemble le mode d’emploi de la tendresse. Il y a avait quelque chose de très reposant dans l’idée d’être avec lui. (…) Elle savait juste que c’était le moment, et que dans ces situations, c’est toujours le corps qui décide. Il était sur elle maintenant. Elle s’agrippait.
Seule la délicatesse sauve le livre, naïf et même banal. Mais il est plus que sauvé, il est délicat comme peut l’être un amour incongru. Et ils se sentaient bien...
07:59 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : roman, littérature, société |  Imprimer
Imprimer
03/12/2012
La part de l’autre, roman d’Eric-Emmanuel Schmitt
– Adolf Hitler : recalé.
– Adolf H. ; admis.
Cette annonce de l’Académie des beaux-arts change le monde. On oscille entre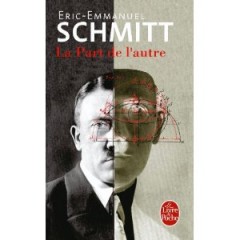 un monde réel, dans lequel le personnage d’Hitler se promène avec difficulté jusqu’à son suicide et un monde imaginaire où Hitler devient peintre. Pas le grand peintre qu’il souhaite devenir, mais un artiste acceptable qui finit par reconnaître qu’il n’a pas l’étoffe d’un grand maître et qui survit à cela.
un monde réel, dans lequel le personnage d’Hitler se promène avec difficulté jusqu’à son suicide et un monde imaginaire où Hitler devient peintre. Pas le grand peintre qu’il souhaite devenir, mais un artiste acceptable qui finit par reconnaître qu’il n’a pas l’étoffe d’un grand maître et qui survit à cela.
Toutes les deux ou quatre pages, on passe d’un personnage à l’autre, parfois en se demandant duquel il s’agit : Docteur Jekyll ou Mrs Hyde ?
Du nouveau chancelier de l’Allemagne, l’auteur écrit : « Ils ignoraient qu’ils n’avaient pas désigné un homme politique, mais un artiste. C’est-à-dire son exact contraire. Un artiste ne se plie pas à la réalité, il l’invente. C’est parce que l’artiste déteste la réalité que, par dépit, il la crée. D’ordinaire, les artistes n’accèdent pas au pouvoir : ils se sont réalisés avant, se réconciliant avec l’imaginaire et le réel dans leurs œuvres. Hitler, lui, accédait au pouvoir parce qu’il était un artiste raté. »
Du peintre, il imagine, dans un dialogue entre le professeur et un de ses élèves, la lutte de celui qui découvre qu’il n’est pas un grand peintre : « – Une vie, ça ne se fait pas tout seul. Ce n’est pas vous qui la donnez. Ce n’est pas vous qui choisissez vos dons. (…) A quarante ans, vous décidez de faire des enfants et vous décidez de ne plus peindre. En fait, ce que vous désirez, c’est décider. Maîtriser votre vie. La dominer. Fût-ce en étouffant ce qui s’agite en vous et qui vous échappe. Peut-être ce qu’il y a de plus précieux. Voilà, vous avez supprimé la part de l’autre en vous comme à l’extérieur de vous. Et tout ça pour contrôler. Mais contrôler quoi ? »
Eric-Emmanuel Schmitt se justifie et explique son roman dans son journal : « J’élabore un double portrait antagoniste. Adolf H. cherche à se comprendre tandis que le véritable Hitler s’ignore. Adolf H. reconnaît en lui l’existence de problèmes tandis qu’Hitler les enterre. Adolf H. guérit et s’ouvre aux autres tandis qu’Hitler s’enfonce dans sa névrose en se coupant de tout rapport humain. Adolf H. affronte la réalité tandis qu’Hitler la nie dès qu’elle contrarie ses désirs. Adolf H. apprend l’humilité tandis qu’Hitler devient le Führer, un dieu vivant. Adolf H. s’ouvre au monde ; Hitler le détruit pour le refaire. Non seulement La part de l’autre donne le principe du livre mais ce titre en suggère la dimension éthique : poursuite de l’altérité chez Adolf H., fuite de l’altérité chez Hitler. »
C’est un livre profond, parfois intéressant, mais qui devient lassant pendant sa lecture. Où veut-on en venir ? Cette question vous taraude tout au long des pages et la réponse ne se trouve pas dans le livre, mais dans le journal où l’auteur décrit ses interrogations. Vous êtes frustré lorsque vous fermez ce long roman de 500 pages, vous l’aimez lorsque vous le refouillez et retournez au point de départ. Que ce serait-il passé si l’Académie des beaux-arts en avait décidé autrement ? Adolf H. manque sans doute un peu de personnalité pour devenir la controverse d’un Hitler névrosé, mais sorcier des foules. A l’opposé d’Adolf Hitler, qui craint les femmes, Adolf H. réussit sa vie grâce aux femmes : Onze-heures-trente, sœur Lucie, Sarah, sa femme, juive.
05:18 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, histoire, psychologie, femme |  Imprimer
Imprimer
28/11/2012
La chambre à remonter le temps, roman de Benjamin Berton
L’histoire pourrait être passionnante. Une chambre qui, lorsqu’on y reste suffisamment longtemps, vous fait sortir deux ou trois jours plus tard ou, parfois, plus tôt. Benjamin a découvert cette propriété de la chambre après l’achat d’une maison au Mans. Le prologue du livre reprend sa fin, comme un retour sur le temps, un éternel recommencement. Mais quel recommencement ? La vie de Benjamin n’est ni drôle, ni passionnante. Celle d’un Français moyen qui côtoie des Français moyens. C’est long et ennuyeux de voir à quel point ces vies sont sans aucun idéal, aucune passion, ni même joie d’instants partagés. Céline, sa femme, n’arrange rien, elle est égale à lui-même et autoritaire : métro (mais on est au Mans), boulot (il le sèche de plus en plus souvent), dodo (ils ne dorment que rarement ensemble).
de la chambre après l’achat d’une maison au Mans. Le prologue du livre reprend sa fin, comme un retour sur le temps, un éternel recommencement. Mais quel recommencement ? La vie de Benjamin n’est ni drôle, ni passionnante. Celle d’un Français moyen qui côtoie des Français moyens. C’est long et ennuyeux de voir à quel point ces vies sont sans aucun idéal, aucune passion, ni même joie d’instants partagés. Céline, sa femme, n’arrange rien, elle est égale à lui-même et autoritaire : métro (mais on est au Mans), boulot (il le sèche de plus en plus souvent), dodo (ils ne dorment que rarement ensemble).
L’auteur est prolixe. On se demande comment il fait pour trouver tant de choses à dire pour traduire l’ennui et la grisaille. De toutes petites aventures avec des gens sans intérêt. Alors pourquoi poursuivre ce livre ? Parce que, malgré tout, l’histoire pourrait être passionnante. Ces allers et retours du temps sur l’échelle métrique ! Alors, on espère, on devance le moment où le quotidien sera dépassé par l’insolite, le fantastique, l’irrationnel. Mais on traîne ainsi jusqu’aux dernières pages qui vous ramène aux premières. Si l’on n’y prend pas garde, on recommence la lecture sans même s’en rendre compte. Le temps est circulaire pensent certains peuples. Oui, c’est vrai, ici il tourne en rond et on ne sait quand va s’arrêter cette dissociation entre personnages vrais et ectoplasmes comme ils finissent par s’appeler.
Mais pour ne pas rester sur une note pessimiste, je vous fais part de la critique de Bernard Quiriny : « D’un côté, c’est un tableau doux-amer de la vie des trentenaires, confortable et mesquine, avec ses petits événements (faire un enfant), ses petits engagements (s’acheter une maison), ses petits rites (recevoir à dîner) et ses petits drames (se séparer). D’un autre, une peinture des frayeurs de la classe moyenne : l’insécurité, le fantasme de la barbarie à nos portes, la tentation de l’autodéfense. D’un autre côté encore, une chronique conjugale drôle et effrayante (Céline n’est pas commode, il finit par ne plus la supporter, la trompe et, sommet de comique macabre, recourt à un marabout africain pour l’empoisonner) et un autoportrait du trentenaire mâle (fier et plein de doutes, consommateur de porno en ligne). Et, pour finir, c’est un récit fantastique bien mené, qui recycle le thème du voyage dans le temps pour en faire l’échappatoire d’un garçon qui s’ennuie, comme si seul l’irrationnel pouvait encore troubler le flux prévisible de la vie moderne. »
07:04 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, société, couple |  Imprimer
Imprimer
01/11/2012
Aral, roman de Cécile Ladjali
C’est un monde mouvant, tantôt effrayant, tantôt attendrissant, toujours chaud, plein de frémissement, comme ces vibrations qu’Alexeï, musicien sourd, entend. Il se marie avec son amie d’enfance, Zena. Ils ont grandi à Nadezhda, au bord de la mer d’Aral qui s’est retirée. Il n’y reste plus que le sable, la pollution et la misère. Mais ce monde est le leur et ils y trouvent le bonheur, chaud, envahissant, comme leurs corps qui se découvrent et se parlent en caresses.
Il se marie avec son amie d’enfance, Zena. Ils ont grandi à Nadezhda, au bord de la mer d’Aral qui s’est retirée. Il n’y reste plus que le sable, la pollution et la misère. Mais ce monde est le leur et ils y trouvent le bonheur, chaud, envahissant, comme leurs corps qui se découvrent et se parlent en caresses.
Mais un jour, après quelques années heureuses, Zena part travailler en France. Alexeï reste seul avec sa musique. Il prépare un opéra, il joue pour les orphelins de Nadezhda et découvre qu’il sort de cet endroit où les enfants n’ont pas d’histoire. Il rencontre Nulufar, jeune prostituée, belle comme un démon. Il s’installe chez elle, sans cependant la posséder. Mais elle boit l’eau de la ville et est atteinte d’une maladie qui la fait régresser. Elle est comme une enfant de dix ans et il assume cette paternité. Sa vie s’enfonce dans la boue laissée par la mer, près des bateaux gisant sur le flanc, rouillés. Un jour, pour la sainte Rita, Alexeï voit l’eau remonter. Il remarque une fille qui s’installe à côté de lui, sur sa serviette de bain. Zena se lève, entre dans l’eau, il la rejoint. Elle enlève son maillot pour être douce et nue dans ses bras. Dans l’eau elle boit mes larmes. Dans l’eau je bois ses larmes. La mer. Nos visages. Ils rient ensemble et le sel mord les minuscules égratignures que notre histoire a laissées sur nos corps qui se serrent. Une eau joyeuse remplit la vasque ouverte de nos deux vies.
Quelques très belles pages sur la musique : Du désir de musique, je dirai qu’il est très simple et demande à être immédiatement satisfait. Il vient comme la faim, la soif, l’excitation amoureuse. (…)
Moi j’entends la musique partout : dans le sable, dans l’eau, dans les arbres. Le long des falaises de craie, parmi les jupes des fillettes qui jouent à la marelle, ou sur la frimousse crasseuse des bambins qui volent des oranges au marché Saint-Hilarion. En fait je n’invente rien. Jamais. Je restitue. Mais ce que les gens ont du mal à concevoir c’est que ma perception des choses se traduise musicalement, alors que je suis sourd. Ils sont idiots : un artiste choisira toujours le mode d’expression qui annulera sa douleur. (…)
La musique est un souvenir. Une tension en direction de ce qui fut et qu’on rappelle. Les vagues. Les ondes. Le ressac. Voilà à quoi ressemble la musique. Elle et un fleuve Alphée qui retourne au mouvement qui l’a engendré. Elle est un antipoison à la disparition. Je n’ai jamais composé avec du temps mais avec de la durée. Avec des lignes brisées, dans des intervalles, au creux des interstices que le laisse la mémoire ou me confiait le hasard. Ma musique est une sorte d’anomalie.
La beauté du livre tient principalement à l’écriture de Cécile Ladjali. Déliée, sensuelle par l’évocation des perceptions autres que celles de l’ouïe, faite de phrases courtes, désossées. Elle nous donne l’envie de lire ses autres livres.
06:02 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, littérature, musique, femme |  Imprimer
Imprimer
11/10/2012
Un amour, roman de Dino Buzzati
« Un matin de février 1960, à Milan, l’architexcte Antonio Dorigo, quarante-neuf ans, téléphona à Mme Ermelina. »
Ainsi commence le roman de Dino Buzzati. Il s’agit d’obtenir un rendez-vous avec une fille. Quand ensuite le rendez-vous avec une fille était pris son corps entier commençait à attendre, dans un état tout ensemble douloureux et superbe, difficile à expliquer, presque la sensation d’être une victime qui s’offrait sans restriction au sacrifice, de tout son corps dénudé, en un abandon et un débordement de languissantes ardeurs…
Il rencontre Laïde et se souvient, en un instant, d’avoir déjà vu cette fille : Ce fut à ce moment précis qu’un déclic se produisit au plus profond d’Antonio, une sorte de mystérieux coup de cloche ; il vécut ce qu’on peut ressentir quand – perdu dans une immense campagne déserte – on entend l’appel d’une voix très lointaine… Antonio s’aperçut soudain qu’une fille marchait devant lui…. Elle marchait un pas décidé, impérieux, presqu’arrogant, sans remuer les hanches, d’une allure splendide, orgueilleuse, faisant battre avec un aplomb remarquable ses talons hauts et fins sur le pavé. Le mouvement imprimait à ses jeunes jambes une sorte de trépidation interne, qui allait des chevilles à l’évasement des mollets, allant se perdre ensuite sous le jupon…
Une fillette du peuple, un de ces types physiques bien définis, sans tape à l’œil, en qui l’on découvre peu à peu une élégance naturelle totale.
La retrouve-t-il, en est-ce une autre ? Il ne sait. Elle se trouvait assise sur le divan long. Il en eut au premier regard une impression agréable, sans plus. Une frimousse pâle, qu’un nez bien planté et bien droit, une petite bouche, des yeux ronds et étonnés, rendaient spirituelle. Un ensemble frais, plébéien, mais sans vulgarité. Il la regarda, cherchant à mesurer le plaisir qu’il allait bientôt en retirer. Il s’aperçut que l’ovale du visage était fort beau, pur, sans rien de classique pourtant…
Dans quelques minutes cette créature fraîche et gracieuse, dont il avait toujours ignoré l’existence, qui possédait une famille, une enfance, une jeunesse, tout un monde peuplé d’une infinité de personnages, fait d’un tissu compliqué à l’extrême de souvenirs, d’habitudes, de connaissances, d’espoirs, de particularités physiques, de journées heureuses et de tristes instants, complètement ignorés par lui, cette créature tellement plus jeune que lui, dans quelques minutes il allait la tenir nue entre ses bras, étendue sur le lit.
Antonio reprend rendez-vous, une fois, deux fois, et devient amoureux de cette fille. C’est l’histoire de cette dépendance que nous conte Dino Buzzati et de tous les affronts que subit l’architecte. Elle est danseuse à la Scala. Elle lui raconte quelques brides de sa vie et très vite, il y avait bien des invraisemblances dans toute cette histoire… Que lui importait après tout ? Il allait encore la posséder une ou deux fois au maximum, cette Laïde. Et puis sa curiosité émoussée ; il s’en lasserait. En réalité, le voici embarqué dans une aventure sans limites dans laquelle elle tire les ficelles. Il n’a pas conscience de cette dépendance. Non. Il l’aimait pour elle-même, pour ce qu’elle représentait de féminin, de caprice, de jeunesse, de simplicité populaire, d’effronterie, de liberté, de mystère. Elle était le symbole d’un monde plébéien, nocturne, joyeux, vicieux, ignominieusement intrépide et sûr de soi qui fermentait d’une vie insatiable auprès de l’ennui et de la respectabilité des bourgeois.
Comment peut-on apprécier un livre qui ne parle que de rendez-vous avec une putain, me direz-vous ? Tout simplement parce que l’auteur écrit d’une merveilleuse façon, décrit les rapports entre les deux êtres ou plutôt ce que pense et ressent Antonio, avec tant de mélancolique volubilité, que l’on ne peut qu’être ébloui. On pense parfois au livre d’Albert Cohen « Belle du Seigneur » : même hymne éternel à la femme, symbolisé par la noblesse de cette fille du peuple (ce qui n’était pas le cas d’Ariane), et même fascination et désespoir de l’homme qui ne peut l’attendre réellement. On pense aussi, à la lecture d’autres passages, à Marcel Proust. Buzzati invente un style particulier lorsqu’il décrit impressions, sensations, sentiments d’Antonio, sans jamais non plus se mettre parler en son nom (je…). Un exemple : C’est celle-ci qui lui a pénétré l’âme, cette Laïde de cet instant précis, l’enfant qui croyant voir la brillante fortune de l’autre côté du fossé a plongé en frissonnant ses petites jambes dans l’eau pour passer, gluante terre glaise, la terrible vase mise en place par la grande ville où elle se sent absorbée peu à peu, ou de jour en jour elle s’engloutit davantage et pendant ce temps-là sur la rive opposée la lumière d’or s’éloigne s’éloigne devient un mirage inaccessible ; le fossé est un marais qui se perd à l’infini, sombre et boueux ; et rageuse entêtée elle continue d’avancer, on lui a dit que l’important était d’insister… Et alors elle se débat pour sortir de la fosse, elle veut faire voir aux autres qui lui sourient sur la berge mais ne la respectent plus, qu’elle aussi est une créature digne de vivre et, oubliant tout ce qui est arrivé, elle redevient enfant, comme pour tout reprendre dès le commencement.
Ce sont des moments de folie littéraire où le style qui se veut ne pas en être un, parce que débridé, sans ponctuation, comme sorti brut du cerveau. En réalité, il est d’une concision merveilleuse, d’une vérité pure, véritable enchantement non des phrases et de leur musique, mais de l’ambiance intérieure qu’il procure. Ainsi se perçoit et se vit l’emprise de cette fille sur Antonio. Ce n’est pas un roman social, ni même un roman sur les rapports entre la femme et l’homme. Non. C’est une histoire dont le seul plaisir est dans sa lecture, même si vers la fin, elle traîne un peu.
07:43 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, littérature |  Imprimer
Imprimer
06/09/2012
La Centrale, d’Elisabeth Filhol
« Trois salariés sont morts au cours des six derniers mois, trois agents statutaires ayant eu chacun une fonction d’encadrement ou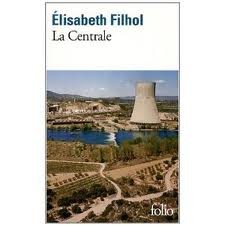 de contrôle, qu’il a bien fallu prendre au mot par leur geste, et d’eux qui se connaissaient à peine on parle désormais comme de trois frères d’armes, tous trois victimes de la centrale et tombés sur le même front. »
de contrôle, qu’il a bien fallu prendre au mot par leur geste, et d’eux qui se connaissaient à peine on parle désormais comme de trois frères d’armes, tous trois victimes de la centrale et tombés sur le même front. »
Ainsi commence La Centrale, un roman consacré aux centrales nucléaires et aux travailleurs saisonniers qui vivent des arrêts de tranche (moment de grand nettoyage d’un réacteur), les DATR pour Directement Affecté aux Travaux sous Rayonnements. On ne s’ennuie pas au cours des cinquante premières pages. Le DATR qui joue le rôle de narrateur a eu un incident au cours d’une séquence de son travail et a pris des doses supplémentaires. On nous décrit les procédures, les impressions, voire les sentiments de l’homme surexposé. On décrit également sa vie quotidienne, en caravane avec quelques copains. Progressivement on se sent englué dans ces rayonnements et la protection qu’il faut porter. « Chair à neutrons. Viande à rem. On double l’effectif pour les trois semaines que dure un arrêt de tranche. Ce que chacun vient vendre c’est ça, vingt millisieverts, la dose maximum d’irradiation autorisée sur douze mois glissants. Et les corps peuvent s’empiler en première ligne, il semble que la réserve soit inépuisable. »
Mais bientôt on se lasse de ces descriptions de procédures, de bouffe dans la caravane, d’incidents sur le circuit primaire, du professionnalisme des uns, du manque de compassion des autres. Page 75, on change de CNPE (une Centrale Nucléaire de Production d’Electricité, pour les initiés). On passe de la centrale de Chinon, à tours réfrigérantes, à la centrale du Blayais : agence d’intérim, formation à la charge de l’embauché, hébergement dans un mobile home, puis la centrale avec explication sur son fonctionnement et un détour par Tchernobyl et les erreurs des opérateurs. Enfin, un des intérimaire pète un plomb, quitte son travail sans l’achever et finit en dépression ou en suicide, on ne sait pas exactement.
Que reste-t-il de cette histoire et est-ce une histoire ? Ce n’est pas un roman au sens où un roman raconte justement une histoire. Il n’y en a pas. Ce sont des impressions, des incidents, des événements, des explications techniques, mais sans suite, sans commencement ni fin. On débute le livre avec intérêt pour un contexte insolite, mais on s’épuise faute de carburant motivant. C’est un pâté constitué d’ingrédients trop divers qui ne vous nourrit pas ou si peu. Certes, on a appris quelque chose sur les centrales nucléaires et la vie des saisonniers. Mais ceci ne permet pas de constituer une intrigue.
07:03 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, centrale nucléaire |  Imprimer
Imprimer











