14/10/2011
Les catilinaires, roman d’Amélie Nothomb
« A l’approche de mes soixante-cinq ans, Juliette et moi cherchions quelque chose à la campagne ? Nous avons vu cette maison et aussitôt nous avons su que ce serait la maison ? Malgré mon dédain des majuscules, je me dois d’écrire la Maison, car ce serait celle que nous ne quitterions plus, celle qui nous attendait, celle que nous attendions depuis toujours. »
Ainsi commence Les catilinaires qui racontent l’arrivée inopinée dans ce paradis d’un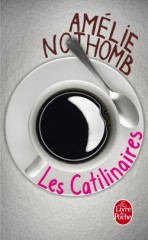 emmerdeur, monsieur Bernardin, cardiologue de son état, qui chaque jour entre chez eux, de quatre heures à six heures, prend son café, ne répond que par oui ou non à leurs imaginatives questions, et s’impose sans aucune politesse. Palamède, car tel est son prénom, les dérange à tel point qu’ils ne savent plus quoi inventer pour s’en débarrasser. Un jour, ils partent se promener à 4 heures moins dix, le laissant seul devant leur porte. Le lendemain, elle est au lit parce qu’elle a pris froid. Il frappe à la porte qu’ils ne veulent pas ouvrir, à tel point qu’ils leur semblent qu’il va la casser. Emile, son mari, celui qui raconte leur mésaventure, finit par ouvrir. Mais Palamède refuse d’examiner Juliette et lui demande une tasse de café. Il finit par monter et pose sa main sur le front de Juliette. – Rien, elle n’a rien. Mais il est dans la chambre et s’installe sur une chaise. – Docteur, vous n’allez pas rester là ? Si je vais au salon, vous devez venir aussi. – Je ne peux pas la laisser seule. – Elle n’est pas malade.
emmerdeur, monsieur Bernardin, cardiologue de son état, qui chaque jour entre chez eux, de quatre heures à six heures, prend son café, ne répond que par oui ou non à leurs imaginatives questions, et s’impose sans aucune politesse. Palamède, car tel est son prénom, les dérange à tel point qu’ils ne savent plus quoi inventer pour s’en débarrasser. Un jour, ils partent se promener à 4 heures moins dix, le laissant seul devant leur porte. Le lendemain, elle est au lit parce qu’elle a pris froid. Il frappe à la porte qu’ils ne veulent pas ouvrir, à tel point qu’ils leur semblent qu’il va la casser. Emile, son mari, celui qui raconte leur mésaventure, finit par ouvrir. Mais Palamède refuse d’examiner Juliette et lui demande une tasse de café. Il finit par monter et pose sa main sur le front de Juliette. – Rien, elle n’a rien. Mais il est dans la chambre et s’installe sur une chaise. – Docteur, vous n’allez pas rester là ? Si je vais au salon, vous devez venir aussi. – Je ne peux pas la laisser seule. – Elle n’est pas malade.
Ils choisissent alors la dérision. Mon cher Palamède, que pensez-vous de la taxonomie chinoise ? Et pendant dix pages, le couple échange des réflexions sur la manière d’effectuer des classifications, tout cela de manière extraordinairement savante et ponctuée de citations inconnues dont le but est de faire sortir de ses gonds Palamède. Imaginez, cher ami, que je me mette en tête de vous d’écrire en commençant par énumérer tout ce que vous n’êtes pas. Ce serait fou. Par où débuter ? Par exemple, on pourrait dire que le docteur n’est pas un animal à plumes : En effet, et il n’est pas un emmerdeur, ni un rustre, ni un idiot. Mais l’hôte reste impassible.
Alors ils imaginent d’inviter le docteur avec sa femme à diner. Un kyste, cette chose était un kyste. Eve fut tirée d’une côte d’Adam. Madame Bernardin avait sans doute poussé comme un kyste dans le ventre de notre tortionnaire… Palamède avait épousé l’amoncellement de chair dont on l’avait libéré. […] Chère madame, quelle joie de vous rencontrer. A ma grande surprise, un tentacule de gras se détacha de la masse et se laissa toucher par les doigts de ma femme.
Et reprirent les visites imposées de Bernardin chaque jour de quatre à six. Ils découvrent que Palamède est un homme qui n’éprouve aucun plaisir à quoi que ce soit ? Ni à manger, ni à boire, ni même à emmerder. C’est un cauchemar. Il fait fuir une ancienne élève d’Emile. Le lendemain celui-ci accueille monsieur Bernardin par un « Foutez le camp et ne revenez plus jamais ! ».
Dans la nuit, Emile se lève, réveillé par un bruit de moteur qui venait de la maison d’en face. Il découvre Palamède dans sa voiture en situation de suicide par les gaz d’échappement. Il le sort et l’apostrophe en attendant l’ambulance. Rentrés chez eux, la pensée de sa femme seule dans sa maison les oblige à y revenir. Elle dort. Ils prépare une soupe, seule nourriture qui lui convienne vraiment.
C’est maintenant le printemps. Monsieur Bernardin ne vient plus de 4 à 6. Il rit de ce que Juliette et Emile font pour eux. Après quelques autres péripéties et énervements, Emile tue Palamède dans son lit en l’étouffant. Juliette ne sait rien ? Je ne le lui dirai jamais. Si elle se doutait que l’homme qui partage son lit est un assassin, elle mourrait d’horreur. A la faveur de son ignorance, elle a estimé que le trépas du voisin était une bonne chose. Elle allait enfin pouvoir s’occuper de Bernadette… C’est ma meilleure amie, m’a dit Juliette après quelques mois.
Ce livre laisse une impression mitigée. L’histoire est loufoque, exagérée, rien de tout cela ne peut se passer dans la réalité. Mais elle est contée d’une manière tellement proche de la réalité possible qu’elle parait vraie et donc ni drôle, ni attendrissante. Plutôt estomaquante, comme les deux Bernardin. Mais dans le même temps, l’art de conter d’Amélie Nothomb en fait un petit chef d’œuvre qui permet d’oublier l’histoire pour ne s’arrêter qu’aux dialogues, aux descriptions, aux sentiments exprimés par le couple qui croyait avoir trouvé un refuge pour leur vieillesse. L’écriture permet au lecteur de dépasser la fable et de ressentir tout l’art de la romancière, cinglant, plein d’humour caché. Bref, une leçon d’écriture.
06:37 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, imagination |  Imprimer
Imprimer
02/10/2011
Cosmétique de l’ennemi, roman d’Amélie Nothomb
Désolé, mais cette fois-ci je ne crierai pas au chef d’œuvre. Ce roman m’a paru plat, sans consistance, une performance littéraire peut-être, mais surement pas un livre enchanteur ou passionnant. Un exercice de style, sans intérêt littéraire.
"COSMETIQUE, l’homme se lissa les cheveux avec le plat de la main. Il fallait qu’il fût présentable afin de rencontrer sa victime dans les règles de l’art." Ainsi commence le livre qui raconte, dans un hall d’aéroport où les passagers attendent un avion en partance, l’étrange rencontre entre Jérôme Angust, qui part en voyage d’affaires, et Textor Texel, un homme qui veut à tout prix engager la conversation et ne plus le quitter. Jeux de passe verbaux, refus, redémarrage de la conversation, injures, rien n’y fait, Textor ne décolle pas de Jérôme.
Je ne vous raconterai pas la suite, je me suis arrêté à la page 75 après que Textor ait raconté le viol d’une jeune fille dans le cimetière de Montmartre, puis sa rencontre quelques années plus tard. J’ai estimé à cet endroit du livre que j’en avais assez lu pour me faire une idée de son contenu. J’avais tenu bon jusque là, mais je craquais. C’en était trop.
Alors, je regardais à la fin du livre. Oh stupeur (sans tremblement). Il finissait en suicide (dernière page) ou en meurtre (avant-dernière page). De quel personnage, me direz-vous ? Si le meurtre de Textor par Angus est bien conté de manière à peu près clair en quelques lignes, le suicide reste incertain, malgré une demi-page, entre une deuxième mort de Textor ou celle de l’auteur du meurtre précédent. Cela finissait aussi mal que cela avait commencé.
Que dire ? Amélie Nothomb ne signe pas là son meilleur livre, c’est certain. Elle a voulu jouer, jouer avec les mots, jouer avec l’échange entre deux êtres, jouer à tromper ses lecteurs au travers d’un dialogue qui lasse très vite, tel un échange de balles interminables entre deux mauvais joueurs de tennis. La seule fois où l’on entend la frappe sèche sur les raquettes se trouve en fin de livre, par la mort de l’un, puis peut-être de l’autre. Et encore, il faut dresser l’oreille pour l’entendre !
05:30 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman |  Imprimer
Imprimer
25/09/2011
Il y a longtemps mon amour, roman de Vladimir Volkoff (1998)
Ce n’est pas un roman, plutôt une autobiographie voilée. Volkoff se raconte ou plutôt raconte ses amours passés, parce que le temps le poursuit et qu’il a encore beaucoup de choses à dire. Alors il relate sous le personnage de Ladislas Radowa-Dzikowski, vicomte de La Vieillevigne, totalement fictif, mais très proche sentimentalement de lui, ses aventures féminines jusqu’au grand amour de sa vie, Elise. Grand nostalgique d’un passé révolu, qu’il considère en même temps comme totalement dépassé, il use de son ton à la fois romantique et réaliste, charmeur et désabusé. Volkoff traditionnel et moderne, aristo et homme de l’ombre.
Il décrit ainsi son premier amour, Aude, fille du secrétaire de mairie, qui était le sacré, la poésie même. A quinze ans, il apprit qu’elle était enceinte du mécano du village. Ils se revirent encore un fois, des lustres de lustres après, dans un bistrot, au fond d’une autre province… Touchant, oui, mais, finalement, ils n’avaient rien d’autre à se dire, sinon qu’ils s’étaient attendus et qu’ils ne s’attendraient plus.
Etudiant à la Sorbonne, il connut Rosemonde. Ils prennent le métro ensemble, saine distraction. Il l’invite au bal de la Sorbonne auquel elle va avec sa mère comme chaperon et où elle fit connaissance avec Michmich, jeune garçon qui va finir par ravir la belle à Ladislas sans toutefois en devenir le mari ou même l’amant. Mais, entre temps, Ladislas l’embrasse et en profite jusqu’au moment du choix, qu’il refuse.
Militaire, aspirant, il fait connaissance avec un personnel féminin de l’armée de terre, une PFAT, Yvonne, employée comme lui dans le renseignement. Ils sont faits l’un pour l’autre, affamés d’amour l’un et l’autre, lecteurs de romans et auditeurs de musique classique. Ladislas veut parfaire son éducation. Il voulait Yvonne transplantée, transmutée, il voulait une Yvonne qui ne fut plus Yvonne, et elle l’y encouragea. Le malentendu n’apparut pas immédiatement. Quinze jours plus tard, Ladislas lui demande si elle veut l’épouser. Ils se marièrent. Cela ne dura guère plus d’un an. Ce fut alors la séparation. Pour Ladislas, l’attente et la rencontre de l’âme sœur se terminaient dans la déconfiture totale.
Rentré en France, toujours dans le théâtre d’ombres, il découvre Luciole, secrétaire dans les mêmes lieux. Il déjeune chaque jour avec elle, mais elle est mariée. Il cherche à la prendre un soir, mais elle refuse. Il prenne une chambre dans un hôtel, mais elle refuse encore. Enfin, un jour, il la raccompagne et elle lui dit viens, maintenant, j’ai envie. Mais son père les surprend au lit. Il fuit. Après un dernier entretien, il ne la revit plus.
Toute autre est Bérénice de Fruminy, comtesse du Saint-Empire. Lorsque Bérénice parut au Hache-menu, elle déplut. Son port de tête altier, son cou sculptural, l’ovale irréprochable de son visage, la rigueur de ses traits classiques, la plénitude de ses formes, surprenante dans une aussi jeune femme, et l’arrogance constante de son maintien avait de quoi irriter de jeunes hommes qui aiment aimer facilement. Ladislas, lui, fut ravi de cette attitude hautaine à laquelle ce physique se prêtait si bien ; son orgueil trouvait enfin à qui parler ; il avait rencontré une femme à qui il n’avait rien à apprendre sur le chapitre du dédain. Ils se lièrent. Après les aventures habituelles entre une jeune fille et un jeune homme, une absence insolite et prolongée de sa petite amie, elle lui déclara : « Il y a une chose que je ne vous ai pas dite hier. Je devais avoir un enfant, d’où mon retard à rentrer à Paris. Une fausse couche la semaine passée. Passez me prendre ce soir à la même heure. » Mythomane, affabulatrice ? Il ne sut pas, il ne la revit pas.
Il y eut Emmeline (oui, avec deux m) avant Elise. Bretonne, un peu sorcière, il s’intéressait lui-même à l’ésotérisme, elle avait aimé un allemand pendant la guerre, puis s’était mariée avec un autre allemand. Avec d’autres, j’ai joué à des jeux. La coquetterie, la jalousie, la bouderie, les piques, le bras de fer amoureux. Vous, je veux vous aider à vivre. Vous n’aurez jamais un instant de déplaisir par ma faute.
Enfin, Elise dont Ladislas est tombé amoureux deux fois, à dix ans de distance en une pièce en quatre actes. Premier acte : A la Sorbonne, échange de lettres enflammées, mais elle refuse cette amourette. Deuxième acte : l’amitié, une affinité, sans doute, et l’élection de cette affinité, plus la confiance l’un dans l’autre, le besoin l’un de l’autre, l’admiration l’un pour l’autre, l’être bien avec l’autre, bref une flexion complète des prépositions sympathiques. Bien après le mariage de Ladislas avec Yvonne, il la revit et elle tombe amoureuse de lui. Troisième acte : l’amour. Il était à l’époque l’amant d’Emmeline. Vinrent les aveux, empreints d’une consternation amusée : « J’éprouve pour vous de l’amitié, de la confiance, de l’estime, de la tendresse, du respect, du désir. La somme ne s’appelle-t-elle pas amour ? écrivait Ladislas à son amie, et elle répondait, médusée : « Sans doute… » Comme l’annulation de son mariage tardait, elle le suit dans ses pérégrination et lui inspire la poésie. Quatrième acte : le mariage, lorsque l’annulation en cour de Rome arrive. L’amour qui liait Elise à Ladislas leur était si précieux qu’un instant ils hésitèrent à le hasarder sur la case mariage, comme jadis ils avaient hésité à miser leur amitié sur la case amour. Après la vente du château, ils s’installent dans la métairie voisine. Mais, époux et parents, ils restaient avant tout des amants.
Et voilà… Il y a longtemps, mon amour… Oui, il y avait longtemps.
C’était Volkoff, funambule et poète, homme de l’ombre, que j’ai rencontré dans le train pour Lille où nous allions à une table ronde parler de renseignement et d’information. Nous avions devisé toute la durée du voyage sur la manipulation, lui prétendant que toute conversation, voire toute rencontre humaine est une recherche de manipulation, moi défendant l’idée que ce qui différencie le juste des autres hommes est sa faculté à laisser libre l’autre de penser ce qu’il veut après lui avoir donné les raisons de croire à ce que lui, l’homme juste, croit.
05:16 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, amour |  Imprimer
Imprimer
11/09/2011
Le livre de ma mère, d'Albert Cohen

« C’était ma mère et jamais plus je ne vivrai ces merveilleux moments passés ensemble ». Chacun de nous, ou presque, pourrait le dire à propos de sa mère, mais personne ne saurait le dire aussi bien, de manière aussi belle, qu’Albert Cohen. Avec la même verve et la même délicatesse que dans Belle du seigneur, l’auteur se rappelle ces petits riens qui constituent l’ensemble des souvenirs d’une personne aimée au-delà d’un amour des corps.
Il a des mots tendres et drôles comme l’herbe au printemps :
« Mais si je la grondais, elle obéissait, pleine de foi, immédiatement atterrée par les perspectives de maladie, me croyant si je lui disais qu’en six mois de régime sérieux elle aurait une tournure de mannequin. Elle restait alors toute la journée scrupuleusement sans manger, se forgeant tristement mille félicités de sveltesse. Si, pris soudain de pitié et sentant que out cela ne servirait à rien, je lui disais qu’en somme ces régimes ce n’était pas très utile, elle approuvait avec enthousiasme. « Vois-tu, mon fils, je crois que tous ces régimes pour maigrir, ça déprime et ça fait grossir. » Je lui proposais alors de dîner dans un très bon restaurant. « Eh oui, mon fils, divertissons-nous un peu avant de mourir ! » Et dans sa plus belle robe, linotte et petite fille, elle mangeait de bon cœur et sans remords puisqu’elle était approuvée par moi. »
Il décrit les délirantes promenades dans les rues de Genève, en été, lorsque sa mère, cardiaque, avançait à pas menus :
« Quand on traversait la rue ensemble à Genève, elle était un peu nigaude. Consciente de sa gaucherie héréditaire, et marchant péniblement, ma cardiaque, elle avait si peur des autos, si peur d’être écrasée, et elle traversait, sous ma conduite, si studieusement, avec tant de brave application affolée. Je la prenais paternellement par le bras et elle baisait la tête et fonçait, ne regardant pas les autos, fermant les yeux pour pouvoir mieux me suivre ma conduite, toute livrée à ma direction, un peu ridicule d’aller avec tant de hâte et d’épouvante, si soucieuse de n’être pas écrasée et de vivre. Faisant si bien son devoir de vivre, elle fonçait bravement, avec une immense peur, mais toute convaincue de ma science et puissance et qu’avec son protecteur nul mal ne pouvait lui survenir. »
Il a la mélancolie des jours d’automne lorsque les souvenirs viennent effleurer la conscience :
« Maman de mon enfance, auprès de qui je me sentais au chaud, ses tisanes, jamais plus. Jamais plus, son odorante armoire aux piles de linge à la verveine et aux familiales dentelles rassurantes, sa belle armoire de cerisier que j’ouvrais les jeudis et qui était mon royaume enfantin, une vallée de calme merveille, sombre et fruitée de confitures, aussi réconfortante que l’ombre de la table du salon sous laquelle je me croyais un chef de guerre. Jamais plus son trousseau de clefs qui sonnaillaient au cordon du tablier et qui étaient sa décoration, son Ordre du mérite domestique. Jamais plus son coffret plein d’anciennes bricoles d’argent avec lesquelles je jouais quand j’étais convalescent. O meubles disparus de ma mère. Maman, qui fus vivante et qui tant m’encourageas, donneuse de force, qui sus m’encourager aveuglément, avec d’absurdes raisons, qui me rassuraient, Maman, de là-haut, vois-tu ton petit garçon obéissant de dix ans ? »
Il a enfin les pleurs de l’hiver lorsque le ciel si bas fait resurgir la complainte des regrets :
« Elle attendait tout de moi avec sa figure un peu grosse, toute aimante, si naïve et enfantine, ma vieille Maman. Et je lui ai donné si peu. Trop tard. Maintenant le train est parti pour toujours, pour le toujours. Défaite et décoiffée et bénissante, ma mère morte est toujours la portière du train de la mort. Et moi je vais derrière le train qui va et je m’essouffle, tout pâle et transpirant et obséquieux, derrière le train qui va emportant ma mère morte et bénissante. »
Oui, ce livre est un petit chef d’œuvre de mémoire, drôle, plein d’anecdotes, aux souvenirs embués des regrets qu’ont tous les enfants à la mort d’un parent. Méditation d’un enfant vieilli resté seul face à son enfance, il fait revivre celle-ci, l’enjolive, puis revient aux derniers jours, ceux de son âge adulte, se reprochant ses manquements, son impuissance à lui faire plaisir parce que trop préoccupé de sa propre vie.
« Voilà, j’ai fini ce livre et c’est dommage. Pendant que je l’écrivais, j’étais avec elle. Mais sa Majesté ma mère morte ne lira pas ces lignes écrites pour elle et qu’une main filiale a tracées avec une maladive lenteur. Je ne sais plus que faire maintenant. Lire ce poème moderne qui se gratte les méninges pour être incompréhensible ? »
04:23 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman |  Imprimer
Imprimer
05/09/2011
Métaphysique des tubes, roman d’Amélie Nothom
La vie d’Amélie, de un à trois ans. Cela se passe au Japon, mais surtout cela se passe à travers les yeux d’un enfant de cet âge, y compris dès la naissance, une naissance en trois temps.
Premier temps : le rien, pendant deux ans. Et ce rien n’était ni vide ni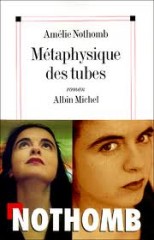 vague : il n’appelait rien d’autre que lui-même. Ce rien est Dieu, absolue satisfaction. Dieu était Dieu. Il était satiété et éternité…Les seules occupations de Dieu étaient la déglutition, la digestion et, conséquence directe, l’excrétion. […] C’est pourquoi à ce stade de son développement, nous appellerons Dieu le tube. Il y a une métaphysique des tubes. […] Dieu avait la souplesse du tuyau, mais demeurait rigide et inerte, confirmant ainsi sa nature de cube. Il connaissait la sérénité absolue du cylindre. Il filtrait l’univers et ne retenait rien.
vague : il n’appelait rien d’autre que lui-même. Ce rien est Dieu, absolue satisfaction. Dieu était Dieu. Il était satiété et éternité…Les seules occupations de Dieu étaient la déglutition, la digestion et, conséquence directe, l’excrétion. […] C’est pourquoi à ce stade de son développement, nous appellerons Dieu le tube. Il y a une métaphysique des tubes. […] Dieu avait la souplesse du tuyau, mais demeurait rigide et inerte, confirmant ainsi sa nature de cube. Il connaissait la sérénité absolue du cylindre. Il filtrait l’univers et ne retenait rien.
Deuxième temps, plus bref, six mois : hurlements et colères. La plante n’est plus une plante ! Dieu se conduisait comme Louis XIV : il ne tolérait pas qu’on dorme s’il ne dormait pas, qu’on mange s’il ne mangeait pas, qu’on marche s’il ne marchait pas et qu’on parle s’il ne parlait pas. Ce dernier point surtout le rendait fou. Découverte du langage.
Troisième temps : deuxième naissance. Ce fut alors qu’elle naquit, à l’âge de deux ans et demi, en février 1970, dans les montagnes du Kansai, un village de Shukugawa, sous les yeux de ma grand-mère paternelle, par la grâce du chocolat blanc. C’est moi ! C’est moi qui vis ! C’est moi qui parle ! Je ne suis pas « il » ni « lui », je suis moi ! […] En me donnant une identité, le chocolat blanc m’avait aussi fourni une mémoire : depuis février 1070, je me souviens de tout. […] Je devins le genre d’enfant dont rêvent les parents : à la fois sage et éveillée, silencieuse et présente, drôle et réfléchie, enthousiaste et métaphysique, obéissante et autonome. […] On commença à m’appeler par un prénom.
Elle se parle peu à peu à elle-même sans vouloir cependant le dire aux autres. Quel mot choisir en premier pour le révéler : maman, puis papa ; mais le troisième fut aspirateur. Elle découvre la mort et en parle avec Nishio-san, sa gouvernante. Elle apprend la haine, celle de Kashima-san, la seconde gouvernante, appartenant à la vieille noblesse japonaise et qui rend tous les blancs responsables de sa destitution. A l’occasion d’une presque noyade, elle parle comme tout le monde d’une voix posée. « Elle parle ! Elle parle comme une impératrice ! », jubile son père.
Chaque chapitre contient une histoire, un petit rien qui fait le charme de ce livre, épisode burlesque ou malheureux. Il y a celui des leçons de chant de nô de son père qui se finit dans les égouts un jour d’inondation, celui des querelles entre les deux gouvernantes, enfin celui des carpes offertes pour son anniversaire et l’étrange comportement de Kashima-san face à son évanouissement et sa nouvelle noyade.
« Ensuite, il ne s’est plus rien passé. » Ainsi se finit le roman d’Amélie Nothomb, à l’âge de trois ans, fin de l’enfance divine des Japonais et Japonaises. Ce n’est en fait pas vraiment un roman, mais pas non plus un livre de souvenirs. C’est un récit plein de vigueur enjouée, de remarques comiques, de profondeurs métaphysiques déguisées sous des pantalonnades. Un livre plein d’esprit, pétillant d’intelligence.
06:40 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman |  Imprimer
Imprimer
17/06/2011
La porte étroite, d’André Gide, 1909
C’est le titre qui nous donne la clef du livre : « Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite, car la porte large et le chemin spacieux mènent à la perdition, et nombreux sont ceux qui y passent : mais étroite est la porte et resserrée la voie qui conduisent à la vie, et il en est peu qui les trouvent. »
Elle pourrait sembler banale et mièvre cette histoire de Jérôme et d’Alissa, cet amour de deux êtres qui ne cessent de s’aimer sans pouvoir se rejoindre. Juliette, la sœur d’Alissa, qui aime aussi Jérôme, est le prétexte du développement du thème du livre.
C’est le procès, fait par André Gide, d’une vie pieuse et d’une morale chrétienne mal comprise que s’imposèrent beaucoup de jeunes filles de l’époque. Ne jamais vouloir sacrifier au plaisir terrestre et immédiat, mais toujours s’imposer une conduite plus haute qui refuse le bonheur de ce monde pour un bonheur plus lointain. Croyant faire leur bonheur, elles bâtissent de leurs propres mains leur malheur et souvent celui des autres. Alissa se sacrifie d’abord pour sa sœur Juliette, puis ce sacrifice devenant inutile, elle se force à jouer son rôle par orgueil et fausse piété. Car c’est de cela dont Gide fait le procès, une fausse éducation chrétienne entraînant au péché par orgueil et exaltation, orgueil de sainteté et de renoncement. Le drame d’Alissa est de ne pouvoir choisir entre sa morale et son amour. Elle meurt de cette ambigüité sans oser la résoudre.
Jérôme et Juliette vivent une même ferveur religieuse, approfondie par des lectures communes. Au fil des ans, Jérôme ne cesse de souhaiter épouser Alissa tout en se forçant avec elle et pour elle à une vertu sans faille : « Je ferais fi du ciel si je ne devais pas t’y retrouver. » Malheureusement, Alissa découvre l’amour de sœur Juliette pour Jérôme. Elle annule leurs fiançailles, et laisse le champ libre à sa cadette. Mais celle-ci, assurée que Jérôme n’éprouve rien pour elle, rivalise dans le sacrifice en épousant un tiers. Une longue séparation permet à Jérôme et Alissa de retrouver une certaine sérénité. Ils échangent à nouveau leur amour sans toutefois évoquer la possibilité d’un bonheur matériel. Séparer à nouveau, en raison de cette obsession d’un bonheur trop haut, il se retrouve peu avant les derniers instants d’Alissa, qui meurt d’un goût trop prononcé pour le sacrifice.
Les souvenirs de Jérôme, très bien écrits malgré ce qu’en dit Gide (flasque caractère […] impliquant la flasque prose), ne sont que l’histoire de leur vie dont l’explication est donnée par le journal d’Alissa :
_ Pourquoi me mentirais-je à moi-même ? C’est par un raisonnement que je me réjouis du bonheur de Juliette. Ce bonheur que j’ai tant souhaité, jusqu’à lui offrir de lui sacrifier mon bonheur, je souffre de le voir obtenu sans peine, et différent de ce qu’elle et moi imaginions qu’il dût être. Que cela est compliqué ! Si… Je discerne bien qu’un affreux retour d’égoïsme s’offense de ce qu’elle n’ait pas eu besoin de mon sacrifice pour être heureuse.
Je suis comme humilié que Dieu ne l’exige plus de moi. N’en suis-je donc point capable ?
_ Il me semble à présent que je n’ai jamais tendu à la perfection que pour lui. Et que cette perfection ne puisse être atteinte que ans lui, c’est, ô mon Dieu, celui d’entre vos enseignements qui déconcerte le plus mon âme.
_ Hélas, je ne le comprends que trop bien à présent, entre Dieu et lui, il n’est pas d’autres obstacles que moi-même. Si, peut-être, comme il me le dit, son amour pour moi l’inclina vers Dieu tout d’abord, à présent cet amour l’empêche ; il s’attarde à moi, me préfère et je deviens l’idole qui le retient de s’avancer plus loin dans la vertu. Il faut que l’un de nous d’eux y parvienne, et désespérant de surmonter dans mon lâche cœur mon amour, permettez-moi, mon Dieu, accordez-moi, la force de lui apprendre à ne m’aimer plus, de manière qu’au prix des miens, je vous apporte ses mérites infiniment préférables… Et si mon âme sanglote aujourd’hui de le perdre, n’est-ce pas pour que plus tard, je le retrouve en Vous…
Epilogue, Jérôme et Juliette dix ans plus tard :
_ Si j’épousais une autre femme, je ne pourrai faire que semblant de l’aimer.
_ Ah ! Alors tu crois qu’on peut garder si longtemps dans son cœur un amour sans espoir ?
_ Oui, Juliette.
_ Et que la vie peut souffler dessus chaque jour sans l’éteindre ?
La critique littéraire Pascale Arguedas explique que « Ce court roman écrit en 1905, paru en 1909 — premier vrai succès de librairie d’André Gide — est le négatif de L’Immoraliste qui célébrait le monde enivré des couleurs, des parfums, du corps humain, une aspiration à la « gloire célestielle ». […] Histoire d'un sacrifice, de l’adultère, du protestantisme et du puritanisme, ce roman d'apprentissage et de l'abnégation, d’inspiration fortement autobiographique, se présente telle une parabole et rend compte d'une société refoulée dont l’auteur s'attache à dénoncer les failles. […] Dans un style sobre et dépouillé, André Gide exploite l’intérêt dramatique, moral et didactique, en observateur, analyste et peintre de lui-même, présentant Alissa comme le symbole de l'amour impossible. »
06:29 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, littérature, roman, christianisme |  Imprimer
Imprimer
13/05/2011
Détruire, dit-elle
"Détruire, dit-elle" est un roman de Marguerite Duras paru en mars 1969 aux éditions de Minuit.
1969 aux éditions de Minuit.
C'est aussi un film qu’elle a réalisé, avec Catherine Sellers et Michael Lonsdale.
Le décor : un périmètre dans la forêt où les gens viennent s’isoler, vivre eux-mêmes, s’apprendre à vivre eux-mêmes dans le repos. Ici les livres, qu’ils soient à lui, Max Thor, ou à elle, Elisabeth Alione, ne servent à rien, ils font partis du décor. Rien ne se passe dans cet hôtel, tout commence et rien ne s’achève, car aujourd’hui n’a plus de rapport avec hier. Le temps ne coule plus ou coule sans souvenirs, sans souvenirs d’impressions durables, sauf, peut-être, le souvenir de ce qui est et non pas de ce qui arrive.
C’est dans ce monde, où rien ne compte qu’être, que fonctionne la destruction comme cette musique des dernières pages, cette fugue de Bach qui s’arrête, reprend, s’arrête à nouveau, repart, jusqu’à ce qu’elle fracasse les arbres, foudroie les murs. Elle arrive en trois temps, trois actes du livre. Dans un premier temps, il n’y a rien, rien ne se passe, on regarde et Marguerite Duras pose le décor et ses personnages. Dans un deuxième temps, arrive Alissa qui est la destruction à l’œuvre et cette destruction place ses racines et les enfonce dans le décor subrepticement, imperceptiblement. Enfin, dans un troisième temps, les deux forces opposées, l’avenir avec le groupe d’Alissa, Stein et Max Thor et le passé avec Bernard et Elisabeth, s’affrontent et se déchirent, enracinant la destruction chez Elisabeth Alione sans qu’elle-même le perçoive, sans toutefois aller jusqu’au bout de l’acte, jusqu’à ce qu’il y a au bout de la destruction, c’est-à-dire la folie. La folie, c’est Alissa, l’inacceptation de tout état de fait, la destruction de tout le passé, donc de toutes les habitudes.
Les personnages maintenant : que sont-ils ? Il y a en fait deux forces en action, deux clans qui s’opposent. Ceux qui sont tournés vers l’avenir, qui savent ce que les autres ne savent pas, et ceux qui sont soumis au passé, qui ne savent rien, qui ne savent même pas qu’il y a à savoir, qui vivent de leur habitudes.
Stein sait. Il sait au-delà de la folie, vers ce vide qui est au-delà. C’est un sage, une sorte de moine, pourrait-on dire. Il se refuse à tout ce qui semble constituer la vie de chacun, le mariage, un métier, des projets. Il ne cherche rien, rien de ce que cherchent les autres. Il peut se permettre de faire des choses que les autres ne feraient pas, qu’ils appelleraient indiscrètes. Les autres ne l’intéressent pas vraiment, il les regarde comme on observe un troupeau. Lui-même ne l’intéresse pas. Il se contemple comme il examine les autres, sans retenue aucune (quelquefois j’entends ma voix, dit-il).
Alissa n’est pas encore allée au-delà de la folie, de cette folie apparente engendrée par la destruction. Elle est la destruction (détruire, dit-elle) et c’est en fait elle qui déclenche le drame, car rien ne serait survenu sans elle. Alissa sait, dit Max Thor. Mais que sait-elle ? se demande-t-il. Sans doute ne le sait-elle pas elle-même, n’est-elle pas capable de le formuler. Seul Stein pourrait le faire, mais Stein ne répond pas. Alissa comprend Stein d’instinct, intuitivement, elle le sent fémininement et Stein la comprend. C’est pourquoi l’amour naît aussitôt entre eux, ontologiquement, pourrait-on dire.
Max Thor n’est pas encore du même camp. Il cherche, il s’interroge, il observe à la manière dont regarde Elisabeth Alione. Quelque chose le fascine et le bouleverse dont il n’arrive pas à connaître la nature », aussi bien chez Elisabeth que chez Alissa. Il ne connaît pas Alissa, sa femme. Il la cherche, car il sait que c’est en elle qui doit être la réponse ; et ce problème, le seul qui le touche vraiment, s’effacera de lui-même, sans qu’il ait besoin d’en avoir la réponse, au cours du troisième temps du livre, au cours de l’affrontement. Alors il saura ce qu’est Alissa et Stein. Elisabeth Alione aussi le fascine. Il l’aime d’un amour différent de celui qu’il éprouve pour Alissa (amour inquiet et interrogateur, tourné vers l’avenir), d’un amour tourné vers ce passé qu’il ne peut encore quitter tout à fait, ne sachant pas l’avenir.
Enfin, il y a Elisabeth Alione, qui en fait n’existe pas en elle-même, c’est-à-dire en tant qu’être propre, individuel et personnel. Elle ne croit pas en elle-même. Elle croit à ce que les autres disent d’elle. « Elle est à celui qui la veut, elle éprouve ce que l’autre éprouve ». Elisabeth Alione, c’est le passé. Tout n’existe pour elle que par le passé et l’avenir lui fait peur, car aucun passé ne s’y rattache. Aussi a-t-elle peur des trois autres et surtout d’Alissa. Elle ne les comprend pas, parce qu’elle ne sait rien d’eux alors qu’eux savent tout d’elle. Une fois dans sa vie, Elisabeth Alione aurait pu être en tant que personne véritable, mais elle a eu peur de cette lettre du médecin qu’elle a montré à son mari parce que là encore elle avait peur d’un avenir différent du passé, inconnu. Puis elle a regretté son geste, parce que quelque chose en elle disait oui à la lettre. Sa maladie véritable venait en fait de cette contradiction entre ce qu’elle croyait être et e qu’elle était réellement, intérieurement. La destruction de l’ancienne Elisabeth commence le jour où elle rencontre Alissa, puis Stein. Elle découvre par l’intermédiaire d’Alissa la véritable cause de sa maladie. Elle ne peut plus redevenir ce qu’elle était auparavant, bien qu’elle ne s’en rende pas compte, et au delà de la peur qu’elle a d’abord éprouvé, elle découvre le dégoût (Ces nausées… Ce n’est qu’un début, dit Max Thor. Bien… Bien, dit Stein). « Il y a eu un commencement de… comme un frisson… non… un craquement de… du corps », dit Stein. « Ce sera terrible, ce sera épouvantable, et déjà elle le sait un peu ».
La destruction a fonctionné comme cette musique, cette fugue de Bach, qui s’arrête, reprend, s’arrête de nouveau, repart jusqu’à ce qu’elle passe la forêt, fracasse les arbres, foudroie les murs.
« Détruire dit-elle est le plus étrange des livres de Marguerite Duras. Il ressemble à une cérémonie dont nous ignorerions le rituel et suivrions néanmoins, fascinés, le déroulement. Comme l’indique le titre, c’est peut-être l’idée de destruction qui s’impose le plus directement à nous, et encore à condition que détruire ne signifie rien de brutal, de violent, d’explosif, mais soit plutôt synonyme de miner, saper, corroder... Il y a, bien entendu, dans l’œuvre de Marguerite Duras, nombre d’éléments qui portent en germe Détruire dit-elle. Mais l’essentiel serait plutôt dans un glissement, un décalage dans les mots ou dans l’image qui étaient parfois sensibles dans Moderato cantabile ou dans Le Ravissement de Lol V. Stein et qui, ici, nous entraînent dans un univers de folie, ou plutôt d’insidieux dérèglement mental : chaque mot, chaque geste pris séparément ont l’apparence de la logique, mais c’est l’enchaînement qui donne l’impression que l’esprit chavire. »
Anne Villelaur (Les Lettres françaises)
04:58 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, littérature, destin |  Imprimer
Imprimer
31/03/2011
Paludes, d’André Gide, publié en 1895
Paludes, c’est l’histoire du terrain neutre, celui qui est à tout le monde, l’histoire de la troisième personne, celle dont on parle, qui vit en chacun de nous, l’histoire de l’homme couché (dans Virgile, il s’appelle Tityre), homme ordinaire qui s’accommode de son petit domaine.
« La perception commence au changement de sensation, d’où la nécessité du voyage », dit André Gide. « On ne sort pas, c’est un tort. D’ailleurs on ne peut pas sortir. Mais c’est parce que l’on ne sort pas. On ne sort pas parce qu’on se croit déjà dehors. Si l’on se savait enfermé, on aurait du moins l’envie de sortir. »
Autre propos de l’homme qui ne peut pas voyager : « Il y a des choses que l’on recommence chaque jour simplement parce qu’on n’a rien de mieux à faire ; il n’ya là ni progrès, ni même entretien, mais on ne peut pas pourtant ne rien faire… C’est dans le temps le mouvement de l’espace des fauves prisonniers ou celui des marins sur les plages. »
« Etre aveugle pour se croire heureux. Croire qu’on y voit clair pour ne pas chercher à voir puisqu’on ne peut se voir que malheureux. »
Pourtant, il ne s’agit pas de voir ou d’être aveugle, mais bien d’ignorer la recherche de la lentille qui donnera la vue. On ne peut être que par rapport à quelque chose qui résonne en nous. « Je ne puis jamais arriver à me saisir moi-même sans une perception, dit Hume. Nous sommes seulement un faisceau ou une collection de différentes perceptions qui se succèdent avec une inconcevable rapidité, et qui sont dans un flux et un mouvement perpétuel. »
Paludes raconte la semaine d’un écrivain en mal de voyage. Y domine le personnage de Tityre, berger de tous les temps, habitant des marécages où fourmille une vie insolite. Qui est Tityre : Celui qui vit dans des marais, disposant d’un emploi du temps prédéfini dans un agenda et qui contraste avec le modèle de vie de son auteur qui fréquente les salons parisiens ? Hubert, qui chasse la panthère, imprégné de rationalité ? Richard, peut-être, l'orphelin qui épouse une femme sans amour ? Ou le narrateur qui voyage avec Angèle jusqu’à Montmorency ? Dans cette satire des salons littéraires de Paris, les descriptions sont ironiques. Gide qualifiait ce livre de sotie et réfutait le terme de roman. La caractéristique principale de cette œuvre de Gide est la modernité de son style et de son récit.
En juillet 1895, Camille Mauclair écrit à propos de Paludes dans le Mercure de France : « J’aime Paludes, comme tout ce qu'écrit M. André Gide, parce que cela vient d'une âme extrêmement fine, hautaine et souffrante, et qu'il y a éparses dans ses livres quelques unes des choses du cœur que nous aurions tous voulu dire aux grandes minutes passionnées de notre vie. C'est le caractère spécialement prenant de son œuvre, qu'elle naît du dedans, intensément. C'est très difficile, littérairement parlant, d'imaginer, de construire et d'écrire ce petit livre apologique, et il est fait avec un charme et une légèreté que peu d’entre nous ont connus. Mais on ne s'en aperçoit même pas, tant on va d’un bout à l'autre avec l'impression qu'il faut ici s'occuper non d'un talent, mais d'une âme. »
05:34 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman |  Imprimer
Imprimer
21/03/2011
La symphonie pastorale, d’André Gide, 1919
Ce n’est pas seulement l’histoire de l’éducation d’une aveugle que décrit André Gide, mais aussi la naissance d’un amour impossible. Un pasteur explique dans son journal intime comment il adopta Gertrude, une petite aveugle de quinze ans, qui vivait auparavant à la manière d’un animal. Nous assistons à la naissance des sensations, puis des sentiments de Gertrude, guidée par le pasteur qui lui dévoile un monde d’amour et de beauté dans lequel le mal, le péché et la mort n’ont pas de place.
Il emmène Gertrude au concert et c’est à l’écoute de la symphonie pastorale de Beethoven qu’elle découvre la nature et les couleurs :
_ Est-ce que vraiment ce que vous voyez est aussi beau que cela ?
_ Ceux qui ont des yeux ne connaissent pas leur bonheur.
Jacques, le fils du pasteur, s’éprend d’elle. Son père, implacablement, refuse cet amour et ce n’est que plus tard qu’il comprend qu’il aime Gertrude d’un amour moins pur qu’il ne le croyait. Gertrude aussi l’aime et le lui avoue, ne connaissant pas le mal, mais seulement le bonheur de vivre en communion avec la nature, les hommes et Dieu.
_ Vous savez bien que c’est vous que j’aime, pasteur… Je ne vous parlerais pas ainsi si vous n’étiez pas marié. Mais on n’épouse pas une aveugle. Alors pourquoi ne pourrions-nous pas nous aimer ? Dites, pasteur, est que vous trouvez que c’est mal ?
_ Le mal n’est jamais dans l’amour.
C’est dans l’ambigüité de l’amour envers Dieu et ses créatures et de l’amour envers un être que le pasteur se débat d’autant plus difficilement que Gertrude ignore le péché et ne connaît, comme il l’avait souhaité, que le bonheur.
Dans la deuxième partie du livre, Gertrude s’ouvre au monde des hommes et fait connaissance avec la tristesse, le malheur et le péché. Un médecin, ami du pasteur, lui rend la vue et, en découvrant le monde, Gertrude découvre son péché. Elle veut se suicider en se jetant à l’eau. Ce suicide manqué ouvre les yeux du pasteur qui découvre que ce n’est pas lui qu’elle aimait vraiment, mais Jacques. Celui-ci hélas ne peux plus l’épouser, étant rentré dans les ordres. Alors elle s’éteint doucement.
_ Quand vous m’avez donné la vue, mes yeux se sont ouverts sur un monde plus beau que je n’avais rêvé qu’il pût être. Mais non, je n’imaginais pas si osseux le front des hommes. Quand je suis entré chez vous, ce que j’ai vu d’abord, c’est notre faute, notre péché. Non, ne protestez pas. Souvenez-vous des paroles du Christ : « Si vous étiez aveugle, vous n’auriez point de péché. » Mais à présent, j’y vois… Quand j’ai vu Jacques, j’ai compris soudain que ce n’était pas vous que j’aimais, c’était lui.
Ecrit sous la forme du journal intime du pasteur, ce roman reste encore d’actualité malgré des tournures et des sentiments qui ne s’exprimeraient plus ainsi. A travers cette histoire, l’auteur peint les souvenirs de son enfance et dénonce, thème favori, une certaine hypocrisie religieuse. Il nous livre également un message : les aveugles ne sont pas toujours ceux que l’on croit. Au-delà de la morale de l’histoire, ce livre enchante par son atmosphère délicate et sa poésie. La fin malgré tout laisse une impression de tragique difficilement supportable après la beauté des premières pages.
Au-delà de l’histoire et de l’analyse psychologique qui l’accompagne, reconnaissons que le style d’André Gide contribue à faire de ce roman un livre exceptionnel. « On peut dire que le récit de La Symphonie Pastorale s’organise selon une structure complexe. Le style de cette œuvre est épuré, ciselé, raffiné et précis. La composition de La Symphonie Pastorale est plutôt unie, largement progressive, bien qu’on puisse constater une série de parallélismes entre les événements et leurs effets moraux. Les mots sont choisis avec soin par son auteur. Ce qui attire l’attention du lecteur c’est la densité du texte malgré sa brièveté, la pudeur des sentiments malgré leur intensité » (Marc Dambre, La symphonie pastorale d’André Gide, Paris, Gallimard, 1991).
Oui, cela peut sembler désuet de parler de romans qui datent de bientôt un siècle, mais la beauté est intemporelle. Les sentiments restent les mêmes depuis que les tragédies grecques ont tenté de les disséquer. Ils ne font que s'exprimer différemment. Le langage de Gide est magnifique, mais très probablement plus personne n'oserait écrire une histoire semblable.
06:56 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, psychologie, écriture |  Imprimer
Imprimer











