31/03/2016
Vues multiples sur le monde
Et le monde est Un et multiple.
On y passe en dansant, sans jamais le comprendre!
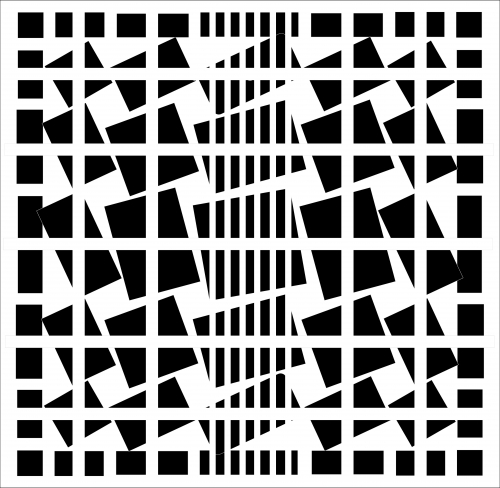
07:32 Publié dans 22. Créations numériques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art cinétique, optique art, dessin, peinture |  Imprimer
Imprimer
30/03/2016
Féminité
Je suis la femme fidèle et bienveillante
Les enfants m’entourent de leurs bras
Les hommes me serrent contre leur torse
L’oiseau vient picorer dans ma main
L’écureuil saute mon épaule et va
J’aime contempler l’innocence du monde
Éprouver la bruine sur mes paupières
Baigner mon corps à la fontaine
Réchauffer celui qui m’a donné sa vie
Et border les petits dans leur lit
Et quand vient l’heure de la mort
Je couvre de mon ombre leur souvenir
Et rend l’hommage affectueux et sincère
A ceux qui attendent pour partir
Qu’un baiser recueille leur dernier souffle
Oui, je suis la femme fidèle et affable
Je suis la caresse avenante et ferme
Je parcours l’univers éperdu et cruel
Et lui donne son attente persistante :
L’amour inépuisable de la féminité !
© Loup Francart
07:43 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, littérature |  Imprimer
Imprimer
29/03/2016
Liberté
Il partit un jour, droit devant. Nul ne pouvait l’en empêcher, même pas le seigneur du lieu. Il emportait un mouchoir qu’il avait noué sur un bâton. Il contenait ses trésors : une pipe, un paquet de tabac, un briquet, ses papiers, un livre, un seul. Il marchait vers l’ouest, vers cette mer dont il avait entendu parler. Il ne l’avait jamais vu : un ruban argenté qui bleuissait vers l’horizon. Certains s’y étaient noyés de curiosité. Ils avaient marché jusqu’à l’eau, puis avaient continué, sans se réveiller.
En marchant, il se souvenait. Ils étaient deux, lui et l’autre. Qui était-il ? Il ne sait. Ils s’étaient rencontrés un soir, marchant côte à côte dans une montée. Ils s’étaient échangé une cigarette, avaient parlé, s’étaient apprécié pour leur aptitude au silence. Ils ne s’étaient échangés que trois mots et il ne savait plus lesquels. Mais peu importe, ils marchaient côte à côte et cet effort commun les avait rapproché. Ils avaient dormi sur le bord du chemin, serrés l’un contre l’autre. La nuit est froide en altitude. Ils étaient repartis le lendemain et ne s’étaient plus quittés.
Le troisième jour, ils étaient proches du col. La liberté de l’autre côté. Ils avaient observé les mouvements des patrouilles. Une toutes les deux heures. Cela leur laissait le temps de passer. Ils avaient tenté leur chance, avaient coupé les barbelés, s’était engagé au-delà, dans cette campagne perdue qui leur offrait sa virginité. Un coup de feu ! Un seul. Le compagnon s’était écroulé. Mort sur le coup. Un regard terne, un sourire aux lèvres, le V de la victoire au bout des doigts. Il avait récupéré ses papiers et une lettre que l’homme portait sur lui. Il avait repris sa route, très vite, sans se retourner, après avoir glissé la lettre dans son mouchoir. Il s’était caché dans les fourrés, avait franchi la frontière par une vallée étroite et s’était retrouvé libre, mais seul.
Alors il avait ouvert la lettre. Elle était couverte d’une écriture étroite, les lettres entassées les unes sur les autres au point de se confondre. Le geste était délié, arrondi, poétique. Il finit par pouvoir lire :
Je te suis depuis des jours
Ta silhouette, mon guide
Me devance au carrefour
Et me fait apatride
Rien d’autre. Mais cela avait suffi à le motiver. Il avait marché des semaines, rompu avec la société, ne tendant que vers son but, l’océan. Il ne l’avait pas atteint. C’était son destin.
La liberté, c’est ne rien avoir pour être pleinement.
La liberté peut-elle se vivre seule ?
07:53 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie |  Imprimer
Imprimer
28/03/2016
La fin de l'histoire (28)
Il put passer la première nuit avec eux. Ils l’installèrent dans une pièce qui tenait lieu de dortoir. Trois d’entre eux restèrent avec lui et commencèrent à se déshabiller sans aucune gêne. Ils enfilèrent des sortes de pyjamas, déballèrent des matelas qui étaient dans un coin roulés en boule et se couchèrent dessus sans un mot. Ils s’endormirent vite, le laissant seul avec ses interrogations.
Que faire ? se demanda-t-il. Mon chemin se trouve entre deux attitudes : la passivité imposée par l’avertisseur ou une liberté non conquise qui ne mène à rien. Entre les deux, il n’avait connu que sa propre voie qui le laissait insuffisamment expérimenté et celles de Charles et Magrit qui s’étaient fait prendre par la dP. Y a-t-il des hommes réellement libérés ? Et même s’il en trouvait, l’aiderait-il à parfaire sa libération ? Ne risquait-il pas de se trouver lui-même prisonnier d’un maître qui le contraindrait à pratiquer des voies auxquelles il n’adhérerait pas. Oui, il tenait à sa propre liberté, une liberté consciente et non une soumission à un gouvernement, un maître qui lui impose ses pensées et actions.
Il se souvint avoir lu dans le livre que lui avait donné Charles qu’il existait trois sortes d’hommes qui sont en recherche de la liberté réelle : le fakir, le moine et le yogi. Le fakir travaille sur son corps physique et s’impose bien des épreuves pour se libérer de cet esclavage au corps. Il peut se tenir debout, sans un mouvement, pendant des jours entiers sous le vent, la pluie, la neige ou le soleil ardant. Il peut finir par dompter son corps, mais ses émotions et ses pensées restent non développées. Il a conquis la volonté, mais il ne possède rien à quoi il puisse l’appliquer. Le moine travaille sur ses sentiments. Il soumet toutes ses émotions à une seule émotion, la foi. Il développe en lui-même l’unité, mais une unité qui éteint son corps physique et sa raison. Enfin, le yogi travaille, lui, sur son intellect. Il sait, mais ne peut tirer parti de sa victoire sur lui-même. Cette vision des choses lui avait paru enfantine malgré ses apparences méthodologiques. Il était évident que le fakir devait obligatoirement maîtriser ses émotions et son intellect s’il voulait arriver à la maîtrise du corps, que le moine ne pouvait atteindre la spiritualité sans un certaine maîtrise du corps et de la raison et que le yogi ne peut devenir son propre maître que par, au moins au début, imitation d’un véritable maître.
Le livre donnait alors la possibilité d’une quatrième voie qui ne peut être enseignée. Elle doit être trouvée et cet effort pour trouver est le premier test sur la voie de la libération. Cette voie n’exige pas le renoncement. Au contraire, les conditions de vie habituelles où il se trouve placé sont les meilleurs, car elles sont naturelles. La voie n’est pas liée à des exercices, la maîtrise des émotions ou le savoir, mais à la compréhension par l’expérience, par l’accumulation d’échecs, de petites victoires et de franchissement de barrières difficilement identifiables, mais réelles. Le livre appelait cette voie celle de l’homme rusé. Il dépasse la recherche sur les différents Je qui constituent son moi. Il s’élève vers un soi qui dépasse son corps, ses émotions et son intellect, ou plutôt qui en fait la synthèse et sait les faire fonctionner ensemble. Mais comment conduire les rares personnes ayant un besoin de liberté suffisamment fort à une telle unité. Il voyait bien que tout arrive en l’homme, qu’il n’était pas maître de lui-même et que cette maîtrise demande un long apprentissage hors des sentiers battus, dans lequel les circonstances extérieures jouent un rôle important. Lui-même en serait-il là s’il n’avait pas eu les contraintes qui se sont révélées à lui. Attention, se dit-il, ne pas te considérer différent ! Oui, entre en toi-même, ne te laisse pas prendre au jeu des comparaisons ! Là-dessus, il s’endormit profondément.
07:14 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, société, individu, liberté |  Imprimer
Imprimer
27/03/2016
Pâques 2016
La vie ? Des flashs de bonheur dont les images éparses n’ont pas de cohérence thématique. Le bonheur n’a pas d’homogénéité. Il est, dans sa force, sa soudaineté et sa fuite. Il est l’instant pur, le moment où le ciel se confond avec la vie. Chacun d’entre nous vivons quelques instants magiques où le cœur se dilate et s’emplit d’une profondeur que nous n’avions jamais soupçonnée. Alors la lumière intérieure s’accroît. Une étrange envie de crier, de chanter, de danser prend le corps et l’âme. Il n’y a plus d’idées. Absence d’idées. L’idée n’est pas la chose. L’idée n’est pas bonheur.
Quel est le plus grand bonheur ? Je crois que c’est réaliser ses aspirations les plus profondes. C’est un bonheur à construire, difficile à assumer, car le monde s’obstine à vous faire dévier de cette vocation qui est une lumière dans les jours. Quel bonheur de vivre l’instant présent dans la campagne, marchant dans cette terre chaude, odorante, fumante des jours de printemps. Oui, la nature comble le vide de l’âme par sa présence sensuelle. Le bonheur est dans cette rencontre de l’âme et du corps, de l’aspiration et de la sensation, de l’idée de l’amour et de l’amour lui-même. L’amour est cette transformation mystérieuse, inexplicable, de notre vision du monde. La pesanteur des jours devient apesanteur des instants. Alors, le bonheur, intemporel ! Chacun de ces instants ne constitue pas le temps. Ce sont des trous dans le temps, des îles sur les flots de notre histoire personnelle, le passage au-delà du miroir de nos opinions.
Et chaque jour ces instants sublimes de bonheur nous donnent une idée de la résurrection : un trou d’air qui s’éternise !
07:40 Publié dans 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pâques, résurrection, vie, mort, éternité, instant |  Imprimer
Imprimer
26/03/2016
Demain
La ville se prélassait derrière la vitre :
Des tours, des barres, des hublots,
Des immeubles, des maisons, des taudis ;
Tout cela devant le moutonnement des nuages,
L’épaisse couche de ouate salie.
Elle le regardait, redevenue enfant,
Le visage détendu, le regard lavé,
L’inquiétude se lisait dans ses yeux
Mais le cœur restait calme et léger.
Elle mit son front dans le creux de l’épaule
Elle hoqueta une fois, doucement,
Pleine de sa sérénité royale,
Donnant le change, bonne comédienne,
Enfant jouant les adultes,
La tendresse au bout des doigts,
La pesanteur de son corps
Remplaçant sa liberté apprise.
Elle lui tendit ses lèvres, chaudes,
Ruisselantes de bonheur promis,
Lui caressa la joue, l’enveloppant
De fragrances pénétrantes.
Son souffle... comme un vent d’air frais
Sur la plaine ouverte devant eux.
Ils joignirent leurs aspirations,
S’enivrèrent l’un de l’autre,
Mêlant la source de leur être
Et se réfugièrent, enlacés
Là où plus rien n’existe,
Que la vie, indéfectible.
Demain sera un jour nouveau !
© Loup Francart
07:52 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer
Imprimer
25/03/2016
L'arrivée de l'anneau de Jeanne d'Arc au Puy du Fou
Un hommage à Jeanne d'Arc qui fait du bien :
07:13 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, patrie, société |  Imprimer
Imprimer
24/03/2016
Fausse perspective 2
Les rues s’enchevêtraient
Un plan de ville en contradiction
Rien ne se trouvait à sa place
Portes au dernier étage
Fenêtres ouvrant sur la lueur
Des perspectives brisées
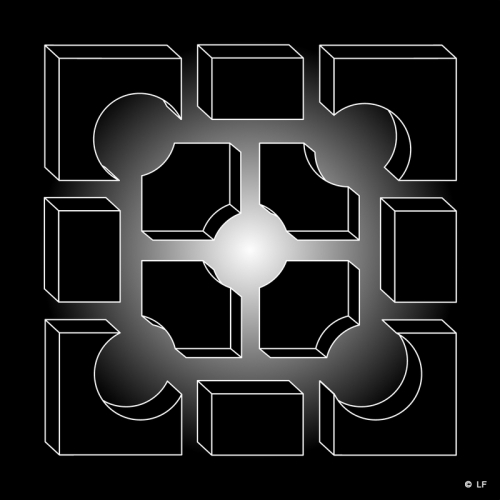
Il a vu l’envers du décor
Cette zone incertaine
Où le cœur chavire
La raison s’efface
Les impressions basculent
Pourtant, quel sage équilibre :
De quel côté se situe-t-il ?
07:34 Publié dans 22. Créations numériques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : optique art, dessin, art cinétique, perspective, illusion |  Imprimer
Imprimer
23/03/2016
La fin de l'histoire (27)
Il n’eut cependant guère le temps de disserter intérieurement de ces points, étant interrogé par de nombreuses personnes, curieuses et entreprenantes.
– D’où venez-vous ?
– Que vous est-il arrivé ?
– Comment avez-vous fait pour que votre indicateur ne s’allume pas ?
Tous posaient ces questions légitimes d’une voix inquiète, tendue, comme si son avenir en dépendait. Nicéophore s’inquiéta : qu’ont-ils tous à m’interroger ainsi ? Soudain, il comprit. Aucun d’entre eux n’était réellement libre. Ils avaient naturellement été rendus libres puisqu’on leur avait arraché leur indicateur. Mais la liberté ne se décrète pas, on ne peut l’imposer. Elle demande un effort personnel, une longue quête qui conduit à une libération progressive. Ces gens étaient perdus. Ils n’avaient pas vécu l’apprentissage de la liberté. Comme des enfants, ils ne savaient que faire et se réfugiaient dans un monde caché où les initiatives étaient limitées. Que faire ? Y avait-il quelqu’un qui pouvait penser en toute conscience ? Il fallait qu’il en eût le cœur net :
– Attendez, s’il vous plaît. Je ne peux répondre à tous en même temps. Avez-vous un chef, quelqu’une qui dirige votre groupe ?
Une femme répondit :
– Non, bien sûr. Nous sommes libres. Nous n’avons pas besoin d’un chef. La liberté nous tient lieu de règle et rien d’autre n’est nécessaire.
Il se laissa entraîner dans une salle basse, aménagée avec des tables et des chaises installées en rond. Ils s’installèrent et me placèrent de telle sorte que tous pouvaient me voir. Un homme se fit l’interprète :
– C’est la première fois que nous voyons quelqu’un qui est encore en possession de son avertisseur et qui, malgré tout, est libre. Comment avez-vous fait ?
Nicéphore raconta sa délivrance progressive, ses doutes, ses efforts, ses échecs, la nécessité de poursuivre sans cesse les exercices qui lui permettaient d’atteindre cette liberté qu’il désirait par-dessus tout. Les « sous-terrains » (c’est ainsi que sont appelés ceux qui se réfugient sous la ville) le regardaient comme une espèce de surhomme, allant jusqu’à le toucher pour s’assurer de sa réalité. Il éprouva deux sentiments contradictoires face à leurs réactions. C’étaient des enfants, avec une conscience à fleur de peau. Ils n’agissaient pas et ne pouvaient que réagir. Comment cependant en étaient-ils arrivés à saisir que la méditation quotidienne qu’ils pratiquaient était ce qui leur permettait de maintenir une certaine liberté malgré tout ? Il ne le comprenait pas. Il éprouvait dans le même temps une certaine tendresse vis-à-vis d’eux. Leur gentillesse le frappait. Bien qu’ils soient désordonnés, sans objectifs, sans même un mode de vie consciemment conçu, ils n’avaient aucun malentendu, brouille ou même jalousie entre eux. Ils étaient de bons camarades, voire même, entre certains hommes et femmes, de bons couples. Et la société semblait exister d’elle-même, sans qu’il soit nécessaire de disposer de règles.
07:08 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, foule, danse, folie collective |  Imprimer
Imprimer
22/03/2016
Noyade
Ouvre tes mains
Laisse-toi pénétrer de lumière
Lâche ta tension pesante
Cesse tes plaintes
Souris à la fourmi sur le gravier
Observe le plongeon de l’oiseau
Vers le moucheron suspendu
Écoute le bruit d’ailes
Des abeilles bourdonnantes
Vide ton cœur de ses trésors
Remplace-les par la résonance
Tremble devant l’inertie
Des hommes qui n’agissent pas
La parole est leur action
Elle est improductive
Sans odeur ni saveur
Elle harangue sans effet
Ils sont gonflés de mots
De verbes inoffensifs
De hurlements sauvages
Qui se retournent contre eux
Ils sont dans l’immédiat
Alors que l’expression
N’est que de longue portée
Claque les doigts
Marche avec tes pieds
Courent sur tes jambes
Foncent vers l’espoir
De tes remuements
Ne dis rien
Laisse-les parler
Remuer leurs lèvres desséchées
Garde ton cœur vierge
Sans une larme, sans un regard
Avance sur la scène de la vie
Ne regarde pas en arrière
Noie-toi dans l’absolu
Et prend ta jumelle
Pour contempler les mouches
Sur l’orange malmenée…
© Loup Francart
07:03 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, littérature |  Imprimer
Imprimer
21/03/2016
Rêve
Ils sont là, face à face...
Ils se regardent...
Qu'éprouvent-ils ?

Oui,
C'est la rencontre du réel et du virtuel...
07:27 Publié dans 12. Trouvailles diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : réalité, virtualité, impression, sentiments |  Imprimer
Imprimer
20/03/2016
La fin de l'histoire (26)
Enfin, un gong retentit, assez léger, laissant une vibration prolongée dans l’air. Il entendit des frôlements, des mouvements, puis quelques pas et il ouvrit les yeux. Les participants à cette réunion avaient bien, tous, une sorte de trou au milieu du front. Ils s’étaient fait retirer l’indicateur. C’était comme une sorte de troisième œil. Cela leur donnait un air décalé, plus grand, plus aérien. Ils semblaient flotter, emplis de majesté. Cependant, en interrogeant ceux-ci, il comprit vite que ce n’était pas le cas. Tout d’abord, ils n’avaient aucune prétention de mysticisme ou même de sagesse. On remarquait également qu’ils avaient peur, malgré tout. Enfin, ils ne cherchaient nullement à se comparer les uns aux autres. Il sembla à Nicéphore que le maître mot de cette communauté était la liberté. L’égalité leur importait peu puisque l’essentiel était de rester libre, chacun individuellement. De même leur conception de la fraternité n’avait rien à voir avec l’idée qu’il suffisait de prendre aux riches pour donner aux pauvres pour établir une fraternité. Celle-ci leur semblait tellement factice. Seule la clarté de la liberté leur suffisait, sans autre modèle à pourvoir.
Nicéphore prit conscience de la dualité existant entre la liberté et l’égalité. Les mots semblaient aller de pair et faisaient noblement, avec le troisième, une trilogie vaillante et sans défaut. Mais en y regardant de près, il se rendait compte d’une impossibilité d’existence entre les deux premiers. L’égalité est inconciliable avec la liberté. À vouloir une égalité à tout prix, en l’imposant de par la loi et un consensus politiquement correct, la liberté n’existe plus. C’est le cas de notre société, se dit-il. Ainsi la belle promesse républicaine à laquelle les gens de la surface tenaient tant, n’était que la malédiction d’une idéologie bien-pensante et endormante. La parole remplaçait l’action, les décisions étaient longues à venir et souvent changeaient entre le moment de leur conception et celui de leur mise à exécution. Ici, en ce lieu sous-terrain, il lui sembla que les choses se passaient différemment. Il n’était pas en mesure de juger de la manière de prendre les décisions. Mais le calme et l’acuité des réflexions promettaient sans nul doute un meilleur équilibre et surtout une plus grande liberté dans la société.
07:40 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer
Imprimer
19/03/2016
Etonnement
S’étonner, c’est toujours détonner
Tout dépend, bien sûr, du ton donné
Cela conduit à une franche adhésion
Ou peut provoquer une âcre division
Mais d’où naît cet éclair sagace ?
Pour certains c’est un trou noir fugace
Pour d’autres, un soleil jaillissant
Une explosion dans un silence angoissant
Et cet éblouissement soudain
Utilisé par d’inhabituels aigrefins
Devient un déclic judicieux
Il crée soudain un état d’objectivité
Fait naître l’étincelle de la créativité
Et ouvre un passage, sublime et malicieux
© Loup Francart
07:27 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer
Imprimer
18/03/2016
Folie
A porto, les Portugais sont gais. Ils allument des bougies dans leur tête, sourient au cosmos et partent nus vers les champs de fleurs. Ils s’enivrent de leurs odeurs sacrées, se roulant dans le foin, embrassant qui ils veulent. Les plus habiles à ce jeu sont les Portugaises. Elles courent de l’un à l’autre, leur minois épanoui, la bouche ouverte sur leurs dents acérées et empoignent les garçons comme des sacs de ciment.
Dans la journée, rien n’apparaît de ces ripailles insolites. Elles travaillent à la maison, entretiennent leur chez elle, jettent un œil à la rue, mais jamais ne sortent sur la chaussée et dansent le Fandango. Au crépuscule, les Portugaises deviennent des loups. Leurs yeux brillent dans l'obscurité et les lucioles courent vers la plage. Elles retirent leurs chaussures, ne gardent que leur chemisier et une jupe légère, puis, doucement, commencent à tourner en rond, les bras levés. C’est une offrande lente à l’obscurité qui tombe. Elles contournent les jeunes hommes d’un pied léger, le regard conquérant, la chevelure en désordre, et se couvrent d’une mince rosée de transpiration qui naît d’elle-même une fois arrivées sur la plage. Leurs aisselles dégagent de lourdes senteurs, leurs jambes s’agitent peu à peu. L’une d’elles se met à chanter d’une voix de basse, doucement, tendrement, comme l’appel d’un moineau sur la gouttière. Elles se regardent, se sourient et se rassemblent sans bruit, sans ordre, instinctivement, comme mues par un ressort interne.
L’une d’elles, la plus hardie, lève les bras et les autres de même. Elle tourne sur elle-même, et les autres de même. Elle esquisse un pas de danse, et les autres de même. La chanteuse chante alors d’une voix claire, elle conte les nuits écrasantes de chaleur, les draps qui collent aux jambes, la gorge sèche, le désir ensevelie dans la chambre et la lune qui, au dehors, leur échauffe le corps. Soudain, la danse commence, d’un seul mouvement, en parfaite harmonie. Elles tournent sur elles-mêmes et répètent les mêmes pas de danse en un piétinement endiablé qui les rend roses d’excitation. La bouche ouverte, le visage exalté, la chevelure en désordre, elles se mettent à chanter ensemble, d’une seule voix grave, emplie d’élans incontrôlés, le regard perdu, les mains tendues vers l’unique. Mais il n’est pas là.
Elles se tournent alors vers la mer, vers la vague qui vient caresser leurs pieds. Cela les rafraîchit, elles accélèrent le rythme, tapant dans leurs mains, frappant du pied, poussant de petites exclamations rauques. La mousse blanche de l’eau s’agite, les couvre de pellicules foncés, puis alourdit leurs jupes qui se collent aux cuisses et mettent en valeur leur déhanchement. D’un seul geste simultané, elles en dégrafent la taille et laissent tomber le morceau de tissu qui baigne dans l’écume et s’éloigne vers le large. La danse devient folie, elles piétinent sur place, prises de tremblements saccadés, certaines commencent à hurler dans leur chant à la terre féconde, d’autres pleurent tendrement, sans un cri, les yeux baignés d’eau de mer. Elles s'enfoncent dans le miroir brillant jusqu’à la taille, mais leur souplesse et leur jeunesse les rend agiles. Elles se sourient, se prennent la main, se serrent entre elles à certains moments, puis s’écartent brusquement, progressant plus avant vers l'océan qui s’ouvre joyeusement, leur préparant une place privilégiée. L’excitation est à son comble, elles ne se rendent compte de rien, toutes à leur affaire. L’eau atteint le menton, elles boivent de grandes gorgées de mer, hoquetant, agitant les bras.
Et bientôt on ne voit plus que ces mains qui s’agitent hors de la surface, puis disparaissent dans l’écume. Encore quelques instants de mousse blanchâtre, puis plus rien. La nuit est là.
Les garçons rentrent chez eux sans un mot. Cette nuit, ils rêveront de ces silhouettes dansant sous la lune et se donnant à l’océan, nues de plaisir anticipé.
07:06 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, foule, danse, folie collective |  Imprimer
Imprimer
17/03/2016
Onde de choc (pictoème)
Un bris de glace…
L’éparpillement du verre…
L’effroi des indolents…
Le cri d’une femme…
Les regards d’effarement…
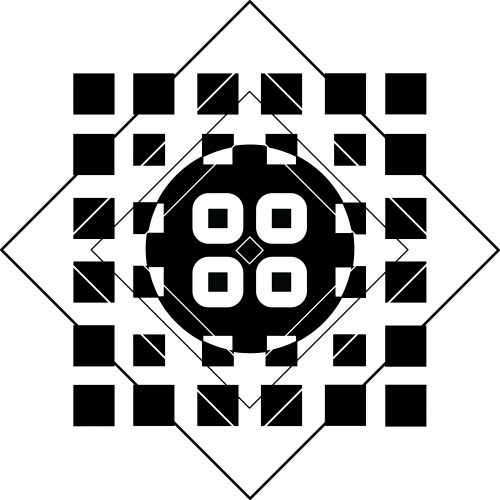
Trois gamins qui rient
Et cherchent leur ballon
Sur le pavage noir et blanc !
07:36 Publié dans 22. Créations numériques, 31. Pictoème | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dessin, art cinétique, op'art, émotion |  Imprimer
Imprimer
16/03/2016
La fin de l'histoire (25)
Deux jours plus tard, les sans-abris lui parlèrent de gens qui habitaient sous la ville.
– Ils sont un peu fêlés, dit l’un d’eux. Ils ne se montrent pas au-dehors. Ils vivent toute l’année dans les boyaux des lignes de métro abandonnées et restent là sans rien faire, assis, les yeux fermés, sans bouger. Ils semblent heureux et même intelligents.
– Sont-ils nombreux ?
– Non, pas tellement, une trentaine, des hommes, mais aussi des femmes. Ils s’entendent bien, mais restent très indépendants les uns des autres. Ils ont tous une cicatrice au milieu du front, très visible. Une sorte de trou…
Nicéphore enregistra cette information qui lui parut être intéressante. Ainsi il y avait des gens qui vivaient hors de tout contrôle social, apparemment. Il semblait même ne plus porter d’indicateur. Peut-être les avaient-ils arrachés ? Il lui fallait trouver là où ils vivaient.
Le lendemain, il demanda à ces deux nouveaux amis de le conduire aux gens dont ils avaient parlé hier. L’un d’eux s’écria que jamais il ne dévoilerait cette cachette et que d’ailleurs il était incapable de retrouver le chemin qui y conduisait. Le second ne dit rien, mais, un peu plus tard, prit Nicéphore à part et lui dit qu’il lui montrerait les galeries où ils sont réfugiés.
Dans l’après-midi, il vint le trouver, lui dit de prendre son bagage et l’entraîna derrière lui. Ils marchèrent longuement, tantôt horizontalement, tantôt presque verticalement : escaliers, couloirs, portes, sans jamais rencontrer personne. Son compagnon ne disait rien. Il semblait savoir où aller, mais en était-il sûr ? Le silence était total. Aucun bruit de la ville ne leur parvenait. Parfois, on entendait l’écoulement des eaux dans les tuyaux ; d’autres fois, c’était le grincement d’une porte rouillée ou le piétinement des rats dans les couloirs. Seule, la lampe électrique que tenait son accompagnateur maintenait une illusion de vivant. Nicéphore était perdu. Il ne savait plus s’il se trouvait loin de la surface, loin du lieu d’où ils étaient partis. Enfin… Une dernière porte, puis la lumière. Ils étaient aveuglés. Elle était chaude, dorée et semblait diffuser le contentement, voire caresser le visage d’un souffle apaisant. Ils s’arrêtèrent, écoutant le silence qui avait mis de la tendresse dans son écho. Derrière une autre porte, ils devinaient des chants, doux comme le beurre sur une biscotte qui craque. Nicéphore eut envie de fuir. Quels étaient ces fous ? se demanda-t-il.
Ils entrèrent. La pièce était sombre, à peine éclairée par quelques bougies. Des hommes et des femmes étaient assis le long des murs, immobiles, silencieux, les yeux clos, en méditation. Ils n’étaient tournés vers rien, se faisaient face, et semblaient être concentrés sur le milieu de la salle. Mais celle-ci était vide. Quelle étrange réunion, se dit-il. Son accompagnateur avait disparu. Il était là, debout, hésitant, le cœur battant. Un des hommes lui fit signe de s’assoir à côté de lui. Il prit un coussin, s’assit en tailleur, redressa sa colonne, joignit les mains et ferma les yeux. Il se sentait bien. La surprise lui avait permis de faire le vide en lui-même. Aussi retrouva-t-il sans difficulté ce qu’il avait découvert dans le désert près de Tombouctou. Peu à peu, cette paix individuelle qu’il éprouvait rejoignit celle des autres. Il eut le sentiment qu’il entrait dans une nouvelle ère, plus électrique, plus chargé de minuscules vibrations qui entretenaient une sorte de courant entre eux. C’était imperceptible, mais néanmoins palpable. Ses poils se hérissaient et semblaient flotter dans l’air. Il se sentit léger, délivré même du souci de maintenir son indicateur éteint. Plusieurs fois, il faillit s’endormir, sa tête tomba sur sa poitrine, le contraignant à une attention soutenue.
07:53 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, société, individu, liberté |  Imprimer
Imprimer
15/03/2016
Nocturne
Le pied léger, elle courait dans la rue
Ce n’est pas qu’elle était pressée, non
Juste une envie de se défouler
Et d’exhiber ce corps, menu et flexible
Il était neuf heures, la nuit tombait
Les passants fuyaient le vent aigre
Le nez enfoui dans un foulard
Les mains de glace dans la poche
Ils virent passer l’orage. Nue
Elle courait sans contradicteurs
Peu pressée d’en finir, y prenant plaisir
Elle souriait aux étoiles qui ouvraient
Leurs froides et célestes rondeurs
Cours, cours, la belle, il le faut
Voici celui qui vient, l’enjôleur
Souple et ferme, il divague
Entre les pavés, il te remarque
La flèche blanche sur les portes
Les fils d’argent flottant au vent
Il est pris dans le filet pervers
Et se dresse derrière elle
Tendu comme un aimant
Ils courent ensemble sans savoir
Qui suit qui, qui est qui
Ce n’est plus qu’un seul corps
Qui se rejoint pour exister
Leurs ombres s’ajustent
Leurs regards se dédoublent
L’effort les revêt de rosées
Le souffle s’accélère
Soudain il aboie, une fois…
Il s’approche et lèche
Le poil hérissé. Tremblante
Elle se tourne vers lui
Et s’offre en pleine rue
Aux yeux des passants
Qui assistent, impuissants
A la danse de l’amour
© Loup Francart
07:20 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, littérature |  Imprimer
Imprimer
14/03/2016
Impossible
Avait-il oublié quelque chose à l'intérieur ?

Il est à l'intérieur et ne peut plus sortir :

07:33 Publié dans 12. Trouvailles diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : curiosité, image, déjanté |  Imprimer
Imprimer
13/03/2016
La fin de l'histoire (24)
Commença alors une vie errante, d’hôtels en chambres louées à des particuliers, avec de longues journées dehors, en guettant le soir avant d’oser entrer dans un refuge incertain. Ce n’est pas que cela lui faisait peur, mais il n’avait pas la tranquillité d’esprit nécessaire pour investiguer franchement et tenter de savoir ce qu’il était advenu de Magrit et Charles. Toujours sur ses gardes, il devait continuer à être libre pour transmettre ce qu’il avait appris au cours de ces quelques mois. Une question le tracassait cependant : était-il dorénavant seul ou y avait-il d’autres personnes qui, comme lui, cherchaient une libération ? Il comprit qu’il ne pourrait trouver une réponse tant qu’il serait soumis à cette vie errante, mais il ne voyait pas où il pourrait aller pour poursuivre ses découvertes, sauf à nouveau à Tombouctou. Mais il faut prendre l’avion, donc disposer de papiers d’identité qui ne soient pas à son nom. Continuer comme aujourd’hui revenait à se faire prendre un jour ou l’autre parce que son avertisseur s’allumerait sans qu’il puisse le contrôler. Il se sentait néanmoins investi d’une mission particulière. Laquelle ? Il ne savait pas trop. Il s’efforçait de la préciser sans trouver réellement une réponse. Il passait plus de temps en méditation, se créant une véritable chambre intérieure dans laquelle il se détachait des influences du monde et qui lui donnait la force d’empêcher l’indicateur de s’éclairer. Cette chambre était vide. Il n’y trouvait rien. Mais ce rien lui permettait justement de ne plus être atteint par l’extérieur. Il concentrait toute son attention à ce qui se passait en lui tout en oubliant son Moi social. Il cultivait le calme. Il s’efforçait de paraître semblable aux autres : paraître seulement et non pas être. Il s’interrogeait sur sa vocation véritable, sur le but de sa vie. Il prit conscience de ses erreurs d’objectifs : toujours courir après un leurre, que celui-ci soit professionnel, social, culturel, familial ou autre. Les aléas de la vie ne devaient pas le guider vers un futur quelconque. Seul le but qu’il arrivera à se fixer lui permettra de poursuivre sa destinée. Il était, dans le même temps, bien conscient que cette vision n’était que temporaire et dépendait du temps et de l’intensité qu’il consacrait à sa méditation. Selon les moments de la journée et les influences subies, il s’écartait plus ou moins de son objectif de trouver la « liberté intérieure ». Cette expression lui était venue un jour où, fuyant un hôtel dont le propriétaire devenait soupçonneux, il comprit cette cassure existant entre la notion de liberté dans la vie quotidienne et une véritable liberté intérieure, faite non pas de satisfaction de ce que l’on veut, mais d’absence de volonté d’obtenir quelque chose. « Liberté intérieure » : un trou d’air dans sa vie difficile, une aspiration qui l’enchantait et le poussait à agir selon celle-ci, à l'écart des habitudes sociales.
Il s’était réfugié sous un pont en raison d’une pluie incessante et y avait trouvé deux clochards (oui, les sans-abris existaient encore, par vocation plutôt que par obligation). Ils avaient bu, sans plus, divaguaient quelque peu et s’étaient moqués de lui. Il n’en ressentait aucune gêne. Il avait même parlé avec eux, calmement, les considérant comme des congénères qui n’ont pas encore découvert cet espace que chacun possède en soi pour se sentir en harmonie avec le monde. Il n’y avait pas création d’une distance entre lui et eux, pas non plus la conscience d’être autre. C’était une aspiration intérieure qui le guidait, un mince souffle qui lui faisait comprendre l’incroyable destinée commune qu’ils possédaient, eux et lui, et qui le poussait à les comprendre et les aider. Sensation étrange, comme l’habitation d’un souffle qui passait au travers de son corps et l’entraînait à une attention soutenue pour s’oublier lui-même.
07:41 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, société, individu, liberté |  Imprimer
Imprimer
12/03/2016
Le soleil dans toute sa splendeur
https://www.youtube.com/watch?v=GSVv40M2aks
Mieux vaut se taire et admirer plutôt que d'expliquer ou de commenter.
Seul un poème peut traduire ce qu'on éprouve devant ce spectacle.
07:19 Publié dans 12. Trouvailles diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : création, astrophysique, imagerie, big-bang |  Imprimer
Imprimer
11/03/2016
Concert
Dans leur montée en intensité
Les sons pénètrent ton opacité
Transpercent l’apparence funeste
Et te conduisent au vide céleste
L’harmonie est fleuve, puis mer
Envahissant l’être et ses recoins amers
Emportant cœur et esprit en ballade
Te ceignant d’une aimable accolade
Viens à l’horizon, dit la mélodie
Viens danser sur la ligne hardie
Déploie tes ailes ankylosées
Et plane sans plus te reposer
Les sons huilés des violons
Enferment tes appréhensions
L’aigre discours de la clarinette
T’incline au repos dans la dunette
Le chant solitaire de la soprane
Te fait franchir la membrane
Qui contient ton être intérieur
Il te confie à l’auguste prieur
La porte est franchie sans peur
Vient l’intense moment de stupeur
Quand l’œil vacille et plonge
Dans les eaux translucides des songes
© Loup Francart
07:49 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer
Imprimer
10/03/2016
La mode féminine
La mode féminine se renouvelle sans cesse, et cela fait des années que cela dure. Qui eût cru, il y a un an, qu’il convenait maintenant de n’avoir ni jupe, ni robe, ni pantalon. Non, ne vous méprenez pas ! Elles ne vont pas nues et leurs vêtements restent décents.
La grande majorité s’est dotée d’une double peau, fine, noire bien entendu, dont elles se contentent pour se promener dans les rues de Paris. Elle porte, pour cacher le haut, une large ceinture en tissu. Ce n’est pas une jupe, elle est trop petite. Ce n’est pas non plus une robe car le haut est constitué d’un pull qui laisse le nombril découvert. Certes, à cette époque de l’année, elle porte au-dessus un manteau en doudoune, également noir. Cela leur permet de cacher l’essentiel. La rue est pleine de la réclame pour Dim : longues jambes effilées, montant si hautes qu’on les voit au ciel. Aux pieds, elles chaussent volontiers ces boots du Moyen-âge avec des talons qui ne montent pas aux cieux, mais presque. Parfois, le haut de la chaussure retombe mollement vers le sol en fleur épanouie, comme pour marquer un certain laisser-aller qui lui est toujours à la mode.
promener dans les rues de Paris. Elle porte, pour cacher le haut, une large ceinture en tissu. Ce n’est pas une jupe, elle est trop petite. Ce n’est pas non plus une robe car le haut est constitué d’un pull qui laisse le nombril découvert. Certes, à cette époque de l’année, elle porte au-dessus un manteau en doudoune, également noir. Cela leur permet de cacher l’essentiel. La rue est pleine de la réclame pour Dim : longues jambes effilées, montant si hautes qu’on les voit au ciel. Aux pieds, elles chaussent volontiers ces boots du Moyen-âge avec des talons qui ne montent pas aux cieux, mais presque. Parfois, le haut de la chaussure retombe mollement vers le sol en fleur épanouie, comme pour marquer un certain laisser-aller qui lui est toujours à la mode.
Avouons cependant que cette nouvelle mode a des contraintes. Comment s’assoir en restant décente ? Il convient de bien tenir serrés ses pinceaux, de décrire un arc de cercle avec les hanches en fléchissant légèrement, pour, si l’on calcule bien, se retrouver assise sur le siège convoité. Certaines doivent s’entraîner longuement avant d’exécuter cet exercice périlleux avec l’aisance nécessaire. Il est vrai que d’autres, une minorité, il faut le dire, se laissent tomber sur leur siège sans aucune élégance, tel un sac de pommes de terre. Elles ne disposent pas de pinceaux, mais de solides piliers qui ne se manient pas de la même manière. Là, on se dit qu’il ne s’agit pas de parisiennes, mais de fraiches migrantes de province.
Une minorité, sans doute peu avertie des changements de la mode, continue à enfiler, difficilement, un pantalon. Mais est-on sûr qu’il s’agit d’un pantalon. Il est tellement serré qu’il est difficile de distinguer la différence entre le collant et le pantalon. L’objectif reste le même : des jambes en or qui ne tiennent qu’à un fil. Le pantalon est bien sûr en grande majorité noir, parfois bleu américain, car un seul ustensile ne change pas malgré les évolutions de la mode : le Blue Jean, anciennement dit Lewis. Après les trous aux genoux ou même ailleurs, ceux-ci sont à nouveau entiers, mais si étroitement économes en tissu qu’elles se demandent si elles pourront y entrer. Elles doivent s’y prendre à trois fois pour enfiler ces chausses, et utiliser un tire-botte pour les retirer. Mais disposer d’échasses pour voir et, surtout, être vue est un privilège qui vaut bien quelques sacrifices.
Quelques fantaisistes, parce qu’elles sont suffisamment dénudées vers le haut, portent de longues bottes de cuir qui montent jusqu’aux genoux, voire plus au-dessus pour quelques rares exceptions. Dans ce cas, leurs collants sont clairs et non noirs. Elles introduisent un contraste voulu entre le buste rapetissé et les bottes de sept lieux, et mettent en évidence le dessin oblong des deux fuseaux qui relient l’ensemble.
Enfin – vous en rencontrez deux ou trois par jour – certaines se laissent admirer en braies, rayées comme il se doit. Malheureusement, ce genre d’attribut n’est pas, le plus souvent, porté par des personnes filiformes. On les voit donc dans une glace déformante qui maquille l’élégance naturelle de la parisienne. Oui, il existe des exceptions qui n’ont pas le galbe nécessaire et qui s’égarent dans Paris, malgré les avertissements de la presse : Paris, capitale de l’élégance.
06:44 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mode, féminité, parisienne, collant |  Imprimer
Imprimer
09/03/2016
La fin de l'histoire (23)
Il ressentit tout à coup la légère pression des liens entre lui-même et le monde. Il rattrapa une jeune fille et, instantanément, fut englobé dans ces pensées. Il ne vit qu’une moitié de joue et les cils de l’œil gauche, le tout entouré de cheveux foisonnants. Cette joue devint une sorte de miroir qui lui renvoyait son entendement aussi naturellement que si elle avait pris un téléphone pour lui parler. Il était en elle comme il était dans ses propres pensées une minute auparavant. Un saut d’un monde à l’autre, sans transition, le laissant aussi à l’aise dans l’un que dans l’autre. Cela ne dura pas longtemps, cinq ou dix secondes. Mais quelle précision ! Femme tout d’un coup, il était plongé dans une vision féminine du monde. Il voyait en femme une situation entrevue habituellement avec plus de distance et moins d’implication des sens. Là, le monde était plus rond, plus caressant, plus à fleur de peau également. C’était un monde plus concret, plus ancré dans les sensations et sentiments, moins distant et probablement plus vrai, parce que plus enraciné dans la réalité. Il touchait le monde et les fibres qui relient chaque être ou chaque chose avec un autre et jouais une autre symphonie, plus charnelle, plus tendre, moins rationnelle et plus vivante. Les femmes donnent naissance au monde alors que les hommes le décortiquent. Ils jouent aux cubes, inlassablement, édifiant et démolissant le monde, pendant que les femmes nagent dans leurs relations, pour y trouver l’harmonie qui les relie. Il comprit qu’une femme ancre sa place dans le monde en jouant de ces fibres qui unissent entre eux les êtres et les choses. Les hommes, eux, s’attachent plus à construire et reconstruire leur position dans le temps et l’espace pour atteindre un équilibre précaire que les nouvelles relations établies entre eux amènent à une nouvelle mobilité. Il ressentit l’importance de disposer des deux visions. Elles consacrent un accomplissement qui devient un commencement, une autre manière de percevoir l’univers, une unification des liens entre les deux aspects de la nature, la féminine et la masculine. Ce fut une sorte de mariage intérieure, la naissance d’une intense luminosité due à la jonction entre le tout et l’absence de moi. Enfin ! Il était, unique, au milieu de tous, parmi tous et tout, parce qu’il avait oublié ce moi encombrant, taraudé de questions sans réponses. Quelques instants plus tard – combien ? Il ne le savait – il eut l’impression de se réveiller. Il était dans un état d’exaltation passionnée, sous l’effet d’une tension intérieure impressionnante, mais tellement enrichissante. Progressivement il retrouva la ville, le passage des passants, le bruit des poubelles, le bourdonnement des voitures démarrant au feu rouge. Le monde reprenait sa place, redevenu éternel et indifférent. Mais en lui, désormais, le rire et les larmes se mêlaient, devenus un même état d’être, au-delà des sensations et des sentiments.
Le lendemain, il apprit par les médias l’arrestation de Magrit. Comment avaient-ils su ? La dP l’avait arrêtée à quatre heures du matin en pénétrant chez elle avec l’aide d’un bélier. Les premiers comptes rendus la désignaient comme une dangereuse idéologue, antisociale et néfaste à l’esprit républicain. Bien sûr, il n’était nullement indiqué où elle avait été transférée. Diable ! Cela se rapproche ! Que faire ? Dois-je rester dans mon appartement ou, au contraire, partir loin d’ici ? Il ne savait. En attendant de prendre une décision, il rassembla dans un petit sac quelques vêtements, deux livres, ses papiers d’identité, de l’argent. Il était prêt pour toute fuite ou même arrestation. D’abord prendre des forces, se dit-il. Il médita une heure, s’efforçant de retrouver les sensations de la nuit. Puis, il sortit, avec son sac. Bien lui en prit. À peine avait-il franchi le premier carrefour, qu’il entendit les avertisseurs des voitures de la dP. Lui aussi était donc recherché !
07:20 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, société, individu, liberté |  Imprimer
Imprimer
08/03/2016
Trompe l'oeil
Quelques trompe-l’œil :
Suspendu et introuvable !

Allez savoir où est le réel !

07:34 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : trompe-l'oeil, street art |  Imprimer
Imprimer
07/03/2016
Numériser
Je numérise
Tu numérises…
Quelle menue risée !
C'est un haïku !
Certes, il manque d'élégance
Est-il possible de s’esbaudir
D’un vilain jeu de mots
Prolongé en mauvais jeu de mains
Mais où en est-on ?
Le chameau a-t-il trois bosses
Ou le boss a-t-il un cerveau ?
Qui tire les vers à la ligne
Et quel poisson d’avril
Les rend rectiligne ?
C’est bien ainsi le délire !
© Loup Francart
07:01 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, comique |  Imprimer
Imprimer
06/03/2016
La fin de l'histoire (22)
Ainsi je ne suis pas seul, se dit-il. Magrit a également choisi. Mais je ne comprends pas comment elle fait. Prend-elle toujours la pilule ? Comment fait-elle pour lutter contre ses effets. Il faudra que je lui demande. Il rentra vite chez lui, sentant que son cerveau commençait à s’embrouiller et qu’il n’en était plus maître. Il rentra d’extrême justesse. À peine avait-il franchi sa porte que son indicateur s’alluma, le dénonçant automatiquement. Il ferma aussitôt les rideaux, craignant que cette lueur n’attire les regards. Il s’installa en posture de méditation et commença à entrer en lui-même, calmant les battements de son cœur et ses inquiétudes. Tentant de respirer consciemment, il découvrit une autre manière de faire silence en lui, particulièrement efficace lorsqu’il est en situation de stress. Il eut l’impression de respirer au-dedans de lui-même. Partant du ventre, sa respiration fit naître en lui un espace libre au-dessous de la gorge, comme un air de liberté inviolable qui grandissait en lui et allégeait ses difficultés. Très vite, il se sentit délivré, libre, aérien. Ce fut une exaltation sans fin, un trou dans le réel qui le faisait changer de monde. Il se détendit, laissant jouer ses muscles, ses tendons, tout en maintenant son corps droit. Il eut le sentiment d’être aspiré et de se nettoyer intérieurement. La frontière entre son personnage extérieur et sa réalité intérieure s’éclipsa ou, tout au moins, devint transparente. Il acquit une lucidité qu’il n’avait jamais connue jusqu’à présent. Il ouvrit les yeux, constata que son indicateur s’était éteint. Il s’endormit très vite et ne se réveilla que dans la matinée, en pleine forme. Il sortit courir dans la ville et eut l’impression de voler entre les immeubles. Il sentit son cœur devenir chaud et chaque passant lui sembla aimable et beau.
Quelle sensation extraordinaire ! se dit-il. Il courait et le monde s’ouvrait. Les liens se tissaient entre les immeubles, d’autres liens entre les gens qu’il croisait. Tous ces liens donnaient une étrange conformité au paysage, comme un revêtement de couleurs douces et huilées. Il écouta le martèlement de ses chaussures sur le sol goudronné. Il devenait de plus en plus léger et sentait son poids devenir plus faible, moins sensible. Sa légèreté intérieure se transmettait à sa perception extérieure. L’enveloppe de son corps s’amenuisait. Il ne sentait plus la différence entre cette présence extérieure des êtres et des objets et celle, intérieure, de son propre moi qui devenait inexistant. C’est cette absence de personnalité qui lui permettait de vivre ce moment unique, l’osmose de son être avec le monde. L’univers était en lui et il était l’univers.
07:18 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, société, individu, liberté |  Imprimer
Imprimer
05/03/2016
J.S. Bach Fugue in G minor BMW 578
http://www.youtube.com/watch?v=0kc81fkeN28&feature=re...
Une Magnifique interprétation du quartet de llevant de llevant.
La musique, c’est la vie avec Jean-Sébastien Bach.
Promenade un matin d’été, descente vers la rivière et plongeon dans l’eau fraîche…
07:40 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, baroque, bach, fugue |  Imprimer
Imprimer
04/03/2016
Fourmillement
Il est quatre heures, une heure normale pour se recoucher après deux heures d’écriture. Doucement, je me glisse dans le lit, soulevant légèrement la couette (eh oui, les Français se sont mis à la mode allemande, avec avantage !). J’installe mon corps dans la meilleure position possible, je ferme les yeux, laissant malheureusement mon imagination prendre la barre. Ce n’est pas grave, si j’arrive plus ou moins à l’orienter. Le vide s’installe peu à peu. Un picotement sournois me surprend. Un microbe, non un peu plus gros, se promène sur mon nez. Je ne le sens pratiquement pas, mais il s’incruste, tournant sur lui-même, l’air innocent. Ne pas bouger ! me suis-je dis en entrant dans le lit. Alors je tente, vainement, de ne pas sentir ce fourmillement. Mais il est tenace. Il se propage comme les ondes à la surface de l’eau. Non, ne bouge pas ! Mais finalement, je sors une main vengeresse et écrase cet animal ou la croyance en un animal, d’un coup d’ongle vindicatif. Puis, je passe plusieurs fois mon doigt en lieu et place. Ouf ! Je vais pouvoir m’endormir sans difficulté. Effectivement, je ne suis plus dérangé par ce picotement. Oublié, ou presque. Il suffit de ne pas y penser. Mais le seul fait de se dire qu’il ne faut pas y penser, vous amène bien sûr à y penser et à laisser sa pensée s’attacher à cette pensée. Je me force à ne pas bouger. Ça passe, ça passe ! Mes pensées repartent vers d’autres lieux. Elles tendent à se clamer, à quasiment d’arrêter. Là. Quel bonheur !
Mais rien n’est fini. Une démangeaison subite sur la cuisse m’oblige à me gratter de la main gauche. Juste un seul coup de doigt, pour éteindre cette envie de repasser la main encore et encore jusqu’à ne plus avoir qu’une cuisse rougie. Cela semble suffisant. Ce passage rafraîchissant du doigt ne me laisse plus qu’un vague souvenir dans la chair, comme un léger monticule sur la plaine de la mémoire. L’oscillateur reste plat. Je reprends ma respiration lente, j’en oublie mon corps, seule la tête continue à fonctionner, certes petitement, mais avec efficacité. Laisse courir ces images, ne t’y attarde pas ! Je me passe d’images, ce ne sont plus que des couleurs qui s’accumulent en gros noyau au centre de ma vision. C’est presqu’une peinture de Mathieu qui change sans cesse de formes et de couleurs. Je n’ai plus la force de penser. Mes pensées vont s’arrêter.
Ah ! Ma femme préférée, la seule en fait, vient de se retourner. Elle m’effleure d’une main, la pose sur mon bras, me réchauffe. J’ai perdu le nœud de peinture et retrouvé les images qui défilent à nouveau devant mes yeux fermés. Souvenirs, émotions, succès, défaites, tout y passe, dans le désordre, et me vient l’envie de me gratter le bras sur lequel sa main repose. Délicatement, je lui prend le poignet, le pose sur l’oreiller, embrasse le bout de ses doigts et me tourne délicatement pour reprendre une position la plus neutre possible. Ne pas se gratter et encore moins se chatouiller ! Refaire le vide en soi est une gymnastique nocturne en vogue. Sentir le trou d’air qui passe dans sa gorge, pénètre les poumons, descend jusqu’au plexus, puis repart dans l’autre sens jusqu’à débarrasser la tête de ces fantomatiques impressions qui courent au fond du cerveau.
Dieu, qu’il fait chaud ! me dis-je tout à coup. Une rosée envahit l’espace de chair délicate entre la lèvre supérieure et le bas du nez. Oui, c’est vrai, il fait chaud ! Je découvre mes épaules en tirant vers le bas la couette et me donne une impression de bain de mer lorsque vous soulevez la dernière vague mourante de mousse blanche. Brrrr ! Non, recouvre-toi, me dis-je. Et la mécanique repart, le ressort tendu, souvenirs, émotions, succès, défaites, et bien d’autres choses encore. L’oscillateur marque des hauts et des bas, la machine est toujours vivante et incontrôlable. Un quart d’heure plus tard, je me bats toujours avec la couette, tantôt trop descendue, tantôt trop englobante. Mais l’intérieur des yeux commence à fatiguer. Oui, c’est bien l’intérieur puisqu’ils sont fermés. Mais il y a une sorte de deuxième voile qui s’installe progressivement, comme un brouillard familier qui envahit l’écran de cinéma d’une laiteuse fantaisie. Pourtant un chatouillement intempestif me contraint à passer le coude sur les côtes sans cependant gratter cette partie du corps, sensible en période nocturne. Ah… Je ne peux résister. Avec l’autre main, je sors des ongles vengeurs et, ostensiblement, me gratte le lieu des supplices. Cela fait du bien ! Aussi, en un instant, je sombre dans l’étoupe du sommeil, en un lieu sans temps qui me prend dans ses bras jusqu’au lendemain matin.
Oui, c’est vrai... ça chatouille ou ça grattouille, et même, parfois, ça papouille.
07:21 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nocturne, sommeil, veille, inconscient, insomnie |  Imprimer
Imprimer
03/03/2016
Aspiration
Quel est ce feu bouillonnant
Qui monte de tes entrailles
Tel le trop-plein d’un volcan
Déversé en pluie de mitraille
A peine sorti de la nuit sans fond
Il t’entraîne dans sa danse
T’étourdit, te promène sur le pont
T’étreint et sans cesse te relance
Pourquoi cette aspiration vers le large
Sans lieu ni durée, qui t’entraîne
Vers cette promenade inhumaine
Tu te tiens, de toi-même, à la marge
Et tu contemples ce double, hagard
Qui t’emporte, sans aucun égard
© Loup Francart
07:14 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer
Imprimer
02/03/2016
Se garer entre deux voitures
Il est des jours où tout est simple parce que vos perceptions sont démultipliées. Ainsi en est-il lorsque vous garez votre voiture en ville.
Habituellement vous vous y reprenez à deux fois et même plus, n’arrivant pas à trouver le bon angle d’attaque, la courbe majestueuse à effectuer pour vous glisser sans contact entre deux voitures et le trottoir. Cela vous rappelle les prisons américaines que l’on voit dans les vieux films : trois murs, une grille à travers laquelle le détenu passe avidement les bras comme pour aspirer une brassée d’air pur. Vous vous laissez balloter entre les parechocs ou vous cognez trop vite sur la pierre sèche du trottoir sans comprendre pourquoi vous n’arrivez pas à entrer. Vous êtes comme l’incarcéré qui se fait parfois projeter par ses codétenus entre les trois murs et la grille. Vous avez cependant l’avantage d’être dehors et vous cherchez à vous glisser dedans. Le prisonnier est hélas dedans et voudrait bien sortir dehors. Toute autre ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ne saurait être que fortuite.
Mais d’autres jours, plus rares et délicieux, vous faites preuve d’une intensité extraordinaire de conscience. Dieu vous glisse une goutte d’huile sur le corps et vous guide hardiment dans ce coin obscur sans que vous vous en rendiez compte. Pourtant rien ne vous y prépare. Vous n’avez aucune acuité supplémentaire avant de commencer à tourner votre volant à droite pour laisse l’avant de la voiture partir à gauche pendant que son arrière-train accepte de chercher une place sur sa droite. Vous avez la sensation de vous assoir sur un fauteuil non rempaillé dont les montants de bois vous rentrent dans les fesses. Alors vous vous contorsionnez pour trouver une agréable assise. Nouveau coup de volant, à gauche cette fois-ci, qui vous permet d’entrer en catimini dans l’espace promis et envié. Vos sensations s’exaspèrent. Vous avez des picotements au bout des doigts, des pieds et de votre postérieur qui vous avertissent de l’approche de l’obstacle et vous font l’éviter. Vous vous sentez grandi, vous redressez la tête qui vous sort du cou et vous permet de mesurer la distance entre la roue arrière et le trottoir. Alors d’un geste sublime vous tournez à nouveau votre volant à droite pour caser le reste de votre corps entre les parechocs, avec douceur, sans heurt, entrée triomphale dans cet antre de paix qu’est la place qui vous a été offerte par un collègue parti quelques instants plus tôt. Vous n’avez pas encore conscience de cette agilité des sens qui vous a permis cette glissade bienheureuse dans un créneau étroit.
Au moment de couper le contact, un silence impressionnant se fait en vous. Tout devient fluide, vous baignez dans le bonheur qui est à portée de main. Votre cœur se dilate et devient une grotte qui résonne du moindre bruissement, votre vue s’affine jusqu’à vous montrer ce que vous ne voyez jamais, un fil d’araignée qui s’étire entre le tableau de bord et le parebrise. Il luit au soleil et vous dit : « Oui, elle est belle la vie, belle de ces petites choses sans intérêt qui lui donnent du sel et en font un plat goûteux que vous dégustez en une seconde qui devient l’éternité avant de retrouver la gaucherie de tous les jours et de sentir, en vous passant la main sur la joue, votre barbe qui pousse ».
07:15 Publié dans 12. Trouvailles diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : manoeuvre automobile, permis de conduire, garage, créneau |  Imprimer
Imprimer











