07/08/2016
La mue (13)
Aujourd’hui, il est huit heures du soir. Je perçois la clé dans la serrure. La porte se referme. J’entends parler Joséphine. Je ne sais ce qu’elle dit, mais une voix d’homme lui répond, assez grave et douce. Puis j’entends « Chut ! » Elle vient vers moi, seule et l’air de rien. Elle prend le voile opaque et le met sur la cage. Je ne vois plus et entends très mal, d’autant plus qu’elle met une symphonie de Beethoven assez fort, la 3e dite héroïque, si vivante qu’elle me fit dresser les plumes sur le corps et plus particulièrement mon aigrette qui se tient raide comme un balai. J’ai beau tendre l’oreille, je ne comprends pas ce qu’ils se disent. J’ai beau faire du bruit, agiter mes ailes, cogner mon bec sur les barreaux, rien n’y fait. Je ne suis plus là pour elle et elle m’ignore totalement.
Après leur diner, il semble s’incruster. La musique devient douce et moderne. Un chanteur noir remplace le classique. Oui, ce n’est pas mal, mais que font-ils ? Je n’entends plus rien, sauf quelques soupirs de temps à autre. Je comprends que j’ai définitivement perdu l’amour de Joséphine ou, au moins, que je suis remplacé comme prétendant. Cela me fit une drôle d’impression. C’était une deuxième rupture, presque plus pénible que celle de la mue. Joséphine, que fais-tu ? Je me souvins des nuits passées à nous raconter nos vies respectives, à nous caresser doucement, à échanger nos salives dans des baisers de feu, à explorer nos corps et à les rapprocher. Elle avait un grain de peau très doux, elle savait m’embrasser avec fougue, passer ses doigts sur mon dos pour le faire frémir. Je lui prenais la tête et baisais son cou qui sentait le caramel. Je lui imprimais mes mains sur ses seins et parfois m’aventurais plus bas. Et tout cela n’est plus. Je suis remplacé par un inconnu qui peut faire la même chose, sans vergogne. Non, je ne chanterai pas pour protester, je resterai silencieux. Je finis par m’endormir, blotti sur mon nid douillet.
07:37 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : conscience, rêve, détour, monde invisible |  Imprimer
Imprimer
06/08/2016
Nuit, toujours
La nuit te prend parfois, au creux de ton sommeil, et te renvoie à ton image dans le brouillard des jours lorsque l’éveil succède au rêve sans transition, comme le passage d’un métro qui ne t’est pas destiné. Alors tu descends sans bruit vers la cuisine, ce refuge de tes nuits discrètes où ton cœur chavire de bonheur d’être seul éveillé dans un village où tous dorment d’un sommeil lourd et chargé d’ignorance. Et cette descente vers le paradis, marche après marche, t’encourage dans ta décision de t’éveiller et de laisser aller ton inconscient à de longues phrases sans fin qui, comme une robe de mariée, déroule sa traîne de quart d’heure en quart d’heure, jusqu’à ne plus distinguer le moment où tu es descendu et celui où tu remontes, déjà rassasié de ce temps qui s’écoule sans raison, par inadvertance, telle une bouteille à la cave qui a perdu inopinément son bouchon, va-t’en savoir pourquoi.
Tu t’installes dans cette attitude particulière aux nuits où tu te sais seul point de réflexion, petite marmite où bouillonnent les idées alors que tous ont mis au frigidaire leurs soucis, leurs joies, leurs espérances et que tous encore ont capitulé devant l’inanité de la vie et fermé leurs cœur et leur intelligence ou même leur âme à l’attrait d’un désert où l’on erre sans relâche jusqu’à ne plus savoir si l’on va s’en sortir. Tu bois ton café qui a filtré pendant tes réflexions entrecoupées de regards vers la machine dans l’attente d’un réchauffement du corps en parallèle à la tiédeur de l’esprit qui s’installe en toi. Le breuvage aussitôt filtré, tu as empli ton bol, jeté un nuage de lait dans le liquide noir pour qu’il prenne l’expression d’une métisse rondouillarde qui enchante le palais et tu t’es lancé dans cette divine inconnaissance qui guette tout homme à trois heures du matin, éveillé mais plein de songes qui, pour autant qu’ils te semblent, feront ton délice d’une nuit. L’œil vague, la main reposant sur la table, l’autre tenant ton bol à hauteur de ton visage, tu laisses errer ta conscience sans savoir où elle s’échappe, comme ces souris que tu vois apparaître parfois entre la cuisinière et tes pieds, ombres vivaces qui te font prendre conscience de ta vanité d’humain. Alors un sourire discret se dessine sur ton visage, car tu te vois enfant réveillé à la même heure et perdu dans une cuisine autre, terrifié mais fier d’être debout pendant que tous dorment encore.
Puis, tu montes enfouir ta personne dans un bureau devenu ton refuge, loin des cris et des pleurs d’enfants que tes propres enfants ont eux-mêmes engendrés, et tu entres dans ce monde imaginaire auquel tu te livres entièrement, dans lequel tu te baignes et t’immerges avec une délectation que tu ne soupçonnais quelques minutes auparavant. Là, devant ton ordinateur et tes méninges, tu laisses filer les mots qui sortent en chapelet et les rattrapes dans un filet à papillons qui laisse parfois filtrer des paroles doucereuses ou malveillantes mais toujours apaisées par l’ouate de l’obscurité.
Enfin, viens le moment où, ayant déversé une littérature sauvage sur l’écran sans savoir ce que tu veux en faire, tu es las et à nouveau le corps cède au sommeil qui te gagne, tu sens la pesanteur des petits matins, avant l’aurore, et te laisse gagner par un engourdissement dans lequel tu te sens bien. Il est temps de fermer ta machine, d’arrêter de mouliner ces flots de paroles vaines, même si par acquit de conscience, tu relis une nouvelle fois ce que ton jus à produit, sans toutefois avoir la lucidité pour corriger quelques fautes d’orthographe ou de style qui resteront jusqu’à la prochaine lecture, demain ou un autre jour, ou même jamais comme cela t’arrive bien souvent.
Tu éteins la lumière, te glisses en catimini dans la chambre conjugale, entres sans bruit entre les draps maintenus frais par une fenêtre ouverte été comme hiver pour laisser entrer les secrets du monde invisible qui enchanteront tes rêves lorsque le soleil se sera montré. Et chaque jour, la journée commencera en pensant à une nuit de bonheur où tu sentis en toi l’infini travailler et te tendre la main.
07:07 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : conscience, rêve, détour, monde invisible |  Imprimer
Imprimer
18/07/2016
Le roman ou la vie
Il est quatre heures. La première partie de la nuit est finie. La fenêtre ouverte m’envoie les premières lueurs du jour, ténues, mais réelles. Je descends l’escalier, prépare la cafetière, y verse l’eau, mets un filtre que je saupoudre de farine de café. Je finis un roman, Après l’équateur, de Baptiste Fillon. Je ne sais qu’en penser. Il y a une qualité de l’écriture et des descriptions rudes, en bourrasques. On discerne l’évolution du style lorsqu’on avance dans les pages. Première partie : la mer, le long cours, la vie de l’équipage. Deuxième partie, comme un prélude : quelques jours chez sa maîtresse, au Brésil avec laquelle il a eu un enfant. Il ne sait s’il veut rester auprès d’elle ou rejoindre sa famille officielle. Troisième partie : le retour au foyer, où la colère du marin vis-à-vis de l’inutilité de cette vie bourgeoise éclate. Je ferme le livre.
Un sentiment de vide, d’inexistence, de tromperie permanente quel que soit le lieu, le moment, les interlocuteurs et les circonstances. C’est à l’image de l’actualité. Aucune certitude, aucune raison d’être, la vie au jour le jour, sans aspiration, sans guide, sans espoir. Depuis quelques mois, j’ai ce sentiment devant les livres que j’ouvre. Ils ne m’enrichissent pas, ne me font pas rêver, ne me permettent plus de sortir de moi-même et d’errer dans le monde avec un but précis. Oui, le livre est fini. Je n’ai rien appris sur la vie, c’est toujours le même rabâchage d’existences ratées en relents d’aventure qui sentent l’amertume et la capitulation. Et la fin est à l’image du fil des pages. Il part pour son dernier embarquement. Il rejoint sa deuxième femme, la non-régulière. Mais en est-on sûr et qu’y trouvera-t-il ?
Je n’écris cela qu’après coup. Je n’ai pas immédiatement ces réflexions toutes empaquetées. Je suis assis dans la cuisine et je regarde les étagères emplies de bocaux et poteries. Mes yeux s’éclaircissent, l’éclat des verres s’accentue, mon cerveau se vide, une énorme bulle d’air m’emplit le cœur, elle monte vers la surface du moi et explose. La cuisine s’illumine, se nettoie de ses scories et je suis là, vierge de toutes sensations, éveillé et dégrisé du quotidien. Je regarde chaque bocal, chaque objet avec un œil nouveau, propre et aiguisé. Assis, ici et maintenant, je vis hors du remue-ménage quotidien des sensations, émotions, sentiments et réflexions. Oui, cela, on ne trouve pas dans un livre !
07:19 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, vie, existence, réalité, rêve |  Imprimer
Imprimer
09/06/2016
Une maison insignifiante
Curieux par nature, comme tous les humains finalement, je passe la tête, tentant de distinguer quelque chose dans l’obscurité. Oui, elle est habitée par une femme. On sent son odeur doucereuse. Ne pas se laisser prendre, rester sur ses gardes ! Je cherche l’interrupteur à droite, à l'opposé de l’ouverture de la porte. Je le trouve à gauche. Quelle idée ! Lumière : faible, veloutée, caressant les objets plutôt que les éclairant. Un fauteuil Voltaire, un piano droit, un tapis effilé, quelques photos aux murs, dont une femme encore jeune, blonde, au sourire incertain, qui vous regarde étrangement. Elle semble presque vivante et vous fait un signe de la main : « Viens », semble-t-elle dire. Non, elle ne bouge pas. Ce n’est qu’une photo. Mais je ne la quitte pas des yeux. Elle reste muette. Une porte au fond de la pièce est entrebâillée et un escalier, sur la gauche, permet de monter à l’étage. Je l’emprunte. Un palier avec trois portes. J’ouvre la première. Elle donne sur une chambre aux volets fermés. Le soleil laisse quelques raies sur le sol recouvert de moquette grise et des grains de poussière dansent dans ses rayons. Rien d’intéressant, me dis-je en refermant la porte. La seconde s’ouvre sans bruit, comme entretenue de quelques gouttes d’huile passées sur ses gonds. Une chambre de femme. Je distingue un jupon du début du siècle, une robe au teint passée, une paire de chaussures hautes. Apparemment, il s’agit d’une jeune femme. La même probablement que celle vue sur la photo.
A ce moment, j’entends du bruit sur le palier. Je la vois passer, droite, fière, le regard perdu. Vite ! Je me cache derrière le paravent. Elle revient sur ses pas et pénètre dans la pièce. Elle ouvre un placard, en sort une robe jaune, assez longue, avec des volants en guise de manches. Retirant sa robe de chambre, elle l’enfile, se regarde dans la glace, avance de deux pas, recule de trois, puis avance, à tel point qu’elle disparaît derrière le miroir. Plus rien. Personne. A-t-elle vraiment existé ? Ne reste que cette odeur persistante, déjà perçue en bas en entrant dans la maison. Non, même avant, dans le jardin. Le silence est revenu, lourd, angoissant. J’étouffe. Que fais-tu ici, me dis-je. J’ai peur tout à coup et je presse le pas pour descendre les escaliers et me diriger vers la porte de sortie. Au moment où je tourne la poignée, un bruit bizarre retentit, semblant venir du premier étage : une sorte de plainte inhumaine, qui se prolonge inutilement, au-delà du souffle habituel d’un humain. Elle dure, dure à tel point que je sors épouvanté et referme au plus vite la porte. Dehors, toujours le silence. Pas un chant d’oiseau, pas un grattement, pas un chuintement. Je cours jusqu’au portail et me retrouve dans la rue, mes oreilles débouchées. Quel rêve, me dis-je. Non pourtant, ce n’est pas un rêve, j’ai bien vu cette femme changer de robe et disparaître dans la glace de l’armoire. Qu’est-elle devenue ?
Je n’ose plus retourner dans la maison et je pars vers le centre en m’efforçant de ne plus y songer. Mais chaque fois que je repasse devant le portail, je ne peux m’empêcher de revivre ces moments et d’en éprouver une angoisse indescriptible. Ne vous inquiétez pas, j’ai retrouvé mon âge réel. Seul mon sourire garde un regret imperceptible. Je n’arrive plus à sourire comme auparavant.
07:41 Publié dans 11. Considérations diverses, 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, impression, rêve, vision, psychologie |  Imprimer
Imprimer
08/06/2016
Une maison insignifiante
Hier, j’étais à un vernissage. Peu de gens, des œuvres assez disparates, car il y avait quatre exposants qui ne semblaient pas avoir grand-chose en commun. Tout à coup, un tableau, une maison, insignifiante, mais qui attirait mon regard. J’eus envie d’écrire son histoire, ou une histoire qui s’y rapporte.
Il passa devant l’entrée, un simple portail constitué de deux piliers de pierre brute. Il eut l’impression que la maison le suivait des yeux. Il se retourna, mais rien. Elle se tenait immobile, insignifiante, effacée. Il poursuivit donc son chemin.
Le lendemain, elle est toujours là, à la même place, guillerette cette fois. Le soleil luit haut dans le ciel et les hirondelles ont repris leurs rondes échevelées. Tiens, les deux piliers sont plus avenants aujourd’hui, remarque-t-il. Il s’arrête, intrigué. Ce chemin de gravier sale qui mène à la maison lui tend les bras : « Viens ! » lui dit-il. La maison semble inoccupée. Les rideaux des fenêtres ne bougent pas, les portes restent fermées, l’arbre est toujours pelé. Non seulement pas un signe de vie, mais une impression d’abandon augmentée par la peinture de la façade, une peinture violette, non, disons mauve pâle, un peu sale. Le jardin est également laissé à lui-même ; les herbes envahissent tous les recoins. Tiens, mais c’est vrai. Il n’y a pas un animal. Je franchis l’espace entre les piliers et avance d’un pas. Un silence étouffant, roide, au goût de farine. Mes pas soulèvent une petite poussière fine qui retombe lentement, au ralenti. Un silence oppressant qui résonne dans les oreilles et endort les autres sens, y compris la vue. Une sorte de voile grisâtre s’est abattue sur mes yeux. Je rentre dans un autre siècle. Je vieillis très vite. Le compteur tourne à toute vitesse les années en remontant vers ma jeunesse. Mais je vieillis malgré tout. Une impression désagréable. Ah, il ralentit, puis s’arrête : cent douze ans. Je ne sens plus mes os. Ils sont tellement friables. Ma peau est devenue jaune et gaufrée. Ma tête est restée la même. Ni mieux, ni moins bien. J’ai toujours eu quelques difficultés à l’équilibrer pour m’en servir. Tantôt elle penche du côté du cœur et me fait accéder au royaume des larmes, tantôt elle penche du côté de l’intellect et déborde de concepts. Ils deviennent si encombrants que je dois les entasser à la cave, dans le ventre mou des idées perdues.
J’avance à petits pas, respirant une odeur de papier vieilli recouvert d’une fine pellicule de poussière rose, féminine. Non, elle sent le musc, odeur masculine s’il en est. Mais s’y ajoute un mélange de rose, de mûre et d’angélique qui détonne dans ce jardin désuet. Au moment où j’arrive à la porte au linteau arrondi, celle-ci s’ouvre en grinçant. Personne n’en sort. Elle bée devant moi, comme une invitation muette, et je ne vois rien d’autre qu’une ombre épaisse et collante.
La suite et fin : demain !
07:36 Publié dans 11. Considérations diverses, 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, impression, rêve, vision, psychologie |  Imprimer
Imprimer
22/05/2015
Un couple insolite (11 fin)
Le soir même, Damien et Isabelle se retrouvèrent au pied de leur immeuble. Ils ne cherchèrent pas un instant à s’embrasser ou même à se serrer la main, sachant tous deux la déception qui les attendait. Ils se sourirent, l’air gêné et prirent un air dégagé qui ne les trompa ni l’un, ni l’autre. Ils choisirent d’aller prendre un café au bistrot du coin pour se raconter leur week-end. Ils s’assirent pensifs, se regardant avec avidité, mais sans que l’un ou l’autre tendent une main secourable ou même esquisse un geste tendre vers l’autre. Alors Damien raconta sa journée d’hier. Isabelle fut horrifié : « Il a osé et, pire, cela a marché. Suis-je donc la seule qu’il ne puisse toucher alors qu’auparavant nous nous fondions l’un en l’autre avec amour ? » Damien tenta de se justifier :
– Ce fut soudain, comme un irrépressible besoin que je ne maîtrisais pas. Il fallait que je sache. Ce fut un soulagement. J’en conclus que j’étais normal et qu’il se passait quelque chose entre nous deux. Quoi, je ne le savais, mais j’avais l’esprit rassuré et c’était déjà un soulagement.
Il raconta ensuite ce qui s’était passé ce dimanche, son ennui et sa rencontre fortuitement avec le vieillard. Isabelle qui jusque-là restait circonspecte, s’anima soudain.
– La voilà la solution, s’écria-t-elle joyeusement. Elle lui prit la main, lui dit de laisser un billet sur la table et, sans plus attendre, l’entraîna vers leur immeuble.
Jamais jusqu’à présent elle n’avait fait attention à l’orientation de l’immeuble, de leur appartement et encore moins de leur chambre et de leur lit. Sa place leur importait peu, seul comptait le rectangle sur lequel ils pouvaient s’étendre, se raconter leur bonheur au fil des jours. Ils ouvrirent la porte fébrilement, se débarrassèrent de leur manteau et coururent vers leur chambre.
– Stop ! dit Damien. Avant de nous précipiter, réfléchissons. Comment placer notre lit autrement ?
Ils constatèrent qu’il n’était guère possible de le tourner dans l’autre sens, c’est-à-dire verticalement par rapport à l’emplacement actuel.
– Peut-être en le mettant dans ce coin, suggéra Isabelle en montrant du doigt l’opposé de l’emplacement actuel.
Bien que le lit ne semblait pas offrir le même équilibre dans l’agencement de la pièce, ils acceptèrent l’idée de dormir dans un lit coincé dans un coin. L'inconvénient était majeur. L’un d’eux ne pouvait trouver sa place qu’en montant sur le lit avant de pouvoir glisser ses jambes dans les draps. Damien convint que cette gymnastique lui appartenait, prétendant que si tout se passait bien elle serait vite enceinte et ne pourrait plus exécuter ces gestes simples, mais pénibles pour quelqu’un qui n’a plus sa souplesse habituelle.
En moins de temps qu’il ne faut pour le dire, ils modifièrent l’emplacement du lit, de la commode et des deux chaises qui leur permettaient de ranger leurs vêtements le soir. Heureux, ils se regardèrent, les yeux brillants, impatients de cette nuit qui venait et annonçait la fin de leur cauchemar. Ils décidèrent d’ouvrir une bouteille de champagne pour fêter cet espoir revenu. Isabelle prépara un plateau, quelques friandises. Damien fit sauter le bouchon avec douceur, ne laissant entendre qu’un petit pschitt délicat, comme un avant-goût des baisers qu’ils comptaient bien échanger en se réveillant. Ils trinquèrent, burent, burent à nouveau tant si bien qu’ils se couchèrent sans réelle conscience de la solennité de l’instant. Isabelle s’endormit très vite. Damien mit quelques minutes de plus, pensant au vieil homme qu’il avait heurté. Quelle bizarre rencontre, inattendue et miraculeuse. Un signe du destin !
Ils se réveillèrent tôt, vers cinq heures du matin, presqu’en même temps. Dans le noir, sans bouger, Damien appela Isabelle, ou plutôt, murmura son prénom. Elle lui répondit avec chaleur et se tourna vers lui. Il ne peut attendre plus longtemps et lui ouvrit les bras. Elle s’y blottit avec ardeur. Il retrouvait cette sensation infiniment merveilleuse d’un autre monde, fait de hérissement du moindre poil, de frottement des chairs, de caresses insolites, de soupirs involontaires, de chaleur du souffle, de baisers avides. Isabelle pleurait de bonheur : « Mon chéri, mon chéri ! », ne cessait-elle de répéter. Elle s’offrit à leurs retrouvailles, l’esprit ouvert, vide de toute pensée, le corps tendu. « Quel cauchemar nous avons vécu », pensa-t-elle. Elle pleurait en petits hoquets, incapable de se contrôler, riant en même temps. Damien la serrait contre lui, avec précaution, comme un trésor destructible par une simple maladresse. « Mon Dieu, le cauchemar est fini », pensa-t-il avant de se noyer dans cet amour retrouvé.
07:16 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, récit, rêve, réveil, couple, peur |  Imprimer
Imprimer
17/05/2015
Un couple insolite (9)
La journée du dimanche fut pour le couple séparé un calvaire et un moment de grâce. Oui, un calvaire par l’absence de l’aimé(e), un moment de grâce par une attente insoutenable qui les reconstruisit. Errant, l’un dans Paris qui lui paraissait vide, l’autre à la campagne, tout aussi dépeuplée, ils furent contraints de se laisser aller à une expectative mélancolique, un état second qui les tint en alerte, tendus vers la rencontre du soir, lorsqu’enfin ils se retrouveraient. Ils ne voyaient rien, n’entendaient rien. Ils allaient dans le présent comme s’ils se mouvaient dans une piscine, avec des gestes ralentis, un halo de lumière remplaçant le soleil qui était revenu après le temps détestable de la veille. Ce fut pour eux une journée pénible, lourde et déstabilisante. Dans l’après-midi, Damien fit une rencontre. Errant dans une rue, il se heurta à un croisement à un homme assez âgé. Celui-ci tomba par terre, probablement parce qu’il avait du mal à tenir sur ses jambes. Damien l’aida à se relever, lui remis ses lunettes sur le nez et l’invita à prendre un remontant dans le café qui se trouvait là. Cet homme avait quelque chose de troublant. Il était bien réel, mais semblait décalé. A chaque question de Damien, il lui fallait un certain temps pour répondre, comme s’il percevait ce qu’il vivait avec un décalage, faible, mais réel. Il regardait Damien d’un air inquiet et Damien ressentit cette inquiétude au fond de lui. Mais quant à dire de quelle inquiétude il s’agissait, il n’en avait aucune idée.
– Pardonnez ma maladresse. J’étais moi-même préoccupé par un problème personnel et n’ai pas fait attention, alors que j’avais entendu votre pas venant de la droite.
En disant cela, Damien réalisa qu’en réalité il avait bien entendu les pas du vieil homme venant de la droite. Marchant sur le trottoir de gauche et abordant un carrefour, il s’était contenté de jeter un coup d’œil vers l’espace vide du croisement et, ne voyant rien, il avait poursuivi vaillamment sans se poser de question. Un trouble de la perception, sans plus. Il avait été surpris par l’homme venant de la gauche, la tête encore à moitié tournée vers la droite et l’avait heurté de l’épaule gauche assez violemment. Finement, le vieillard observa que Damien venait de sa droite, celle qui tenait sa canne qu’il avait fauchée d’un pied vif, sans mauvaise intention.
– Je ne vous aurais pas heurté avec l’épaule, mais simplement fauché du pied le bout caoutchouté de votre canne ? s’exclama Damien d’un air étonné.
– Oui, cher Monsieur, c’est pourquoi je suis tombé.
Damien ne sut que dire. Il ne comprenait pas sa perception si différente de ce qui s’était passé. Un même événement avec deux versions divergentes et un trouble curieux, une sorte de fente vide dans laquelle il se serait glissé par inadvertance. Il tenta d’expliquer cette sensation au vieil homme. L’œil de celui-ci s’éclaira. Il écouta les causes de l’incompréhension de Damien : la mauvaise perception sonore des pas, son regard vers la droite, le choc des corps et la chute du plus faible. Il avait compris.
07:10 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, récit, rêve, réveil, couple, peur |  Imprimer
Imprimer
13/05/2015
Un couple insolite (8)
Isabelle avait choisi une autre option. Loin de Paris, pour oublier. Elle prit le train, arriva dans une petite gare perdue dans la campagne. Elle s’installa dans la seule auberge du petit bourg et ressortit vêtue d’un imperméable et chaussée de bottes en caoutchouc, adaptées au temps incertain qui régnait depuis qu’elle était arrivée. Ce qu’elle voulait ? Le silence, la réflexion, voire la méditation. Elle ne rêvait pas d’être touchée, caressée. Ses espérances étaient au-delà de l’union des corps. Elle voulait à nouveau entrer en communion avec Damien, que leur esprit ne fasse plus qu’un, que leur cœur batte au même rythme, que leurs pensées coulent l’une de l’autre sans à-coups. Seul le silence extérieur lui amènerait la paix. Sortir de ce brouhaha permanent dans sa tête.
Quittant le village, elle trouva un banc de bois et s’assit. « Contemple la campagne, suis du regard les chemins qui s’éloignent, remonte vers l’horizon jusqu’à ce qu’aucun détail n’apparaisse, plonge dans la fente qui sépare le présent de l’avenir et laisse aller ton corps dans cette fin imprévue, entre l’enfer terrestre et le vide céleste. » Elle ferme les yeux, concentrant son regard intérieur entre les deux yeux. Noir d’abord, puis un rouge chaud, plein, envoûtant, dans lequel elle se sentait bien. Cela l’apaisa. Elle se détendit, offrit son visage aux quelques rayons de soleil et écouta. C’était peu de choses, deux branches qui se caressent, un oiseau pépiant, quelques cris d’animaux divers, très voilés, un silence léger, enchanteur. Bientôt, la lourde membrane séparant l’extérieur et l’intérieur s’amenuisa, se fit légère, presque transparente. Elle se laissa bercer par son souffle, le sentant passer dans les conduits de l’odorat, puis glissant légèrement à la surface du cervelet, poursuivant sa route derrière le larynx et pénétrer avec douceur dans les poumons jusqu’à ce que ceux-ci, imprégnés de ce souffle frais, reprennent le mouvement inverse, lentement, nettoyant sur son passage le chemin sacré qui fait du dehors le dedans et inversement. Elle contemplait maintenant ce monde intérieur, cultivant la vacuité, oubliant même la possibilité d’action. Elle sentit se former à hauteur de la trachée cette boule éphémère, mais réelle, d’un soi, autre que ce moi habituel. Mais bien vite, tout ceci s’effaça. Elle ouvrit les yeux, se sentit mieux, la poitrine plus légère, la tête moins pleine. Elle connaissait cette sensation, ce bonheur ineffable d’une descente en soi jusqu’à l’oubli. Aujourd’hui elle n’ira pas plus loin.
Elle reprit le chemin de l’auberge, le pied léger, regardant le soleil décliner sur l’horizon, sans être importunée par cette fin du jour qui bien souvent la mettait mal à l’aise. Elle rentra, monta dans sa chambre, prit une douche et s’habilla simplement pour un diner frugal. Elle était bien, comme elle ne l’avait pas été une seule fois depuis ce matin détestable où elle n’était plus en harmonie avec son mari.
07:55 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, récit, rêve, réveil, couple, peur |  Imprimer
Imprimer
10/05/2015
Un couple insolite (7)
Sa première réaction fut :
– Ce n’est pas possible.
Elle ne pouvait croire à une histoire qui ne tenait pas debout. Ne pas pouvoir toucher sa femme ! Et, apparemment elle seule, puisqu’il l’avait touché sans aucune difficulté.
– Touchez-moi à nouveau, lui demanda-t-elle en tendant sa main.
Il lui prit la main, la caressa, remonta sur le bras, utilisa son autre main et fit de même. Il alla même jusqu’à lui caresser la joue. Oui, elle était bien là, vivante et pleine. Un sourire heureux s’était répandu sur son visage, une sorte d’extase primaire l’avait transformé : « Je suis normal », pensait-il. Il faillit le crier dans la salle du drugstore et s’arrêta au dernier moment.
– Vous m’avez rendu la vie, lui dit-il d’une voix pénétrante. Je vous invite à diner, ajouta-t-il. Venez.
Et il l’entraîna en la tenant par la main après avoir laissé quelques billets sur la table ronde.
Il l’emmena dans un luxueux restaurant et commanda, avant même qu’on leur apporte la carte, une bouteille de champagne.
– C’est trop, lui dit-elle.
– Non, si vous saviez ce que cela fait du bien de pouvoir toucher une femme ne serait-ce que du bout des doigts.
Elle n’osa pas poursuivre sur le sujet, ne le connaissant pas suffisamment. Elle comprit que cela l’avait beaucoup affecté, au point de l’amener à faire des expériences qu’il pourrait par la suite regretter. Elle changea donc habilement de sujet de conversation, vantant Paris et la douceur de vivre au printemps, la saison la plus parisienne (c’est bien ainsi qu’elle la dénomma). Ils commandèrent le repas, léger. Il lui reprit la main, la caressa, regardant cette rencontre entre deux peaux comme un événement unique, et elle ne pouvait s’empêcher de rire de cet air d’émerveillement qu’il avait.
– Claire, lui dit-il, vous me rendez fou. Je voudrai vous serrer contre moi, embrasser vos yeux noirs, caresser vos cheveux d’ambre, sentir la naissance de votre cou.
Elle lui avait dit son prénom par inadvertance et il s’en était emparé, étonné de cette dénomination. Claire, si claire qu’elle était transparente, sans obscurité. Sans doute, pour cette raison, se méfiait-elle de son comportement parfois trop direct. Cela lui donnait un charme discret. « Je donne un peu, par inadvertance ; mais, je ne le fais pas ouvertement », pensait-elle.
Ils parlèrent beaucoup, de tout et de rien, comme deux amis heureux de se retrouver. Elle apprécia sa conversation, l’encouragea. Il admirait son aisance, naturelle et sans artifice. Ils dinèrent de bon appétit, sans cependant s’appesantir sur les plats. Il demanda l’addition, paya et ils sortirent dans l’air vif de la nuit. Il lui prit le bras et l’entraîna sans savoir où il allait. Ils marchèrent longuement, conversant, se serrant l’un contre l’autre, étroitement unis, mais se regardant encore comme deux êtres séparés par une inconnue, Isabelle, cette femme insaisissable qu’il ne pouvait toucher et qu’elle ne pouvait concevoir. Inconsciemment, il l’avait amené jusqu’à son hôtel. Surpris, il lui demanda si elle voulait monter prendre un verre, ayant remarqué que le petit frigidaire de chambre contenait alcools et jus de fruit.
– Pourquoi pas ? lui dit-elle.
Arrivé dans sa chambre, il lui servit un porto, prit un whisky. Tout en échangeant, ils s’assirent sur le lit. Il tenait sa main comme une preuve de sa normalité à laquelle il avait fini par ne plus croire. Il ne put s’empêcher de se rapprocher d’elle et de lui embrasser le cou, ce lieu de l’être où la bulle se referme dans une intimité ouvrant au monde des sens. Cela la réveilla. Gentiment, elle s’écarta progressivement, avec douceur, le regarda et lui dit :
– Il est temps que je rentre, j’ai beaucoup de travail demain et je dois me reposer. Merci pour cette délicieuse soirée, pour votre spontanéité franche. J’espère que vos difficultés avec Isabelle ne seront bientôt qu’un mauvais rêve et je forme des vœux pour votre couple.
Elle lui tendit la main. Il la prit doucement, posa ses lèvres sur le dos de ses doigts et la laissa partir. Elle avait bien conscience de ce qu’elle faisait. Elle savait qu’il regretterait sa présence. Mais elle ne voulait pas lui créer un autre problème alors que son avenir était ailleurs.
Il ne sut que penser de ce départ qui lui semblait précipité et volontaire. Il ne lui fit pas mal sur le moment, mais peu à peu s’insinuèrent en lui des reproches, sans qu’il sut dire lesquels exactement. Il se déshabilla, se coucha et s’endormit malgré tout sans difficulté.
Dans la nuit, il fit un rêve. Il vit deux anges fouillant des gravats à mains nues. Un diable s’approcha, vêtu de lumière rougeâtre. Il les écouta un moment, puis leur demanda :
– Que faites-vous donc à remuer ces décombres ?
– Ce sont les trésors d’une vie.
– C’est fini, il n’y a rien, même pas un pet de lapin.
Et il disparut à leurs yeux comme s’il n’avait jamais existé.
07:42 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, récit, rêve, réveil, couple, peur |  Imprimer
Imprimer
07/05/2015
Un couple insolite (6)
Damien n’avait qu’une obsession : serrer une femme dans ses bras. La douceur féminine lui manquait. Il avait connu l’exaltation de l’union au cours de ces cinq mois de mariage. Il éprouvait des tremblements nerveux en imaginant le bonheur de ces rapprochements. Il se remémorait l’entrée dans la bulle de l’amour lorsqu’il pouvait enfouir son visage dans le cou de sa bien-aimé, respirer son exhalaison, caresser ses épaules arrondies jusqu’à ces instants sublimes où ils devenaient un, dans un même rêve fait réalité. La nuit, depuis cet instant où il ne put toucher Isabelle, il lui arrivait de pleurer sans bruit dans son lit. Elle est là, se disait-il, mais elle n’est pas là non plus. Qu’est-elle devenue ? Pourquoi faut-il que ce soit à nous à qui cela arrive ? Je t’aime Isabelle, mais où es-tu ?
Il voulait à tout prix en avoir le cœur net. Le problème tenait-il à Isabelle ou à toutes les femmes dès l’instant où il s’approchait d’elles. Il ne savait plus que croire et n’en pouvait plus. Il avait besoin de savoir. Après, il prendrait une décision. Laquelle ? Il ne savait.
Il n’alla pas loin. Il prit une chambre dans un hôtel du quartier des Champs-Elysées, s’habilla avec élégance et se rendit au drugstore, lieu de fréquentation d’hommes et de femmes en mal de connaissance, du moins le pensait-il. Il commanda un whisky, histoire de se mettre dans l’ambiance et d’envisager cette nouvelle vie à laquelle il n’avait jamais pensé jusqu’à maintenant. Il se laissa bercer par le bruit monotone des chaises remuées, des conversations alentour, de la très légère musique de fond et des commandes des garçons qui passaient devant lui la main à plat sur leur plateau contenant de nombreux verres et bouteilles. Quel spleen ! Il voyait la foule circulant au dehors, des petits, des gros, des fines, des grassouillettes, des élégantes et des sportives, des souriantes ou des revêches. Il se prit à rêver. Celle-ci qui marchait avec élégance, engoncée dans un léger manteau, le minois souriant, regardant sa montre et accélérant sa marche. Celle-là, petite brune, serrant un paquet, de chocolat probablement, se réjouissant de le déguster une fois rentrée chez elle. Il fut tiré de sa rêverie par une jeune femme qui s’installa à une table à côté de lui. Son regard avait fui, mais il l’avait vu un instant auparavant le regardant avant de s’assoir. C’était une assez grande femme, blonde, les traits bien dessinés, portant une petite bague moderne à l’auriculaire de la main droite. Elle tenait son petit sac à main contre elle et cherchait le garçon d’un œil attentif. Lorsqu’elle le vit, elle leva la main et lui fit un signe. Elle commanda d’une voix souple et posée, mélodieuse, presque musicale. Il croisa à nouveau son regard et lui fit un sourire. Elle n’y répondit pas, mais ne parut nullement gênée par cet échange subliminal. Elle attendait sa commande regardant dehors, comme lui. Celle-ci arriva enfin, un gin tonic avec deux glaçons. Elle se détendit ave un affaissement du haut du corps, très léger, non pas un avachissement, mais une simple détente des épaules et des avant-bras, un léger abandon des mains posées sur ses cuisses et un sourire voilé d’une timidité de bon aloi. Elle trempa ses lèvres dans le liquide transparent et reposa son verre, heureuse de ce moment de relaxation. Il ne put s’empêcher de lui faire la remarque :
– Vous semblez si bien !
Elle le regarda, sourit et lui répondit :
– C’est si bon de se détendre après une journée de travail épuisante. Regardez ces gens qui courent dans tous les sens. Ils ne prennent même pas le temps de profiter de l’heure sereine avant de rentrer chez eux.
– C’est vrai. Nous oublions tous la douceur de vivre. Préoccupés par des pensées futiles au lieu de contempler les minutes qui passent sans penser à rien.
Ils bavardèrent tranquillement et cela lui fit du bien. Il fut distrait de son idée fixe. Plus de démangeaisons nerveuses, plus d’envies de fuir n’importe où. Il profitait de cette heure sans aucune arrière-pensée. Il rapprocha sa table, une petite table ronde, et se retrouva bientôt à côté d’elle. Elle n’était pas réellement belle, le visage jeune, mais un peu empâté au niveau de l’attache du cou. Elle avait un regard vif, presqu’étincelant par moment. Elle savait rire en racontant une anecdote, il sut l’écouter sans forcer son rôle, heureux de cette entente rapide.
– L’autre jour, j’étais allé faire des courses près de l’Opéra. J’ai vu sortir d’un magasin chic une sorte de princesse arabe accompagnée de deux autres femmes également élégantes et chargées de paquets qu’elles engloutirent dans le coffre ouverte d’une luxueuse voiture. Le sol était inégal, fait de ces pavés très parisiens, traitres parce que cachant des interstices invisibles. Elle se prit un talon dans un de ceux-ci et tomba durement sur le sol. Les deux autres jeunes femmes qui l’accompagnaient ne firent pas un mouvement pour l’aider à se relever. Elles se jetèrent un coup d’œil et sourirent en tournant la tête, heureuse de voir que leur patronne était comme elle et pouvait avoir des défaillances. Il fallut qu’un homme aide la belle à se relever malgré la gêne que cela procurait à celle-ci. Qui veut faire l’ange fait la bête, conclut-elle en riant.
– Oui, ce sont des instants de joie que d’assister à de tels changements de situation. Elle n’était pas blessée au moins ?
– Non, pas du tout. Mais furieuse, ça, oui !
Il ne put s’empêcher de lui toucher le coude en répliquant :
– Cela se comprend, imaginez-vous dans une situation semblable, par exemple transportant dans un sac en papier des pots de confiture achetés dans une bonne épicerie et ceux-ci tombant à terre parce que le papier du fond a lâché. Eclaboussée par la confiture rependue sur le trottoir, que feriez-vous ?
Peu lui importait ce qu’il disait. Seul comptait le contact qu’il avait eu avec cette femme élégante et charmante. « Elle existe », pensa-t-il aussitôt qu’il sentit une certaine résistance au bout de ses doigts. Il eut envie de crier de joie et de la prendre dans ses bras. Il ne put s’empêcher de sourire plus que de raison, voire de rire d’émerveillement d’avoir le contact avec ce coude de femme, quelle qu’elle soit. Elle le regarda, surprise de sa réaction décalée par rapport à l’histoire qu’elle avait racontée. Tout en souriant, il se dit qu’il était plus simple de tout lui raconter, Isabelle, son mariage, sa « maladie » et l’effet que cela lui avait fait de la toucher et de la sentir consistante.
07:15 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, récit, rêve, réveil, couple, peur |  Imprimer
Imprimer
05/05/2015
Un couple insolite (5)
Le scanner ne leur donna aucun éclaircissement. Tout était normal. Dépités, ils rentrèrent chez eux, sans même pouvoir se jeter dans les bras l’un de l’autre. Ils retournèrent consulter le professeur, mais celui-ci avoua son incompétence. Il n’avait jamais vu ni entendu parler d’un tel cas. L’enfer commençait, à petites doses, s’infiltrant lentement dans l’esprit de Damien et d’Isabelle. Ils n’avaient rien à se reprocher, rien à redire de leur vie en commun. Mais cette situation les laissait impuissants. Que faire quand l’adversité vous frappe sans qu’il soit possible de riposter ou de la contourner ? Rien. Rien, c’est-à-dire l’inertie et la non-action ; bref, une attitude déprimante parce qu’incontournable. Et cette attitude entraîne des divergences de perception, donc d’émotions.
Isabelle laissait de temps à autre transparaître sa peine, quelques larmes qui suffisaient à énerver Damien. « A quoi cela sert-il de pleurer sur notre situation ? Mieux vaut trouver des solutions. » Malgré ces reproches voilés, elle ne pouvait s’empêcher de penser aux mois précédents lorsqu’ils se réjouissaient de se retrouver le soir ensemble dans leur lit. Dorénavant ils retardaient ce moment. Ils regardaient la télévision sans parler, une première émission, puis une deuxième jusqu’à ce que l’un d’entre eux s’endorme à moitié sur le canapé. Ils allaient se coucher par la force des choses. Il fallait travailler le lendemain. Ils leur étaient même arrivés de s’endormir tous les deux et de se réveiller à quatre heures du matin, ne sachant plus s’ils devaient attendre le lever du jour ou aller se coucher. Elle ne pouvait alors s’empêcher de reverser quelques larmes. Elle pleurait chaque jour, malgré les reproches de Damien.
Celui-ci avait des moments de découragement qui s’exprimaient par des départs impromptus de l’appartement. « Où va-t-il encore ? se demandait Isabelle. Elle ne comprenait pas qu’il puisse avoir besoin de moments de solitude. Il marchait une heure ou deux, traversant la moitié de Paris et rentrait épuisé. Il allait directement se coucher. Isabelle le rejoignait, mais il était déjà endormi. Elle le caressait alors, rêvant aux tendres attouchements qu’il lui prodiguait auparavant. Il était devenu sec comme un bois mort.
Un jour, n’en pouvant plus, ils convinrent qu’ils pourraient prendre quelques jours chacun de leur côté et essayer de faire un point. Ils ne sentaient plus leur corps, n’avait plus d’émotions positives, plus de sentiments l’un envers l’autre et encore moins de capacité de raisonnement. Ils firent leur valise chacun de leur côté, emportant quelques vêtements inutiles, un livre qu’ils ne liraient ni l’un, ni l’autre et leur trousse de toilette. Ils fermèrent la porte à clé, se regardèrent, descendirent l’escalier à petits pas, elle l’embrassa sur le palier de l’immeuble, il lui dit à dimanche soir et ils partirent, l’un à droite, l’autre à gauche. Trente pas plus loin, ils se retournèrent quasiment ensemble, se firent un signe de la main, puis poursuivirent leur route. Chacun se demandait s’il reverrait l’autre, s’il aurait le courage de revenir pour à nouveau affronter cette situation inimaginable.
07:36 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, récit, rêve, réveil, couple, peur |  Imprimer
Imprimer
02/05/2015
Un couple insolite (4)
Une minute plus tard, il rentra, s’assit à son bureau, sortit une feuille d’ordonnance et commença à écrire. Il s’interrompit comme s’il avait une nouvelle idée et il leur avoua sa perplexité.
– J’avoue ne pas comprendre. Vos deux examens sont tout ce qu’il y a de plus normaux. J’ai besoin que vous me montriez ce qu’il se passe lorsque vous, Monsieur, essayez de toucher Madame. Allez-y, je vous en prie.
Damien avança sa main vers le buste d’Isabelle. Il ne sentit rien. Isabelle ne semblait pas là. Voulant en avoir le cœur net, le professeur leur demanda de se dévêtir tous les deux en ne gardant que leur dessous. Damien avança à nouveau sa main vers le corps d’Isabelle. Celle-ci disparut lorsqu’elle pénétra sa peau. Le professeur écarquilla les yeux et lui demanda de poursuivre plus profondément pour que sa main ressorte de l’autre côté du corps d’Isabelle. Ce fut le cas. Il voyait une coupure entre l’épaule et la main que comblait le corps d’Isabelle. Il eut alors une idée surprenante. Donnant à Damien son stéthoscope, il lui demanda de se séparer d’Isabelle. Impossible. Damien ne pouvait extraire sa main qui tenait l’appareil. Il était comme ces enfants qui, la main dans un pot de bonbons, ne peuvent la ressortir parce qu’ils ne veulent pas les lâcher. Isabelle ne sentait rien. Le médecin reprit son stéthoscope et Damien sortit sa main sans aucune difficulté, comme si sa femme n’avait pas de corps.
– Nous avons donc appris quelque chose. Aucun corps étranger ne peut pénétrer votre personne. Seule la peau contre la peau crée le problème.
– Ce n’est pas tout à fait exacte, le reprit Isabelle. N’oubliez pas que dans le lit je porte une chemise de nuit et que, tout à l’heure, j’étais habillée.
– Madame, vous avez raison. Mais cela me donne une idée. Que se passe-t-il si c’est vous qui voulez toucher votre mari.
– Mais rien du tout. Je le touche, tout simplement. Tenez.
Joignant le geste à la parole, elle s’approcha de Damien, avança la main et ne put aller au-delà d’un simple toucher.
– Il est bien là, présent, comme d’habitude.
– Essayons autre chose. Monsieur, entrez votre bras et ne bouger plus. Maintenant, Madame, dégagez-vous de ce bras, c’est-à-dire marchez comme s’il n’était pas là.
Isabelle fit deux pas de côté, sans rien ressentir. Le bras de son mari restait à l’horizontal, désormais seul, entièrement visible. Il le laissa tomber.
– J’avoue ne pas comprendre pour quelle raison lorsque c’est vous, Monsieur, qui cherchez à toucher votre femme, vous ne le pouvez pas, mais qu’inversement votre femme vous touche tout à fait normalement. Ma seconde interrogation vient de l’origine de votre mal. Tient-elle au corps de Madame ou aux mains de Monsieur ? Madame, pourriez-vous vous approcher de Monsieur et tenter de le toucher avec votre pied ?
Isabelle, malgré le comique de la situation, fit ce que lui demandait le praticien. Elle prit la pause d’un karatéka portant un yoko geri. Son mari la regarda étonné en faisant un Ah signifiant qu’elle lui avait fait mal. Il ne dit rien de plus, se massant la poitrine un court instant.
– A vous Monsieur, maintenant.
Il prit plus de précaution et lui toucha une cuisse avec la pointe de son pied. Celui-ci passa au travers sans aucune hésitation.
Aucune des trois personnes présentes n’étaient conscientes du comique de la situation : un homme et une femme, en tenue légère, qui semblaient se battre devant un homme en blanc qui les regardait, perplexe. Ils étaient tous préoccupés par cette énigme incompréhensible et qui risquait de porter ombrage à leur relation. Le professeur s’interrogeait : « Que faire ? Pour quelle raison lorsque c’est Monsieur qui veut toucher Madame cela n’est pas possible, alors que lorsque c’est Madame qui veut toucher Monsieur il n’y a aucune difficulté. La réponse survint au professeur en un instant : c’est une question de volonté et de circonstances psychiques. Monsieur est volontaire. Il aime prendre sa femme dans ses bras et la caresser. Madame aime se laisser prendre et ne pense pas à volontairement prendre son mari dans ses bras. Oui, c’est possible, mais comment leur expliquer ? »
– Je vous remercie de vous être prêtés aimablement à ces différents exercices qui n’avaient d’autre but que de me permettre de comprendre. Vous pouvez maintenant vous rhabiller.
Ils se rendirent derrière le paravent, se regardèrent, se sourirent, allèrent naturellement l’un vers l’autre. Damien arrêta son mouvement, se rappelant son incapacité à la toucher. Isabelle l’embrassa sur la bouche, confiante. Décidément, quel drôle de situation, pensaient-ils tous les deux. Mais cela ne peut durer.
Habillés, assis devant le bureau du professeur, ils attendaient le diagnostic. Mais celui-ci était bien en peine d’en donner un. Alors, pour se donner bonne contenance, il leur expliqua :
– Je commence à entrevoir ce qui se passe. Mais j’ai besoin d’examen complémentaire. Je vous prescris à tous les deux un scanner complet avant de me prononcer.
Il téléphona au centre qui disposait d’un scanner, écrivit une lettre au médecin qui examinerait les résultats et les laissa partir. Il continuait à se demander ce que pouvaient avoir ce couple qui semblait heureux et sans problème.
07:55 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, récit, rêve, réveil, couple, peur |  Imprimer
Imprimer
01/05/2015
Un couple insolite (3)
Ils se retrouvèrent chez eux vers 19 heures. Isabelle, arrivée la première, mit beaucoup de soin à préparer ces retrouvailles. Elle avait décidé de se battre pour que leur mariage ne pâtisse pas de cet événement. Elle prépara un apéritif avec des friandises et attendit, légèrement inquiète. Lorsque Damien introduisit sa clé dans la serrure, Isabelle secoua la tête, se massa le front et commanda son plus beau sourire.
– Bonjour mon chéri. Ta journée s’est-elle bien passée ?
Damien, lui, n’avait de cesse de revoir Isabelle pour la serrer dans ses bras. Mais dans les circonstances actuelles, il n’osait pas se rapprocher d’elle dans la crainte d’être déçu. Il commença par répondre en posant sa serviette sur une chaise, se tenant derrière comme en retrait.
– Pas bien, il faut le dire. Je n’ai cessé de penser à notre aventure et aux moyens d’y faire face. Et toi, comment s’est passée ta journée ?
– J’ai bien travaillé. J’ai téléphoné à Sylvie qui m’a donné l’adresse d’un professeur spécialiste du toucher à l’hôpital Saint Louis. Nous avons rendez-vous demain à 15 heures.
– Quelle bonne nouvelle, dit Damien. J’avoue ne pas comprendre ce qui nous arrive exactement. Je te vois, je t’entends, je sens même ton odeur si douce dans mes narines, mais je ne peux te toucher. C’est comme si tu n’étais pas là. Mes mains passent à travers toi sans même que je sente la moindre résistance. Je pourrai m’assoir sur ton siège, toi présente, comme si tu n’étais pas là ! Je ne connais plus la douceur de ta peau, la courbe de tes seins, et pourtant je sens la caresse de tes cheveux sur mon cou. C’est inexplicable et inextricable.
Elle lui prit la main, la caressa, la porta à sa joue et ne put s’empêcher de laisser quelques larmes s’échapper de ses paupières. Il ne sentait rien. Ils tentèrent de regarder la télévision, assis côte à côte sur le canapé, chacun de son côté, comme deux célibataires. Mais aucun programme ne put retenir leur attention. L’agitation de ces gens sur l’écran n’avait plus de sens pour eux. Ils se couchèrent tôt et ne purent s’embrasser avant de fermer les yeux.
Le lendemain, après une matinée morne et un déjeuner pendant lequel ils ne se parlèrent pas, ils furent introduits dans le bureau du professeur Jean Sédoux, dermatologue, supposé spécialiste du toucher. Il soignait l’acné, l’eczéma, les mélanomes, les mycoses, le psoriasis, les allergies cutanées, les verrues, les angiomes, le lupus, la gale, les corps et durillons et bien d’autres maladies encore liées à l’enveloppe corporelle. Il avait l’assurance des grands professeurs de médecine, l’air gentil, mais sûr de lui, comme s’il savait d’avance ce que le patient a et comment le guérir.
N’ayant pas l’habitude de voir deux patients en même temps, il s’étonna tout d’abord de cette double présence.
– Alors, qui de vous deux est malade ?
Ils ne surent répondre. Certes, Damien semblait à l’origine du mal. Mais Isabelle souffrait aussi de ne pouvoir être touchée. Elle ne sentait rien lorsqu’il passait sa main au travers de son corps. Pourtant, elle n’était pas transparente, elle pouvait se toucher, pincer son bras, enfiler ses collants.
A ces premières explications, le professeur ne comprit rien. De quoi leur parlaient-ils ? Il sourit d’un air incrédule, hocha la tête et leur demanda de recommencer, l’un après l’autre. Damien raconta comment ils avaient constaté cette étrange maladie, sa peur de ne rien sentir dans le lit de la présence de l’autre alors qu’il la voyait. Isabelle détailla ses sensations et ses impressions, sans toutefois arriver à expliquer en quoi elle était atteinte par ce même mal. Elle finit par fondre en larmes sans que Damien puisse la prendre dans ses bras et la consoler.
Le professeur ne souriait plus. Il ne comprenait pas cette étrange maladie qui n’était probablement pas une maladie, mais qui n’était pas non plus d’ordre purement psychique puisqu’elle avait des manifestations très concrètes physiquement. Il demanda à Damien de passer derrière le paravent et de se déshabiller. Après un examen rapide de sa peau, il ne put que dire qu’il ne voyait rien à signaler. Il le frappa avec son marteau à réflexe. Rien à signaler non plus. Il lui demanda de le toucher et même de le pincer. Il ressentit aussitôt les doigts du patient, le pincement normal entre le pouce et l’index. Rien à signaler non plus. Il lui demanda de se rhabiller. Il était perplexe. Peut-être l’examen de sa femme lui apporterait quelques éléments de compréhension.
Il pria donc Isabelle de passe derrière le paravent et de ne garder que ses sous-vêtements. Il la fit s’étendre sur le divan médical et entreprit les mêmes examens que ceux qu’il avait pratiqués sur Damien. Le constat fut le même : rien à signaler. Il lui demanda de se rhabiller, se lava les mains pour se donner une contenance et revint s’assoir à son bureau. Il n’avait aucune idée de ce qu’il se passait. Le temps lui sembla arrêté. Sa tête n’arrivait plus à réfléchir. C’était un grand vide dans ses pensées de praticien qui fit monter en lui une telle transpiration qu’il dut sortir son mouchoir pour garder son sang-froid. Il leur demanda de l’excuser quelques instants et il sortit précipitamment de son cabinet. Ils se regardèrent en souriant. Le praticien était perdu.
07:35 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, récit, rêve, réveil, couple, peur |  Imprimer
Imprimer
29/04/2015
Un couple insolite (2)
Le lendemain, ils se réveillèrent difficilement, chacun restant un moment dans la brume du sommeil avant de se tourner vers l’autre. Damien, le premier, tendit un bras vers Isabelle et se réveilla instantanément. Rien. Isabelle n’était pas là. Il ne rencontrait que du vide. Il se tourna vers elle et la vit. « C’est bien vrai. Ce n’est pas un cauchemar ! Je la vois et je n’arrive pas à la toucher », se dit-il, atterré. Isabelle, quant à elle, ne réalisa la situation qu’en voyant la tête de Damien. Un fossé les séparait dorénavant, l’amour devenait sans objectif puisqu’il était impossible d’étreindre l’amour de sa vie comme il était également impossible de recevoir des caresses de l’être aimé. Isabelle venait en un instant de percevoir l’étendue du désastre. Non seulement Damien ne peut étreindre Isabelle. Mais en contrepartie, Isabelle ne peut recevoir la douceur d’une main sur son corps. « Mutilés, nous somme mutilés », murmura-t-elle pour elle-même. Alors elle se leva, s’approcha de son mari, lui prit la main, le forçant à se lever. Elle le débarrassa de son pyjama et le contempla, nu. Puis elle se déshabilla et s’offrit à son regard, les mains ouvertes, rayonnante de beauté. Ils communièrent ensemble du regard de l’autre et l’espoir revint.
– Ce n’est pas possible. Nous allons tout faire pour guérir, se promirent-ils.
– Dès demain, prenons plusieurs jours de congé et cherchons celui ou celle qui nous guérira, déclara Isabelle.
– Oui, et dès aujourd’hui, je regarde sur Internet ce que l’on peut trouver sur cette maladie, répliqua Damien.
Ils firent leur toilette et s’habillèrent sans rien dire, chacun étant préoccupé par cette situation inextricable. Leur petit déjeuner fut pénible. Isabelle ne put retenir quelques larmes, malgré sa volonté de paraître enjouée comme d’habitude. Damien ne sut comment lui manifester sa déconvenue, puis sa peine. Ils revêtirent leur manteau, descendirent l’escalier et se dirent au revoir sans pouvoir ni s’embrasser, ni même se serrer la main. Se quitter comme deux étrangers leur serrèrent le cœur. Ils réalisèrent en une seconde l’immense solitude dans laquelle ils se trouvaient. Ils firent trois pas, se retournèrent, se regardèrent, les yeux noyés de larmes, se sourirent, impuissants, puis partirent chacun de leur côté.
Arrivé au bureau, Damien se plongea dans son ordinateur. Il chercha toutes sortes de mots-clés et commença par « manque de toucher ». Il tomba sur une note de lecture du Dr Lucien Mias intitulé Je me sens moi…parce que tu me touches. Pour lui, le toucher est le sens le plus « spécifiquement humanisé, le moins candide, le seul réaliste comme le savait Thomas et comme l'apprend très vite l'enfant ». Il poursuit : Il y a 2 500 ans, Anaxagore a dit : « L'homme est intelligent parce qu'il a des mains. » J. Piveteau renversa la formule : « L'homme a des mains parce qu'il est intelligent. » Saint Thomas d'Aquin les met d'accord : « L'homme possède par nature la raison et la main. Cette raison raisonne mal si elle n'engage pas la main. Cette main travaille en vain si la raison ne s'engage pas dans son travail. » Il apprit que certaines personnes ne supportent pas qu’on les touche : « Le contact physique, c’est pire que d’être vue toute nue. Je me sens dévoilée, j’étouffe, j’ai l’impression que c’est le début de la fin. » Mais cette recherche lui parut bientôt vaine. Rien n’est dit sur l’absence bien concrète de toucher, car ce cas-là n’existe pas avec un corps valide et en bonne santé.
Isabelle, en tant que femme, s’enferma dans son bureau et téléphona aussitôt à sa meilleure amie, Sylvie, qu’elle connaissait depuis l’enfance. Elle lui raconta prudemment leur aventure, sans toutefois s’étendre sur leur constat. Sylvie, qui était kinésithérapeute, fut bien sûr étonnée d’une telle affliction. Elle se souvint que pendant ses cours, un professeur leur avait parlé de quelques cas curieux et elle promit de la rappeler après avoir trouvé ses coordonnées. Une heure plus tard, elle rappela Isabelle et lui donna le numéro de téléphone du professeur à l’hôpital Saint Louis. Aussitôt un rendez-vous fut pris avec la secrétaire du médecin pour le lendemain. Isabelle était ravie, elle allait enfin pouvoir reporter sur quelqu’un d’autre leur souci. Son moral ravivé lui permit de passer une journée de travail à peu près normal malgré la pression psychologique de la nuit.
La journée de travail de Damien fut traversée de moments de désespoir. Il n’arriva pas à se concentrer, participa à deux réunions sans pouvoir dire un mot et partit du bureau dès 18 heures. Il n’avait qu’une hâte, retrouver Isabelle et lui demander si elle avait une solution.
07:45 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, récit, rêve, réveil, couple, peur |  Imprimer
Imprimer
28/04/2015
Un couple insolite (1)
Damien est un homme heureux. Il a épousé Isabelle il y a cinq mois. Il l’aime et elle l’aime. Ils travaillent tous les deux, mais rien ne vient troubler leur entente.
– Isabelle, Isabelle, où es-tu ? cria Damien en pleine nuit. Il venait de se réveiller. Il devait être trois heures ou quelque chose comme ça. Il avait étendu son bras droit comme il le fait habituellement. Mais il ne rencontra que le vide.
– Isabelle, Isabelle ?
– Mais je suis là, mon chéri. Pourquoi cries-tu si fort ?
– Mais où ?
– Et bien, dans le lit, à côté de toi.
Damien fouilla de son bras droit l’étendue du lit à la place où elle était censée se tenir. Mais en vain. Il se dit qu’elle avait peut-être changé de place dans la nuit. Il étendit son autre bras, jusqu’au bord du matelas, sans rien rencontrer. Doucement il fouilla des deux pieds le fond du lit. Rien. Pourtant la place était chaude.
– Isabelle, arrête de te moquer de moi !
– Mais je ne moque pas de toi, je suis là, à côté de toi.
– Mais non, tu n’es pas là, je ne touche rien. Oui, je t’entends, tu es surement dans la pièce et même pas loin du lit, mais tu n’es pas dedans. Reviens vite, je t’en supplie, la blague n’est pas drôle à cette heure.
– Je t’assure que je suis là, dans notre lit, à côté de toi. Tiens je touche ta main. Me sens-tu ?
– Oui, c’est vrai. Je sens ta caresse sur ma peau. Comment se fait-il que je ne puisse te toucher ?
– Je ne sais. Tu dois être encore endormi ou mal réveillé. Veux-tu que j’aille te faire un café ?
–Mais non, cela n’a rien à voir ! En tout cas, je ne peux te toucher. Pourtant, je t’entends et le drap est chaud de la chaleur de ton corps. Je veux ton corps. Qu’en as-tu fait ?
– Rien, il est là, près de toi.
– Mais je ne peux le toucher. Que se passe-t-il ?
Isabelle commençait à s’inquiéter : « Qu’est-ce que c’est que cette histoire. Je n’ai jamais entendu parler d’une telle situation ».
– Mais enfin, Damien, cesse de plaisanter. Je viens de me réveiller et je ne suis pas prête à ce genre de blague. Je te touche, je te caresse et tu ne sens rien. Aurais-tu perdu toute sensibilité. Je n’ai jamais entendu une telle idiotie. Un mari qui ne peut saisir sa femme alors qu’elle est dans son lit. C’est absurde !
– C’est pourtant la réalité, je t’assure. Me permets-tu d’allumer. Ferme les yeux de façon à ne pas être aveuglé, puis ouvre-les progressivement.
Isabelle fit ce que Damien lui demandait. Elle le voyait à côté d’elle, l’air inquiet, blanc comme un linge. Il la voyait, elle était bien là, mais il ne pouvait la toucher. Il ne rencontrait que le vide. Il avança le bras, tendant son index avec douceur, mais rien. Comme si sa femme n’était pas là. Et pourtant il la voyait, parlait avec elle, sentait le poids de ses mains sur son corps. Elle s’approcha de lui et lui fit un baiser sur la joue, puis sur la bouche. Il les sentit, s’en trouva mieux, mais dès qu’il essaya de la prendre dans ses bras, il ne rencontra que le vide. Rien, un trou d’air.
– Ce n’est rien, mon chéri. Rendors-toi. Demain matin tout ceci sera passé. Je serai à toi et tu seras à moi, comme d’habitude.
Ne pouvant rien faire de plus, il finit par se laisser persuader que ce n’était qu’une impression passagère qui cesserait dès qu’il aurait à nouveau dormi. « Le réveil laisse parfois des restes de mauvais rêves qui sont longs à évacuer. Et puis, elle est là malgré tout. Elle me parle, elle me caresse, je la vois, je l’entends. Ah ! Est-ce que je sens toujours son parfum chanel N°5 ? » Il se pencha sur elle, ou plutôt sur l’endroit où il croyait qu’elle se trouvait. Oui, il retrouvait ce parfum élégant qui faisait sa personnalité. Il s’y était habitué. Mais aujourd’hui cette fragrance lui tournait la tête, réveillait en lui la chaleur de l’amour, l’association entre le toucher et l’odorat.
– Ma chérie, où es-tu ? Je te sens comme lorsque je j’enfouissais mon visage dans le creux de ton cou, mais je n’ai plus cette sensation d’appartenance qui fait de l’amour un don suprême. Comment allons-nous nous aimer maintenant que je ne peux te toucher ?
– Rendors-toi, attends demain. Tout ceci n’est qu’un mauvais rêve.
Elle se tourna sur le côté, gardant la main sur la cuisse de son mari qui, lui-même, se laissa réchauffer par ce geste féminin. Il eut du mal à s’endormir. Il fermait un œil et se réveillait en sursaut. Enfin, il se laissa glisser dans un rêve sans fin le long d’un tunnel qui l’isolait de la réalité. Ce fut le noir jusqu’au matin.
07:47 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, récit, rêve, réveil, couple, peur |  Imprimer
Imprimer
04/04/2015
L'escalier
Chaque nuit, le premier jour, la première nuit le hantent. Alors se lever devient une délivrance. Dans le noir et les lueurs de la rue, il descend l’escalier. C’est une plongée dans les pensées, dans un passé perdu et un avenir à trouver. C’est le début d’une méditation. Insolite, certes ; mais vivante et transitoire.
L’escalier est étroit. C’est un trou dans un coin de la maison, encombré d’objets hétéroclites, tels que balais, sacs, bouteilles pleines, à boire les jours de spleen. Il y passe pour se simplifier la vie. L’autre, le grand escalier, encombré de livres et d’enfants ne sachant s’ils veulent monter ou descendre, est celui des jours de la normalité. Ici, c’est le puit sans fond, le hoquet dans la perception, l’effondrement des sensations. En descente, il n’y prend pas garde, tendu vers la cafetière. Une fois le breuvage pris, les secondes ont une autre dimension. Ragaillardi, il sort de la cuisine. Il éteint la lumière. Le réverbère suffit pour éclairer la première marche. Les autres se montent dans l’automatisme de la cadence d’une ritournelle. Il s’engouffre à l’entrée de l’échelle, plein des rêves d’enfance.
Cet escalier, c’est sa galerie. Elle est étouffante. Les tableaux se précipitent sur vous, collent à la rétine, vous dépouillent de vous-même, vous enserrent d’abstraction géométrique. Oui, ne sachant plus ou les mettre, il a trouvé ce recoin, cette descente en lui-même, ce puits sans fond de l’inspiration. Il y a encore quelques vides, à remplir au fil du temps et des toiles vierges achetées à la ville voisine. Il monte les marches une à une, souvent sans y penser. Mais ce matin, un pincement au cœur l’a surpris. Pourquoi ? il ne sait. En un instant, il s’est dissous dans la cage étroite, devant la géométrie abstraite. Sa vie résumée dans un placard garni d’images qui ne représentent rien. Désespoir ? Non… Délivrance…
Un courant d’air l’aspire vers le haut, ses cheveux se dressent sur la tête, c’est une chute à l’envers qui lui coupe le souffle. Il monte en spirale, à la vitesse de l’éclair, dans une ascension fulgurante, contemplant ses tableaux comme un ultime rêve à abandonner aussi. Aïe ! Il se cogne la tête au plafond. Il se retourne, les bras en croix, scotché sur le bouchon du puits de l’abstraction géométrique. Quelle singulière familiarité ! Un résumé qui sent la nuit, ouvert sur le vide. Et peu à peu, son corps traverse le plâtre, les tasseaux, les tuiles et s’évade dans l’obscurité qui finit sa java endiablée.
Le rythme des pas montant les marches, la lente progression de la main sur la rampe, le froid qui le saisit lentement, le rappellent à lui-même… Oui, il est encore là, bien vivant, éveillé. Arrivé en haut des marches, il se retourne et contemple toutes ces toiles emplies de signes géométriques. Un résumé…
07:27 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : op'art, art cinétique, abstraction géométrique, rêve |  Imprimer
Imprimer
18/02/2015
La bande dessinée
Une bande dessinée, c’est un morceau de rêve dans un monde à part. Ses héros sont de pacotille, mais quel bonheur de pouvoir un moment s’évader de la vie quotidienne. Vous partez en images à la rencontre de l’imagination débordante de l’auteur. Vous la connaissez par cœur et c’est justement pour cette raison que vous aimez vous y plonger. C’est un retour à l’enfance, le plaisir de se retrouver en culotte courte, vautré sur le lit, la bande dessinée enfouie entre les cuisses, les genoux dressés. Vous ne sucez plus votre pouce, mais c’est tout juste.
Aujourd’hui vous partez en Syldavie, ce pays charmant, d’une Europe révolue aux traditions slaves. C’est le Moyen-Age, le siècle de Louis XIV, le romantisme du XIXème siècle et l’ère communiste tout à la fois. Vous vous rêvez en prince, avec un uniforme étincelant, jouant les espions, transgressant les frontières, entouré de belles femmes. Vous vivez une autre vie, enfoui dans votre lit, au chaud, en rupture avec la société et les mondanités. C’est une cure de jouvence, un clin d’œil à votre jeunesse, un retour à la famille oubliée dans les péripéties de l’existence. Vous vous revoyez dans la chambre de votre enfance, rêvant à un avenir dont vous ne voyez pas l’issue, de même qu’aujourd’hui vous ne savez pas non plus ce que vous réserve le lendemain.
Vous ne parlez pas de destin. Celui-ci est trop figé. Il vous met dans une boite qui vous conduit inéluctablement au néant. Vous ne savez vers quoi vous allez, mais l’Autre à déjà tout décidé. Mieux même, les voyantes (elles sont bien sûr féminines), qui font preuve de beaucoup de perspicacité, vous diront cet avenir implacable dont vous ne pourrez plus vous débarrasser. Votre route est-elle tracée d’avance ? Non, surement pas. Vous croyez à la liberté personnelle. Vous croyez à un avenir inconnu, même maintenant, alors que vous atteignez un âge qui ne laisse que peu d’espoir de changement de destinée. Certes, vous pourriez encore la modifier, mais cette destinée que vous avez construite et que les autres ont également façonnée, vous appartient. Elle a laissé ses racines dans votre vie présente. Votre liberté n’est pas totale, elle doit respecter la liberté des autres et surtout leur affection. Car vous avez planté votre tente dans un paysage de bonheur et d’amour que vous portez en vous grâce à eux, ceux qui vous ont construit parce que vous les avez reconnus, fait naître ou adopter par amitié. Et votre destin n’est pas ce que la société retient de vous, mais ces instants de vérité où vous choisissez votre véritable liberté : la construction d’une vie personnelle qui se mêle à celle de vos proches et fait de vous un être à part.
Retour à la bande dessinée. Vous repartez en voyage, dans ces pays imaginaires si proches de la réalité, où les bons sont les bons et les méchants les méchants. Ah, là aussi l’existence s’est figée en un imaginaire de rêve, si peu proche de la réalité. Rien d’inconnu malgré tout. C’est le contexte bon enfant d’Hergé qui déteint sur vous. Vous ne savez plus où vous êtes. C’est votre plus grande liberté, une évasion sans fin que vous offrent gratuitement les plis voluptueux de votre encéphale.
Dieu, où donc vous a conduit cette bande dessinée. Vous endossez mille destins en rêve et vous n’en vivez qu’un. Mais combien est précieuse cette vie déroulée pas après pas dans l’ignorance totale d’un avenir inconnu. Celui-ci devient vôtre progressivement, il vous colle à la peau et vous ne pouvez vous en débarrasser. Alors adoptez-le !
07:28 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : enfance, lecture, rêve, société, destin, existence |  Imprimer
Imprimer
26/10/2014
Nuit et changement d'heure
Assis devant ma table de travail, je m’interrogeai sur ce que j’allais bien pouvoir faire, toujours un peu tendu à ces moments-là, quand l’inquiétude se mêle au bonheur de l’écran blanc. Oui, on ne parle plus de page, même si celle-ci apparaît encore, virtuellement, sous vos yeux. Je ferme les yeux et me voilà parti, monté sur la planche à surf, pourvu d’un coup d’accélérateur, comme une glissade impromptue sur une plaque de verglas.
– Attend ! Où vas-tu ? Tu pars sans savoir.
– Oui, et alors ? N’est-ce pas le propre de la vie que d’errer sans but dans l’immensité des possibilités ?
– Que d’égarements, de doublons, d’insuffisances. Maîtrise ton énergie ! Tu t’engages dans le vide et te laisse basculer dans l’inadvertance.
– J’aime l’inconnu des nuits sans sommeil, quand vers trois heures, après m’être réveillé d’un café fort, je monte dans mon antre et pars en fumée dans un ciel étoilé, sautant dans le vide, les pieds coincés sur mon snowboard. Que se passe-t-il alors ? Je ne sais. Je reviens échevelé, la tête pleine de brouillard vert, les yeux rougis, les muscles las, les oreilles tombantes. Où suis-je allé, je ne sais. Mais quel bienfaisant repos de l’esprit, quelle réjouissance du cœur, lorsque s’accumulent dans ma besace les phrases moelleuses qui gonflent mon égo et lui donne de la consistance. Sont-elles bonnes ces heures inutiles de pas de danse de l’esprit, lorsque vous perdez votre image corporelle et que tous les grains de l’existence se rassemblent en un lieu secret, inconnu des autres et même peut-être de vous-même. Je m’enfonce dans le noir des nuits d’espérance et plus les ans passent, plus ce refuge prend de l’ampleur. Un instant ouvert sur le monde. Non… Ouverture sur un autre monde, sans paysage et sans matière, où le seul plaisir est ce vide étrange qui m’attire, chatoyant, mais sans existence réelle.
– Illusion ! Tu te laisses égarer. Regarde la consistance de ta table et même de ton écran. Il vit. Les mots s’inscrivent tous seuls sur la ligne. Seul ton rêve te fait croire à l’existence de ce monde d’illusion où rien n’est comme tu l’expérimentes chaque jour.
– Mais j’aime, j’adore ces moments de repos complet de l’esprit, lorsqu’il effectue une montée spectaculaire vers l’infini. Je descends mon centre de gravité et me penche légèrement vers la droite pour amorcer un virage et éviter une planète qui me frôle. Je sens son souffle me rafraîchir. Je pourrai la cueillir, la porter à ma bouche et prendre la fièvre de l’absence, me vider totalement de mon être et devenir une coque transparente errant dans l’éther comme une bulle d’air prise dans le courant d’une eau pétillante. Et je monte, je monte toujours plus haut. Ah, attention ! Ne pas trop se laisser entraîner, la bulle risque d’éclater. Je m’interroge. Je ne serai plus, mais n’aurai pas non plus atteint la limite de la matière. Tiens bon, ouvre les yeux, attache-toi à ton corps, qu’il continue de respirer et de penser en acteur illégal, mais bienvenu.
Deux heures que je suis là. J’ai perdu la notion du temps à vagabonder dans un espace sans limite. Je me suis laissé entraîner dans l’entonnoir des réflexions qui semble faire un trou sur la couverture de l’existence. Dieu soit loué, je me suis récupéré dans ce lit douillet et chaud, comme baignant de saveurs de baisers doucereux, un peu alangui de ce voyage au-delà du temps et de l’espace. Comme sur un nuage je me suis posé et je contemple en bas la vie qui reprend. Le jour se lève, petite lueur pleine d’espoir sur une journée nouvelle. Qu’elle était bonne cette fin de nuit parmi ce rien qui est tout et qui conduit à l’immortalité. Devenu invincible, je ris à mon corps qui continue de vieillir. J’ai revitalisé ma jeunesse et mes espérances sont plus vives que jamais. Quel élixir : deux heures d’absence du monde et je peux maintenant affronter ce jour qui s’annonce pur et vierge, comme une larme de bonheur entre deux morceaux de pain noir. Ce sandwich est le bienvenu.
Un changement d’heure acidulé…
07:10 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : égarement, rêve, espoir, vitalité |  Imprimer
Imprimer
13/05/2014
La boite à musique
« Entrez, entrez, Messieurs-Dames ! » Il entra sans savoir pourquoi. Il se promenait sur l’avenue Pratel lorsqu’il se heurta à une foule massée autour d’une porte d’immeuble. C’était un cube tout simple, une construction sans beauté ni même forme. Pourtant tous semblaient espérer entrer. Au-dessus de l’entrée il y avait une pancarte : « Participer au concert, devenez musicien. » N’ayant rien à faire de cette après-midi ordinaire, il se laissa convaincre de faire la queue pour savoir ce qui pouvait se passer dans ce cube.
Enfin ! Il approchait de l’entrée. Un curieux appareil filtrait les prétendants. Certains étaient rejetés et ressortaient par une autre porte quelques mètres plus loin. Les autres étaient guidés vers un couloir étincelant et lisse qui s’étirait sans qu’on puisse en voir le bout. La personne devant lui arriva à hauteur de la machine. Il introduisit son doigt dans une petite ouverture, entra la tête dans une petite alcôve et appuya sur un bouton, Un tremblement perceptible le parcourut. Il était classé musical et entra dans le couloir. A son tour. Il fit de même. Il introduisit son doigt dans l’embrasure. Rien ne se passa. Il entra sa tête dans l’alcôve. Tout était noir. Le bruit des conversations s’estompa. Un silence impressionnant. Il appuya sur le bouton avec appréhension. Il sentit son doigt danser sans qu’il ne puisse rien faire et des bruits étranges lui parvinrent. C’étaient des résonnances singulières, des harmoniques insolites, peu en accord avec ce qu’on appelle normalement musique. Il pensa à une plainte collective, mais dont on distinguait chaque son individuellement, de manière très claire, une vibration infime, mais pure, si pure qu’elle le libérait de toute pensée. Une lumière verte s’alluma progressivement dans l’alcôve, dévoilant une entrée pourvue de nombreux escaliers. « Suivant ! » Il avait passé l’épreuve et pouvait entrer dans le cube. Au tournant du couloir, une boutique distribuait des résonophones. Il le passa sur l’épaule comme ces sacs à dos à une seule bretelle et introduisit les deux embouts dans ses oreilles. Poursuivant son chemin, il pénétra dans le hall de l’immeuble. Quelle agitation. Des gens montaient et descendaient sans cesse des escaliers pourvue de paliers où ils s’entassaient avant de repartir vers le haut ou vers le bas. Des lumières assez vives apparaissaient, s’effaçaient, coulaient entre les escaliers, avec un rythme précis. Les patients (d’où tenaient-ils cette appellation ?) suivaient le rythme avec grâce, un sourire aux lèvres, concentrés. Parfois, certains se regroupaient sur plusieurs étages, formant une sorte de chapelet et leur sourire s’élargissait en une transe passagère. Puis chacun repartait vers le haut ou le bas, à droite, jamais à gauche. Si on les suivait du regard, on bouclait le tour du hall et on revenait au point de départ, mais pas forcément à la même hauteur. Tous avaient l’air de savoir parfaitement ce qu’ils avaient à faire. Ils n’hésitaient pas. Monter, à droite, descendre d’un étage, remonter de deux étages et redescendre sans pause ou encore en s’arrêtant sur un des nombreux paliers affectant chaque escalier.
Il se souvint d’un cours de sciences naturelles dans lequel des souris parcouraient des tubes transparents et pouvaient choisir leur destination. Elles étaient gratifiées de petits courants électriques si leur choix se portait sur la gauche. Alors elles tournaient, tournaient jusqu’à ce qu’elles meurent d’épuisement. Quelques générations plus tard (il avait fallu attendre plus d’une année pour le constater), ces souris ne pouvaient plus marcher droit devant elle. Les pattes de gauche avaient forcies, celles de droite s’étaient tassées. Le laborantin n’était jamais arrivé à reproduire le phénomène inverse et les souris préféraient mourir sur place plutôt que tourner à gauche. Personne ne comprenait ce phénomène, une sorte d’aimantation pour la droite, repoussoir de toute velléité gauchère.
Il se laissa faire par le mouvement qui s’imprimait dans sa tête. Il montait, descendait, s’arrêtait sur tel palier, repartait, avançant vers la droite imperceptiblement. Peu à peu, il se sentit plus léger, plus en forme. Il commença à transpirer, mais très légèrement. Il devait accélérer parfois et d’autres fois ralentir, jusqu’à s’arrêter pendant de petites pauses. Puis il repartait, seul ou avec d’autres, vers un nouvel épisode. Il parcourut quasiment tous les étages, de haut en bas, de gauche à droite, jusqu’au retour au point de départ. Il était soulé, repu, rafraîchi, débarrassé de tout souci, le visage étincelant de bonheur, comme saisi d’une fièvre bienfaisante. Sans qu’il s’en rendit compte, il fut dirigé vers une salle plus petite, à l’éclairage réduit, munie de sièges confortables. Il s’assit, sans un regard pour ces voisins, ferma les yeux et s’endormit aussitôt. Mais était-ce réellement le sommeil, plutôt une sorte de rêverie éveillée qui le maintenait sans volonté. La séance commençait. Il vit d’abord comment s’opérait le choix des patients à l’entrée. Les lignes des empreintes digitales entraient en résonnance. Si cela ne se produisait pas, le passant était rejeté sans explication. Le résonophone ne laissait pas entendre de musique. Il permettait de créer la musique. Le patient ne l’entendait pas, mais il suivait les directives de la partition sans qu’il puisse s’y opposer. Il montait, descendait, s’arrêtait, accélérait, ralentissait, sans même avoir l’impression d’obéir à des ordres précis. Tout ce qu’il faisait lui procurait une grande sensation de liberté. Et il vit l’envers du décor, une petite pièce sans fenêtre où plusieurs techniciens étaient assis face à de nombreux cadrans et boutons qu’ils tournaient dans un sens ou dans l’autre selon des ordres précis. Un chef d’équipe tenait une sorte de baguette de sourcier et s’agitait en cadence en suivant un cahier ouvert devant lui. On montra certaines pages couvertes de signes : des lignes parallèles sur lesquelles se promenaient des ronds noirs ou blancs, généralement pourvus d’une queue dressée vers le haut ou le bas. Certaines se tenaient par la main, formant une sorte d’échelle horizontale qui pouvait se prolonger jusqu’à un rond sans queue qui marquait une pause. Il ne comprit pas grand-chose devant cette petite usine concentrée dans laquelle chacun semblait savoir exactement ce qu’il avait à faire. Parfois, un technicien levait les sourcils, comme sous l’effet d’une sorte de transe. D’autres fois, l’un d’eux se concentrait plus profondément, l’œil vif, le geste délié et entamait une sarabande endiablée. Les autres le regardaient, semblaient approuver, admiratifs de ces mouvements singuliers. Ils s’entendaient bien et donnaient un sentiment de sécurité et de puissance inhabituel.
Le noir se fit dans la salle et une étrange musique le contraint à se concentrer. Il ne put résister. Elle s’empara de lui à tel point qu’il ne savait plus où il se trouvait. Aucun repère visuel et les repères auditifs changeaient sans cesse. Son siège se mit à bouger. Il montait et descendait au rythme de la musique. Il fut pris de vertige. Il se laissa aller, enivré, goûtant cette détente involontaire jusqu’à la fin du morceau. Repu, il récupéra quelques instants. La lumière se fit dans la salle. Il fut invité à sortir. D’autres personnes attendaient leur tour. Il se retrouva dans la rue, encore mal remis de cette expérience étrange, mais somme toute agréable. Le ciel lui parut plus bleu, les rues plus propres, les gens plus souriants, le quotidien plus avenant. Il était passé dans la machine à laver les humains, inventée par les anges qui s’ennuyaient au paradis et qui faisaient de la musique pour se distraire.
07:20 Publié dans 43. Récits et nouvelles, 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, société, réalité, rêve |  Imprimer
Imprimer
12/04/2014
Bertrand Flachot, photographe et dessinateur
Bertrand Flachot ne se contente pas de prendre de bonnes photos, il les "enrêve" de barbe à papa et les transforme en paysage magnifique et évocateur qui prolonge la réalité au-delà de l’espace stricte de la photo elle-même.


Oui, ce sont bien des photos, soignées et enjolivées de traits brouillons et sans forme qui leur donnent un air d’irréel plein de charme.
Il élabore ainsi des séries : arborescences, sédiments, diffractions, involutions, qu’il compose avec patience, acharnement, jusque dans la galerie en débordant sur les murs. Il a dû, enfant, être le champion du gribouillage, et cela lui a réussi, car c’est un artiste et non un communicateur qui cherche à en mettre plein la vue.
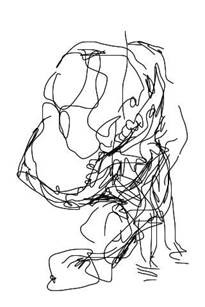
Voici ces cahiers de dessin : des cartes du temps et de l’espace, trace de l’homme dans l’éternité. Oui, c’est beau de simplicité et d’innocence.

La montagne vient à lui, s’insère dans la maison, se fond entre les murs, imprégnant l’atmosphère de paysages obsédants et de neurones qui pénètrent la conscience. Est-ce une photo, un dessin, un rêve, une réalité flou. On ne sait et peu importe. Ce qui compte, c’est l’impression que le sujet procure à celui qui le regarde.

Même l’humain est sujet d’étonnement frisotté d’un romantisme délicat :
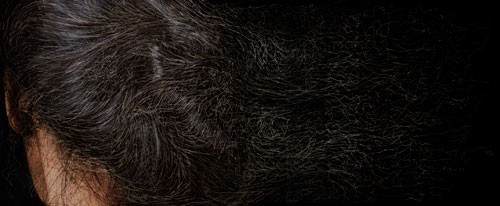
Allez voir cet artiste étonnant à la Galerie Felli, 127 rue Vieille du Temple 75003 Paris. Vous ne perdrez pas votre temps et en découvrirez un autre !
07:33 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : dessin, photographie, impression, rêve, beauté |  Imprimer
Imprimer
10/01/2014
Les insomnies de François Ducassier
François Ducassier se leva brusquement, dit à peine bonsoir et sortit dans la nuit. Il avait hâte de se coucher. Arrivé chez lui, il se changea et s’offrit aux dieux de la nuit.
A deux heures quarante-cinq, il se réveilla. Il ne reconnut pas sa chambre au papier de fleurs mauves. Il tendit la main vers la petite table où se trouvaient ses lunettes et trouva le flanc de bois massif d’un meuble important, une commode probablement. Il chercha vainement le fil électrique et le commutateur. Alors il se dressa sur son lit. Il lui sembla plus haut, plus large, plus imposant. La lumière lunaire permettait de distinguer la masse des objets qui peuplaient la chambre. Lourdeur, pensa-t-il. Il sortit ses jambes, les laissant pendre sur le bord du lit sans qu’elles touchent par terre. Ses pantoufles étaient encore là. Il sauta, les enfila, passa une robe de chambre et, tendant les bras en avant, marcha vers ce qui était auparavant la fenêtre. Il n’y avait qu’une glace qui reflétait les pâles rayons diffusés par une autre ouverture, à gauche. Il trouva enfin un commutateur électrique. Hésitant, il alluma et poussa un cri étouffé.
Ce n’était pas sa chambre. Plus solennelle, elle était large, revêtue d’un épais tapis, chargée de meubles imposants, un bureau empire, une commode Louis XVI, une table entourée de quelques chaises. Elle était ornée de miroirs encadrés richement et de tableaux représentant des campagnes foisonnantes. La fenêtre s’entourait de rideaux lourds, surchargés de perroquets opulents. Il se rassit sur le bord du lit, plongeant en lui-même pour essayer de se souvenir de ce qu’il avait fait la veille. Oui, il s’était bien couché dans sa chambre. Alors que faisait-il là ? N’ayant pas de réponse, il entrouvrit la porte et contempla le long couloir sur lequel s’ouvraient de nombreux seuils, tous semblables. Il sortit, laissant ouverte la porte de cette chambre insolite et fit quelques pas. Pas un bruit, pas un mouvement signalant une présence. Un tombeau ! Il courut jusqu’au bout du couloir, un escalier s’ouvrait montant et descendant autour de son axe central. Il monta un étage. Même couloir encadré de portes imposantes. Il poursuivit un étage plus haut, puis deux, puis trois. Même désolation opulente et silencieuse. Alors, il redescendit cinq étages, toujours le même couloir. Se penchant par-dessus la rampe, il vit une interminable descente d’escalier qui s’enfonçait dans la terre, sans fin, comme une illusion d’optique. Levant la tête, même impression, une hélice tourbillonnante sans limite. Il remonta d’un étage, traversa le couloir et retrouva la porte de sa nouvelle chambre, entrouverte sur son opulence. De guerre lasse, il se recoucha, réfléchissant à ce qui lui arrivait. Mais à peine s’était-il installé confortablement, qu’il s’endormit.
Le lendemain matin, il se réveilla dans sa chambre, la vraie, celle qu’il connaissait depuis toujours, plus modeste et familière. Il se rappela ce réveil inconfortable, son errance dans les couloirs, l’escalier sans fin. L’impression d’infini lui serra à nouveau le cœur, lui laissant une vague nausée dans la gorge. Sa journée se déroula normalement, mais il ne se sentait pas réel. Un léger décalage s’était emparé de sa vision habituelle. Il se regardait travailler, déjeuner, converser, se promener. C’était un autre lui-même, en tout point semblable, mais il n’était pas au centre de ce personnage, au centre de son monde et même du monde en général. Cet imperceptible décalage n’était pas véritablement gênant en soi, mais il le mettait mal à l’aise. Il allait comme s’il avait un caillou dans sa chaussure, claudiquant dans sa présence face au temps qui coule.
Le soir, il rentra plus vite que d’habitude. Il se coucha, songeant à mettre à portée de main une boite d’allumette, une lampe électrique et ses lunettes. Il s’endormit sans appréhension, comme chaque jour. A deux heures quarante-cinq, il se réveilla. Même changement de chambre, même impression de grandiloquence et même silence. Il se leva, marcha vers la porte, l’entrouvrit. C’était le même couloir avec les mêmes portes et, au fond, la cage d’escalier. Il parcourut sa longueur pour se retrouver devant la vertigineuse montée ou descente. Il se sentit suffoquer. Une odeur de mort semblait l’engloutir. Il regagna péniblement sa chambre, se recoucha et n’eut à nouveau aucun mal à s’endormir.
Pendant presqu’un mois, la même aventure se renouvela. Il dépérissait. Ses yeux rougis par l’insomnie ne reflétaient qu’une immense inquiétude. Il marchait à côté de lui-même, regardant son ombre vivre, manger, rire et parfois pleurer. Il entama une liaison avec une jeune femme drôle et enjouée qui lui permit de survivre. Lorsqu’il la serrait dans ses bras, il avait l’impression d’exister. Son parfum sucré remplaçait la senteur de mort qui l’habitait toutes les nuits. Il revivait, prenant un certain intérêt à pétrir la chair tendre et ferme du corps de cette femme qui tous les matins le sortait de sa prison imaginaire ou réelle.
Un jour, le trentième du mois, il lui parla de ce rêve réel qui l’assaillait. Elle eut l’air étonné, mais sans plus. La première nuit, elle s’efforça de se tenir éveillée, mais s’endormit à deux heures. La deuxième nuit, elle mit un réveil sous son oreiller, ouvrit un œil et s’assit sur le lit sans faire de bruit. Elle attendit. A deux heures quarante-cinq, il se leva d’une manière tout à fait naturelle, et sortit. Il rentra trois-quarts d’heure plus tard et se recoucha comme si de rien n’était. Au petit déjeuner, dans l’intimité du matin, elle lui raconta ce qu’elle avait vu. En fait rien d’autre que cette sortie qui lui semblait normale. Elle le serra contre elle, l’enfermant dans ses effluves qui l’enivraient joyeusement et accepta un retour dans les draps froissés. Chaque matin, elle écoutait le récit de la nuit, toujours le même et à chaque fois elle l’emportait dans l’ivresse de l’amour jusqu’à lui faire oublier l’épisode nocturne qui le faisait dépérir. Enfin vint le jour où il dormit sans être réveillé. Le lendemain, il n’eut rien à raconter si ce n’était sa délivrance. Alors elle se leva, revêtit avec lenteur sa robe blanche qui lui tombait sur les pieds, se maquilla, rangea ses quelques affaires dans une petite mallette, l’embrassa sur la bouche et sortit en laissant la porte ouverte. Pas un mot ne fut échangé, pas un geste qui pouvait dire « ne pars pas ». Et d’un coup, le décalage devenu habituel s’interrompit.
L’esprit de François avait retrouvé sa place dans son corps, au centre de lui-même. Une vague nostalgie restait en lui. Elle se manifestait le soir avant de se coucher. Mais dès qu’il fermait les yeux tout s’évanouissait. Il ne resta bientôt rien de cette division du temps et de l’espace qu’il ne comprit jamais, et qu’il finit par oublier.
07:55 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, littérature, écriture, rêve |  Imprimer
Imprimer
02/05/2013
L'échappatoire
Quelque part, en France, il existe une installation très spéciale sur un fleuve : un bac à double sens permet de le franchir. La plupart des gens l’évitent. Il est perdu dans la campagne et un pont suspendu se trouve à quelques kilomètres. Seuls ceux qui ne le connaissent pas ou les habitants des villages des deux rives s’essayent à franchir le fleuve à cet endroit. Deux gardiens, employés par la commune, sont là pour le péage. C’est une obligation légale établie lors de la construction des bacs il y a plusieurs dizaines d’années. Le montant du passage est suffisamment élevé pour qu’on soit obligé de passer à plusieurs. Mais le prix n'est pas fixe. Il dépend du nombre de passagers pour la traversée dans un sens, mais aussi dans l’autre sens. Il dépend également du poids des impétrants, de l’heure de la journée, du passage des bateaux assez fréquent en milieu de journée et de l’humeur des gardiens. Le péage est fondé sur la capacité à négocier de celui qui veut tenter l’aventure. Car il faut avant tout trouver un leader qui prend à sa charge cette mission périlleuse.
La négociation commence entre les demandeurs d’une rive. Combien acceptent-ils d’investir pour traverser ? Quatre euros, cinq, voire sept ? La discussion dépend bien sûr du nombre de personnes, mais aussi du temps de négociation et de l’heure à laquelle elle se termine. Lorsqu’ils se mettent d’accord, une entente réelle a pris forme et ils défendront leur point de vue envers et contre les volontaires de l’autre rive. Le leader va alors voir le passeur, lui donne le chiffre atteint et reprend la négociation avec lui. Souvent, le chiffre demande quelques ajustements de la part du groupe qui finit par consentir à ajouter quelques dizaines de centimes. Le gardien appelle alors son collègue par téléphone. Il est assez fréquent qu’il n’ait pas en face un groupe semblable prêt à traverser. Il faut alors attendre. Certains groupes jouent aux cartes, d’autres observent les mouettes tracer dans l’air des courbes vertigineuses, quelques-uns, mais peu, ne se parlent pas et attendent en silence. Lorsque le groupe opposé est prêt – ce qui signifie qu’il a effectué les mêmes opérations de négociation – le leader, par l’intermédiaire du gardien entame la négociation entre les deux groupes. Elle peut durer. Certains s’entendent très vite, mais il est arrivé qu’elle se prolonge au-delà de la journée. Généralement elle se situe entre quinze minutes et une heure. Chaque leader met son point d’honneur à ne pas céder aux exigences de l’autre. Ce sont parfois les autres membres du groupe qui finissent par accepter les conditions outrancières de l’autre rive. Les gardiens ont également leur mot à dire, en fonction des différentes variables exposées plus haut. Habituellement ils anticipent d’un quart d’heure le changement de tarif : arrivée d’un train de bateaux, passage d’une perturbation atmosphérique ou tout autre élément ayant un poids sur le prix. Lorsque les négociations sont terminées, on débouche une bouteille de part et d’autre de la rive et on la laisse ouverte sur la table dans le bureau des passeurs. Le groupe s’entasse dans la barge, le gardien revêt son casque, met le moteur en route, donne un coup de sirène et commence la traversée. Le croisement des groupes s’effectue généralement au milieu. On s’invective à pleine voix, les hommes gesticulant de part et d’autre. Certaines femmes agitent leur parapluie en poussant de petits cris. Puis les embarcations s’éloignent l’une de l’autre et l’on n’entend plus que le clapotis des vagues sur la coque. A l’arrivée, tous se précipitent dans le bureau des gardiens pour voir la bouteille dont le prix avait également été négocié. Le leader la prend, emplit de manière équitable chaque verre, et chacun boit religieusement le fond d’alcool auquel il a droit. Lorsque la dégustation est finie, on se salue d’une inclinaison de la tête et chacun repart vers ses occupations, heureux d’être enfin parvenu de l’autre côté.
Pourquoi, me direz-vous, ces gens perdent-ils un temps précieux à ces opérations difficiles et aléatoires de négociation au lieu d’aller traverser sur un pont somme toute assez proche ? C’est le seul endroit en France où l’on trouve un tel système. Il est en fonctionnement depuis pas mal de temps et personne ne le remet en cause, même pas les maires des deux communes qui payent les deux gardiens. Ce que l’on peut dire, c’est que c’est également le seul lieu en France où il n’y a ni crime, ni délit. Le rôle du bac est d’établir un lien social et quasi éthique entre les habitants des deux villages. Ils se connaissent bien, s’estiment pleinement, s’invectivent fortement sur le bac et apprécient de pouvoir boire un coup chaque fois qu’ils traversent la rivière. La négociation tient lieu de trop plein à leur agressivité. L’ai-je rêvé ou est-ce vrai ?
07:14 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : conte, rêve, création |  Imprimer
Imprimer
26/10/2011
Imagination périlleuse du rêve
Imagination périlleuse du rêve qui navigue entre la veille et le sommeil. Le souvenir en reste plus fidèle, comme un parfum d’amertume que l’on traine avec soi tout le jour, après avoir entrouvert une porte défendue et entraperçu les images de réminiscences ignorées.
Imagination et rêve : souvenirs, évaporation de la pensée, création pure, qu’est-ce ? Une torpeur tiède qui se fabrique le matin quand les draps vous enveloppent de chaleur et que les cloches de l’angélus réveillent en vous l’idée d’exister. Parfois une idée sera reprise après le réveil et pourra même vous éclairer pendant la journée, vous aider à sortir d’une impasse de la création. D’autres fois, elle vous empêchera de surmonter la douleur de l’enfantement des idées et vous contraindra à rester en attente tout au long du jour, jusqu’à la nuit bienfaitrice qui balaiera cette léthargie.
Ne pas s’abandonner à de tels délices, mais au contraire refreiner tout excès d’imagination hors de l’imagination créatrice. Tourner son imagination vers la réalité et y englober l’univers entier jusqu’à en faire la vie.
01:04 Publié dans 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rêve, imagination, création |  Imprimer
Imprimer
16/07/2011
Lever de soleil derrière la montagne
Derrière la montagne, se cache l’avenir, incertain, trouble certes, mais lumineux, attirant comme les bras d’une femme.
Le reflet laiteux dans l’ombre de la montagne n’est qu’un pâle souvenir du passé qui s’estompe devant un avenir inconnu, mais combien captivant.

Cette toile à l’huile n’emploie qu’une seule couleur, ocre brun très foncé ou ocre rouge jaune très clair, les deux plus ou moins blanchis. L’ocre est en Afrique la couleur de l’initiation. C’est une des plus beaux pigments naturels encore utilisés de nos jours. Elle est inaltérable, ce qui explique la conservation des peintures pariétales. Sa chaleur envoûte, sa couleur charme le regard, sa profondeur entraîne à la rêverie.
06:44 Publié dans 23. Créations peintures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, rêve, montagne |  Imprimer
Imprimer
25/05/2011
Gnossienne n°3, d’Erik Satie
Une bonne interprétation, mélancolique, ni trop vite, ni trop lentement, mais quel dommage ce choix de prise de vue :
Une autre interprétation qui laisse le rêve courir à la surface de la peau :
Une troisième interprétation qui accélère probablement un peu trop l’énoncé du thème, mais qui soutient un rêve serein :
Enfin, une dernière interprétation, tout aussi bonne, permettant une autre entrée dans la musique de Satie :
Un rêve éveillé.
Le thème s’annonce une première fois, très simple, en deux phrases musicales, comme un souvenir qui surgit dans la mémoire, sans qu’il constitue réellement une pensée précise. La première phrase, de 3 notes doublées, est reprise dans la seconde, de quatre notes, doublées également, comme une sorte de réminiscence vague de la première, un peu différente, mais avec le même rythme et la même tonalité, comme une évocation plus précise. L’ensemble du thème constitue une mélodie en écho, précise, mais donnant une profondeur insolite à son énoncé. C’est un souvenir de repos dans la campagne, un jour de printemps, en haut d’une colline, et vous contemplez à moitié endormi le paysage qui s’étend à vos pieds, calme, silencieux, presque sans mouvement. L’eau y coule au fond d’une petite vallée et ce sont les chatouillements de ses variations qui créent cette musique enjôleuse. On l’entend de loin, comme un vague rappel d’une vie chatoyante, mais ensommeillée.
Ce thème en deux parties est alors énoncé à nouveau et permet au cerveau détendu de relier ses impressions une nouvelle fois pour qu’elles puissent ensuite donner libre cours à leurs variations en changeant de ton. Ce changement de ton ne brise rien du rêve musical. Il reprend dans un même rythme une nouvelle version de la mélodie, une fois, avant de se lancer dans une phrase improvisée proche du thème initial, comme si l’eau ne s’écoulait plus avec la même saveur, multipliait ses frémissements et semblait dire : « Ecoutez-moi, je suis la permanence et l’immanence cachée, écoutez-moi, laissez-vous aller dans cette torpeur infinie et goutez cet instant ! »
Et le thème musical revient, dans un autre ton, plus bas, toujours aussi calme et enjôleur, une première fois, puis une seconde avant, à nouveau, de se lancer dans une envolée improvisée, comme si un papillon venait interrompre le charme de l’eau pour lui substituer son vol, léger, imprévisible, discontinu, mais serein. Et cette cascade de sons se renouvelle avant de se perdre dans l’accompagnement rythmé, peu audible, comme un soutien à la rêverie, mais jamais comme une harmonisation chargée de donner du volume à la mélodie. Cet accompagnement reste indépendant du déroulement de la mélodie, comme un léger souffle d’air dans la campagne qui ajoute à la sérénité du lieu.
En conclusion, retour de la mélodie initiale, toujours en deux phrases, 3 notes doublées, suivies de quatre notes également doublées, un première fois, puis une seconde, qui se termine par un ajout de deux notes doublées, montantes, sorte d’envoi vers la poursuite de ces instants de rêve.
Comme cette musique est belle de simplicité, de calme, presque de recueillement, non pas au sens religieux du terme, mais dans l’enveloppement d’un halo insaisissable qui donne à l’écoulement du temps une forme nouvelle, celle d’un absolu présent qui s’enfuit malgré tout lentement, si lentement qu’on le perçoit comme une durée illimitée. Paul Landormy (La musique française après Debussy, Gallimard, 1943), explique que Satie a la pudeur de ses émotions. En effet, on trouve dans sa musique une retenue secrète, comme un regret de la vie qui s’échappe par tous les pores de la peau.
Oui, malgré tout ce que l’on dit de lui, homme versatile, immoral, humoriste, impressionniste, prophète, éternel précurseur de nouvelles formes musicales, mais ne les exploitant jamais, Eric Satie est un grand musicien qui sait charmer l’esprit au travers de sensations quasiment corporelles.
Un site permettant de faire connaissance avec Eric Satie :
http://www.musicologie.org/Biographies/satie.html
Enfin, la partition :
03:31 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, rêve |  Imprimer
Imprimer
19/03/2011
Une tasse de thé, au matin
Au matin, lorsque rien encore ne bouge, ni dans la maison, ni même au dehors, parce qu’il est tôt et que la nuit continue d’envelopper les rêves des dormeurs, je me lève, l’esprit éveillé, heureux de cette nouvelle journée qui commence. Je descends l’escalier, je traverse les pièces du rez-de-chaussée, sans allumer parce que j’aime ce défi de l’enfance de marcher dans le noir sans toucher les meubles et objets qui les encombrent, avant d’atteindre la cuisine, refuge initial du matin.
Pendant que les ampoules tardent à éclairer correctement tout ce qui n’est pas dans un cercle proche (oui, ce sont des ampoules basse consommation, tellement basses qu’elles peinent dans un premier temps à éclairer), je mets de l’eau fraiche dans la bouilloire et attends que ses premiers sifflotements se soient fait entendre pour ouvrir la porte du buffet, encouragé par son odeur de vaisselle propre, et sortir une tasse, une soucoupe et une cuillère. Je vais ensuite chercher un sachet de thé dans le placard qui abrite des trésors de futurs festins, pendant que la pièce s’éclaire d’une douce lumière et dévoile les secrets de ses recoins. La bouilloire enfin arrêtée se tait.
Alors commence la délicate activité de l’infusion du thé dans l’eau chaude. Celle-ci commence faiblement par une lueur à peine orangée qui se dissout au fond du bol, puis s’élargit en nuage intérieur, l’eau restant claire sur les bords alors que progressivement sa cavité se colore d’une couleur indéfinissable en perpétuel changement. L’odeur du thé envahit les narines, dilatant les bronches, caressant gentiment les sens jusqu’à les envelopper d’un engourdissement provisoire, avant de s’évaporer dans la lueur de l’ampoule situé au dessus de la table.
Après avoir plusieurs fois sorti le sachet, laissé le contenu de liquide s’écouler dans la tasse, diluant un nuage plus foncé que celui du breuvage initial, puis l’avoir laisser tomber à nouveau dans l’eau de plus en plus colorée de celui-ci, geste qui me rappelle celui du goupillon que l’on trempe dans le bénitier pour saluer une dernière fois celui qui est passé de vie à trépas, je pose le sachet sur un coin de l’évier comme une dépouille molle et sans couleur qui n’a plus d’utilité mais que l’on pourrait peut-être réutiliser s’il s’avérait que le breuvage n’est pas suffisamment fort ou parce que j’aurais ajouter un peu d’eau après en avoir plusieurs gorgées. J’arrête alors toute spéculation gestuelle, attendant que le breuvage soit buvable, c’est-à-dire moins chaud. Instant d’innocence ou d’impatience, quand le désir ne peut être satisfait dans l’immédiat et qu’il convient de laisser le temps user les secondes dans la torpeur matinale. L’infusion de thé fume, envahissant le halo de lumière du plafond d’un brouillard léger et tiède. Pour m’occuper, je regarde au dehors la nuit qui peu à peu s’ouvre d’une mystérieuse blessure, comme une fente dans sa chair, et laisse apercevoir la ligne d’horizon, qui se réduit à une dentelle d’arbres au loin, dans un pays encore inconnu des dormeurs.
Impatient, je hume les effluves sortant de la tasse, me rapprochant de celle-ci jusqu’à la toucher délicatement, du bout des lèvres, prudemment, comme un baiser sur la joue d’un enfant, dont l’odeur aigre est la conséquence de ses jeux endiablés dans le jardin. Mais la puissante chaleur de la boisson m’incite à une grande prudence, comme la crainte et le désir de toucher un cadeau qui ne vous a pas encore été donné. Attendre encore un peu que je puisse tremper mes lèvres dans ce breuvage odorant, odeur sucrée de feuilles et de fruits sur laquelle traine malgré tout le goût du foin en juillet à la tombée de la nuit, mais de manière presqu’imperceptible. S’il est trop chaud, le liquide ne laisse plus diffuser ce parfum qui est remplacé par une impression de brûlure. Attente donc, avec un regard sur le levée du jour, comme un halo dans une vision trouble parce qu’indéfinie en raison du manque de clarté.
Reprise de la tasse, les doigts sur le haut de la courbe, à l’endroit où se posent les lèvres, en raison de la chaleur extrême de sa cavité arrondie et plus encore de son fond qui repose sur la table et y laisse une empreinte de vapeur faite de petites bulles très légères, qui éclatent autour des poussières déposées sur l’horizontalité du bois. Je trempe les lèvres sur la surface du liquide ocre rouge, aux reflets parfois orangés, frontière entre l’air et l’eau, infime partition des éléments dont on a du mal à définir l’exacte lieu du passage entre l’un et l’autre, jusqu’à ce qu’à l’aspiration ténue, je sente monter vers le palais le parfum odorant des fruits chauds avec cet arrière goût d’herbes sèches qui restent le souvenir de ces premières gorgées, à l’aube, au sortir de l’hiver. Je ferme les yeux et me laisse pénétrer par cette lente ouverture intérieure qui empoigne l’être lorsque l’invisible se dévoile subrepticement quand on ne l’attend pas. Alors éclate une nouvelle appréhension de la vie, de ces instants privilégiés du matin, qui donne au jour nouveau un goût d’inattendu et de pourtant connu. Ce n’est pas la madeleine de Monsieur Proust, mais la joie toujours renouvelée d’un instant où tout bascule vers un monde où l’intérieur et l’extérieur se confondent dans une même vision de plénitude ressentie intégralement.
Mais le thé est encore trop chaud pour être réellement bu. On n’en saisit que quelques subtiles impressions qui ne peuvent se transformer en félicité. Frontière indescriptible, parce qu’inappréciable physiquement, entre le moment où le thé est encore trop brûlant pour être bu en chaleureuses gorgées et déjà trop refroidi pour être apprécié dans l’intégralité de son arôme. Ce moment passe sans que l’on prenne conscience de son passage, et, soudain, le thé devient un breuvage comme les autres, que l’on boit par habitude parce qu’il faut boire quelque chose le matin avant de faire sa toilette et de se vêtir des vêtements appropriés à ce qui est projeté de faire. On le boit alors à grandes gorgées, tentant de retrouver la senteur paradisiaque dont on s’était promis de jouir lorsqu’il était encore brûlant. Et bientôt, reposant la tasse déjà tiède sur la table, on ressent une impression d’absence au plus profond de soi, comme un rêve que l’on a laissé filer par inadvertance ou besoin de sommeil. Alors l’on se lève, encore un peu alourdi par les restes de sommeil, mais surtout par cette insatisfaction que l’on ne peut maîtriser : trop chaud, trop tiède, où se trouve le juste milieu ?
07:24 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : réveil, matin, thé, rêve |  Imprimer
Imprimer
05/02/2011
Revenir, comme après un long voyage
Revenir, comme après un long voyage,
Dans ces pièces qui abritent vos souvenirs,
Ou plutôt les objets qui font que vous êtes vous-même,
Depuis vos cahiers d’écolier abritant vos impressions
Cueillies au fil des années, jusqu’au goût subtil
Des salades préparées par la même main amoureuse.
Retrouver intacte également la brillance du secrétaire
Comme un objet de collection utilisé quotidiennement.
Se réjouir du silence feutrée qui colle à l’appartement
Et emmitoufle nos pensées de mièvres délices.
Attention, ne pas se laisser envahir par cette quiétude amère
Qui, progressivement, noie l’esprit dans un tourbillon d’images
Sans suite, sans fin, sans consistance, sans pouvoir sur le monde.
Le retour doit rester un commencement et non une continuité.
Donner les éclairs nécessaires à la redécouverte
Comme la foudre transperce le ciel bleu nuit, un soir d’été.
Par exemple, le confort dodu du lit,
Comme un édredon de crème fouettée et de fraises des bois,
Ou cette place préférée dans le canapé, façonnée au fil des jours,
Comme un creux de mollesse et d’habitude,
Ou encore la plainte verdoyante des pieds du fauteuil
Noyés dans la forêt de troncs qui encombre le salon.
Oui, ouvrir les yeux sur une nouvelle réalité
Ou de nouvelles sensations ou des perceptions inédites.
Quel plaisir d’éprouver pour un quotidien dépourvu d’attraits
Des sentiments qui serrent le cœur, dégazent l’esprit,
Ouvrent des perspectives roses dans un ciel bleu cobalt.
Vert comme une pomme ou un élastique sucré,
Le paysage de notre vie quotidienne prend le poids de l’avenir,
Débarrassé du passé, dans la désaffection des réminiscences,
Difficilement présent par manque de consistance,
Ouvert à l’inconnu, tendu vers un horizon improbable,
Et pourtant attrayant comme une sucette glacée.
07:49 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, poésie, rêve, retour |  Imprimer
Imprimer
09/12/2010
Rêve
C'est ainsi que j'imagine les rêves : Des contextes plus ou moins différents qui s'expriment par le fond du tableau et des bulles qui éclatent et créent des événements. Alors l'imagination s'en donne à coeur joie.
Cela donne une certaine cohérence dans l'incohérence, tout ce qu'il faut pour revêtir de légèreté l'optimiste béat.

18:27 Publié dans 24. Créations dessins | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : dessein, peinture, beauté, rêve |  Imprimer
Imprimer













