08/05/2012
Tuer le père, roman d'Amélie Nothomb
D’emblée, Amélie Nothomb introduit au cœur de l’intrigue, un duel entre deux visions éthiques de la vie. L’un, Joe Whip, joueur invétéré, très doué de ses mains, l’autre, Norman Terence, hippie bon enfant, qui ne triche pas.
Le premier rencontre le second par l’intermédiaire d’un homme, un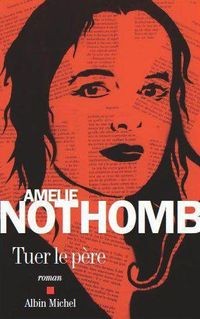 belge, sans que l’on sache ce qu’ils se sont dits. Joe s’introduit dans le couple Norman-Christina et devient pratiquement leur fils, malgré un manque évident de différence d’âge. Norman lui enseigne les tours de cartes et lui apprend, contre son gré, à tricher. Le récit développe ensuite le combat entre les deux hommes, le second voulant faire du premier son fils adoptif, malgré les tricheries, l’absence de reconnaissance, les attaques de son couple, l’indifférence de Joe.
belge, sans que l’on sache ce qu’ils se sont dits. Joe s’introduit dans le couple Norman-Christina et devient pratiquement leur fils, malgré un manque évident de différence d’âge. Norman lui enseigne les tours de cartes et lui apprend, contre son gré, à tricher. Le récit développe ensuite le combat entre les deux hommes, le second voulant faire du premier son fils adoptif, malgré les tricheries, l’absence de reconnaissance, les attaques de son couple, l’indifférence de Joe.
Qu’en retenir ? Eh bien, je ne sais. Le récit est assez inhabituel chez l’auteur. Le ton également. On était habitué à plus d’humour et plus de verve. Ce n’est pas que le récit s’éteint par manque de vigueur. Non. Mais en fermant le livre, quel arrière-goût ! Un rien nous gène pour dire qu’il s’agit d’un bon roman. Le manque d’explication sur l’attitude de Joe ? L’incompréhensible pari entre Joe et le belge au détriment de Norman ? Tout cela laisse un goût amer malgré la nouveauté de l’écriture et de l’ambiance générale du livre.
Au fond, un bon livre est celui qui apporte un plus à notre manière de voir le monde. Là, on reste perplexe, que signifie tout ceci ?
06:36 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman |  Imprimer
Imprimer
03/05/2012
Le Zubial, roman d’Alexandre Jardin (Gallimard, 1997)
Le Zubial n’est ni un oiseau, ni même un animal, c’est un humain, le père du narrateur. Il est mort à quarante-six ans, mais son souvenir est si vivant qu’il transcende la tristesse et fait régner une joie intérieure à défaut des farces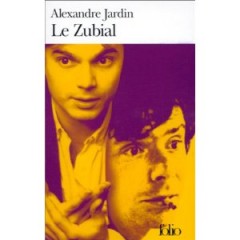 extérieures. La joie communicative qui émanait du Zubial était faite d’un étrange parfum d’irréalité, lequel tenait à la façon de tout revisiter à l’aune de ses fantasmes et son goût pour les situations invraisemblables.
extérieures. La joie communicative qui émanait du Zubial était faite d’un étrange parfum d’irréalité, lequel tenait à la façon de tout revisiter à l’aune de ses fantasmes et son goût pour les situations invraisemblables.
Le thème principal du livre : le Zubial, bien sûr. Imaginez que vous êtes lui. Imaginez que vous vous donnez soudain le droit d’être furieusement heureux. Oui, imaginez une seconde que vous n’êtes plus l’otage de vos peurs, que vous acceptez les vertiges de vos contradictions… Imaginez que vous êtes résolument libre, que vous ayez rompu avec le rôle asphyxiant que vous croyez devoir vous imposer en société. Vous avez quitté toute crainte d’être jugé… Imaginez que la traversée de vos gouffres ne vous inspire plus que de la joie.
Le deuxième thème : les femmes, toutes les femmes, extasiées, envoûtées, amoureuses, tant, qu’elles commémorent une fois par an sa mémoire en l’église Sainte Clothilde. A l’insu de leur mari ou amant, quittant leurs jalousies d’antan, elles se réunissaient en secret depuis seize ans pour le remercier d’avoir existé, ou du moins poursuivre le dialogue qu’elles avaient entamé avec ce grand vivant quand il l’était encore.
C’est un livre d’anecdotes, parfois nostalgiques, celui d’un encore enfant qui se réjouissait, s’envolait aux côtés d’un père qui était bien plus qu’un père, un clown, un ange et un diable. Car je savais que ce récit ne serait pas un recueil de souvenirs, mais un livre de retrouvailles. Ce n’est pas une nuance, c’est une différence qui me remplit de vie à mesure que j’écris ces lignes. Et s’il m’arrive de pleurer en l’écrivant, ce sera de joie. Mon père est mort, vive le Zubial !
C’est une France espiègle, drôle, ludique, abracadabrantesque, que nous décrit la plume d’Alexandre Jardin, laissant trainer un brin de romantisme et de mélancolie avant de rebondir dans une nouvelle aventure tout aussi folle. Etre Jardin, c’est être fou jusqu’à la ruine. Je demandais à mon père ce qu’allait coûter notre périple. Il me répondis que cela n’avait pas d’importance, ou plutôt qu’il était important que j’apprenne à consacrer l’essentiel de mes revenus ou ceux des autres pour conquérir les femmes que j’aimais ; le reste ne pouvait être qu’un mauvais placement, immoral de surcroît. Telles étaient les règles du Zubial, toujours à cheval sur certains principes. (…) Chez les Jardin, devenir soi passe par d’exténuantes exigences. Ce que nous sommes ne nous suffit pas, jamais. Vivre signifie enfourcher un destin, aimer est pour nous synonyme de se projeter dans des amours vertigineux. Le normal est notre hantise, l’exorbitant notre mesure et notre ridicule vanité.
Dernière pirouette du narrateur : Je crois tenir de lui le sentiment que mes volontés, même invalidées par les contingences, finiront toujours par dessiner les contours du réel. Fondamentalement pessimistes l’un et l’autre, nous restons convaincus que le bonheur est la seule issue, que le mal est un affreux malentendu et que les désirs irrépressibles peuvent tout dynamiser.
07:49 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, société |  Imprimer
Imprimer
24/04/2012
L’éclaircie, roman de Philippe Sollers
Le livre est intitulé roman. Mais s’agit-il d’un roman ?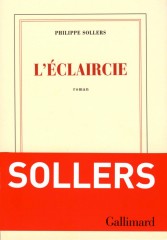 Si l’on en prend la définition, le roman serait une œuvre d'imagination en prose, assez longue, qui fait vivre des personnages présentés comme réels. Or que fait vivre ce livre ? Je ou moi (le narrateur), ma sœur Anne (Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?), Lucie, mon amour de l’après-midi, qui se met nue avant de parler avec moi. Sont-ce des personnages inventés ou les reflets de ma réalité ? On ne le sait ! Autour de ceux-ci des personnages bien réels ou plutôt des spectres, principalement Manet et Picasso, et leurs femmes et enfin ceux qu’ils ont côtoyé au long de leur vie. Et tout ceci fait un roman ? Cela rappelle Kundera, mais en moins beau, une écriture plus déliée certes, mais moins imaginative, plus moqueuse, moins profonde.
Si l’on en prend la définition, le roman serait une œuvre d'imagination en prose, assez longue, qui fait vivre des personnages présentés comme réels. Or que fait vivre ce livre ? Je ou moi (le narrateur), ma sœur Anne (Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?), Lucie, mon amour de l’après-midi, qui se met nue avant de parler avec moi. Sont-ce des personnages inventés ou les reflets de ma réalité ? On ne le sait ! Autour de ceux-ci des personnages bien réels ou plutôt des spectres, principalement Manet et Picasso, et leurs femmes et enfin ceux qu’ils ont côtoyé au long de leur vie. Et tout ceci fait un roman ? Cela rappelle Kundera, mais en moins beau, une écriture plus déliée certes, mais moins imaginative, plus moqueuse, moins profonde.
Certes, le terme de roman ou latin vulgaire, s’adresse, à l’origine, à toute la littérature narrative, mais très vite la narration ne concerna que des personnages inventés vivant un récit fictif. Philippe Sollers aurait pu sous titrer « L’éclaircie » du terme de journal littéraire ou journal intime, voire de méditation. Il est vrai que le roman d’aujourd’hui remet en cause la forme romanesque. S’agit-il d’une biographie, dans laquelle l’auteur raconte la vie d’un personnage ayant existé, ou d’une autobiographie, car le narrateur du livre est bien « je », « moi », c’est-à-dire lui, l’auteur, Philippe Sollers ? Bref, il se met en scène et raconte sa vie, qu’elle soit fictive ou réelle ou à la fois l’une et l’autre. Il médite sur le siècle qu’il vit, mais cette méditation est un récit d’événements intimes qui permettent de se raccrocher à ce qu’il aime : la peinture, les femmes, le tout enrobé de littérature, de musique (peu), de sœurs et de mères.
Il y a les femmes qu’on connaît, celles qu’on croit connaître, celles que l’on ne connaît pas en les connaissant, les variantes et les variables sont nombreuses, mais pas innombrables. Etre explorateur de ce tourbillon en mutation demande des dons particuliers, pinceau et stylo intérieurs, dessin, couleurs, oreilles. Victorine n’est pas Berthe (Morizot), qui n’est pas Méry, qui n’est pas Suzon. Albertine n’est pas Albertine, Molly Bloom est, et n’est pas, Nora Joyce, Frieda, dans le Château, est plus Kafka qu’on ne croit. (p.224)
Si une belle femme est morte, on dira qu’elle était l’orgueil du soleil, les délices du vent. A une jeune fille en fleur, on conseillera de jouir vite, du cou, du front, des lèvres, des cheveux. (p.216).
Les vraies fleurs sont chez Manet, les enfin vraies femmes chez Picasso. Parfaites, imprévues, elles s’offrent à leurs expériences. Elles s’épanouissent, éblouissent, vieillissent, périssent, ce sont elles qui balisent le fleuve du temps. (p.232)
Finalement, il s’agit bien de lui, Philippe Sollers, puisqu’à la fin il écrit : « J’apprends en même temps (voyez le roman) que Trésor d’Amour (roman de Philippe Sollers, 2011) va être traduit par une nouvelles maison d’édition créée en février 2010 à Pékin. C’est le moment exact de ma rencontre avec Lucie et de l’arrivée du manuscrit de Casanova à Paris. On se la joue mégalo sur plus de deux siècles. Pari. » (p.236)
J’ai d’abord détesté : trop nombriliste, voire intimiste dans les révélations, et, au-delà, trop brouillon, sautant d’une idée à l’autre sans transition ni fil directeur. Puis, reprenant la lecture une seconde fois, j’ai aimé cette évocation des deux peintres, la connaissance réelle qu’il avait de leurs vies et des rapports entre leurs peintures et leurs femmes. C’est bien une méditation qui ne dit pas son nom, comme le parfum d’un siècle qui est encore présent, mais qui est déjà en train de passer pour laisser place à l’arrogance de la communication, d’une jeunesse sans culture (Tout ce qui s’annonce comme culture est faux, vide, bavard. Les animateurs sont là, vous pas), d’une photographie remplaçant la peinture qui, devenue moderne, est hideuse. Les embarrassés du sexe et du sentiment vont beaucoup au cinéma… (p.183)
07:52 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, société, femme |  Imprimer
Imprimer
21/04/2012
J’apprends l’hébreu, roman de Denis Lachaud
Il apprend l’hébreu à sa manière, seul, sans professeur, et il en profite pour raconter sa découverte de Tel Aviv et du monde juif. Il est l’enfant d’un banquier français, il a une mère, une sœur et un autre frère. Il déteste ce dernier qui le lui rend bien. On ne sait s’il est sain d’esprit. On découvre sa manière de voir, de sentir, d’aimer Israël. « Un jour, la vérité s’est révélée à moi dans son âpre nudité : je comprends de moins en moins ce que les autres me disent… J’ai cherché une solution et quand on cherche on trouve… J’ai acheté le dictaphone qui me permet de transformer les mots dits en mots écrits… Je me sers aussi du dictaphone pour entendre ce que je n’aurai pas dû entendre, tel un espion. »
Il découvre que Tel Aviv est construit sur le sable. Il ne sait pas comment on fait pour vivre sur le sable. Et il voit quelqu’un qui le regarde, caché sous le sable. Après qu’il ait fait connaissance avec deux voisins : Madame Lev et Monsieur et Madame Masri, il découvre qui le regarde. Cette nuit pendant que j’étais couché, Benjamin est venu me parler. Il s’est glissé jusqu’à ma chambre sans un bruit. Moi je lisais… « C’est moi sous le sable, a-t-il dit, c’est moi que tu devines. »
Il va souvent à la plage : J’étale ma serviette sur le sable dans la cacophonie générale. Je m’allonge et peu à peu le monde se tait. Soudain, je m’aperçois que j’entends les vagues. Me voilà revenu à moi. A la fin de ma vie, j’irai mourir sur une plage, dans la rumeur des vagues qui lie le présent à ses deux voisins imaginaires, le passé et le futur. Je n’aurai pas peur. Je disparaîtrai peu à peu à la vue des hommes et des femmes qui marchent sur le sable. Tout ira bien et le soleil plongera dans l’eau.
Il progresse en hébreu : Leçon après leçon, je découvre la structure de la langue, j’apprends ce qui structure la nation qui la parle. Aujourd’hui, le livre me révèle qu’en hébreu, le verbe être ne se conjugue pas au présent. Etre au présent, ça n’existe pas, non. On peut être au passé, on peut être au futur, mais pas au présent… Désormais, je ne suis pas. J’étais et je serai. Au présent, je me contenterai de devenir. Ça change toutes les perspectives. Apprendre une langue m’a toujours permis de découvrir comment je dois regarder le monde dans lequel je vis.
Le jour de ses dix-huit ans, il décide de quitter sa famille et de s’installer en Israël. Pourtant Madame Lev lui dit : « Je sais que tu veux partir et tu as raison. Il faut partir… Il te faut trahir ceux que tu n’as pas choisis pour l’ouvrir à ceux que tu choisiras. Ça m’a pris une vie pour comprendre ça, Frédéric. Je te le dis. Tu feras ce que tu voudras. »
Et ce jour-là, il prend le train pour Jérusalem. Il va voir le tombeau de Benjamin Ze’ev Herlz, le créateur de l’Etat d’Israël. Il se prend pour lui. « Je suis revenu dans l’autre sens, la marge est à droite, la page s’ouvre à la gauche de ma plume. » Et il devient juif au point de devenir fou, ou presque.
Un beau livre, écrit de manière un peu folle, autant dans l’écriture (on va à la ligne après presque toutes les phrases) que dans le récit, rationnel mais décousu. On ne comprend pas où il va ni ce qu’il veut faire, mais on le vit. C’est parfois difficile à suivre, mais on persiste et c’est nécessaire. On va jusqu’au bout dans sa folie, et, finalement, on est content d’avoir découvert Israël à travers la folie du jeune homme. Il s’est construit son territoire, ce territoire qui est un peu son obsession. Mon corps est mon territoire. On me l’a dit, je me souviens. J’aime cette idée. J’aime la caresser. Malheureusement, je ne connais pas en toutes circonstances les limites de mon corps…Je ne peux pas me confier à ma connaissance parcellaire de ses frontières. ‘Mon corps est mon territoire » fuit devant moi en tant que phrase insaisissable. J’essaie de m’en emparer, en vain.
07:20 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, israël, psychologie |  Imprimer
Imprimer
17/04/2012
Le sumo qui ne pouvait pas grossir, roman d'Eric-Emmanuel Schmitt
Il est maigre, long, plat et il vend des produits de contrebande sur le trottoir. En passant devant lui, shomintsu s'exclame : "Je vois un gros en toi." Chaque jour, il le lui répète. Il finit même par lui offrir un billet pour assister à un combat de sumo. La première fois, il le déchire. La seconde, il y va, pour voir. Et il est conquis : "Je ne pouvais pas mépriser des individus qui dévouent leur vie au combat, qui sculptent leur corps, qui prouvent autant d'ingénuité que de force ?" Il entre dans l'école de Shomintsu, une des meilleures.
Il y rencontre la soeur de son champion qui, un jour, bondit sur lui et lui annonce : "Un jour je me marierai avec toi! Il l'oublie, préoccupé à grossir, ce qui n'arrive pas.Alors il va voir son maître et lui annonce sa démission. Celui-ci le fait parler. Il raconte sa vie, sa mère qui ne l'aime pas, son père qui s'est suicidé.Plus tard, son maître lui explique :
- Tu dois être là et pas là en même temps. Toi et pas toi. Tu dois te hisser au dessus de toi et ton adversaire pour englober la situation en ayant l'intuition de l'acte adéquat.
- Comment parvient-on à cela ?
- Par la méditation. En obtenant le vide en soi.
- Désespérant: avant il n'y avait pas de gros en moi; maintenant que le gros arrive, il n'y a plus de vide.
Comme il n'arrive pas à méditer, son maître l'emmène dans un jardin zen. "C'est alors que l'expérience se produisit... ça tournait en moi... Une force s'introduisit, me gonfla, me porta, me souleva. Mon corps éclata avec volupté, abandonna ses limites et ma peau qui se déchirait partit flotter, en plusieurs morceaux épars, disjoints, au dessus du jardin... Le jardin avait cédé la place à un jardin invisible qui dégageait une énergie bienfaisante... Je m'étais quitté, j'étais le vide au dessus de moi, le vide, ce vide qui est le vrai centre du monde."
Il a maintenant confiance en lui. Il sort avec la soeur du champion, mais lui annonce qu'il ne veut pas d'enfant. Comme elle insiste, il la quitte. Il gagne la plupart de ses compétitions. Il retourne voir son maître et lui donne à nouveau sa démission. Celui-ci lui explique qu'il fait parti de sa famille et qu'il s'est donné pour mission de veiller sur lui. Il lui apprend la maladie de sa mère, une malformation cardiaque qui la rend trop gentille, trop optimiste :
-Alors c'est normal qu'elle ne soit pas normale? - Voilà. - Donc moi je suis normal de trouver ça anormal? - Voilà - Finalement il est normal qu'elle ait une conduite anormale, et normal que moi je ne le supporte pas ? - Voilà. - Donc quoique anormaux tous les deux à cause de la situation, nous sommes normaux tous les deux.
Rassuré, il se précipite chez sa petite amie et, posant sa main sur son beau ventre plat, il lui dit, les yeux dans les yeux : "Je vois la grosse en toi."
Eric-Emmanuel Schmitt possède l'art de donner une leçon de vie à partir d'une situation de rien. Le récit n'est que le support de ce qui se cache derrière, une compréhension de la vie et la recherche d'un accomplissement que ses héros finissent par trouver en eux-mêmes, simplement. Il nous conduit à une compréhension profonde des mécanismes du vrai bonheur, au delà des fatras habituels, au plus profond de l'être. Dans cette histoire de sumo, c'est la méditation zen qui est l'épicentre du récit. Dans chacun de ses livres, il explore la sagesse d'autres religions, pour mettre en évidence les points communs, très simples, que sont les rapports entre l'homme et le cosmos, au delà de toute religion.
Merci à l'auteur, pour ces plongées dans la finalité de l'homme d'une manière insolite, simple et humaine.
07:11 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, écriture |  Imprimer
Imprimer
13/04/2012
Deuxième méditation sur la beauté, de François Cheng
François Cheng pose la question importante : « L’univers n’est pas obligé d’être beau, mais il est beau ; cela signifierait-il quelque chose pour nous ? »
Oui, l’univers et les êtres qui l’habitent sont beaux. Alors se pose la question suivante : « Cette beauté naturelle que nous observons, est-elle une qualité originelle, intrinsèque à l’univers qui se fait, ou résulte-t-elle d’un hasard, d’un accident ? »
Ne cherchons pas à trancher entre la thèse du hasard et de la nécessité et une thèse plus inspirante. Observons simplement que notre sens du sacré ne vient pas seulement du vrai, mais également du beau, c’est-à-dire de quelque chose qui frappe par son énigmatique splendeur, qui éblouit et subjugue. L’univers est plus qu’une donnée, il se révèle un don invitant à la reconnaissance et la célébration.
La beauté est quelque chose de virtuellement là, depuis toujours là, un désir qui jaillit de l’intérieur des êtres ou de l’Etre, telle une fontaine inépuisable qui, plus que figure anonyme et isolée, se manifeste comme présence rayonnante et reliante, laquelle incite à l’acquiescement, à l’interaction, à la transfiguration.
La beauté appelle à une autre vie que l’on peut vivre pleinement dès ici-bas. Consacrons du temps à côtoyer la beauté, quelle qu’elle soit. Laissons-nous nous emplir de beauté, cela nous aidera à vivre sans pour autant nous voiler la face devant le malheur.
07:07 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, méditation, sagesse, accomplissement |  Imprimer
Imprimer
12/04/2012
Le fait du prince, roman d’Amélie Nothomb
Panne informatique hier, plus rien sur la machine. Quelle engeance ! Mais dans le même temps, cela a du bon, car je prends du recul. Mais le recul est-il une preuve de sagesse ? Alors entre recul et réponse d'urgence, agissons du mieux possible !
Si un invité meurt inopinément chez vous, ne prévenez pas la police. Appelez un taxi et dites-lui de vous conduire à l’hôpital avec cet ami qui a un malaise. Le décès sera constaté en arrivant aux urgences et pourrez assurer, témoin à l’appui, que l’individu a trépassé en chemin. Moyennant quoi, on vous fichera la paix.
Amélie Nothomb a le don en un paragraphe au début de chacun de ses livres de dresser l’identité de celui-ci. Là, il s’agit de la prise de personnalité de quelqu’un qui est venu mourir chez le narrateur. Il passe ainsi de Monsieur Baptiste Bordave à Monsieur Olaf Sildur et il va progressivement s’installer chez lui où loge déjà une jeune femme. Et l’histoire conte cette prise de possession jusqu’au moment où Sigrid, c’est le nom de la jeune femme, comprend et participe à cette prise de possession, elle devient la femme de Bordave-Sildur.
Le livre se finit ainsi :
Certains matins d’hiver, Sigrid me demandait de la conduire jusqu’au cercle polaire. Il fallait rouler plus d’un jour et traverser la frontière norvégienne jusqu’à la côte. Parfois la mer avait gelé, les îles n’étaient plus des îles, on les gagnait à pied sec.
Sigrid contemplait interminablement la blancheur et je croyais savoir à quoi elle pensait. Pour moi, ce blanc était celui de la page vierge que j’avais conquise.
Comme il s’agit d’une romancière d’un certain renom, on entame le livre avec appétit, puis l’on poursuit en se disant que cela va démarrer, jusqu’à ce que l’on arrive au trois quart du roman, alors on plonge vers la fin, sans grand espoir d’un meilleur que ce que nous avons déjà lu. Du début à la fin, on erre dans un désert inhumain de rencontre d’êtres humains qui se jouent une comédie sans intérêt. Quel ennui et quelle perte de temps. Certes, l’auteur est toujours aussi diserte dans ses dialogues, parfois pince sans rire, mais beaucoup plus rarement que dans ses livres concernant sa jeunesse. En conclusion, le livre pourrait se résumer à leur première rencontre :
– Elle but d’un trait. Quand elle eut fini sa flûte, je crus que ses yeux avaient doublé de volume.
– Le champagne est si froid que les bulles ont durci, dit-elle. On a l’impression de boire de la poussière de diamants.
Malheureusement, ce n’est que de la poussière et non de véritables diamants !
14:15 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, nothomb |  Imprimer
Imprimer
07/04/2012
L’idiot de Shanghai, nouvelle de Pierre Péju
C’est une histoire à la chinoise, incompréhensible et impossible, mais qui est belle à lire et à méditer. Un homme de lettres est envoyé en Chine pour donner aux lecteurs d’un journal ses premières impressions sur l’évolution de la Chine. Tout est prévu à l’avance et il est accompagné d’une jeune fille, dénommé Lala, accompagnatrice qui le noie d’explications et l’emmène dans tous les lieux importants. Et toujours, toujours : « Avez-vous commencé à écrire vos impressions ? » Traversant un musée consacré à la peinture chinoise traditionnelle, il remarque une feuille de papier de riz représentant un paysage à peine esquissé, peint à l’encre de Chine. Il est magnifique et l’un des deux personnages représentés le ravit, huit virgules noires, tel un idiot poursuivi par une averse d’idéogrammes. Il était l’idiot de la montagne et l’auteur l’idiot de Shanghai.
Chine pour donner aux lecteurs d’un journal ses premières impressions sur l’évolution de la Chine. Tout est prévu à l’avance et il est accompagné d’une jeune fille, dénommé Lala, accompagnatrice qui le noie d’explications et l’emmène dans tous les lieux importants. Et toujours, toujours : « Avez-vous commencé à écrire vos impressions ? » Traversant un musée consacré à la peinture chinoise traditionnelle, il remarque une feuille de papier de riz représentant un paysage à peine esquissé, peint à l’encre de Chine. Il est magnifique et l’un des deux personnages représentés le ravit, huit virgules noires, tel un idiot poursuivi par une averse d’idéogrammes. Il était l’idiot de la montagne et l’auteur l’idiot de Shanghai.
Il ne souhaite plus qu’une chose avant son départ, rencontrer la dame de Shanghai, promesse faite à une douanière, qui doit lui donner un cadeau à ramener à Paris. Celle-ci, belle, élégante, sort pour lui remettre ce cadeau lorsqu’une immense bousculade les oblige à fuir la maison. Un jeune enfant lui remet une robe noire, couverte d’idéogrammes.
Voulant lire une adresse sur une carte de visite, il s’aperçoit qu’il ne sait plus lire. Il arrive à grand peine à sortir de Chine en utilisant des stratagèmes pour se faire expliquer pancartes et papiers à remplir. Arrivé en France, la douanière l’intercepte et prend la robe qui devait contenir des informations importantes sur les trafics entre l’Europe et la Chine. L’interprète éclate de rire, elle ne contient qu’un vieux conte chinois racontant l’histoire d’un lettré et d’un enfant inculte qui grimpent sur une montagne. Arrivé en haut, le lettré jette un à un les livres dans le vide au grand désespoir du tout jeune homme : « Tous ces classiques ! La parole des sages ! Jetés dans le vide ! » Le vieux lettré se met à rire. L’enfant tremble comme une feuille. Alors le vieillard prend un livre au hasard dans le lourd fardeau de son jeune compagnon. Toutes les pages sont vierges… Blancheur et silence…
L’histoire en elle-même semble assez creuse. Elle l’est. Peu d’intrigues, encore moins de dialogues, oui, des descriptions tout de même, mais pas quoi faire une véritable histoire digne d’être écrite. Et pourtant, tel un conte chinois, derrière l’apparente sobriété de l’écriture, on soupçonne, on devine la grandeur, l’immensité et le mystère de la ville de Shanghai. Cette nouvelle est belle par ce qui n’est pas dit : toute la psychologie de la Chine perçue dans l’absence de lettres et de mots et qui n’est décrite qu’au travers d’événements minuscules qui arrive à un européen perdu dans ce monde étrange de l’Extrême-Orient.
07:08 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, nouvelle, culture, civilisation |  Imprimer
Imprimer
24/03/2012
Les amants du Spoutnik, roman d’Haruki Murakami
Au printemps de sa vingt-deuxième année, Sumire tomba amoureuse pour la première fois de sa vie. Cet amour aussi dévastateur qu’une tornade dans une vaste plaine ravagea tout sur son passage, lançant des choses dans les airs, les réduisant en menus morceaux, les écrabouillant sans ménagement. (…) L’objet de cet amour absolument mémorable était marié, avait dix-sept ans de plus que Sumire et, surtout, était une femme. C’est de là que partit toute cette histoire, et là aussi qu’elle s’acheva (ou presque).
son passage, lançant des choses dans les airs, les réduisant en menus morceaux, les écrabouillant sans ménagement. (…) L’objet de cet amour absolument mémorable était marié, avait dix-sept ans de plus que Sumire et, surtout, était une femme. C’est de là que partit toute cette histoire, et là aussi qu’elle s’acheva (ou presque).
Ainsi commence l’histoire de Sumire, une jeune fille indécrottablement romantique, doublée d’une cynique et d’une têtue. Mais c’est aussi l’histoire du narrateur qui est amoureux de Sumire. Et c’est également, forcément, l’histoire de Miu, la femme fatale, toujours vêtue avec une rare élégance et conduisant une jaguar bleu marine de douze cylindres.
Sumire avait décidé d’écrire et s’était installée dans un petit appartement où elle s’efforçait de réaliser une œuvre complète en y mettant sa passion intérieure. Mais elle n’était pas prête. Il lui manquait l’alliance entre la fiction et le monde, que seule une cérémonie magique peut apporter, par exemple, comme le lui suggéra son ami, asperger sa porte du sang d’un chien. Alors elle décide, sur la demande de Miu, de travailler pour elle. Elles deviennent amies et Miu l’emmène en Grèce pour lui servir de secrétaire. Quelques temps plus tard, le narrateur reçoit un coup de téléphone de Miu : Sumire a disparu, pouvez-vous venir ?
Alors il entreprend le voyage et débarque dans l’île où il fait connaissance de Miu. Au cours des jours suivants, elle lui raconte les journées avec Sumire et la nuit où Sumire tenta de lui dire son amour. Mais Miu la repousse et lui explique la raison de ses cheveux blancs comme neige. Sumire retourne dans sa chambre et, le lendemain matin, a disparu. Miu et le narrateur auront beau tout faire pour retrouver Sumire, elle s’est évanouie. Il finit par retourner au Japon, seul. Il retrouve ses habitudes, sa maîtresse, avec laquelle il rompt. Un jour, il croise Miu en voiture, qui passe telle une coquille vide, comme si la chaleur de la vie avait disparu de sa personne.
Cependant, un jour, le téléphone se mit à sonner :
– Je suis de retour, déclara la voix de Sumire, très sereine, très réelle. Je suis passée par des périodes difficiles, mais j’ai fini par rentrer. On pourrait dire ça aussi pour résumer l’Odyssée d’Homère en mois de cinquante caractères.
– C’est bien, dis-je.
– C’et bien ? Qu’est-ce que çà veut dire ? J’ai sué sang et eau, traversé des milliers d’épreuves pour revenir jusqu’ici, et toi, tu ne trouves que ça à dire : c’est bien ? Pour un peu, j’en pleurerais ! (…)
–J’avais vraiment envie de te voir, tu sais.
– Moi aussi. C’est quand j’ai cessé de le faire que je l’ai compris. J’ai compris que j’avais besoin de toi. Tu fais parti de moi et moi de toi. Vois-tu, je crois que quelque part, dans un lieu très improbable, j’ai tranché la gorge de je ne sais quel animal. J’ai aiguisé mon couteau et je l’ai fait, avec un cœur de pierre. Symboliquement, comme pour bâtir une porte chinoise. Tu comprends ce que je dis ?
Comme d’habitude, l’auteur navigue entre un réel très concret, plein de détails de tous les jours, et des pensées, des sentiments, voire des faits, insolites, inexplicables et qu’il ne cherche pas à expliquer. Cet équilibre entre les deux aspects de la vie telle que la voit Murakami fait le charme discret du livre, sans que l’on sache exactement d’où il vient. On le ferme et l’on se demande si c’est beau. On se dit : c’est tout ? Mais lorsqu’on y repense, on découvre, sans pouvoir le comprendre, qu’une fois de plus Murakami, par une poésie qui ne dit pas son nom, a réussi à charmer ses lecteurs. Mais ils ne savent pas exactement pourquoi ils sont charmés.
07:35 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, poésie, japon, réalisme |  Imprimer
Imprimer
14/03/2012
Péplum, roman d’Amélie Nothomb
Amélie Nothomb, la surdouée des dialogues et de la joute verbale, s’en est donnée à cœur joie dans ce livre. Malheureusement, le résultat est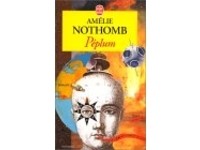 mitigé. D’abord, est-ce un roman ou une pièce ? Un roman puisqu’elle l’a choisi ainsi, le titre Péplum étant sous-titré roman. Mais c'est un dialogue sans explication, à prendre brut. D'ailleurs, pourquoi Péplum, qui est une tunique de femme dans l’antiquité ? Certes, la narratrice le porte dans cette aventure dans le futur.
mitigé. D’abord, est-ce un roman ou une pièce ? Un roman puisqu’elle l’a choisi ainsi, le titre Péplum étant sous-titré roman. Mais c'est un dialogue sans explication, à prendre brut. D'ailleurs, pourquoi Péplum, qui est une tunique de femme dans l’antiquité ? Certes, la narratrice le porte dans cette aventure dans le futur.
La romancière se fait opérer et se réveille dans une salle bien différente de celle d’un hôpital. A son chevet, Celsius, scientifique énigmatique lui annonce qu’elle est en 2580. Et le dialogue commence, fait de petites phrases courtes, cinglantes, ironiques. Cela durera jusqu’à la fin du livre, que je n’ai pas lu en entier. A la page 90, j’ai déclaré forfait, lassé, voire écœuré au vrai sens du terme, par ces réparties permanentes, comme une partie de tennis dont les balles sont rapides, trompeuses, envoyées aux quatre coins du court et qui dure des heures, voire des jours. Ces échanges peuvent être drôles lorsqu’ils sont enrobés d’une situation et d’évènements, mais un livre complet d’anathèmes entre deux pèse trop lourd.
On y trouve cependant quelques détails intéressants. C’est ainsi que Celsius explique à A.N. :
– Moi qui vous parle, je suis oligarque.
– Compliments.
– Vous ne me demandez pas en quoi consistent ces tests ?
– Il est inutile de vous le demander. Quand un premier de la classe a eu une bonne note, il finit toujours par réciter les questions, les réponses et les félicitations.
– Nous sommes évalués sur trois plans : notre intelligence (en ce, compris notre culture), notre caractère (en ce, compris notre honnêteté) et notre santé (en ce, compris notre beauté).
– Votre beauté ?!
– Oui. Les laids ne sont pas admis.
– C’est d’une injustice flagrante !
– Pas plus que le reste. Être jugé sur son intelligence est aussi injuste que d’être jugé sur sa beauté.
On y trouve même quelques réflexions intéressantes :
– De toute éternité, le Beau est plus rentable que le Bien.
– Rentable !
–Réfléchissez. Le Bien ne laisse aucune trace matérielle – et donc aucune trace, car vous savez ce que vaut la gratitude des hommes. Rien ne s’oublie aussi vite que le Bien. Pire : rien ne passe aussi inaperçu que le Bien, puisque le Bien véritable ne dit pas son nom – s’il le dit, il cesse d’être le Bien, il devient de la propagande. Le Beau, lui, peut durer toujours : il est sa propre trace. On parle de lui et de ceux qui l’ont servi. Comme quoi le Beau et le Bien sont régis par des lois opposées : le Beau est d’autant plus beau qu’on parle de lui, le Bien est d’autant moins bien qu’il en est question. Bref, un être responsable qui se dévouerait à la cause du Bien ferait un mauvais placement.
Mais très vite on se lasse de ces affrontements permanents qui ne sont que des dialogues creux où seuls comptent le persiflage et le quolibet.
N’ayant pas tout lu, je n’ai pu m’empêcher d’aller voir à la fin ce qui se passait. Et, bien sûr, tout cela se termine par l’écriture d’un roman qui raconterait l’aventure : Quand j’eus fini de rédiger ce manuscrit, je l’ai apporté à mon éditeur. J’ai précisé qu’il s’agissait d’une histoire vraie. Personne n’a daigné me croire.
07:27 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, roman, femme |  Imprimer
Imprimer
06/03/2012
La femme au miroir, roman d’Eric-Emmanuel Schmitt
Trois femmes, vivant à des époques différentes, l’une, Anne, à Bruges pendant la Renaissance, la seconde, Hanna, à Vienne au temps de Freud et la troisième, Anny, à Hollywood de nos jours. L’auteur fait tout pour nous suggérer une réelle ressemblance entre elles, voire faire penser qu’il s’agit de la même. Toutes les trois se disent différentes des autres femmes, celles qui obéissent aux conventions sociales, se marient, ont des enfants. Elles refusent chacune le rôle que la société et les hommes veulent leur faire jouer.
Anne refuse le mariage, erre dans les bois, trouve un moine qui lui explique qu’elle cherche Dieu sans le savoir. Après quelques hésitations sur sa vocation, elle devient béguine. Elle passe l’examen de passage avec la Grande Mademoiselle qui, après une demi-heure de silence, lui dit :
– L’âme ne sait voir la beauté que si elle est belle elle-même. Il faut être divin pour obtenir la vue du divin.
Elle finit sur le bucher, en innocente, opposé à l’archiprêtre, accusé par sa cousine qui l’a toujours haï.
Hanna, mariée à un homme riche, charmant, finit par divorcer, lassée de la course à l’enfant où l’entraînent les autres femmes. Elle devient médecin de l’âme et, un jour, passe le pont du béguinage. Elle s’installe sous le tilleul cher à Anne et ressent la même chose.
– Soudain, il me sembla que tout l’univers s’était concentré là. Les battements des ailes légères paraissaient la respiration de la plante. Le monde s’organisait en un décor panoramique qui enchâssait cette rencontre précieuse de l’animal et du végétal, me montrant l’essentiel, la continuité de la vie innocente, tenace.
Quant à Anny, elle se complaît dans l’alcool, la drogue et le sexe. Elle n’en sortira pas vraiment, mais son métier d’actrice, où elle excelle, la sauve. Après bien des péripéties, sans intérêt, elle trouve le rôle d’Anne et en fait son chef d’œuvre en montant sur l’échafaud comme une reine ou une sainte.
Curieux comme au fur et à mesure du temps, les femmes qui sont présentés semble plus creuses, moins structurées, moins belles dans leur âme. Anne, la visionnaire, est pure et communie avec la nature et Dieu. Hanna tombe dans la psychologie, Anny ne réussit qu’un coup, qui ne répare pas une vie égarée.
Cela reflète-t-il la réalité ? Non sûrement pas ! Mais Anne, la pure, a marqué au-delà de sa vie l’existence d’autres femmes, aspirant elles aussi, à cette soif d’absolu au-delà du devoir social.
06:41 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, société, destinée |  Imprimer
Imprimer
29/02/2012
L’art et le beau
« On prouve tout ce qu’on veut, et la vrai difficulté est de savoir ce que l’on veut prouver. » Ainsi parle Alain dans son « Avant-propos du Système des beaux-arts », écrit en 1926 et qui n’a pas perdu de pertinence. Il poursuit : « Le choix est tout fait, et inébranlable, et ce qu’on voudrait prouver, à savoir que l’œuvre est belle, est affirmé sans aucun doute par l’œuvre elle-même. »
C’est pourquoi l’art, à l’inverse des mathématiques, n’a pas de point de vue universel et les appréciations que l’on y porte, ne sont que le reflet de la pensée d’un seul, parfois partagées par un certain nombre d’autres humains.
Cependant, ne l’oublions pas, le goût pour l’art, et donc l’intérêt que l’on y porte, est également affaire d’éducation. Mais jusqu’à un certain point seulement. Apprendre à apprécier une œuvre et l’apprécier réellement est différent. Disons plutôt que l’on apprend pourquoi l’on apprécie telle œuvre plutôt que telle autre, on apprend à en goûter la vision d’ensemble et chacun des détails, mais au fond de nous, en dehors des modes et de l’influence des autres, on sent instinctivement ce qui nous plaît ou ne nous plaît pas. On baptisera chef d’œuvre ce que d’autres considèrent comme sans valeur esthétique, voire médiocre. Alors l’art serait-il simplement affaire de goût ?
Eh bien, là aussi, nous sommes sur la corde raide des sommets, avec, à droite et à gauche, la pente qui conduit à deux lieux opposés. Mais c’est bien cette fine limite, qui est le juste milieu, qui détient la vérité. Rien n’est blanc ou noir, tout est nuance et non pas gris. Et ces nuances sont la couleur de la vie et du monde.
On rejoint là un autre auteur, Maurice Nédoncelle, avec son livre « Introduction à l’esthétique », aux presses universitaires de France en 1963. Que nous dit-il ? L’esthéticien est le philosophe de l’art : il cherche à en éclairer la nature, à en décrire l’origine, les espèces, la finalité ; il essaie d’en discerner les rapports avec le beau, il analyse le mystère de la beauté même. Mais il ajoute aussitôt après : On peut se demander, il est vrai, si une telle réflexion est utile et ne se résout pas en verbiage… Nous pouvons nous familiariser avec le beau, nous ne pouvons le définir, il est aussi réel et indéfinissable qu’une personne vivante. Et c’est bien en cela que telle œuvre d’art fascine certains et pas d’autres, parce qu’elle ne correspond pas à sa façon d’appréhender la vie.
En réalité, l’œuvre d’art nous plaît parce qu’elle rencontre en nous une aspiration, une élévation de l’âme dont nous avons besoin pour vivre. Or, parce que chaque homme est unique, nous avons tous des voies différentes pour arriver à notre réalisation. L’œuvre d’art reflète plus ou moins ces voies et nous entraîne vers le haut selon que la beauté que l’on y trouve correspond à la voie qui nous permettra de nous élever. Mais alors, me direz-vous, l’œuvre d’art n’a pas de valeur universelle ? Si, elle en a bien, car cette élévation, cette aspiration se rejoint bien en un point, que certains appellent Dieu, quel que soit celui-ci, que d’autres appellent principe universel, et qui possède mille noms selon la pensée de chacun. Au-delà du Big bang, cette lumière qui éclaire le Tout, constitue notre ultime réalisation. Elle est sans nom et l’on comprend que dans certaines religions on ne nomme pas Dieu (le judaïsme n’accorde que des attributs à YHWH), on ne représente pas Dieu (l’Islam a ainsi développé un art géométrique fascinant et impressionnant faute de pouvoir développer des images), voire même l’idée d’un dieu supérieur n’existe pas (le bouddhisme est une religion sans Dieu).
Pour revenir à notre vision de l’art, et donc à notre idée du beau, il semble que celui-ci a donc un rôle très particulier. Par l’attirance irrévocable que certaines œuvres possèdent, et qui est différente selon les personnes, l’art est une aide précieuse et un moyen sûr pour conduire à sa propre découverte, au-delà d’un moi imprégné de contexte, environnement, histoire, géographie, société et même mathématique, la science la plus universelle.
25/02/2012
La plaisanterie, roman de Milan Kundera
Le roman laisse successivement la parole à Ludvik, Helena, à nouveau Ludvik, Jaroslav, de nouveau Ludvil, Kpska, enfin ludvik-Helena-Jaroslav. Il est vrai que l’on s’embrouille un peu à chaque nouvelle partie, car on ne sait qui dit je, même si son nom est indiqué sous le numéro de la partie.
Helena raconte comment elle a aimé Pavel, son mari, lors d’un meeting où elle découvre la vie : Nous nous fréquentions depuis près de deux ans et je commençais à ressentir une pointe d’impatience, rien d’étonnant, nulle femme n’entend se satisfaire d’une simple amourette d’étudiant… Le Parti contraint Pavel à épouser helena. On a chanté, on a dansé et je répétais à Pavel, si nous devions nous deux nous trahir, nous trahirions tous ceux qui célèbrent ces noces avec nous…J’ai envie de rire aujourd’hui quand je pense à tout ce que nous avons finalement trahi par la suite. Helena cherche l’amour, elle le cherchera toute sa vie et finira par le trouver, sans pouvoir l’éprouver. Elle parait aux autres une sainte Nitouche : Je savais pourtant bien combien il serait simple d’oublier bel et bien mon juvénile rêve d’amour, franchir la frontière pour me retrouver sur les terres de cette étrange liberté où n’existe ni honte, ni retenue, ni morale, dans le domaine de cette bizarre liberté ignoble où tout est permis, car il suffit d’entendre, au-dedans de soi, la pulsation du sexe, cette bête.
commençais à ressentir une pointe d’impatience, rien d’étonnant, nulle femme n’entend se satisfaire d’une simple amourette d’étudiant… Le Parti contraint Pavel à épouser helena. On a chanté, on a dansé et je répétais à Pavel, si nous devions nous deux nous trahir, nous trahirions tous ceux qui célèbrent ces noces avec nous…J’ai envie de rire aujourd’hui quand je pense à tout ce que nous avons finalement trahi par la suite. Helena cherche l’amour, elle le cherchera toute sa vie et finira par le trouver, sans pouvoir l’éprouver. Elle parait aux autres une sainte Nitouche : Je savais pourtant bien combien il serait simple d’oublier bel et bien mon juvénile rêve d’amour, franchir la frontière pour me retrouver sur les terres de cette étrange liberté où n’existe ni honte, ni retenue, ni morale, dans le domaine de cette bizarre liberté ignoble où tout est permis, car il suffit d’entendre, au-dedans de soi, la pulsation du sexe, cette bête.
Pendant ce temps, Ludvik vit le premier naufrage de sa vie, à cause de Marketa, jolie jeune fille de dix-neuf ans, qui ne comprend pas les blagues. Ils étaient en faculté, dans ces années du communisme où tous épient tout le monde, où la moindre parole est analysée, le moindre sourire suspecté. Aussi lorsqu’elle part en stage et lui écrit qu’elle est contente tandis que lui était mal d’elle, il lui envoit une carte portant les mots : L’optimisme est l’opium du genre humain ! L’esprit sain pue la connerie. Vive Trotski ! Ludvik. Marketa ne répond pas. A la rentrée il est convoqué devant le comité des étudiants du Parti. Il est rejeté de toute sa vie d’étudiant et se retrouve incorporé. Je commençais à comprendre qu’il n’existait aucun moyen de rectifier l’image de ma personne, déposée dans une superbe chambre d’instance des destins humains ; je compris que cette image (si peu ressemblante dut-elle) était infiniment plus réelle que moi-même ; qu’elle n’était en aucun façon mon ombre, mais que j’étais, moi, l’ombre de mon image ; qu’il n’était nullement possible de l’accuser de ne pas me ressembler, mais que c’était moi le coupable de cette dissemblance ; et que cette dissemblance, enfin, était ma croix, dont je ne pouvais me décharger sur personne et que j’étais condamné à porter. Mais Ludvik refuse de capituler, bien que sa dissemblance n’est visible que pour lui seul. Et graduellement, sa vie perd sa continuité, sa vue s’accommode à cette pénombre de dépersonnalisation et il commence à distinguer des gens autour de lui. Il raconte ses errances avec ses camarades. Il rencontre Lucie, une ouvrière qui vit dans un foyer, qui lui redonne la vie. Le temps recommence à s’articuler et à se décompter. Il connait le bonheur. Puis, il passe de la tendresse à une nouvelle Lucie, sensuelle lorsqu’elle essaye une robe qui lui dévoile les proportions de son corps balancées avec grâce. Après bien des péripéties, il obtient un rendez-vous dans une chambre. Mais elle se refuse à lui. Et il continue à la désirer derrière le grillage de la caserne. Il finit par la perdre de vouloir la prendre contre son gré.
Jaroslav, lui, raconte sa passion pour les chants et la musique de Moravie, qui se caractérise par une tonalité à la septième mineure, qu’elle appartienne au mode éolien, dorien ou mixolidien, d’après les tons d’église. Kundera écrit de très belles pages sur cette musique si particulière. Il raconte l’amitié d’adolescents entre Jaroslav et Ludvik qui s’est renforcée grâce à leur amour de la musique.
Ludvik reprend la parole pour raconter sa rencontre avec Helena, journaliste, dans un hôtel. Et très vite, il la discerne non plus en tant que professionnelle, mais en tant que femme, apte à fonctionner en tant que femme. Mais helena est mariée avec Pavel Zemanek, une personnalité du parti. Il l’emmène dans une chambre empruntée et la fait parler de son mari qui lui rappelle ses heures sombres. Il voit cette femme assise en face de lui, ivre, les joues en feu, la jupe roulée jusqu’à la ceinture. « Déshabillez-vous, Helena », dit-il. Il est extrêmement rare que l’amour physique se confonde avec l’amour de l’âme. Que fait-elle au juste, l’âme, pendant que le corps s’unit (de mouvement immémorial, universel et invariable) à l’autre corps… Que deux corps l’un à l’autre étrangers se confondent, ce n’est pas rare. Même l’union des âmes peut se produire quelquefois. Mais il est mille fois plus rare qu’un corps s’unisse avec son âme et s’entende avec elle pour partager une passion. Qu’à donc fait mon âme pendant que mon corps faisait l’amour avec Helena ? Et helena devient amoureuse de Ludvik, ce qui ne plaît pas du tout à celui-ci. Elle finit, plus tard, par tenter de se suicider. La fin du livre est quelque peu confuse : l’orchestre, le clarinettiste instituteur, l’infarctus de Jaroslav.
Qu’en retenir ? Ce n’est pas l’histoire en elle-même, qui reste malgré tout difficile à suivre et manque de continuité. L’art de Kundera ne passe pas par un scénario bien conçu, mais par des retours sur lui-même, sur ses réflexions à propos de tout, comme un livre de philosophie ouvert sur la vie, sans encombrement de volonté d’enseigner. On y trouve de magnifiques envolées sur l’amour, autant physique que platonique, sur la solitude, sur le temps, sur la musique, sur l’embrigadement idéologique.
Le résumé du livre se trouve dans ces quelques lignes :
Oui, j’y voyais clair soudain : la plupart des gens s’adonnent au mirage d’une double croyance : ils croient à la pérennité de la mémoire – des hommes, des choses, des actes, des nations) et à la possibilité de réparer (des actes, des erreurs, des péchés, des tords). L’une est aussi fausse que l’autre. La vérité se situe juste à l’opposé : tout sera oublié et rien ne sera réparé. Le rôle de la réparation (et par là la vengeance et le pardon) sera tenu par l’oubli. Personne ne réparera les tords commis, mais tous les torts seront oubliés.
07:18 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, roman |  Imprimer
Imprimer
19/02/2012
Ni d'Eve, ni d'Adam, roman d'Amélie Nothomb
"Le moyen le plus efficace d’apprendre le japonais me parut d’enseigner le français". C’est sur cette pirouette que commence le roman d’Amélie Nothomb, moins désopilant que d’autres, mais néanmoins agréable.
Celui à qui elle va apprendre le français est un japonais sympathique, sans doute moins japonais que la plupart. Il aime « jouer » et présente Amélie comme sa maîtresse, en tant qu’enseignante bien sûr et non en tant que compagne. C’est pourtant ce qu’elle deviendra plus tard après avoir été promenée en Mercedes immaculée, avoir pénétrée dans la maison des parents japonais, puis l’avoir laissé pénétrer dans la sienne. Ils finissent par passer trois semaines dans l’appartement de Christine, une belge travaillant à l’ambassade.
"Il me rendait heureuse. J’étais toujours joyeuse de le voir. J’avais pour lui de l’amitié, de la tendresse. Quand il n’était pas là, il ne me manquait pas. Telle était l’équation de mon sentiment pour lui… Ce que j’éprouvais pour ce garçon manquait de nom en français moderne, mais pas en japonais, où le terme de koi convenait. Koi, en français classique, peut se traduire par goût. J’avais du goût pour lui. Il était mon koibito, celui avec lequel je partageais le koi : sa compagnie était à mon goût."
Leurs conversations pouvaient être des plus élevées. Ainsi ils parlent de Marguerite Duras, dont Amélie dit : "Quand on achève un livre de Duras, on éprouve une frustration. C’est comme une enquête au terme de laquelle on a peu compris. On a entrevu des choses au travers d’une vitre dépolie. On sort de table en ayant faim". Mais elle portait également sur des différences culturelles plus terre à terre : "Rinri, respectueux de la tradition, se récurait entièrement avant d’entrer dans le bain : on ne souille pas l’eau de l’honorable baignoire. Je ne pouvais pas me plier à un usage que je trouvais si absurde. Autant mettre des assiettes propres dans un lave-vaisselle. – tu as peut-être raison, mais je suis incapable de me conduire autrement. Profaner l’eau du bain est au-dessus de mes forces."
Mais, un jour, son élève, après lui avoir fait manger des poulpes vivants au restaurant, lui fait un cadeau : une bague de platine incrustée d’une améthyste : « Veux-tu m’épouser ? » Ce ne fut pas la seule demande. Il y eut deux-cent quarante, d’après Amélie. Un soir fatiguée, alors qu’il la demande à nouveau en mariage, elle répondit non et s’endormit. Le lendemain, il lui laisse un mot : "Merci, je suis très heureux". Le soir, il l’emmène au restaurant, elle se dit tout à coup que si Rinri l’avait interrogé de façon négative, ce qui est courant dans ce pays compliqué, elle était cuite. Alors elle saisit la cruche de saké et demande : – "Ne veux-tu pas encore du saké ? Non, répondit courtoisement le jeune homme. Je reposai donc la cruche inutile. Rinri parut déconcerté et se servit lui-même."
Alors elle ne pense plus qu’à une chose, fuir. Juste avant Noël, elle prend un billet d’avion et quitte le Japon. Rinri l’accompagne à l’aérogare sans se douter que c’est la dernière fois.
Quelques années plus tard, elle retourne au Japon pour une dédicace, retrouve Rinri devant elle, qui lui dit : "– Je veux te donner l’étreinte fraternelle du samouraï ? (…)
Il avait trouvé les mots justes. Il avait mis plus de sept ans à les trouver, mais il n’était pas trop tard. (…) Tellement plus beau et plus noble qu’une bête histoire d’amour.
Ensuite, chaque samouraï lâcha le corps de l’autre samouraï. Rinri eut le bon goût de partir aussitôt sans se retourner. Je levai la tête vers le ciel afin que mes yeux ravalent leurs larmes."
Ni d’Eve ni d’Adam est un roman divertissant en raison des incompréhensions culturelles qui émaillent le récit. Néanmoins on n’y sent pas la verve du Sabotage amoureux ou de Métaphysique des tubes. Ce n’est ni un de ses meilleurs livres, ni un de ses plus mauvais. Il se lit plaisamment.
07:17 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, roman, japon |  Imprimer
Imprimer
25/01/2012
La sorcière de Portobello, roman de Paulo Coelho (Flammarion, 2007)
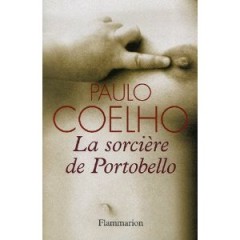
« Personne n’allume une lampe pour la cacher derrière la porte : le but de la lumière, c’est d’apporter davantage de clarté autour de vous, de vous ouvrir les yeux, de vous montrer les merveilles qui vous entourent. Personne n’offre en sacrifice son bien le plus précieux : l’amour. Personne ne confie ses rêves à des individus destructeurs. Sauf Athéna. »
Athéna est la fille adoptive d’un couple libanais qui l’a recueillie dans un orphelinat en Roumanie et qui est tzigane. Son histoire n’est racontée qu’au travers des récits faits par les gens qui la connaissaient et qui parle à tour de rôle. Certains en disent : « Elle voulait vivre, danser, faire l’amour, voyager, réunir des gens autour d’elle pour montrer qu’elle était savante, exhiber ses dons, provoquer les voisins, profiter de tout ce que nous avons de plus profane – même si elle cherchait à donner un vernis spirituel à sa quête. »
Une autre en dit que : « Athéna a mis au jour le monde richissime que nous tous portons dans l’âme, sans se rendre compte que les gens n’étaient pas prêts à accepter leurs pouvoirs. Nous, les femmes, quand nous cherchons un sens à note vie, ou le chemin de la connaissance, nous nous identifions toujours à l’un des quatre archétypes classiques. La Vierge (…), la Martyre (…), la Sainte (…), enfin la Sorcière qui recherche le plaisir total et illimité – donnant ainsi une justification à son existence. Athéna a été les quatre à la fois… »
L’âme religieuse, Athéna se tourne d’abord vers la musique, et celui qui l’écoute dit : « J’étais là tout entier, sans passé, sans avenir, vivant uniquement cette matinée, cette musique, cette douceur, ma prière inattendue. Je suis entré dans une sorte d’adoration, d’extase, reconnaissant l’être en ce monde… Mais très vite Athéna se fixe une seconde mission : « Cette mission, c’est la maternité. Je dois l’accomplir ou je deviendrai folle. Si je ne vois pas la vie se développer en moi, je ne pourrai plus accepter la vie qui est à l’extérieur. » Elle se marie, a un enfant, divorce et quitte l’église parce qu’on lui refuse la communion.
Alors elle se consacre à la danse. « Quand je danse, je suis une femme libre. Plus exactement, je suis un esprit libre, qui peut voyager dans l’univers, regarder le présent, deviner l’avenir, se transformer en énergie pure. » Un voisin l’initie à la danse et à la recherche du Sommet qui est caché en chacun de nous. Elle entre en extase, c’est-à-dire est capable de sortir d’elle-même. Elle prend un emploi dans une banque, et, peu à peu, la banque change d’état d’esprit. Tout devient plus coulant, plus naturel.
Son directeur de banque l’envoie dans les pays arabes pour faire des affaires. Elle fait connaissance avec Nabil Alaihi, un bédouin, qui l’initie à la calligraphie et lui révèle le sens du mot maître : un maître n’est pas celui qui enseigne quelque chose, mais celui qui pousse son élève à donner le meilleur de lui-même afin de découvrir ce qu’il sait déjà.
Ayant reçu l’aval de son maître, elle part en Transylvanie à la rencontre de sa véritable mère qui lui explique ses convictions : Nous en possédons pas la terre, c’est elle qui nous possède. (…) Nous ne croyons pas que Dieu ait fait l’univers ; Dieu est l’univers, nous sommes en lui, et il est en nous. (…) Nous n’adorons rien, nous communions seulement avec la création. – Et pourquoi faites-vous cela en groupe, puisque nous pouvons célébrer seul notre contact avec l’univers ? – Parce que les autres sont moi. Et moi, je suis les autres.
Athéna repart à Londres et s’intéresse au culte de la Mère, de l’Unité divine. Son amie Edda lui dit alors : J’adorerais pouvoir te voir donner des leçons sur ce que tu apprends ; c’est çà l’objectif de la vie – la révélation. (…) Maintenant, rentre et va à la rencontre de tous ces gens qui pensent que tu sais tout. Convaincs-toi qu’ils ont raison, parce que nous tous savons tout, il s’agit seulement d’y croire.
Et Athéna commence à enseigner et se laisse guider par la voix : Va à l’encontre de tout ce que tu as appris jusqu’à présent – toi qui es maîtresse du rythme, laisse le passer par ton corps, mais ne lui obéit pas. (…) Et soudain, j’ai senti un vide immense, qui a été rempli par une présence chaleureuse, aimante, amicale. Autour de moi tout était différent. (…) Au bout d’un certain temps, l’âme s’est détachée du corps, un espace s’est ouvert, et la Mère a enfin pu entrer. (…) Je suis contente que, à ce moment, la Mère ait gagné la bataille. Un homme a été sauvé du cancer, un autre a accepté sa sexualité, un troisième a cessé de prendre des pilules pour dormir.
Athéna rassemble les foules, elle fait des disciples, mais dans le même temps se fait des ennemis. Alors elle disparaît.
L’épilogue est assez équivoque. On la retrouve dans un quartier de Londres, assassinée. Mais le dernier chapitre met en scène un policier qui aurait organisé son départ en maquillant un crime. Elle est vivante et poursuit sa mission : préparer le chemin de la Mère, poursuivre une tradition qui a été abolie pendant des siècles, mais qui à présent commence à resurgir. Et l’on revient au commencement du livre, à sa première phrase : Personne n’allume une lampe pour la cacher derrière la porte : le but de la lumière, c’est d’apporter davantage de clarté autour de vous, de vous ouvrir les yeux, de vous montrer les merveilles qui vous entourent.
La construction du livre est assez intéressante. Les chapitres sont constitués des écrits de chaque personne qui a connu Athéna à un moment de sa vie. Ainsi l’on ne connait d’elle que ce que l’on en a dit ou que ce que ces intimes en ont vu : Heron Ryan, journaliste ; Edda, son amie, médecin ; sa mère adoptive ; le directeur de la banque ; le bédouin et bien d’autres encore. Sorcière, elle ne s’exprime pas elle-même. Mais est-elle vraiment sorcière ?
Cependant l’objet même du livre est ambigu : l’auteur a-t-il développé cette histoire sans pour autant croire aux propos qu’il tient sur ses aspects spirituels, ou, au contraire, pense-t-il réellement à cette connaissance immanente qui conduit à la réalisation personnelle ? Paulo Cuelho s’est-il laissé entraîner par sa célébrité qui le contraint à écrire toujours plus de livres qui traitent de spiritualité ?
On pourrait le penser lorsqu’on ouvre un autre livre écrit par celui-ci en 2008 qui se nomme « La solitude du vainqueur » et qui m’a rappelé le livre de Houellebecq « La carte et le territoire » par ses descriptions d’une société du paraître et de la célébrité, qui seule compte de nos jours. Et les deux auteurs semblent s’y complaire, malgré le maquillage nécessaire à ce genre de propos.
07:03 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, spiritualité |  Imprimer
Imprimer
20/01/2012
La carte et le territoire, roman de Michel Houellebecq
On lit l’introduction ou le prélude avec circonspection : où va-t-on ? Le problème du chauffe-eau ne peut constituer un roman, même de Michel Houellebecq. Alors on poursuit sur la première partie : les dessins de Jed, puis la photographie, tout cela à travers son enfance, son adolescence et le début de sa vie adulte. J’avoue que je n’ai rien saisi d’intéressant avant la page 62 (1ère partie, chapitre 3), car là : Jed acheta une carte routière « Michelin Départements » de la Creuse, Haute-Vienne. C’est là, en dépliant sa carte, à deux pas des sandwiches pain de mie sous cellophane, qu’il connut sa seconde grande révélation esthétique. Cette carte était sublime. Bouleversé, il se mit à trembler devant le présentoir. Jamais il n’avait contemplé d’objet aussi magnifique, aussi riche d’émotion et de sens que cette carte Michelin au 1/150 000 de la Creuse, Haute-Vienne. L’essence de la modernité, de l’appréhension scientifique et technique du monde, s’y trouvait mêlée avec l’essence de la vie animale. Le dessin était complexe et beau, d’une clarté absolue, n’utilisant qu’un code restreint de couleurs. Mais dans chacun des hameaux, des villages représentés suivant leur importance, on sentait la palpitation, l’appel, de dizaine de vies humaines, de dizaines ou de centaines d’âmes – les unes promises à la damnation, les autres à la vie éternelle. (p.54)
Jed fait connaissance avec Olga, une russe travaillant en France chez Michelin, pour le guide. On commence à entrevoir le sujet d’un roman qui jusque là se résumait au chauffe-eau et à toutes sortes d’évènements sans beaucoup de cohésion. Très vite, on tombe dans le milieu dit artistique : romanciers, peintres, photographes. Le voilà lancé par Olga qui organise sa deuxième exposition : Jed avait affiché côte à côte une photo satellite prise aux alentours du ballon de Guebwiller et l’agrandissement d’ne carte Michelin « départements » de la même zone. Le contraste était frappant : alors que la photo satellite ne laissait apparaître qu’n soupe de vers plus ou moins uniformes parsemée de vagues taches bleues, la carte développait un fascinant lacis de départementales, de routes pittoresques, de points de vue, de forêts, de lacs et de cols. Au dessus des deux agrandissements, en capitales noires, figurait le titre de l’exposition « la carte est plus intéressante que le territoire ».
Et l’on retombe dans les aventures d’un artiste contemporain dans son milieu branché, jusqu’au départ d’Olga qui est envoyée par Michelin en Russie. Alors il abandonne la photo et se lance dans la peinture. Il peint les métiers simples pendant sept ans, telle sa toile « Claude Vorilhon, gérant de bar-tabac », puis élargit ses travaux : « Aimée, escorte-girl », « Bill Gates et Steve Job s’entretenant du futur de l’informatique ». Il lui manque bientôt le portrait d’un écrivain.
C’est l’objet de la deuxième partie du roman, qui concerne sa rencontre avec Michel Houellebecq, romancier. Houellebecq décrit Houellebecq. Il fallait avoir l’idée de ce jeu de miroir. On trouve dans cette partie des réflexions intéressantes :
Quelques mots drôles et caricaturaux : « C’est l’inconvénient avec les polytechniciens, ils reviennent un peu moins cher que les énarques à l’embauche, mais ils mettent d’avantage de temps à trouver leurs mots. » (p.91)
Quelques affirmations qui ne manquent pas de clairvoyance : Etre artiste, à ses yeux (de Jed, le peintre) c’était avant tout être quelqu’un de soumis. Soumis à des messages mystérieux, imprévisibles, qu’on devait donc faute de mieux et en l’absence de toute croyance religieuse qualifier d’intuitions ; messages qui n’en commandaient pas moins de manière impérieuse, catégorique, sans laisser la moindre possibilité de s’y soustraire – sauf à perdre toute notion d’intégrité et tout respect de soi-même.
Quelques analyses intéressantes comme celle sur l’architecture du milieu du XXème siècle : Le courant dominant quand j’étais jeune était le fonctionnalisme. Il ne s’était rien passé depuis Le Corbusier et Van der Rohe. (…) Comme les marxistes, comme les libéraux, Le Corbusier était un productiviste. Ce qu’il imaginait pour l’homme, c’était des immeubles de bureaux, carrés, utilitaires, sans décoration d’aucune sorte ; et des immeubles d’habitation à peu près identiques, avec quelques fonctions supplémentaires – garderies, gymnase, piscine ; entre les deux, des voies rapides. Dans sa cellule d’habitation, l’homme devait bénéficier d’air pur et de lumière, c’était très important à ses yeux ; et entre les structures de travail et les structures d’habitation, l’espace libre était réservé à la nature sauvage. (…) C’était une sorte d’écologiste avant la lettre, pour lui l’humanité devait se limiter à des modules d’habitation circonscrits au milieu de la nature, mais qui ne devait en aucun cas la modifier.
Mais inversement, l’auteur a tendance à décrire avec force détails des choses sans intérêt, telle la description d’un appareil de photo (p.161 à 164), l’histoire de Beauvais (p.180-181). Il meuble le chapitre par de longues discussions entre Jed et son père. Celui-ci peint le portrait de Houellebecq, son chef d’œuvre. Enfin, il retrouve Olga de retour de Russie. Nouvelles mondanités avec Jean-Pierre Pernaut, Patrick Le Lay, Claire Chazal. Il couche avec Olga, mais repart voir Houellebecq, parle longuement avec lui et le quitte en fin de nuit, marquant ainsi la fin de la 2ème partie.
La troisième partie est un roman policier avec pour personnage principal le commissaire Jasselin : Houellebecq a été assassiné dans des conditions atroces. Description du crime, des efforts de Jasselin, sa rencontre avec Jed, quelques réflexions sur la criminalité quand Jasselin cherche à briser la glace avec Jed : Ce type l’intriguait (…) Son travail à lui était de pister le gibier, puis de le rapporter afin de le déposer aux pieds des juges, et plus généralement du peuple français (…) Dans le cadre d’une enquête policière, le coupable était à peu près vivant – ce qui permettait à la France de demeurer bien notée dans les enquêtes sur les droits de l’homme régulièrement publiés par Amnesty International.
Le roman se poursuit avec la mort du père de Jed qui se fait euthanasié en Suisse, la résolution de l’affaire Houellebecq, sans intérêt, et la décision de Jed de s’installer dans l’ancienne maison de ses grands-parents, dans la Creuse. Puis, il meurt, dans une certaine sénilité.
Que penser de ce livre ? J’avoue que je ne suis pas séduit par Houellebecq, bien qu’il soit encensé partout. Prix Goncourt 2010, l’écrivain est maintenant bien connu du grand public. Est-il pour autant réellement apprécié ?
Il faut reconnaître que la manière de raconter de Michel Houellebecq est surprenante. Il y a des digressions sans intérêt et très pointues sur tel ou tel sujet et l’on se demande ce qu’elles viennent faire dans le texte, n’apportant aucun élément au récit. Il y a également des descriptions éprouvantes sur, par exemple, la manière de faire cuire des spaghettis, mais sans aucun humour, brut de fonderie. Peu de sentiments : l’amour de Jed pour Olga est si brièvement évoqué qu’on se demande s’il y a réellement un amour entre eux. Tout reste froid et dépassionné. Bref, Houellebecq nous parle d’argent, d’art, de la vie mondaine qui contente les personnes médiatisées. Rien de bien encourageant pour en faire un souvenir de lecture enchanteresse. Quant à en faire un manuel de sociologie, ce serait exagéré.
07:36 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, roman, goncourt |  Imprimer
Imprimer
14/01/2012
Le sabotage amoureux, roman d’Amélie Nothomb (Albin Michel, 1993)
Livre fou de drôlerie, d’humour décapant, de sauvage frénésie, d’une fille de diplomate dont la famille est mutée à Pékin dans les années 70.
Au grand galop de mon cheval, je paradais parmi les ventilateurs. J’avais sept ans. Rien n’était plus agréable que d’avoir trop d’air dans le cerveau. Plus la vitesse sifflait, plus l’oxygène entrait et vidait les meubles… L’élégance de mon assiette suffoquait les passants, les crachats, les ânes et les ventilateurs… Dès le premier jour, j’avais compris l’axiome : dans la Cité des Ventilateurs, tout ce qui n’était pas splendide est hideux.
Et le roman commence par une guerre contre les Allemands de l’Est. Elle est la benjamine. On la nomme éclaireur. La mission de l’éclaireur est d’éclairer, dans les multiples acceptions du terme. Et éclairer, ça m’irait comme un gant : je serais un flambeau humain. Elle raconte leurs luttes contre les petits Allemands, luttes d’abord verbales, puis physiques, puis avec l’arme secrète : un pot d’urine. Mais elle fait connaissance avec Elena, une italienne qui devint le centre du monde. Elle était belle comme un ange qui poserait pour une photo d’art. Elle avait les yeux sombres, immenses et fixes, la peau couleur de sable mouillé. Ses cheveux d’un noir de bakélite brillaient comme si on les avait cirés un à un et n’en finissaient pas de lui dévaler le dos et les fesses. Son nez ravissant eût frappé Pascal d’amnésie… Décrire Elena renvoyait le Cantique des Cantiques au rang des inventaires de boucherie.
Or Elena ne veut pas jouer à la guerre. Une seule chose lui importe : être regardée. Mais cet amour que lui déclare l’auteur la laisse froide : Que tu es bête ! Alors Amélie se noie dans des courses à cheval, bolide lâché dans la Cité des Ventilateurs. Elle lui explique qu’elle a un cheval. Mais cela ne touche pas la belle Elena.
Quand je vis Elena accorder de l’attention à un ridicule, je fus scandalisée… Il s’appelait Fabrice et paraissait le meneur de la classe des petits. Ma bien-aimée avait choisie le pouvoir : j’avais honte pour elle.
Après une intensification des hostilités, la guerre fut lutte à mort et Amélie devint célèbre pour le faire debout, sans les mains, entre les deux yeux du général allemand, un garçon. L’enfant contracta la bronchite du siècle. Elena commence alors à s’intéresser à Amélie, mais celle-ci, sur les conseils de sa mère, fait semblant de la dédaigner. Après la signature d’un armistice avec les Allemands de l’Est, imposée par les parents, sa seule préoccupation est toujours Elena qu’elle continue à dédaigner, jusqu’au jour où elle craque, se sabote (d’où le titre du livre) et lui avoue : « Je t’aime. Je n’ai pas arrêté de t’aimer… Maintenant je ne ferai plus semblant. Ou peut-être que je recommencerai, mais alors tu sauras que je fais semblant. » Elena dit avec une indifférence écrasante que confirmait son regard : C’est tout ce que je voulais savoir. Elle tourna les talons et partit à pas lents qui s’enfonçaient à peine dans la boue. Alors Amélie poursuit la belle : Et toi, Elena, tu m’aimes ? Elle me regarda, l’air poli et absent, ce qui constituait une réponse éloquente, et continua à marcher. Je le ressentis comme une gifle. Mes joues cuisaient de colère, de désespoir et d’humiliation.
Ainsi finit le livre avec pour épilogue une lettre de son père qui rencontra un jour le diplomate italien et qui lui apprit qu’Elena était devenue une beauté fatale. Merci à Elena, parce qu’elle m’a tout appris de l’amour.
Entrée sur un cheval en Chine, Emilie repart amoureuse. Mais à New York, l’affectation suivante de son père, dix petites filles tombèrent folles amoureuses d’elle. Elle les fit souffrir abominablement. Livre délirant d’images et de rêves mêlés à la réalité, il se lit d’un seul jet, avec des sourires et souvent des rires, rappelant le monde de l’enfance que nous avons quitté un jour, pour notre plus grand regret.
Merci à l’auteur de nous faire revivre par son imagination abracadabrantesque ces moments merveilleux de guerre enfantine et d’amour méconnu.
06:52 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littéature, écriture, roman |  Imprimer
Imprimer
04/01/2012
L’art du roman (suite du 31 décembre)
L’art du roman est avant tout dans le style et non dans l’histoire qui a moins d’importance qu’on ne lui accorde. Revenons à nos propos précédents. Etaient opposés deux constructions d’un roman : soit sur les souvenirs (qu’ils soient personnels ou publics, inspirés par un fait), soit sur l’imagination.
Mais comment se décrivent les souvenirs qui ne sont que le reflet d’une réalité ayant existé ? Par l’imagination du choix des mots pour décrire ce que vous avez vécu. Et comment se décrit l’imaginaire ? Par la réalité des mots qui transforment l’imagination en structure cohérente qui donne du poids et de la vérité à ce que votre cerveau a concocté. Ce qui signifie que dans tous les cas, c’est votre art de conter, produit de votre culture et de votre personnalité, qui fait la qualité d’un roman.
Or qu’est-ce que l’art de conter ? C’est faire partager sa vision en se servant des mots pour décrire, émouvoir, faire naître des sentiments chez le lecteur (et non forcément décrire des sentiments), qu’ils soient de plaisir, de crainte, de drôlerie, de tristesse, etc. Plus réellement, c’est le choix des mots et leur rythme à travers les phrases qui créent le style.
La première étape consiste à choisir les mots que l’on souhaite utiliser pour arriver au résultat affiché ci-dessus. Un même auteur peut avoir plusieurs registres à sa disposition, selon le sujet sur lequel il écrit. D’autres n’en ont qu’un jeu, toujours le même. Enfin, bien sûr, l’inventaire des mots évolue dans la durée de l’écrivain, avec généralement une augmentation de la pertinence du choix au fur et à mesure de l’écoulement de sa carrière. Ces mots peuvent être simples, précieux, châtiés, recherchés, drôles, etc. L’association des mots entre eux procure également des effets divers, particulièrement lorsque les genres sont mélangés. On ne parle pas là des dialogues et du caractère donné à chaque personnage, mais bien de l’ensemble du récit et du choix du vocabulaire utilisé pour le décrire.
La seconde étape est plus complexe. Il s’agit d’imprimer un rythme aux mots, une musique particulière qui donne la qualité de l’écriture. Le rythme n’est pas seulement fondé sur la longueur de la phrase ou l’emploi différencié de la ponctuation. Il est musique, c’est-à-dire non seulement sons, mais également silence. La syncope donne une tonalité magique à la musique. Quelle est la syncope en écriture ? Probablement dans l’alternance de phrase aux sons variés et qui se lisent avec une respiration différente. A travers le halètement de l’écriture, le lecteur ressent des variations insoupçonnées. Mais ce n’est peut-être qu’une illusion.
En cela le roman rejoint la poésie, mais en cela seulement. Apporter trop de comparaisons, trop de détours dans ce que l’on exprime, fait du roman un chewin gum difficilement digeste. La simplicité, adaptée à l’histoire, est sans doute la meilleure manière de faire passer les idées. Et pourtant, on ne peut qu’admirer, par exemple, le style contorsionné de Marcel Proust ; on ne peut que se régaler du style de Marcel Aimé ou de Jean Giono. Bref, chaque écrivain a son style et celui-ci est sa marque, son flambeau, qui restera dans l’éternité. Ainsi des mémoires de Saint Simon, des écrits de Voltaire ou de Chateaubriand, et, plus récemment, de Marguerite Duras ou de Jorge Luis Borges.
Dieu merci, comme en musique, en peinture et tout autre art, l’infinité des combinaisons et des styles laissent encore de nombreux chefs d’œuvre à écrire et à découvrir.
05:55 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, roman, culture |  Imprimer
Imprimer
02/01/2012
L'ignorance, roman de Milan Kundera
« Qu’est-ce que tu fais encore ici ! » Sa voix n’était pas méchante, mais elle n’était pas gentille non plus ; Sylvie se fâchait. « Et où devrais-je être ? demanda Irena. « Chez toi ! ». « Tu veux dire qu’ici je ne suis plus chez moi ? ». « C’est la révolution chez vous ! » (…) Elle le dit sur un ton qui ne supportait pas la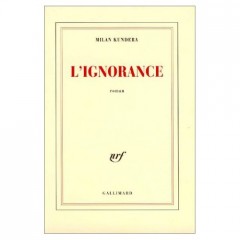 contestation. Puis elle se tut. Par ce silence, elle voulait dire à Irena qu’il ne faut pas déserter quand de grandes choses se passent. (…) Irena vit des larmes d’émotion dans les yeux de Sylvie et elle lui serra la main : « Ce sera ton grand retour ». Et encore une fois : « Ton grand retour ».
contestation. Puis elle se tut. Par ce silence, elle voulait dire à Irena qu’il ne faut pas déserter quand de grandes choses se passent. (…) Irena vit des larmes d’émotion dans les yeux de Sylvie et elle lui serra la main : « Ce sera ton grand retour ». Et encore une fois : « Ton grand retour ».
C’est un livre entre deux : entre deux types de livres de Kundera, les livres anecdotiques, tels que « Risibles amours », et les livres philosophiques tels que « L’immortalité », voire « L’insoutenable légèreté de l’être » ; entre le retour au pays après l’exil et le retour au pays d’exil devenu le vrai pays. D’ailleurs ce livre fut écrit directement en français et non en Tchèque comme les autres cités. Peut-être pour se prouver que maintenant sa vraie patrie est là, en France.
Il raconte l’histoire de deux émigrés : Iréna, d’abord mariée à Martin, puis, après sa mort, vivant avec Gustaf. Elle rencontre à l’aéroport un homme, Josef, qu’elle avait connu autrefois, à Prague. Elle le reconnaît, engage la conversation avec lui. Mais lui ne se souvient pas d’elle et n’ose le lui dire. Il lui laisse le numéro de téléphone de son hôtel. Le livre raconte alors les retrouvailles avec leurs parents et connaissances d’avant l’émigration. Elle convoque ses amies au restaurant, prépare de bonnes bouteilles de vin français. Mais elles lui font comprendre qu’elles préfèrent ce qui vient de chez eux, des chopes de bière. Elles parlent toutes de ce qu’elles vivent, de ce qui se passe à Prague. Elle prend conscience que sa vie en France ne les intéresse pas. Quant à Josef, il refait connaissance avec son frère qui l’accueille chaleureusement. Mais peu à peu il ressent une gêne. Le frère s’est approprié leur maison familiale, s’est emparé de tous les biens, comme si Josef était mort. – Nous avons essayé de te joindre, en vain. – Comment ? Tu connais pourtant mon adresse ! Seul un tableau semble encore l’intéresser, cadeau d’un peintre qui l’avait même dédicacé. Progressivement, il regrette cette visite à son frère et surtout sa belle-sœur. Il souhaite au moins emporter le tableau, mais ceux-ci ne semblent pas le comprendre. Alors il part, sans rien, sauf un cahier qu’il avait écrit lorsqu’il était jeune. Et il revit une scène dans laquelle il ment à une jeune fille qui était amoureuse de lui. Elle tente de se suicider. Elle garde comme un fétiche un cendrier qu’il avait volé dans un hôtel. Il revit également les années passées avec sa femme, avant qu’elle ne meurt.
A la fin du roman (mais est-ce vraiment un roman qui raconte une histoire ou des réminiscences d’une réalité vécue ?), Josef retrouve Irena à l’hôtel. – Alors, comment te plais-tu ? Tu voudrais rester ? – Non, dit-il. Puis il demande à son tour : Et toi ? Qu’et-ce qui te retient ici, toi ? –Rien. Alors ils parlent, parlent encore de tout et de rien. Et ils boivent, ils boivent encore, du vin, de la bière, de l’alcool. Elle se donne à lui, dans une entente totale, avec des mots obscènes. Dans la tête d’Irena, l’alcool joue un double rôle : il libère sa fantaisie, encourage son audace, la rend sensuelle et, en même temps, il voile sa mémoire. Sauvagement, lascivement, elle fait l’amour et, en même temps, le rideau de l’oubli enveloppe ses lubricités dans une nuit qui efface tout. Comme si un poète écrivait son plus grand poème avec une encre qui, immédiatement, disparaît.
Pris d’une impulsion soudaine, elle sort de son sac le cendrier. Tu le reconnais ? Et elle comprend qu’il ne se souvient pas, qu’il ne sait même pas qui elle est. Elle finit par s’endormir. Il part, en laissant un mot sur le tapis : Dors bien. La chambre est à toi jusqu’à demain midi… Ma sœur. Il prend la route de l’aéroport et quitte Prague.
Pourquoi l’ignorance ? Pourquoi pas la nostalgie, souffrance causée par le désir inassouvi de retourner au pays. Kundera l’explique au chapitre 2 de son roman. La nostalgie est la souffrance de l’ignorance. Tu es loin et je ne sais pas ce que tu deviens. Mon pays est loin, et je ne sais pas ce qui s’y passe. (…) Il faudrait ajouter un complément : le désir du passé, de l’enfance perdue, du premier amour.
C’est le roman de ce désir qui s’écroule progressivement au fur et à mesure qu’il devient réalité, jusqu’à ne laisser qu’un goût d’amertume face à l’ignorance des autres qui font comme si l’émigré n’existait pas et comme s’il ne s’était rien passé. Il n’est plus. Il est mort à leurs yeux, ou plutôt, son existence hors du pays ne s’incarne pas dans ce retour. Alors le retour devient un nouveau départ ou un vrai retour dans le pays élu librement.
07:09 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, roman, immigration |  Imprimer
Imprimer
31/12/2011
L'art du roman
Détenir une histoire dans sa tête n’est rien. Encore faut-il être capable de la raconter bien. Si le récit a son mot à dire dans l’art du roman, la manière de le dire importe encore plus.
Et, au fond, est-on sûr que raconter une histoire soit si important que cela pour faire un roman. En réfléchissant bien, sûrement pas. Il existe de nombreux romans qui ne constituent pas une histoire munie d’un début et d’une fin, avec une intrigue et des personnages. Par exemple, les romans de Milan Kundera sont un patchwork de récits courts de personnages qui se mélangent dans le temps et dans l’espace. Mieux, l’histoire peut être poétique ou encore se dérouler hors d’un temps mesuré, voire hors d’un espace défini. Enfin, un roman peut être bâti sans intrigue, de manière pouvant paraître illogique, et cette construction est faite volontairement par l’auteur.
De manière plus générale, on peut dire qu’il existe deux origines pour le récit d’un roman.
Soit celui-ci est fondé sur des souvenirs auquel, bien sûr, l’auteur ajoutera de nombreuses inventions de lieux, de temps, d’action, de personnages, ou encore mêlera sans aucune gêne des souvenirs appartenant à des moments et des lieux différents. Ce genre est parfois ennuyeux parce que l’on sent, sans pouvoir le préciser, cette pâtée mixte qui laisse de gros grumeaux dans un récit chaotique. Mais d’autres auteurs brossent de véritables bijoux à partir d’une expérience personnelle, telle Amélie Nothomb lorsqu’elle fait de ses souvenirs d’enfance un feu d’artifice de paillettes dorées et éblouissantes.
D’autres auteurs, construisent par l’imagination pure. Ces romans font souvent plus vrais, aussi bizarre que cela puisse paraître. La difficulté pour ces imaginaires est d’aller jusqu’au bout de leur épopée inventée, d’en créer des intrigues durables de la première à la dernière page. Admirons dans ce régistre Ken Follett dans son ouvrage "Un monde sans fin". En fait, tout dépend de la manière de construire le récit. Soit l’auteur se fie à une imagination démesurée et la laisse courir librement dans les champs en butinant de ci de là ; soit, au contraire, il construit méticuleusement le plan à suivre, préparant son livre dans les moindres détails jusqu’au déclic qui lui donnera le signal de commencer. Il peut arriver qu’il ne vienne jamais, malheureusement.
En réalité, la plupart des auteurs empruntent aux deux manières, mêlant la fiction à des souvenirs réels avec plus ou moins de bonheur. Ceux chez lesquels prédominent les souvenirs font généralement des romans courts, émouvants. Ceux pour lesquels l’imagination prédomine peuvent écrire des centaines de pages si la verve scripturale est avec eux. Entre les deux existe logiquement le roman historique, mixte des deux tendances, chemin étroit au bord du précipice de l'authenticité. Les deux manières font de bons ou de mauvais livres.
Une autre difficulté du roman est celle des dialogues. Allez dans une librairie et feuilletez les livres qui s’y trouvent. Vous serez frappé de voir que certains romans n’affichent que très peu de dialogues, alors que d’autres sont plutôt chiche en description de contextes ou de sentiments, seules comptent les situations et les réparties. On peut penser que cette différence tient à la psychologie personnelle de l’auteur. Est-il bavard, homme du monde, primaire ou serait-il un secondaire plus renfermé sur lui-même, mais pénétrant le monde d’un œil plus avisé ? Il est sûr que cela joue dans l’art d’écrire et même de se décrire.
Car derrière tout cela que cherche le romancier ? En fait, à se décrire lui-même au travers de tous ces personnages, en fonction de la multitude de personnes qu’il détient en lui-même. Nous avions déjà entraperçu notre difficulté à constituer un être unique, indélébile, constant en pensée et en action. Nous avions également constaté ensemble combien était importante et fragile cet équilibre entre la solitude et le partage, accomplissement nécessaire entre le moi et le soi (voir solitude et partage du 12 août 2011). Or cet équilibre est différent pour chacun. Il n’y a pas de règle, l’important est de le trouver, de pouvoir marcher sur sa crête et de s’y sentir bien, suffisamment bien pour avoir envie de le dire, de le décrire, de le donner en cadeau aux autres. Cela ne signifie pas que le roman sera forcément gaie, instructif, donnant une vision intéressante de la vie. Il pourra être difficile à lire, triste à souhait, mais il y aura toujours au-delà des premières impressions un arrière-goût d’optimisme, d’espoir, de lumière qui rappelle au lecteur que la fonction d’un romancier est avant tout de lui livrer sa vision de la vie, son expérience et ses espérances.
Mais tout ceci ne dit rien du style, de la phrase, de l’art d’écrire qui est aussi important, sinon plus, que tout ce que nous venons de dire. Il faudra en reparler un des prochains jours.
07:46 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, roman, art |  Imprimer
Imprimer
27/12/2011
Oscar et la dame rose, roman d’Eric-Emmanuel Schmitt (Albin Michel, 2002)
Cher Dieu, Je m’appelle Oscar, j’ai dix ans, j’ai foutu le feu au chat, au chien, à la maison (je crois même que j’ai grillé les poissons rouges) et c’est la première lettre que je t’envoie parce que jusqu’ici, à cause de mes études, j’avais pas le temps.
Ainsi commence les lettres d’Oscar, enfant cancéreux à l’hôpital, dont tous savent qu’il va mourir, mais personne ne le lui dit.
Le second personnage important de l’histoire est Mamie-Rose. Elle est là en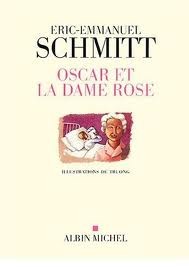 contrebande. Il ya un âge limite pour être dame rose. Et elle l’a largement dépassé. – Vous êtes périmée ? lui demande Oscar. Pas tant que cela, car elle est la seule à assumer la vérité de l’état d’Oscar et à lui dire, à mots couverts, mais il comprend. Alors elle invente son personnage, elle le dresse devant l’enfant et joue son rôle à merveille : catcheuse, tel est mon métier, lui dit-elle. Elle lui explique que Dieu n’a rien à voir avec le père Noël. Il faut lui écrire, comme cela il se sentira moins seul. – Moins seul avec quelqu’un qui n’existe pas ? – chaque fois que tu croiras en lui, il existera un peu plus. Alors l’enfant lui écrit et lui demande : est-ce que je vais guérir ? Il découvre que ces parents sont venus voir le médecin et qu’il n’ont pas eu le courage de venir le voir après avoir appris la triste nouvelle. Il veut voir Mamie-Rose et elle obtient l’autorisation de le voir tous les jours pendant douze jours. A partir d’aujourd’hui, tu observeras chaque jour en te disant que ce jour compte pour dix ans. – Alors, dans douze jours, j’aurai cent trente ans !
contrebande. Il ya un âge limite pour être dame rose. Et elle l’a largement dépassé. – Vous êtes périmée ? lui demande Oscar. Pas tant que cela, car elle est la seule à assumer la vérité de l’état d’Oscar et à lui dire, à mots couverts, mais il comprend. Alors elle invente son personnage, elle le dresse devant l’enfant et joue son rôle à merveille : catcheuse, tel est mon métier, lui dit-elle. Elle lui explique que Dieu n’a rien à voir avec le père Noël. Il faut lui écrire, comme cela il se sentira moins seul. – Moins seul avec quelqu’un qui n’existe pas ? – chaque fois que tu croiras en lui, il existera un peu plus. Alors l’enfant lui écrit et lui demande : est-ce que je vais guérir ? Il découvre que ces parents sont venus voir le médecin et qu’il n’ont pas eu le courage de venir le voir après avoir appris la triste nouvelle. Il veut voir Mamie-Rose et elle obtient l’autorisation de le voir tous les jours pendant douze jours. A partir d’aujourd’hui, tu observeras chaque jour en te disant que ce jour compte pour dix ans. – Alors, dans douze jours, j’aurai cent trente ans !
Dans ces lettres, Oscar raconte les autres enfants qui comme lui sont relégués dans leur chambre, s’amuse, donnent des surnoms tels que Bacon, enfant brulé,, Einstein pour une macrocéphale et Peggy Blue, l’enfant bleue. Elle attend une opération qui la rendra rose. Moi, je trouve que c’est dommage, je la trouve très belle en bleu, Peggy Blue. Il y a plein de lumière et de silence autour d’elle. – Est-ce que tu lui a dit ? – Je ne vais pas me planter devant elle pour lui dire « Peggy Blue, je t’aime bien ». Il ya aussi Sandrine, leucémique. Elle l’incite à l’embrasser. Mais il sait bien que c’est Peggy Blue qu’il aime. Mais elle est fiancée à Pop Corn. – Elle te l’a dit ? demande Mamie Rose. Alors il lui fait écouter son appareil de musique et lui dit : – Peggy Blue, je veux pas que tu te fasse opérer. Tu es belle comme ça. Tu es belle en bleu. Le lendemain, il est monté dans son lit. On était un peu serrés mais on a passé une nuit formidable. Peggy Blue sent la noisette et elle a la peau aussi douce que moi à l’intérieur des bras, mais elle, c’est partout. On a beaucoup dormi, beaucoup rêvé, on s’est tenu tout contre, on s’est raconté nos vies.
Mais Peggy Blue se fait opérer et bientôt part de l’hôpital. Alors, le jour de Noël, dans sa cinquième décennie, il fait une fugue. Il part retrouver Mamie Rose en montant dans sa voiture. Celle-ci invite les parents à venir chez elle. Quand ses parents sont arrivés, il leur a dit :
– Excusez-moi, j’avais oublié que, vous aussi, un jour, vous alliez mourir. Cela les a débloqués, car il les a retrouvés comme avant.
Il a maintenant quatre-vingt dix ans. Et ce jour-là, il comprend que Dieu est là. Qu’il lui dit son secret : regarde chaque jour le monde comme si c’était la première fois.
Cent dix ans. Ça fait beaucoup. Je crois que je commence à mourir.
Il meurt après avoir mis une pancarte sur sa table de chevet : « Seul Dieu a le droit de me réveiller. »
Livre cucu pour enfant ou adulte en mal d’émotion, me direz-vous. Oui, c’est vrai, il est facile d’utiliser un tel thème, qui rappelle un peu Love Story. C’est vrai, il est facile de faire pleurer les âmes sensibles avec une telle histoire. Mais si vous deviez écrire cette histoire, trouveriez-vous les mots pour la dire, dans toute sa vérité, avec une telle simplicité. Sauriez-vous écrire à Dieu et lui dire ses quatre vérités ? Sauriez-vous inventer Mamie Rose et Peggy Blue ? Sauriez-vous faire de la catcheuse une âme aimante et sagace ?
Le livre est court, mais il n’en est pas moins beau, intelligent, sans fausse sensiblerie. Il se lit en deux heures, mais vous le gardez au cœur pendant deux jours au moins.
07:07 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, roman |  Imprimer
Imprimer
21/12/2011
Acide sulfurique, roman d’Amélie Nothomb
Vint le moment où la souffrance des autres ne leur suffit plus : il leur en fallut le spectacle.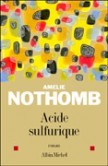
Ainsi commence ce roman extraordinaire ! Il conte une émission de téléréalité, dénommée « Concentration », reproduisant les camps exécrables du nazisme, offerts aux spectateurs de tous les jours. Singulière omelette psychologique qui conduit à la mort. Est-elle réelle, on ne le sait et on ne le saura pas.
Il y a les acteurs du jeu terrible : les kapos, bourreaux impitoyables qui chaque jour décident qui doit mourir ; les détenus, pris parmi la population, au hasard des rafles ; les organisateurs, inconnus, souterrains et vils par leur inaction face aux souffrances des détenus, pour eux seule compte l’audience ; enfin, les spectateurs qui se repaissent des malheurs des détenus et s’insurgent contre les organisateurs, mais qui ne cessent de regarder à travers la caméra voyeuse.
Plus particulièrement, on suivra la kapo Zdena, brutale, défavorisée par la nature tant physiquement que psychologiquement. Elle est intriguée par la divine Pannonique, jeune fille de vingt ans, au visage angélique, ramassée un jour au jardin des Plantes. CKZ 114, ainsi s’appelait Pannonique, était désormais l’égérie des spectateurs. Les journaux consacraient des articles à cette jeune fille admirable de beauté et de classe, dont personne ne connaissait la voix. On vantait la noble intelligence de son expression. Sa photo s’étalait en couverture de nombre de revues…Peu à peu, CKZ devient l’obsession de Zdena. Elle brûle de connaître son prénom. Devant ce refus, elle use d’abord de la schlague. Puis, elle tente la douceur. Elle remplace sa schlague par une imitation inoffensive. Alors elle repose sa question et Pannonique répond : « Je m’appelle CKZ 114. » Le lendemain, nombre de chroniqueurs titraient : Elle a parlé ! Ce qu’il y a de plus singulier dans cet énoncé, c’est le JE. Ainsi, cette jeune fille qui, sous nos yeux consternés, subit la pire infamie qui soit, la déshumanisation, l’humiliation, la violence absolue, cette jeune fille que nous verrons mourir et qui est déjà morte, peut encore fièrement commencer une phrase par un je triomphant, une affirmation de soi. Quelle leçon de courage ! »
La kapo Zdena cherche alors à la corrompre avec du chocolat, car les détenus meurent de faim. Pannonique ne cède pas. Elle distribue le chocolat à sa chambrée. Mais lorsque la kapo envoie la protégée de la jeune fille à la mort, CKZ 114 se poste face à elle, plante ses yeux dans les siens et clame haut et fort : Je m’appelle Pannonique !
Désormais, c’est la lutte entre le bien et le mal qui domine. Pannonique a un besoin de Dieu atroce. Elle a faim de l’insulter jusqu’à plus soif… C’était le principe fondateur qu’elle avait besoin de haïr… Alors, elle serait Dieu pour tout. Elle s’essaye à aimer ZHF 911, une vieille, épargnée en raison des atrocités qu’elle profère et qui font monter l’audience. Il était terrible de se rendre compte que l’être le plus mauvais du paysage appartenait au camp des détenus et non au camp du mal. Pannonique aime réellement une petite fille, malmenée par un homme appartenant vraisemblablement aux organisateurs. Or un jour, à la sélection des condamnés du jour, la vieille et la fillette sont nommées. Les extrêmes s’attirent, on dirait.
Pannonique se tourne alors vers EPJ 327, un homme qui cherche toujours sa présence, car celle-ci est devenue sa raison de vivre. Zdena en conçoit de la jalousie. Elle prend conscience qu’il lui manque la parole : parler pour dire quelque chose. Je suis vide, pense-t-elle. Le lendemain, Pannonique déclare devant les caméras : Spectateurs, éteignez vos télévisions ! Les pires coupables, c’est vous ! (…) Quand vous nous regardez mourir, les meurtriers, ce sont vos yeux. Vous êtes notre prison, vous êtes notre supplice ! Et Zdena lui dit : Bravo. Je pense comme toi.
Désormais la conversation s’engage entre la kapo et CKZ 114, ou plutôt entre Zdena et Pannonique, deux êtres humains. Mais Zdena éprouve du désir pour la jeune fille qui se refuse. Or un jour, l’audience cesse de monter. Les organisateurs inventent donc une nouvelle règle : les spectateurs désigneront chaque jour ceux qui doivent mourir. L’audience repart en flèche. Zdena toujours éprise, accepte de préparer l’évasion de la chambrée.
Mais le lendemain, MDA 802, l’amie de Pannonique est désignée par les spectateurs. La surprise passée, Pannonique s’avança d’un pas et déclara : « Spectateurs, vous êtes des porcs ! Vous faites le mal en toute impunité ! Et même le mal, vous le faites mal ! » Alors la kapo Zdena intervient de façon extraordinaire. Elle exige que l’on relâche les prisonniers sinon elle fait exploser les cocktails Molotov qu’elle tient dans ses deux mains. Elle joue le rôle de sa vie, elle jubile. Elle contraint les organisateurs à faire appel à l’armée qui encercle le camp et laisse sortir les détenus sous l’œil des caméras. Pannonique comprend le revirement de Zdena et lui dit :
– Il faut que je vous dise l’admiration et la gratitude que j’ai pour vous. C’est un besoin, Zdena. J’ai besoin de vous dire que vous êtes la rencontre la plus importante de toute mon existence.
– Attends. Comment as-tu dit ?
– La rencontre la plus importante…
– Non. Tu m’as appelée par mon prénom.
Et, inversement, Zdena appelle pour la première fois CKZ 114 par son prénom : Pannonique.
Lorsqu’on lit les critiques littéraires, on reste ahuri d’une telle unanimité. Terne et gris : voilà ce qu'est le livre d'Amélie, en dit Mélanie Carpentier. Le menu nothombien de cet automne s'avère bien avarié. La voracité a fait place à la gloutonnerie, la finesse à la grossièreté, l'excentricité à la trivialité, écrit l’Express. Tant de bêtise, alliée à une telle absence de talent, décourage presque la protestation, proclame Le Nouvel Observateur. Enfin , Le Monde : "Eteignez vos postes !" Un cri aussi pathétique que ce roman, boursouflé de clichés, de lieux communs, de démonstrations pesantes et de dialogues insipides (...) la romancière montre ses limites et sombre rapidement dans le grotesque et le vain. On peut zapper.
Oserait-on penser que le monde médiatique, attaqué subtilement par ce roman, s’insurge contre une critique de son jeu ? Eh bien oui. Les organisateurs se font connaître par leur dédain, voire leur haine, de tout de ce qui attaque leur pouvoir. Ils n’acceptent l’imagination que si elle les caresse dans le sens du poil. Car finalement, les plus horribles dans ce roman, ce sont bien eux et leur espérance, leur désir, leur amour de l’audience, l’audience, l’audience…
07:43 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, société, médias |  Imprimer
Imprimer
16/12/2011
Mathématique existentielle
Milan Kundera parle d’une mathématique existentielle à propos de rencontres très improbables entre personnes habitant dans des lieux éloignés l'un de l'autre et qui se sont connues il y a longtemps, dans un autre pays. La rencontre était parfaitement improbable, et cette improbabilité même fait tout son prix. Car la mathématique existentielle qui n’existe pas, poserait à peu près cette équation : la valeur d’un hasard est égale à son degré d’improbabilité (Milan Kundera, L’immortalité, 5ème partie - le hasard, 4).
Quelle belle formule. Certes très littéraire, mais la beauté littéraire est comme la poésie. Elle fait effet sans logique réelle. La phrase, les mots, la tournure même de ce qui est exprimée rend en un instant la compréhension plus claire, comme si nous montions sur un petit nuage pour contempler librement la vaste plaine d’une logique hagarde.
Et pourtant, que pourrait bien signifier ce terme de mathématique existentielle. Kundera ne l’explique pas. Il susurre simplement : « Que peut-on dire de sérieux sur les hasards de la vie, sans une recherche mathématique ? » Alors il rêve et dit : « Rencontrer inopinément, en plein Paris, une belle femme qu’on n’a pas vue depuis des années… » Et son interlocuteur, Avenarius, lui répond : « Je me demande sur quoi tu te fondes pour décréter qu’elle était belle. Elle tenait les vestiaires dans une brasserie qu’en ce temps-là je fréquentais tous les jours… En nous reconnaissant, nous nous sommes dévisagés avec embarras. Et même avec un certain désespoir, le même qu’éprouverait un jeune cul-de-jatte en gagnant une bicyclette à la tombola. Nous avions l’impression, tous les deux, d’avoir reçu en cadeau une coïncidence fort précieuse, mais parfaitement inutilisable. Quelqu’un semblait s’être moqué de nous et nous avons eu honte l’un devant l’autre. »
Si les mathématiques ne sont qu’un moyen de calcul du hasard, ils ne disent rien de ce que sera cette rencontre. A chacun de rebondir sur celle-ci ou de la laisser tomber. Le problème est d’ordre psychologique et non mathématique. Ainsi l’on reste libre de traiter ce hasard comme on l’entend, d’en faire un bien, un mal, ou un non événement.
06:49 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, psychologie |  Imprimer
Imprimer
30/11/2011
Robert des noms propres, roman d’Amélie Nothomb, Albin Michel, 2002
Une petite fille, encore bébé, est recueillie par sa tante parce q ue sa véritable mère s’est suicidée. Elle ne sait pas qu’elle ne constitue qu’une pièce rapportée dans la famille et vit perplexe, regardant gravement, profondément les êtres qui l’entourent. Parce que ce regard gênait la maîtresse, elle est renvoyée de la maternelle. Ses parents adoptifs sont fous d’elle, car elle est tellement différente de ses deux présumés sœurs. Son ambition : être danseuse. Elle est inscrite au cours de danse et devient la coqueluche de tous les admirateurs du pas de deux. Mais à cinq ans, sa tante dut se résoudre à la mettre en classe. Ce fut le drame.
ue sa véritable mère s’est suicidée. Elle ne sait pas qu’elle ne constitue qu’une pièce rapportée dans la famille et vit perplexe, regardant gravement, profondément les êtres qui l’entourent. Parce que ce regard gênait la maîtresse, elle est renvoyée de la maternelle. Ses parents adoptifs sont fous d’elle, car elle est tellement différente de ses deux présumés sœurs. Son ambition : être danseuse. Elle est inscrite au cours de danse et devient la coqueluche de tous les admirateurs du pas de deux. Mais à cinq ans, sa tante dut se résoudre à la mettre en classe. Ce fut le drame.
– Tu en mets du temps à réagir ! dit la maîtresse. Tous les enfants s’étaient retournés pour regarder celle qui avait été prise en faute. C’était une sensation atroce. La petite danseuse se demanda quel était son crime. – C’est moi qu’il faut regarder, et pas la fenêtre ! conclut la femme. Comme il n’y avait rien à répondre, l’enfant se tut. – On dit : « Oui, Madame » ! – Oui, Madame. – Comment t’appelles-tu ? demanda l’institutrice, l’air de penser : « Je t’ai à l’œil, toi ! » – Plectrude. –Pardon ? –Plectrude, articula-t-elle d’une voix claire. (…)– Eh bien, si tu cherches à faire ton intéressante, c’est réussi.
Elle ne s’intéressait pas à l’apprentissage de la lecture, et sa maîtresse désespérait. Or, un jour, elle lut comme une première de classe de dix ans. La maîtresse étonnée téléphona à ses parents. – Nous n’avons rien fait du tout. Nous lui avons seulement montré un livre assez beau pour lui donner envie de lire. C’est ce qui lui manquait. Nulle en mathématiques, Plectrude devint la bête noire de sa maîtresse. Ainsi, elle avait deux vies bien distinctes. Il y avait la vie de l’école, où elle était seule contre tous, et la vie du cours de ballet, où elle était la vedette. Fort heureusement, Roselyne, une danseuse du cours de ballet, arriva à l’école et devint l’amie de Plectrude.
Après quelques mois, elles inventent des jeux dangereux : se laisser ensevelir par la neige sans bouger, se laisser foncer dessus par un camion. Plectrude était à ce point danseuse qu’elle vivait les moindres scènes de sa vie comme des ballets. Les chorégraphies autorisaient que le sens du tragique se manifestât à tout bout de champ : ce qui, dans le quotidien, était grotesque, ne l’était pas à l’opéra et l’était encore moins en danse. « Je me suis donné à la neige dans le jardin, je me suis couchée sous elle et elle a élevé une cathédrale autour de moi, je l’ai vu construire lentement les murs, puis les voûtes, j’étais le gisant avec la cathédrale pour moi seul, ensuite les portes se sont refermées et la mort est venue me chercher, elle était d’abord blanche et douce, puis noire et violente, elle allait s’emparer de moi quand mon ange gardien est venu me sauver, à la dernière seconde. »
A douze ans, Plectrude cultivait son enfance. Elle se laissait aller au versant favori de son être ; consciente que, l’année suivante, elle ne le pourrait plus. Arriva un nouveau dans la classe. Mathieu Saladin avait une cicatrice partant de la lèvre. Elle en conclut qu’il s’était battu au sabre. La nuit qui suivit cette première rencontre, Plectrude se tint ce discours : « Il est pour moi. Il est à moi. Peu importe que ce soit dans un mois ou dans vingt ans. Je me le jure. »
Rien n’allait plus à l’école, mais Plectrude fut admise à l’école des rats. Le premier jour fut digne d’une boucherie : « Les minces, c’est bien, continuez comme ça. Les normales, ça va, mais je vous ai à l’œil. Les grosses vaches, soit vous maigrissez, soit vous partez : il n’y a pas de place ici pour les truies. » (…) « Huit heures à la barre par jour et un régime de famine, cela ne paraîtra dur qu’à celles qui n’ont pas assez envie de danser. Alors, que celles qui veulent encore partir partent ! »
Et Plectrude dansa, à avoir mal partout, sans manger. En trois mois, elle perdit cinq kilos. Elle se décalcifiât. Ce qui devait arriver arriva. Un matin de novembre, comme Plectrude venait de se lever en mordant son chiffon pour ne pas hurler de douleur, elle s’effondra : elle entendit un craquement dans sa cuisse. Hospitalisée, les médecins lui disent qu’elle ne pourra plus jamais danser. Revenue à la maison, elle finit progressivement par prendre plaisir à manger, mais sa mère dépérit et lui en veut de grossir. Elle lui parle sèchement à tel point que Plectrude lui demande : « Pourquoi me parles-tu comme ça ? Ne suis-je plus ta fille ? – Tu n’as jamais été ma fille. Et sa mère lui raconte tout. Tout s’effondrait. Elle n’avait plus de destin, elle n’avait plus de parents, elle n’avait plus rien.
Alors Plectrude se lance dans le théâtre et veut un enfant, comme sa mère, au même âge, dix-neuf ans. Après son accouchement, son œuvre étant accompli, elle décide de se suicider en sautant du pont Alexandre III. Au moment où elle allait sauter, elle entend : « Plectrude ! ». C’était Mathieu. Ils s’aiment. Ils se marient. Mais la fin du livre laisse sur sa faim, elle est non seulement insolite, mais difficilement compréhensible. Et à l’heure qu’il est, Plectrude et Mathieu n’ont toujours pas trouvé la solution.
Une fois encore, Amélie Nothomb nous interpelle. Une histoire menée tambour battant, plus de vingt ans de vie en quelques deux cent pages, des dialogues saisissants et opiniâtres, des rebondissements. Cependant la fin surprend, est insaisissable et laisse une impression d’incompréhension qui s’étend à l’ensemble du livre. Quel dommage !
03:00 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, fiction |  Imprimer
Imprimer
18/11/2011
Leçon d’écriture
La description faite par Murakami dans son dernier livre 1Q84 (livre 1, p.125 et suite) est suffisamment détaillée pour donner des idées à ceux que tente l’écriture. Le héros du livre est en effet chargé par son éditeur de revoir un roman écrit par une jeune fille. Ce dernier le trouve bon dans les idées développées, mais pas suffisamment bien écrit pour que le lecteur poursuive au-delà de quelques pages.
En fait, il était midi et demie lorsque Tengo s’attaqua à la réécriture… Pour le moment, il essaierait de corriger cette partie jusqu’à en être satisfait. Il ne changerait rien au contenu, mais il réorganiserait la syntaxe et modifierait radicalement le style. De la même façon qu’on rénove les pièces d’un appartement…
Entrant dans les détails, l’auteur décrit ses procédés de travail comme il expliquerait la façon dont il rend malléable le chewin-gum dans sa bouche pour jouer avec, tantôt l’étirant à profusion en longs et minces filaments, tantôt le concentrant en boule emplissant ses joues pour en goûter plus profondément la saveur.
J’ajoute des explications aux passages difficiles à comprendre à la première lecture. Je m’arrange pour que les phrases coulent mieux. Je coupe les endroits inutiles et les répétitions, je comble les lacunes…
L’écrivain se plonge totalement dans cette mécanique précise de la réparation d’un texte ou de son enjolivement. Il arrive à force de contorsions grammaticales et de recours aux manquements du texte à redéfinir son contenu sans cependant en modifier le sens. Il s’attache également à préciser le lecteur, ou plutôt les réactions du lecteur, se mettant à sa place et imaginant sa compréhension des descriptions.
Mais à quelle catégorie de lecteurs ce texte pouvait-il être destiné ? Tengo l’ignorait, bien entendu. Ce qu’il savait néanmoins, c’est que la Chrysalide de l’air était une fiction tout à fait unique, contradictoire, possédant une beauté originelle et de gros défauts, et qu’en même temps elle recelait un dessein particulier.
Cette première confrontation avec le manuscrit pour en modifier l’équilibre ne suffit bien sûr pas. Il faut se poser la question de la justesse et de l’équilibre des propos, retirer les lourdeurs incongrues, repeser les formules pour les assouplir.
A la suite de son travail, le texte devint deux fois et demie plus long que le manuscrit original. (…) A présent les phrases étaient devenues logiques et sensées, le point de vue était clair et la lecture d’autant plus fluide. Mais l’ensemble avait quelque chose de lourd. En privilégiant la logique, il avait affaibli l’acuité et le tranchant que possédait le début de l’original.
Alors, on se remet à la tâche : supprimer de la nouvelle version les passages non indispensables.
Le travail de rabotage était beaucoup plus facile que celui de remplissage… C’était une sorte de jeu intellectuel. Durant un laps de temps déterminé, il étoffait le texte, autant que possible, puis durant un laps de temps déterminé, il le réduisait, autant que possible. En poursuivant obstinément ces opérations opposées et complémentaires, l’amplitude diminuait peu à peu et le texte finissait par se stabiliser à un niveau d’équilibre satisfaisant.
Mais ce n’est terminé, loin de là. Après une pause, il reprend sa matière. Il imprime les pages réécrites :
Il posa alors les pages imprimées devant lui et relut attentivement l’ensemble, un crayon à la main. Lorsqu’il estimait qu’un passage était oiseux, il le rayait ; lorsqu’il sentait qu’un autre était médiocre, il le développait. Il continua ainsi ses corrections jusqu’à ce que les parties mal adaptées au contexte soient satisfaisantes. Comme on choisit un carreau pour combler un petit espace dans une salle de bain, il sélectionnait précisément le mot qui convenait pour tel passage, il vérifiait son ajustement sous des angles très variés. De minuscules nuances animaient le texte dans pour autant l’abimer.
Pas mal, songea Tengo après avoir entré dans sa machine les corrections faites à la main. Chaque phrase possédait un poids convenable, se lisait naturellement, sans à-coups.
Ainsi s’achève cette leçon d’écriture, passionnante de détails pour ceux qui s’essaient, insupportables pour les non initiés, encore insuffisantes pour les virtuoses du stylo. L’écriture ne serait qu’une vulgaire mécanique dont l’essentiel est un réglage de précision entre un récit qu’il faut raconter, uns syntaxe à utiliser consciencieusement et avec respect, des enjolivements rendant l’ensemble plus seyant, un équilibre de fortune, toujours remis en cause par un fragment à ajuster, par une impression à développer.
Et l’écrivain devient le mécanicien tourmenté par des bruits imprévus, des pétarades incongrues, qu’il faut éliminer pour qu’à la fin le ronronnement du texte apparaisse naturel, sans effort, déroulant son récit à la manière d’une coulée de chocolat dans un moule pour le transformer en appétissante friandise dont le lecteur va se pourlécher les neurones.
07:29 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, écriture, écrivain |  Imprimer
Imprimer
09/11/2011
Antechrista, roman d’Amélie Nothomb
Le premier jour, je la vis sourire. Aussitôt, je voulus la connaître… Une semaine plus tard, ses yeux se posèrent sur moi… Le lendemain, elle vint vers moi et me dit bonjour…
Ainsi s’installe tranquillement Christa dans la vie de la narratrice, laquelle est timide, sans amie, mal à l’aise dès qu’il s’agit d’aborder quelqu’un. Très vite, elle invite Christa à venir coucher chez elle parce que celle-ci habite très loin. Dès l’entrée dans l’appartement, Christa devient dominatrice et humiliante. Après s’être mise nue pour essayer une robe, elle contraint l’auteur, Blanche, à faire la même chose : J’avais seize ans. Je ne possédais rien, ni biens matériels ni confort spirituel. Je n’avais pas d’ami, pas d’amour, je n’avais rien vécu. Je n’avais pas d’idée, je n’étais pas sûre d’avoir une âme. Mon corps, c’était tout ce que j’avais. Elle finit par passer la robe ce qui fait dire à Christa : Elle me va mieux qu’à toi. Puis elle compare leur corps, cache le tee-shirt de Blanche qui doit courir après pour le récupérer. Sa mère entre alors : transformation de Christa, son rire, de démoniaque, devint la fraicheur même, une franche hilarité, saine comme son corps. Ma mère, stupéfaite, regardait cette adolescente nue qui lui serrait la main sans aucune gêne… Et je voyais que celle-ci, sans penser à mal, voyait le beau corps plein de vie de la jeune fille – et je savais que, déjà, elle se demandait pourquoi le mien était moins bien. Christa, en une soirée, séduit le père et la mère de Blanche, les tutoie et les appelle par leur prénom.
Le lendemain, ma mère déclara : Ta Christa est une trouvaille ! Elle est incroyable, drôle, spirituelle, pleine de vie… Mon père lui emboîta le pas : Et quelle maturité ! Quel courage ! Quelle intelligence ! Quel sens des relations humaines !
Ainsi est planté le décor qui permet à la perverse Christa de s’introduire dans la vie de Blanche jusqu’à devenir la fille chérie de ses parents : elle dort dans son lit, l’emmène dans des soirées étudiantes où elle lui fait connaître le flirt, s’impose comme la meilleur en tout et fait tout pour ridiculiser Blanche qui n’ose rien dire devant ses parents subjugués par cette jeune fille exquise. Mais celle-ci va trop loin. Elle provoque Blanche : Pourquoi tes parents parlent-ils tant pendant ces diners ? C’est à peine si je peux en placer une. Déjà qu’ils se servent de moi pour se rendre intéressants !
Blanche découvre toute l’ignominie de Christa, ou plutôt d’Antechrista, comme elle l’a surnommée. Celle-ci n’aimait qu’elle. Elle s’aimait avec une rare sincérité. L’amour était pour Antéchrista un phénomène purement réflexif : une flèche partant de soi en direction de soi. Il lui fallait maintenant ouvrir les yeux de ses parents. Elle part en voyage à Malmédy, lieu où habite Christa et découvre qu’elle lui a menti sur ses conditions de vie. Elle prend des photos, les montre à ses parents et très vite sa mère comprend. Son père téléphone au père de Christa et comprend également que celle-ci ne vit que par et pour le mensonge. Le lendemain, Christa joue l’offensée et part en claquant la porte.
Je ne raconterai pas la fin, car elle constitue une surprise de la part de Blanche, sa revanche. Cependant, dans la dernière page, c’est encore Christa qui a le dessus, de manière indirecte.
Antechrista est le roman de la lutte entre l’intériorité et l’apparence : d’une part, l’intériorité silencieuse et timide, n’osant dévoiler sa vérité, et, d’autre part, l’apparence avec ses mensonges, ses changements d’attitude où tout est conçu pour plaire, même en trompant. C’est sans doute le combat actuel qui se déroule dans les médias, quels qu’ils soient. Dans le roman, le combat est individuel et intimiste. Dans la vie médiatique, le combat est collectif et clamé par les tenants de l’information. Mieux vaut une information quelle qu’elle soit que pas d’information. Le monde pourra-t-il tenir longtemps ce mensonge permanent ?
08:10 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman |  Imprimer
Imprimer
25/10/2011
Contrepoint, roman d’Anna Enquist, Actes Sud, 2010
C'est une visite particulière des variations Goldberg, vue par une femme :
La femme s'appelait tout simplement "femme", peut-être "mère". Il y avait des problèmes d'appellation. Il y avait beaucoup de problèmes. Dans le conscient de la femme, des problèmes de mémoire affleuraient. L’aria qu'elle examinait, le thème à partir duquel Bach a composé ses Variations Goldberg rappelait à la femme des périodes pendant lesquelles elle avait étudié cette musique. Quand les enfants étaient petits. Avant. Après. Elle n’était pas à l'affût de ces souvenirs. Sur chaque cuisse un enfant, puis se débrouiller tant bien que mal, les bras autour de leurs corps, pour produire ce thème ; pénétrer dans la petite salle du Concertgebouw, voir le pianiste entrer sur scène, attendre le souffle coupé l’octave dépouillée de l'attaque - sentir le coude de la fille : "Maman, c'est notre air !" Ce n'était pas le moment. Elle voulait seulement penser à la fille. La fille quand elle était bébé, fillette, jeune femme.
Aria, des variations Goldberg, joué par Glenn Gould :
http://www.youtube.com/watch?v=Gv94m_S3QDo
Cette femme est musicienne, concertiste même. On ne comprend qu’à la fin du livre qu’elle a eu un grave accident au cours duquel sa fille, la fille, a perdu la vie. Cette visite des variations Goldberg, une par une, effeuillant des sentiments et des souvenirs selon la variation, est une thérapie qui permet d’évoquer l’être disparu, bébé, petite fille, jeune fille, femme, sans jamais tomber dans le sentimentalisme, la morbidité ou même l’asthénie. C’est, à travers l’analyse de chaque variation l’évocation de souvenirs tendres, simples, si simples qu’on ne se rend pas compte qu’il s’agit d’une évocation d’évènements douloureux.
Tiens, prends les Variations Goldberg, par exemple. Tu joues l'aria. Mais non, pensa la femme, je ne jouerai jamais plus cette aria. Bon, mets-le au passé, tu as joué l'aria, cet air tranquille, tragique. C'est une sarabande, écoute, un rythme solennel et l'accent sur chaque deuxième temps, une danse lente, peut-être majestueuse. Tu jouais l'aria avec ardeur, avec passion, avec l'obligation d’un sans faute. Les notes prolongées se multipliaient vers la fin en guirlandes de doubles croches, sans pour autant que la cadence perde de son sérieux. Tu ne cédais pas à la tentation de te mettre à jouer plus doucement, en chuchotant à la fin, de conclure par un soupir à peine audible. Non, même à l’époque déjà, tu laissais ces tristes festons aller crescendo au-dessus de la ligne de basse progressant tranquillement, il ne fallait pas se précipiter, et même plutôt ralentir imperceptiblement - mais le tout avec force. Jusqu'à la fin.
C’est un journal qui ne le dit pas, un journal au fil des partitions, tantôt lent, calme, serein, tantôt pressé, courant de souvenirs en souvenirs. Et la femme se reconstruit dans cette analyse des variations de Bach :
L’étude obsessionnelle lui avait permis de savoir jouer les variations, mieux que jamais auparavant, mieux que lorsqu'elle était en bonne santé et complète. Cela aussi l’étonnait, il aurait dû être impossible qu'une pianiste abîmée et amputée puisse connaître sur le bout des doigts cette œuvre compliquée. Elle y était parvenue, en dépit de et grâce à la blessure. Son cerveau endommagé avait réussi à s'imprégner des notes et à distinguer les mélodies. Au rythme de la musique, elle avait chaque jour pu respirer un certain temps naïvement. Par des voies détournées, Bach lui avait donné accès à sa mémoire : chaque variation évoquait des souvenirs de l'enfant, qu'elle notait dans 1e cahier. Avec méfiance, car les souvenirs sont des mensonges. Avec retenue, car elle ne voulait pas faire de sentiment.
Ce n’est que dans les dernières pages que l’on comprend ce lent cheminement au travers la musique si bien construite de Bach, si pleine de calme physique, de douceur des émotions, d’équilibre d’une rationalité invisible, d’ouverture mystique.
Le voyage interminable pour rentrer à la maison, en état de choc total. Les trains, les avions. Les amis attendant en silence dans le hall de l'aéroport. L’enfant froide. La maison pleine de monde, un soir après l'autre. Les pourvoyeurs de repas, les scripteurs d'adresses. Les aides.
L’enfant froide. (…)
La toilette, l'habillage, les soins et la disposition. La petite couverture, la poupée. L’adieu. La levée. Le transfert. Le port. L’installation dans l'endroit où elle va désormais rester. La prise de possession du cimetière comme annexe au salon. Le trépignement devant la grille fermée après quatre heures.
Et comme dans les variations Goldberg, le livre s’achève par une méditation sur l’aria final comme il avait commencé sur l’aria introductive.
Derrière les fenêtres l'été est brûlant. A l'intérieur, il fait sombre et frais. Elle allume la lampe du piano. "Allez viens, dit-elle à sa fille. Je vais te jouer un morceau. Je l'ai beaucoup travaillé. Ecoute." Puis s’épanouit l'aria. Les sons de l'ensemble des trente variations vibrent à chaque note ; l'air simple entraîne derrière lui sans peine un cortège de souvenirs. Il se déploie avec une évidence désarmante. Il contient tout ce qu'aime la femme. (…)
L’avenir s'est retiré dans le recoin le plus éloigné de la pièce. Dehors, la vie continue son insoutenable progression. Dans un petit monde, détaché de l'espace et du temps, la mère joue un air pour son enfant. Pour la première et la dernière fois. La jeune fille s'appuie contre son épaule. "C'est notre air", dit-elle. La mère acquiesce et amorce le crescendo des dernières mesures ; imperturbable, elle fonce vers la fin. A la toute dernière mesure, elle sautera la reprise et aboutira sans ornement à la double octave vide. Dans ce vide se trouve tout. Maintenant elle joue, maintenant et toujours la femme joue l'air pour sa fille.

Contrepoint est un beau livre, discret, intime, qui dévoile le cœur d’une artiste et d’une mère avec douceur, dans le déroulement quotidien des faits simples et l’étude ardue des partitions. Cet entremêlement de la musique et de la vie devient une thérapie douce qui conduit la femme du désespoir à l’acceptation. Le roman est parfois un peu long, un peu lent, mais, au-delà de la femme, on découvre la vie intérieure de Jean-Sébastien Bach, celle de la naissance de ses œuvres, de son architecture musicale dévoilée par la méditation de chacune des variations.
01:36 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, musique, bach |  Imprimer
Imprimer
14/10/2011
Les catilinaires, roman d’Amélie Nothomb
« A l’approche de mes soixante-cinq ans, Juliette et moi cherchions quelque chose à la campagne ? Nous avons vu cette maison et aussitôt nous avons su que ce serait la maison ? Malgré mon dédain des majuscules, je me dois d’écrire la Maison, car ce serait celle que nous ne quitterions plus, celle qui nous attendait, celle que nous attendions depuis toujours. »
Ainsi commence Les catilinaires qui racontent l’arrivée inopinée dans ce paradis d’un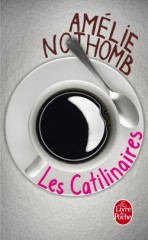 emmerdeur, monsieur Bernardin, cardiologue de son état, qui chaque jour entre chez eux, de quatre heures à six heures, prend son café, ne répond que par oui ou non à leurs imaginatives questions, et s’impose sans aucune politesse. Palamède, car tel est son prénom, les dérange à tel point qu’ils ne savent plus quoi inventer pour s’en débarrasser. Un jour, ils partent se promener à 4 heures moins dix, le laissant seul devant leur porte. Le lendemain, elle est au lit parce qu’elle a pris froid. Il frappe à la porte qu’ils ne veulent pas ouvrir, à tel point qu’ils leur semblent qu’il va la casser. Emile, son mari, celui qui raconte leur mésaventure, finit par ouvrir. Mais Palamède refuse d’examiner Juliette et lui demande une tasse de café. Il finit par monter et pose sa main sur le front de Juliette. – Rien, elle n’a rien. Mais il est dans la chambre et s’installe sur une chaise. – Docteur, vous n’allez pas rester là ? Si je vais au salon, vous devez venir aussi. – Je ne peux pas la laisser seule. – Elle n’est pas malade.
emmerdeur, monsieur Bernardin, cardiologue de son état, qui chaque jour entre chez eux, de quatre heures à six heures, prend son café, ne répond que par oui ou non à leurs imaginatives questions, et s’impose sans aucune politesse. Palamède, car tel est son prénom, les dérange à tel point qu’ils ne savent plus quoi inventer pour s’en débarrasser. Un jour, ils partent se promener à 4 heures moins dix, le laissant seul devant leur porte. Le lendemain, elle est au lit parce qu’elle a pris froid. Il frappe à la porte qu’ils ne veulent pas ouvrir, à tel point qu’ils leur semblent qu’il va la casser. Emile, son mari, celui qui raconte leur mésaventure, finit par ouvrir. Mais Palamède refuse d’examiner Juliette et lui demande une tasse de café. Il finit par monter et pose sa main sur le front de Juliette. – Rien, elle n’a rien. Mais il est dans la chambre et s’installe sur une chaise. – Docteur, vous n’allez pas rester là ? Si je vais au salon, vous devez venir aussi. – Je ne peux pas la laisser seule. – Elle n’est pas malade.
Ils choisissent alors la dérision. Mon cher Palamède, que pensez-vous de la taxonomie chinoise ? Et pendant dix pages, le couple échange des réflexions sur la manière d’effectuer des classifications, tout cela de manière extraordinairement savante et ponctuée de citations inconnues dont le but est de faire sortir de ses gonds Palamède. Imaginez, cher ami, que je me mette en tête de vous d’écrire en commençant par énumérer tout ce que vous n’êtes pas. Ce serait fou. Par où débuter ? Par exemple, on pourrait dire que le docteur n’est pas un animal à plumes : En effet, et il n’est pas un emmerdeur, ni un rustre, ni un idiot. Mais l’hôte reste impassible.
Alors ils imaginent d’inviter le docteur avec sa femme à diner. Un kyste, cette chose était un kyste. Eve fut tirée d’une côte d’Adam. Madame Bernardin avait sans doute poussé comme un kyste dans le ventre de notre tortionnaire… Palamède avait épousé l’amoncellement de chair dont on l’avait libéré. […] Chère madame, quelle joie de vous rencontrer. A ma grande surprise, un tentacule de gras se détacha de la masse et se laissa toucher par les doigts de ma femme.
Et reprirent les visites imposées de Bernardin chaque jour de quatre à six. Ils découvrent que Palamède est un homme qui n’éprouve aucun plaisir à quoi que ce soit ? Ni à manger, ni à boire, ni même à emmerder. C’est un cauchemar. Il fait fuir une ancienne élève d’Emile. Le lendemain celui-ci accueille monsieur Bernardin par un « Foutez le camp et ne revenez plus jamais ! ».
Dans la nuit, Emile se lève, réveillé par un bruit de moteur qui venait de la maison d’en face. Il découvre Palamède dans sa voiture en situation de suicide par les gaz d’échappement. Il le sort et l’apostrophe en attendant l’ambulance. Rentrés chez eux, la pensée de sa femme seule dans sa maison les oblige à y revenir. Elle dort. Ils prépare une soupe, seule nourriture qui lui convienne vraiment.
C’est maintenant le printemps. Monsieur Bernardin ne vient plus de 4 à 6. Il rit de ce que Juliette et Emile font pour eux. Après quelques autres péripéties et énervements, Emile tue Palamède dans son lit en l’étouffant. Juliette ne sait rien ? Je ne le lui dirai jamais. Si elle se doutait que l’homme qui partage son lit est un assassin, elle mourrait d’horreur. A la faveur de son ignorance, elle a estimé que le trépas du voisin était une bonne chose. Elle allait enfin pouvoir s’occuper de Bernadette… C’est ma meilleure amie, m’a dit Juliette après quelques mois.
Ce livre laisse une impression mitigée. L’histoire est loufoque, exagérée, rien de tout cela ne peut se passer dans la réalité. Mais elle est contée d’une manière tellement proche de la réalité possible qu’elle parait vraie et donc ni drôle, ni attendrissante. Plutôt estomaquante, comme les deux Bernardin. Mais dans le même temps, l’art de conter d’Amélie Nothomb en fait un petit chef d’œuvre qui permet d’oublier l’histoire pour ne s’arrêter qu’aux dialogues, aux descriptions, aux sentiments exprimés par le couple qui croyait avoir trouvé un refuge pour leur vieillesse. L’écriture permet au lecteur de dépasser la fable et de ressentir tout l’art de la romancière, cinglant, plein d’humour caché. Bref, une leçon d’écriture.
06:37 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, imagination |  Imprimer
Imprimer
11/10/2011
Oh ! Les beaux jours, de Samuel Beckett
Théâtre de l’inéluctable. Chaque jour passe et ressemble aux autres jours, toujours semblables, mais pendant lequel, imperceptiblement, inéluctablement, les êtres changent sans qu’ils en aient conscience : « Je vois de moins en moins bien… Pas moins qu’hier… Pas mieux que d emain… ».
emain… ».
Chaque geste de la vie quotidienne devient un évènement attendu impatiemment au cours de la journée, de même que la moindre démonstration d’intérêt, de prévenance de la part d’autrui, un sourire, un mot, un geste même, le plus petit soit-il (lever le petit doigt) prend une importance considérable et suffit à éclairer la journée. « Çà que je trouve merveilleux », dit Winnie pour tout ce qui vient rompre la monotonie des heures.
« Quel beau jour encore », telle est la morale de Beckett : il y a toujours une raison d’être heureux, il y a toujours un évènement qui, si on y prend garde, suffit à donner la joie pour une journée. Ce jour où Willie, malgré ses infirmités, sa condition humaine réduite à la vie animale, sort de son trou pour regarder sa femme, est le plus beau jour de la vie de celle-ci, parce qu’il est là, présent, réel. Et cet homme qu’elle ne reconnaît plus, dont la laideur l’effraie, tente de lui témoigner ce qu’il lui reste d’amour, faisant de l’enlisement, de l’incapacité de bouger de sa femme, un paradis aussi beau que celui de sa jeunesse.
06:28 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, théâtre, philosophie |  Imprimer
Imprimer
02/10/2011
Cosmétique de l’ennemi, roman d’Amélie Nothomb
Désolé, mais cette fois-ci je ne crierai pas au chef d’œuvre. Ce roman m’a paru plat, sans consistance, une performance littéraire peut-être, mais surement pas un livre enchanteur ou passionnant. Un exercice de style, sans intérêt littéraire.
"COSMETIQUE, l’homme se lissa les cheveux avec le plat de la main. Il fallait qu’il fût présentable afin de rencontrer sa victime dans les règles de l’art." Ainsi commence le livre qui raconte, dans un hall d’aéroport où les passagers attendent un avion en partance, l’étrange rencontre entre Jérôme Angust, qui part en voyage d’affaires, et Textor Texel, un homme qui veut à tout prix engager la conversation et ne plus le quitter. Jeux de passe verbaux, refus, redémarrage de la conversation, injures, rien n’y fait, Textor ne décolle pas de Jérôme.
Je ne vous raconterai pas la suite, je me suis arrêté à la page 75 après que Textor ait raconté le viol d’une jeune fille dans le cimetière de Montmartre, puis sa rencontre quelques années plus tard. J’ai estimé à cet endroit du livre que j’en avais assez lu pour me faire une idée de son contenu. J’avais tenu bon jusque là, mais je craquais. C’en était trop.
Alors, je regardais à la fin du livre. Oh stupeur (sans tremblement). Il finissait en suicide (dernière page) ou en meurtre (avant-dernière page). De quel personnage, me direz-vous ? Si le meurtre de Textor par Angus est bien conté de manière à peu près clair en quelques lignes, le suicide reste incertain, malgré une demi-page, entre une deuxième mort de Textor ou celle de l’auteur du meurtre précédent. Cela finissait aussi mal que cela avait commencé.
Que dire ? Amélie Nothomb ne signe pas là son meilleur livre, c’est certain. Elle a voulu jouer, jouer avec les mots, jouer avec l’échange entre deux êtres, jouer à tromper ses lecteurs au travers d’un dialogue qui lasse très vite, tel un échange de balles interminables entre deux mauvais joueurs de tennis. La seule fois où l’on entend la frappe sèche sur les raquettes se trouve en fin de livre, par la mort de l’un, puis peut-être de l’autre. Et encore, il faut dresser l’oreille pour l’entendre !
05:30 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman |  Imprimer
Imprimer











