25/09/2011
Il y a longtemps mon amour, roman de Vladimir Volkoff (1998)
Ce n’est pas un roman, plutôt une autobiographie voilée. Volkoff se raconte ou plutôt raconte ses amours passés, parce que le temps le poursuit et qu’il a encore beaucoup de choses à dire. Alors il relate sous le personnage de Ladislas Radowa-Dzikowski, vicomte de La Vieillevigne, totalement fictif, mais très proche sentimentalement de lui, ses aventures féminines jusqu’au grand amour de sa vie, Elise. Grand nostalgique d’un passé révolu, qu’il considère en même temps comme totalement dépassé, il use de son ton à la fois romantique et réaliste, charmeur et désabusé. Volkoff traditionnel et moderne, aristo et homme de l’ombre.
Il décrit ainsi son premier amour, Aude, fille du secrétaire de mairie, qui était le sacré, la poésie même. A quinze ans, il apprit qu’elle était enceinte du mécano du village. Ils se revirent encore un fois, des lustres de lustres après, dans un bistrot, au fond d’une autre province… Touchant, oui, mais, finalement, ils n’avaient rien d’autre à se dire, sinon qu’ils s’étaient attendus et qu’ils ne s’attendraient plus.
Etudiant à la Sorbonne, il connut Rosemonde. Ils prennent le métro ensemble, saine distraction. Il l’invite au bal de la Sorbonne auquel elle va avec sa mère comme chaperon et où elle fit connaissance avec Michmich, jeune garçon qui va finir par ravir la belle à Ladislas sans toutefois en devenir le mari ou même l’amant. Mais, entre temps, Ladislas l’embrasse et en profite jusqu’au moment du choix, qu’il refuse.
Militaire, aspirant, il fait connaissance avec un personnel féminin de l’armée de terre, une PFAT, Yvonne, employée comme lui dans le renseignement. Ils sont faits l’un pour l’autre, affamés d’amour l’un et l’autre, lecteurs de romans et auditeurs de musique classique. Ladislas veut parfaire son éducation. Il voulait Yvonne transplantée, transmutée, il voulait une Yvonne qui ne fut plus Yvonne, et elle l’y encouragea. Le malentendu n’apparut pas immédiatement. Quinze jours plus tard, Ladislas lui demande si elle veut l’épouser. Ils se marièrent. Cela ne dura guère plus d’un an. Ce fut alors la séparation. Pour Ladislas, l’attente et la rencontre de l’âme sœur se terminaient dans la déconfiture totale.
Rentré en France, toujours dans le théâtre d’ombres, il découvre Luciole, secrétaire dans les mêmes lieux. Il déjeune chaque jour avec elle, mais elle est mariée. Il cherche à la prendre un soir, mais elle refuse. Il prenne une chambre dans un hôtel, mais elle refuse encore. Enfin, un jour, il la raccompagne et elle lui dit viens, maintenant, j’ai envie. Mais son père les surprend au lit. Il fuit. Après un dernier entretien, il ne la revit plus.
Toute autre est Bérénice de Fruminy, comtesse du Saint-Empire. Lorsque Bérénice parut au Hache-menu, elle déplut. Son port de tête altier, son cou sculptural, l’ovale irréprochable de son visage, la rigueur de ses traits classiques, la plénitude de ses formes, surprenante dans une aussi jeune femme, et l’arrogance constante de son maintien avait de quoi irriter de jeunes hommes qui aiment aimer facilement. Ladislas, lui, fut ravi de cette attitude hautaine à laquelle ce physique se prêtait si bien ; son orgueil trouvait enfin à qui parler ; il avait rencontré une femme à qui il n’avait rien à apprendre sur le chapitre du dédain. Ils se lièrent. Après les aventures habituelles entre une jeune fille et un jeune homme, une absence insolite et prolongée de sa petite amie, elle lui déclara : « Il y a une chose que je ne vous ai pas dite hier. Je devais avoir un enfant, d’où mon retard à rentrer à Paris. Une fausse couche la semaine passée. Passez me prendre ce soir à la même heure. » Mythomane, affabulatrice ? Il ne sut pas, il ne la revit pas.
Il y eut Emmeline (oui, avec deux m) avant Elise. Bretonne, un peu sorcière, il s’intéressait lui-même à l’ésotérisme, elle avait aimé un allemand pendant la guerre, puis s’était mariée avec un autre allemand. Avec d’autres, j’ai joué à des jeux. La coquetterie, la jalousie, la bouderie, les piques, le bras de fer amoureux. Vous, je veux vous aider à vivre. Vous n’aurez jamais un instant de déplaisir par ma faute.
Enfin, Elise dont Ladislas est tombé amoureux deux fois, à dix ans de distance en une pièce en quatre actes. Premier acte : A la Sorbonne, échange de lettres enflammées, mais elle refuse cette amourette. Deuxième acte : l’amitié, une affinité, sans doute, et l’élection de cette affinité, plus la confiance l’un dans l’autre, le besoin l’un de l’autre, l’admiration l’un pour l’autre, l’être bien avec l’autre, bref une flexion complète des prépositions sympathiques. Bien après le mariage de Ladislas avec Yvonne, il la revit et elle tombe amoureuse de lui. Troisième acte : l’amour. Il était à l’époque l’amant d’Emmeline. Vinrent les aveux, empreints d’une consternation amusée : « J’éprouve pour vous de l’amitié, de la confiance, de l’estime, de la tendresse, du respect, du désir. La somme ne s’appelle-t-elle pas amour ? écrivait Ladislas à son amie, et elle répondait, médusée : « Sans doute… » Comme l’annulation de son mariage tardait, elle le suit dans ses pérégrination et lui inspire la poésie. Quatrième acte : le mariage, lorsque l’annulation en cour de Rome arrive. L’amour qui liait Elise à Ladislas leur était si précieux qu’un instant ils hésitèrent à le hasarder sur la case mariage, comme jadis ils avaient hésité à miser leur amitié sur la case amour. Après la vente du château, ils s’installent dans la métairie voisine. Mais, époux et parents, ils restaient avant tout des amants.
Et voilà… Il y a longtemps, mon amour… Oui, il y avait longtemps.
C’était Volkoff, funambule et poète, homme de l’ombre, que j’ai rencontré dans le train pour Lille où nous allions à une table ronde parler de renseignement et d’information. Nous avions devisé toute la durée du voyage sur la manipulation, lui prétendant que toute conversation, voire toute rencontre humaine est une recherche de manipulation, moi défendant l’idée que ce qui différencie le juste des autres hommes est sa faculté à laisser libre l’autre de penser ce qu’il veut après lui avoir donné les raisons de croire à ce que lui, l’homme juste, croit.
05:16 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, amour |  Imprimer
Imprimer
21/09/2011
Première des « Cinq méditations sur la beauté », de François Cheng
François Cheng nous parle de la beauté en tant qu’élément essentiel de définition de la vie. Homme de nulle part, ou de toute part, comme il le dit, il observe sans parti pris culturel, lui qui appartient aux cultures chinoise et occidentale. Il dit qu’il comprend le vrai qui permet l’existence de la réalité, qu’il comprend le bon, sinon l’humanité s’entretuerait et ne survivrait pas. Mais la beauté ? Elle est là, de façon omniprésente, insistante, pénétrante, tout en donnant l’impression d’être superflue, et c’est là le grand mystère.
Le mystère est pour lui la singularité de chaque être. Chaque herbe, chaque fleur, chacun de nous est unique et irremplaçable. C’est un don inouï. On pourrait imaginer un monde dans lequel chaque catégorie se différencie sans distinction des éléments qui la composent. Non, dans notre monde, toute unité est toujours unique. Et cela, parce que notre unicité est liée à notre condition de mortels. La beauté est effectivement éphémère. Une vraie beauté ne saurait être un état figé perpétuellement dans sa fixité. Son advenir, son apparaître-là, constitue toujours un instant unique ; c’est son mode d’être. Chaque être étant unique, chacun de ses instants étant unique, sa beauté réside dans son élan instantané vers la beauté, sans cesse renouvelé, et à chaque fois comme neuf.
Chaque être est présence, virtuellement habitée par la capacité de beauté, mieux par le désir de beauté. Et cette présence est transcendance. Plus l’être est conscient, plus ce désir chez lui se complexifie : désir de soi, désir de l’autre, désir de transformation dans le sens d’une transfiguration. François Cheng va au-delà, il rejoint les grands mystiques et montre que l’homme, par ce désir, rejoint le désir originel d’une relation qui l’élève et le dépasse. La vraie transcendance est dans l’autre.
Quelle belle méditation, discrète et profonde, pleine de poésie et de mysticisme. Penser la beauté à travers l’Etre, unique, en mouvement, que dis-je, en désir de beauté, n’est-ce pas une idée merveilleusement vraie, fruit d’une connaissance de la vie que peu d’hommes ont.
02:07 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philosophie, beauté, transcendance |  Imprimer
Imprimer
18/09/2011
Stupeurs et tremblements, roman d’Amélie Nothomb
Monsieur Haneda était le supérieur de monsieur Omochi, qui était le supérieur de monsieur Saito, qui était le supérieur de mademoiselle Mori, qui était ma supérieure. Et moi, je n’étais la supérieure de personne. […] Donc, dans la compagnie Yumumoto, j’étais aux ordres de tout le monde.
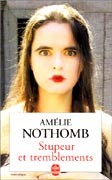
Ainsi commence cette incroyable histoire qui est bien quelque peu autobiographique. Amélie est embauchée pour un an par la compagnie. Elle va connaître les affres de tous les japonais débutants. On commence en bas de l’échelle et l’on ne s’élève qu’à la condition d’une obéissance sans limite. Pas d’initiatives, elles sont toutes mal vues.
Elle commence, sur demande d’un de ses supérieurs, par rédiger une lettre à un certain Adam Johnson pour accepter son invitation à jouer au golfe. Ce directeur lui fait recommencer, recommencer, recommencer, sans explications, jusqu’à ce que sa supérieure, mademoiselle Mori, arrive. Fubuki, c’est son prénom, la charme. Elle était svelte et gracieuse à ravir, malgré la raideur nippone à laquelle elle devait sacrifier. Mais ce qui me terrifiait, c’était la splendeur de son visage. […] Elle avait le plus beau nez du monde, le nez japonais, ce nez inimitable, aux narines délicates et reconnaissables entre mille. […] Fubuki incarnait à la perfection la beauté nippone, à la stupéfiante exception de sa taille. Elle mesurait en effet un mètre quatre-vingt.
Elle prend la fonction de l’ôchakumi, l’honorable thé. Mais lors de la réception d’une délégation étrangère à l’entreprise, elle psalmodie les plus raffinées des formules d’usage, baissant la tête et s’inclinant. On lui donne l’ordre d’oublier le japonais, car il est indécent qu’une blanche parle le japonais. Alors, pour s’occuper, elle décide de distribuer le courrier. Mais elle se fait très vite rabrouée, car voler son travail à quelqu’un est une très mauvaise action. Donc, toujours pour s’occuper, elle décide de mettre les calendriers à jour, après accord de son supérieur. Aussi Monsieur Saito, sans la contredire ouvertement, lui demande de faire des photocopies. Ce qu’elle fait rapidement avec la machine munie d’une « avaleuse ». Il lui demande de le refaire à la main, une fois, puis deux, puis trois, sous prétexte qu’elles sont décentrées. Tout ça pour un règlement de son club de golf. Fubuki compatit. Monsieur Tenshi lui demande alors de rédiger un rapport sur les procédés de fabrication du beurre allégé. Elle se met à la tâche, recherche les raisons des japonais de s’intéresser à ce procédé, téléphone en Belgique où il est mis en œuvre, et sort le lendemain son rapport que l’autre s’attribue sans vergogne. Quelques jours plus tard, nouvelle engueulade, cette fois-ci pour Monsieur Tenshi. Elle apprend ensuite qu’elle a été dénoncée par mademoiselle Mori, qui a souffert des années pour obtenir le poste qu’elle a aujourd’hui. Elle tente une explication avec Kubuki, peine perdue : « Vous avez brigué une promotion à laquelle vous n’aviez aucun droit. » Elle répond : « Vous êtes ma supérieure, oui. Je n’ai aucun droit, je sais. Mais je voulais que vous sachiez combien je suis déçue. Je vous tenais en si haute estime. » Elle eut un rire élégant : « Moi, je ne suis pas déçue. Je n’avais pas d’estime pour vous. »
Alors, Kubuki la met à la comptabilité. Comptable, moi ? Pourquoi pas trapéziste ? lui demande-t-elle. Il n’était pas rare qu’entre deux additions je relève la tête pour contempler celle qui m’avait mise aux galères. Sa beauté me stupéfiait. Mon seul regret était son brushing propret qui immobilisait ses cheveux mi-longs en une courbe imperturbable dont la rigidité signifiait : Je suis une executive woman. Alors elle passe les trois dernières nuits au bureau pour tenter de venir à bout de son travail. La dernière nuit, « soudain, je ne fus plus amarrée. Je me levai. J’étais libre. Jamais je n’avais été aussi libre. Je marchais jusqu’à la baie vitrée. La ville illuminée était très loin au-dessous de moi. Je dominais le monde ? J’étais Dieu. Je défenestrai mon corps pour en être quitte ».
Enfin, après d’autres péripéties, comble de l’horreur, pendant sept mois, elle fut postée aux toilettes de la compagnie Yumimoto. Elle ne perdit pas la face. Mais elle acquit la désaffection des hommes pour les toilettes de son étage. Aussi reçut-elle l’ordre d’être aux toilettes sans y être, c’est-à-dire de sortir lorsqu’un homme entre et d’entrer lorsqu’il ressort pour remettre du papier et nettoyer comme il se doit. Cela dura jusqu’au 7 janvier, date de fin de contrat. Elle eut encore une dernière mission à accomplir : remercier ses supérieurs : la compagnie Yumimoto m’a donné de multiples occasions de faire mes preuves. Je lui en serai éternellement reconnaissante. Hélas, je n’ai pas pu me montrer à la hauteur de l’honneur qui m’était accordé… Nous approchons du terme de mon contrat et je voulais vous annoncer avec regret que je ne pourrai le reconduire.
Elle passe ces derniers instants aux toilettes. « D’instinct je marchai vers la fenêtre… Elle était la frontière entre la lumière horrible et l’admirable obscurité, entre les cabinets et l’infini, entre l’hygiénique et l’impossible à laver, entre la chasse d’eau et le ciel… Une ultime fois, je me jetais dans le vide. Je regardais mon corps tomber. Quand j’eu contenté ma soif de défénestration, je quittai l’immeuble Yumimoto. On ne m’y revit jamais.
Une fois de plus, Amélie Nothomb enchante ses lecteurs d’une histoire qui semble vraie, mais à dormir debout. Sa particularité : décrire avec un sérieux imperturbable ce qui est farfelu, relater avec humour ce qui est sérieux. Au fond, ce livre est-il autobiographique ou non ? Dans les deux cas, le lecteur passe un bon moment, voire un moment merveilleux, comme une oie qui passe au dessus d’une ville lors de sa migration et qui rit des contorsions des humains qui l’habite.
05:56 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, société |  Imprimer
Imprimer
11/09/2011
Le livre de ma mère, d'Albert Cohen

« C’était ma mère et jamais plus je ne vivrai ces merveilleux moments passés ensemble ». Chacun de nous, ou presque, pourrait le dire à propos de sa mère, mais personne ne saurait le dire aussi bien, de manière aussi belle, qu’Albert Cohen. Avec la même verve et la même délicatesse que dans Belle du seigneur, l’auteur se rappelle ces petits riens qui constituent l’ensemble des souvenirs d’une personne aimée au-delà d’un amour des corps.
Il a des mots tendres et drôles comme l’herbe au printemps :
« Mais si je la grondais, elle obéissait, pleine de foi, immédiatement atterrée par les perspectives de maladie, me croyant si je lui disais qu’en six mois de régime sérieux elle aurait une tournure de mannequin. Elle restait alors toute la journée scrupuleusement sans manger, se forgeant tristement mille félicités de sveltesse. Si, pris soudain de pitié et sentant que out cela ne servirait à rien, je lui disais qu’en somme ces régimes ce n’était pas très utile, elle approuvait avec enthousiasme. « Vois-tu, mon fils, je crois que tous ces régimes pour maigrir, ça déprime et ça fait grossir. » Je lui proposais alors de dîner dans un très bon restaurant. « Eh oui, mon fils, divertissons-nous un peu avant de mourir ! » Et dans sa plus belle robe, linotte et petite fille, elle mangeait de bon cœur et sans remords puisqu’elle était approuvée par moi. »
Il décrit les délirantes promenades dans les rues de Genève, en été, lorsque sa mère, cardiaque, avançait à pas menus :
« Quand on traversait la rue ensemble à Genève, elle était un peu nigaude. Consciente de sa gaucherie héréditaire, et marchant péniblement, ma cardiaque, elle avait si peur des autos, si peur d’être écrasée, et elle traversait, sous ma conduite, si studieusement, avec tant de brave application affolée. Je la prenais paternellement par le bras et elle baisait la tête et fonçait, ne regardant pas les autos, fermant les yeux pour pouvoir mieux me suivre ma conduite, toute livrée à ma direction, un peu ridicule d’aller avec tant de hâte et d’épouvante, si soucieuse de n’être pas écrasée et de vivre. Faisant si bien son devoir de vivre, elle fonçait bravement, avec une immense peur, mais toute convaincue de ma science et puissance et qu’avec son protecteur nul mal ne pouvait lui survenir. »
Il a la mélancolie des jours d’automne lorsque les souvenirs viennent effleurer la conscience :
« Maman de mon enfance, auprès de qui je me sentais au chaud, ses tisanes, jamais plus. Jamais plus, son odorante armoire aux piles de linge à la verveine et aux familiales dentelles rassurantes, sa belle armoire de cerisier que j’ouvrais les jeudis et qui était mon royaume enfantin, une vallée de calme merveille, sombre et fruitée de confitures, aussi réconfortante que l’ombre de la table du salon sous laquelle je me croyais un chef de guerre. Jamais plus son trousseau de clefs qui sonnaillaient au cordon du tablier et qui étaient sa décoration, son Ordre du mérite domestique. Jamais plus son coffret plein d’anciennes bricoles d’argent avec lesquelles je jouais quand j’étais convalescent. O meubles disparus de ma mère. Maman, qui fus vivante et qui tant m’encourageas, donneuse de force, qui sus m’encourager aveuglément, avec d’absurdes raisons, qui me rassuraient, Maman, de là-haut, vois-tu ton petit garçon obéissant de dix ans ? »
Il a enfin les pleurs de l’hiver lorsque le ciel si bas fait resurgir la complainte des regrets :
« Elle attendait tout de moi avec sa figure un peu grosse, toute aimante, si naïve et enfantine, ma vieille Maman. Et je lui ai donné si peu. Trop tard. Maintenant le train est parti pour toujours, pour le toujours. Défaite et décoiffée et bénissante, ma mère morte est toujours la portière du train de la mort. Et moi je vais derrière le train qui va et je m’essouffle, tout pâle et transpirant et obséquieux, derrière le train qui va emportant ma mère morte et bénissante. »
Oui, ce livre est un petit chef d’œuvre de mémoire, drôle, plein d’anecdotes, aux souvenirs embués des regrets qu’ont tous les enfants à la mort d’un parent. Méditation d’un enfant vieilli resté seul face à son enfance, il fait revivre celle-ci, l’enjolive, puis revient aux derniers jours, ceux de son âge adulte, se reprochant ses manquements, son impuissance à lui faire plaisir parce que trop préoccupé de sa propre vie.
« Voilà, j’ai fini ce livre et c’est dommage. Pendant que je l’écrivais, j’étais avec elle. Mais sa Majesté ma mère morte ne lira pas ces lignes écrites pour elle et qu’une main filiale a tracées avec une maladive lenteur. Je ne sais plus que faire maintenant. Lire ce poème moderne qui se gratte les méninges pour être incompréhensible ? »
04:23 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman |  Imprimer
Imprimer
07/09/2011
Qu'est-ce que la poésie ?
Qu’est-ce que la poésie ?
L’art de la métamorphose du réel.
Ce matin, je lisais dans la chambre, tout entier dans la douceur du matin, quand le ciel s’étire de bleu en dansant sur les nuages. Je finissais le livre de Didier Decoin, « Une Anglaise à bicyclette », et je me disais qu’il était bon de n’avoir pas d’heure, aucune obligation et que je pourrais, si je le désirais, rester toute la matinée au lit, sur le lit, couché entre les draps, l’esprit au frais, les pieds dans la douceur. Et tout d’un coup, à l’image évocatrice des fées rencontrées par Emily au cours de sa promenade à bicyclette, j’ai senti l’essence de la poésie monter en moi, s’engouffrer dans ma poitrine comme un ruisseau s’engouffre dans une faille terrestre, en grosses cataractes, dans un bruit inquiétant.
La poésie, c’est faire de tout ce qui est extérieur votre intérieur, en personnalisant par cette transmutation subtile du passage de la frontière chacun des objets, décors, personnages que vous choisissez pour leurs attraits indétectables à d’autres. La casserole qui chauffe sur le feu, la main de l’enfant qui joue à vos pieds, la tenture qui clôt la porte du salon où se cachent les fantômes, jusqu’à votre propre corps dont les extrémités semblent ne plus vous appartenir. Tout cela est devenu vôtre, par la grâce de la poésie, et vous les chérissez non pas d’un amour possessif, mais d’un sentiment doucereux, miel sauvage et agapanthe odoriférante, qui vous conduit dans un autre monde, où les jours ne se comptent plus, où les nuits s’écoulent sans que les heures s’égrènent, où seul le souvenir de ces évocations renforcent en vous le plaisir de vivre.
Cette métamorphose s’accompagne d’une modification de la vue, de l’odorat, de l’ouïe et du toucher, et même du goût. Plus rien ne se vit comme avant. La moindre attention à un objet devient un évènement, un livre, presqu’un monument. Vous y découvrez ce que vous n’aviez jamais vu auparavant : le charme ignoré, la couleur cachée, la froideur glacée et bienfaisante, le son rugueux au toucher et bien d’autres choses encore dont vous ne conservez pas forcément un souvenir intangible. Et cette métamorphose vous enchante, vous fait découvrir un nouvel art de vivre, un décor inédit à vos réflexions, une version originale de votre appréhension de la réalité. Celle-ci devient rêve éveillé, voyage sur un nuage doré, symphonie exubérante, mélange de parfums passés et de touches évanescentes du futur. Et pourtant cette transmutation est celle du présent, variable à chaque seconde, faisant de chaque instant une éternité vécue pleinement, douloureuse comme un enfantement.
Mais, simultanément, la poésie, c’est également faire de tout son intérieur un extérieur à donner à tous. C’est se mettre à nu devant les autres, sans peur ni pudeur. C’est accepter de ne plus avoir d’intimité, de dévoiler sa fragilité. C’est s’ouvrir sans fard et donner à contempler ce que d’autres cachent à tout prix : ce que vous ressentez en vérité, ce que vous vivez réellement, au-delà d’une façade de bon ton que vous avez pris l’habitude de fabriquer quotidiennement. Et ce n’est pas toujours simple. Ça peut même, parfois, être une souffrance qu’il faut vaincre.
Et, soudainement, le charme se rompt, chaque objet reprend sa place habituelle. L’œil redevient clair, les bruits coutumiers. Vous caressez la table qui ne résonne plus, vous goûtez le bout du crayon qui ne sent que le bois. Le monde est revenu, il s’étale devant vous, sans mystère ni peur. Vous êtes dans ce qui est et plus rien ne fait que ce qui est extérieur ne devienne intérieur. Avez-vous rêvé ?
En fait, vous avez retracé la ligne de démarcation entre l’imaginaire et l’identitaire, tout cela parce que vous êtes à nouveau entré dans votre coquille, celle que vous vous êtes fabriqué, l’image que vous vous donnez, à vous et aux autres.
Comment repartir vers les cieux de la poésie ? Guetter ce qui vous touche pour le saisir lorsqu’il arrive et ne plus le lâcher avant de l’avoir exploité. Face à la feuille blanche, vous êtes seul, mais dans un entourage de légendes personnelles.
03:45 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, poésie, poème |  Imprimer
Imprimer
05/09/2011
Métaphysique des tubes, roman d’Amélie Nothom
La vie d’Amélie, de un à trois ans. Cela se passe au Japon, mais surtout cela se passe à travers les yeux d’un enfant de cet âge, y compris dès la naissance, une naissance en trois temps.
Premier temps : le rien, pendant deux ans. Et ce rien n’était ni vide ni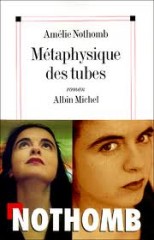 vague : il n’appelait rien d’autre que lui-même. Ce rien est Dieu, absolue satisfaction. Dieu était Dieu. Il était satiété et éternité…Les seules occupations de Dieu étaient la déglutition, la digestion et, conséquence directe, l’excrétion. […] C’est pourquoi à ce stade de son développement, nous appellerons Dieu le tube. Il y a une métaphysique des tubes. […] Dieu avait la souplesse du tuyau, mais demeurait rigide et inerte, confirmant ainsi sa nature de cube. Il connaissait la sérénité absolue du cylindre. Il filtrait l’univers et ne retenait rien.
vague : il n’appelait rien d’autre que lui-même. Ce rien est Dieu, absolue satisfaction. Dieu était Dieu. Il était satiété et éternité…Les seules occupations de Dieu étaient la déglutition, la digestion et, conséquence directe, l’excrétion. […] C’est pourquoi à ce stade de son développement, nous appellerons Dieu le tube. Il y a une métaphysique des tubes. […] Dieu avait la souplesse du tuyau, mais demeurait rigide et inerte, confirmant ainsi sa nature de cube. Il connaissait la sérénité absolue du cylindre. Il filtrait l’univers et ne retenait rien.
Deuxième temps, plus bref, six mois : hurlements et colères. La plante n’est plus une plante ! Dieu se conduisait comme Louis XIV : il ne tolérait pas qu’on dorme s’il ne dormait pas, qu’on mange s’il ne mangeait pas, qu’on marche s’il ne marchait pas et qu’on parle s’il ne parlait pas. Ce dernier point surtout le rendait fou. Découverte du langage.
Troisième temps : deuxième naissance. Ce fut alors qu’elle naquit, à l’âge de deux ans et demi, en février 1970, dans les montagnes du Kansai, un village de Shukugawa, sous les yeux de ma grand-mère paternelle, par la grâce du chocolat blanc. C’est moi ! C’est moi qui vis ! C’est moi qui parle ! Je ne suis pas « il » ni « lui », je suis moi ! […] En me donnant une identité, le chocolat blanc m’avait aussi fourni une mémoire : depuis février 1070, je me souviens de tout. […] Je devins le genre d’enfant dont rêvent les parents : à la fois sage et éveillée, silencieuse et présente, drôle et réfléchie, enthousiaste et métaphysique, obéissante et autonome. […] On commença à m’appeler par un prénom.
Elle se parle peu à peu à elle-même sans vouloir cependant le dire aux autres. Quel mot choisir en premier pour le révéler : maman, puis papa ; mais le troisième fut aspirateur. Elle découvre la mort et en parle avec Nishio-san, sa gouvernante. Elle apprend la haine, celle de Kashima-san, la seconde gouvernante, appartenant à la vieille noblesse japonaise et qui rend tous les blancs responsables de sa destitution. A l’occasion d’une presque noyade, elle parle comme tout le monde d’une voix posée. « Elle parle ! Elle parle comme une impératrice ! », jubile son père.
Chaque chapitre contient une histoire, un petit rien qui fait le charme de ce livre, épisode burlesque ou malheureux. Il y a celui des leçons de chant de nô de son père qui se finit dans les égouts un jour d’inondation, celui des querelles entre les deux gouvernantes, enfin celui des carpes offertes pour son anniversaire et l’étrange comportement de Kashima-san face à son évanouissement et sa nouvelle noyade.
« Ensuite, il ne s’est plus rien passé. » Ainsi se finit le roman d’Amélie Nothomb, à l’âge de trois ans, fin de l’enfance divine des Japonais et Japonaises. Ce n’est en fait pas vraiment un roman, mais pas non plus un livre de souvenirs. C’est un récit plein de vigueur enjouée, de remarques comiques, de profondeurs métaphysiques déguisées sous des pantalonnades. Un livre plein d’esprit, pétillant d’intelligence.
06:40 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman |  Imprimer
Imprimer
01/09/2011
La vie est ailleurs, roman de Milan Kundera (1973)

Ce livre m’a semblé très beau et profond et, simultanément, ennuyeux et factice.
Certaines pages, certains thèmes utilisés dans le roman sont traités avec délicatesse. Citons, par exemple, le chapitre 8 qui décrit la séduction de la mère de Jaromil par le professeur de dessin de son fils. Ou encore la découverte de la poésie par le corps imaginé de Magda, la petite bonne, au chapitre 10 : « Je suis sous l’eau et les chocs de mon cœur font des cercles à la surface. Ce vers offrait l’image de l’adolescent tremblant devant la porte de la salle de bains […] Ah, mon aquatique amour, disait un autre vers, et Jaromil savait que cet aquatique amour c’était Magda, mais il savait que personnes n’aurait pu la reconnaître derrière ces mots, qu’elle était perdue, invisible, ensevelie […] Cette autonomie du poète offrait à Jaromil un magnifique refuge, la possibilité de rêvée d’une deuxième vie ; il trouva cela si beau qu’il tenta dès le lendemain d’écrire d’autres vers et qu’il s’adonna peu à peu à cette activité. »
Et Jaromil s’invente un personnage, Xavier, à la fois différent, mais en même temps semblable, un personnage entreprenant, mais veule. Mais Jaromil grandit et découvre l’amour avec ses rêves, ses hésitations d’adolescent : « L’idée de la nudité féminine lui donnait le vertige. Mais notons soigneusement cette différence subtile : Il ne désirait pas la nudité d’un corps de jeune fille ; il désirait un visage de jeune fille éclairé par la nudité du corps. » Et il finit par faire la connaissance d’une jeune fille, modeste, étudiante, intéressée par les opinions insolites de Jaromil, à tel point qu’elle le traite de gracieux éphèbe. Après de multiples péripéties, il l’embrasse, ce qui lui permet également d’écrire un poème-récit et d’entrer plus avant dans le domaine de la poésie.
On ne sait comment Jaromil devint révolutionnaire, sans doute l’air du temps et la possibilité d’action : « Mais on ne sait jamais dans l’instant présent si la réalité est le rêve ou si le rêve est réalité : les étudiants qui étaient alignés avec leurs pancartes étaient venus là avec plaisir, mais ils savaient aussi que s’ils n’étaient pas venus ils risquaient d’avoir des ennuis. […] Le cortège défilait à travers les rues et Jaromil marchait à ses côtés ; il était responsable non seulement des mots d’ordre inscrit sur les banderoles, mais des clameurs scandées par ses camarades. […] Il les criait d’une voix forte comme un curé dans une procession et ses camarades les répétaient après lui. » (chapitre 19).
Peu après, il connaît l’amour physique avec une petite vendeuse rousse qui l’emmène chez elle dès le premier jour. Et : « Plus je fais l’amour, plus j’ai envie de faire la révolution, plus je fais la révolution, plus j’ai envie de faire l’amour. »
La cinquième partie est par contre plus laborieuse, malgré quelques passages excellents. Elle aborde le thème de la jalousie : jalousie de sa mère pour l’amie, jalousie de Jaromil pour ceux qui l’on touché avant lui. Après une réflexion désagréable d’un camarade de faculté, « il s’émut à l’idée que son amie portait de vilaines robes bon marché, et il voyait là non seulement le charme de son amie (le charme de la simplicité et de la pauvreté), mais aussi et surtout le charme de son propre amour : il se disait qu’il n’est pas difficile d’aimer quelqu’un de resplendissant, de parfait, d’élégant : cet amour-là n’est qu’un réflexion insignifiant qu’éveille automatiquement en nous le hasard de la beauté ; mais le grand amour désire créer l’être aimé à partir, justement, d’une créature imparfaite qui est une créature d’autant plus humaine qu’elle est imparfaite ». « Un jour […] il lui expliqua que la beauté n’a rien à voir avec l’amour. Il affirma que ce qu’il aimait en elle, c’était tout ce que les autres trouvaient laid ; dans un sorte d’extase, il commença même à énumérer ; il lui dit qu’elle avait de pauvres petits seins tristes avec de gros mamelons ridés qui éveillaient plutôt la pitié que l’enthousiasme : il dit qu’elle avait des taches de rousseur et des cheveux roux et que son corps était maigre et que c’était justement pour çà qu’il l’aimait… » La suite de cette partie est un peu pitoyable : la jalousie de sa mère à la venue chez elle de la petite amie rousse, avec l’épisode des spasmes, la conférence des poètes à l’école de police, le détachement et la trahison de Jaromil envers la jeune fille rousse.
Les cinquième et sixième parties sont quelque peu confuses, malgré de beaux passages. Elles sont conçues différemment du reste, faites de petits chapitres parfois sans suite. Le personnage de Jaromil se confond avec d’autres ou avec lui plus vieux. « Dans ce livre, nous dit Kundera, le temps s’écoule à un rythme inverse du rythme de la vie réelle ; il ralentit. […] Chacun regrette de ne pouvoir vivre d’autres vies que sa seule et unique existence ; vous voudriez, vous aussi, vivre toutes vos virtualités irréalisées, toutes vos vies possibles (ah ! l’inaccessible Xavier !). Notre roman est comme vous. Lui aussi voudrait être à d’autres romans, ceux qu’il aurait pu être et qu’il n’a pas été. »
Certes, je n’ai fait que raconter à ma manière ce roman, sans en avoir extrait le jus des idées en un ordonnancement élaboré. Mais je crois que le livre lui-même est ainsi et que cela est voulu par l’auteur. Toute analyse intellectuelle de ce que Kundera a ou aurait voulu dire n’a que peu d’importance par rapport à ce qui est réellement écrit. Laissons nous guider par ce vent de liberté qui souffle au travers des pages, dans le désordre, avec l’amour et la confiance sans retenue envers l’auteur, jusqu’à adhérer ou rejeter son œuvre.
06:04 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, philosophie, poésie |  Imprimer
Imprimer
24/08/2011
Ennemonde et autres caractères, de Jean Giono
Une fois encore, et dans le même ravissement, Giono nous fait pénétrer dans ce monde métaphysique de la Haute Provence, là où les routes font prudemment le tour du pays, où un homme doit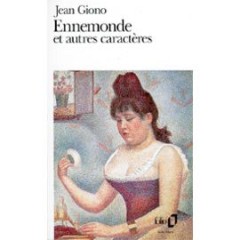 faire dix kilomètres à pied pour rencontrer un autre homme. Terre primitive, très proche de la virginité, elle nourrit l’homme de sa solitude et l’oblige à se conformer à elle.
faire dix kilomètres à pied pour rencontrer un autre homme. Terre primitive, très proche de la virginité, elle nourrit l’homme de sa solitude et l’oblige à se conformer à elle.
Les personnages sont des figures de légende, d’Ennemonde à Honoré, en passant par Clef des cœurs et bien d’autres. Ils vivent dans une métaphysique concrète où tout est poussé à l’extrême. L’amour dans ce pays est une nécessité biologique ou une folie éternelle.
Giono écrit : « Cette façon de procéder réaliste semble au premier abord mal s’accorder avec le fait qu’ils habitent un pays où la vie ne subsiste qu’avec une constante alimentation d’irréalité. Mais c’est que la réalité poussée à l’extrême rejoint précisément l’irréalité. Aller droit aux choses, c’est accepter leur magie ».
06:13 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature |  Imprimer
Imprimer
11/08/2011
Le reliquaire, chronique de Frantz André Burguet
« S’il nous est donné d’envisager sans désespoir le cours du temps, c’est parce que notre passé grandit à mesure que notre mort approche, que les souvenirs nous occupent et nous émeuvent. Reliquaire inviolable, notre mémoire fait pour nous ce que les musées ne sauraient faire pour les arts et les techniques : c’est qu’il n’y a jusqu’à notre mort aucun progrès possible en dehors d’un passé qui est éclairé après coup, mais déformé, mais trahi.
Le privilège de notre mémoire, Elia, c’est sa faiblesse, son infidélité, cette fausseté qui nous permet, en un passé formé à notre image, de vivre selon notre cœur. »
L’auteur nous dit qu’il s’agit d’une chronique. En effet, le récit est conté par l’intermédiaire de lettres non envoyées, de phrases inachevées, de notes sans suite, de fragments de journal. Celle-ci dépeint le drame d’adolescents qui éprouvent leur sensualité en la refusant.
Poétique recherche du souvenir d’heures merveilleuses, le reliquaire est formé des images que l’amour a façonnées au cours des heures de solitude et de rêve. Sans doute, le narrateur n’a-t-il pas vécu les heures qu’il dépeint avec la même force d’âme et la même sensibilité, mais la mémoire a le privilège d’abolir ces imperfections qui nous empêchent de réaliser la béatitude de certains moments.
Il nous reste de ces heures une étrange sensibilité mise à vif par l’impossibilité matérielle de les revivre dans leur réalité propre (et d’ailleurs elles nous décevraient), l’impression que donne un tableau de Corot ou un prélude de Chopin.
05:23 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature |  Imprimer
Imprimer
02/08/2011
D'acier, roman de Silvia Avallone
C’est le roman de l’adolescence, moment où les sentiments sont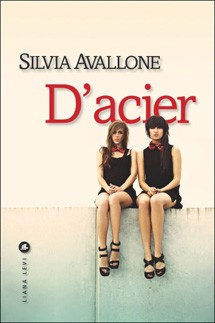 exacerbés, en particulier ceux de l’amitié et de l’amour, mêlés au désir du corps, brutal pour les garçons, plus sournois pour les filles, mais tout aussi réel.
exacerbés, en particulier ceux de l’amitié et de l’amour, mêlés au désir du corps, brutal pour les garçons, plus sournois pour les filles, mais tout aussi réel.
Elles sont deux filles canon, les plus remarquées de Piombino, faubourg ouvrier, au bord de la plage, face à l’île d’Elbe. Elles sortent de l’enfance, entre les manifestations d’amitié de l’enfance et les tentations physiques de l’adolescence. Toute la plage les regarde, les admire, les envie. Elles ne sont pas insolentes, simplement épanouies et sans complexes, sûres de leur beauté. Elles découvrent l’amour. Après des tentatives de manifestation d’amour entre elles, Anna tombe amoureuse de Mattia, beau loup de mer ayant navigué trois ans en Mer Noire. C’est la fin de l’amitié entre Anna et Francesca, cette dernière se sentant trahie par l’attitude d’Anna. Francesca adopte une autre amie, par dépit, une petite boulotte qu’elle n’aime pas. Elle ignore Anna qui découvre l’amour à quatorze ans. Mais, après des péripéties, elles finiront par se réconcilier : Elles souriaient, ne parlaient pas. L’une avait la bouche pleine de dentifrice, l’autre les lèvres entrouvertes, un peu gercées. Elles étaient parfaitement accordées l’une à l’autre.
Histoire banale, sans grand intérêt, semble-t-il. Mais, en premier lieu, elle se passe dans un univers très dur où les hommes sont des machos et les femmes soumises, où les pères veillent sur leurs filles avec des arrière-pensées, dans l’ambiance de l’aciérie, seul moyen de gagner sa vie à Piombino, univers inhumain où les hommes s’épuisent et s’enferment dans des certitudes d’enfant. Et dans ce monde éclosent deux chrysalides sans complexe, devant lesquelles les vieux bavent d’impuissance et les adolescents de désir. Elles sont pourtant comme toutes les filles, regardant les garçons, se pavanant en bande devant eux, rêvant d’être dans leurs bras, mais dédaignant leurs plaisanteries obscènes.
En deuxième lieu, ce qui surprend, c’est la maîtrise des descriptions et de l’écriture en général. Deux exemples :
Anna et Francesca, quand chez Anna il n’y a personne.
Leur corps pulse comme la musique, avec la musique. Elles attendent que la chanson commence pour se déshabiller.
La fenêtre est ouverte. Elles se sont enfermées à clé dans la salle de bain. Elles le font tous les lundis matin, l’été, quand la classe est finie et que tout le monde est au travail. Elles relèvent le store, ouvrent les rideaux. Elles se tiennent là, à moitié nues, au milieu de la pièce. Dans l’immeuble en face, seuls sont restés les retraités et les tire-au-flanc.
Elles se sont maquillées, outrageusement. Le rouge à lèvres déborde, le rimmel coule avec la chaleur et plâtre leurs cils, mais elles s’en fichent. C’est leur carnaval à elles, la provocation qu’elles lancent par la fenêtre. Au fond, elles le savent que quelqu’un pourrait les mater et tomber le pantalon. (p.32)
Elle lui plaisait trop. Elle lui faisait un effet, nom de Dieu, inexplicable. Et puis il se dit que ses intentions n’étaient pas mauvaises. Se persuada qu’il voulait juste la connaître un peu, parler avec elle, découvrir ce qu’il y avait dans cette petite tête, et peut-être même la tenir une minute dans ses bras.
« Eh, la frisée ! », cria-t-il.
Anna en freinant se retourna et scruta la foule.
Merde : elle était à tomber.
Cette frimousse insolente, pendant qu’elle cherchait qui l’avait appelée… elle était fantastique !
Tant pis, il lui expliquerait ; à Alessio, et s’il fallait encaisser la beigne, il l’encaisserait. Anna soudain le vit. Le reconnut. Pila brusquement.
Mattia. MAT-T-IA. Accoudé à la balustrade, beau comme Brad Pitt dans Thelma et Louise, beau comme Ricardo Scamarcio sur la couverture de Cioè.
Elle éprouva une seconde de désarroi, de joie folle, sauvage… (p.182)
Mais je n’irai pas jusqu’à dire qu’il s’agit d’un roman social comme le prétend La Repubblica. Ce serait le déclasser. C’est un bon roman, écrit à 25 ans et tiré à 350 000 exemplaires. C’est tout. Mais, c’est déjà beaucoup.
07:11 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, société |  Imprimer
Imprimer
21/07/2011
Danse, danse, danse, d'Haruki Murakami
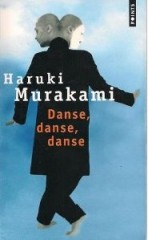
Je lis ce livre d’Haruki Murakami dans lequel il est confronté, dans un hôtel curieux, grand building construit sur l’emplacement d’un petit hôtel minable, mais portant le même nom, l’hôtel du dauphin, à l’homme-mouton (qui a déjà fait l’objet d’un livre antérieur). Et celui-ci ne lui donne qu’un conseil : danse, danse, danse.
" Mais il n’y a rien d’autre à faire que danser, poursuivit l’homme-mouton. Et danser du mieux qu’on peut. Au point que tout le monde t’admire. Danser tant que la musique durera. Ne te demande pas pourquoi. Il ne faut pas penser à la signification des choses. Il n’y en a aucune au départ. Si on commence à y réfléchir, les jambes s’arrêtent. "
Et Haruki (ou plutôt le personnage de ce livre) danse. Il décide de s’installer dans cet hôtel. Il a fait la connaissance de la réceptionniste avec laquelle il devient plus ou moins ami. Il rencontre également Yuki, très belle, qui n’a que treize ans et dont il se fait une amie, malgré les réticences de la jeune adolescente. Il retrouve un camarade d’école qui a réussi et qui est acteur. Il fait la connaissance d’une magnifique prostituée et en fait une amie de cœur. Enfin (je n’en suis qu’au tiers du livre), il revoit au cinéma une amie avec laquelle il a passé quatre ans, Kiki, et s’interroge sur ce qu’elle est devenue. Tout cela semble décousu. Mais au fond, ce qui semble important dans ce livre se résume au simple mot « danse ».
Mais qu’est-ce que danser ? Je vais laisser aller mon imagination ou plutôt ma propre compréhension de ce mot, sans cependant savoir ce que me dira la suite du livre. Je me trompe peut-être, mais c’est ma vision personnelle. Danser, c’est se tenir sur le fil du rasoir entre le besoin de sincérité vis-à-vis de soi-même et la nécessité de jouer un rôle en face des autres. C’est également le juste milieu entre la vie personnelle, intime, et la vie extérieure, en société, même restreinte. Et réussir sa vie, c’est la capacité de chaque individu à réaliser ce cocktail difficile, ni trop, ni trop peu.
Pour cela il faut se lancer des défis qui feront progresser votre personne, pas simplement votre personnage, mais votre moi profond, dans sa confrontation avec lui-même et avec les autres. Ce sont des défis tout à fait personnels, qu’aucun n’a besoin de connaître. Ils ne peuvent être imposés par les conventions ou les ambitions sociales. Ils ne peuvent non plus être une recherche de satisfaction personnelle. Ils doivent comporter l’équilibre entre vos deux êtres, votre moi et votre personne, celle qui se présente aux autres.
Danse, danse, danse… C’est l’exigence de la vie. Si l’on s’arrête de danser parce qu’on est fatigué, ou inversement si l’on tourne sans rythme ni grâce parce qu’on se complaît à ne plus faire que ce que les autres attendent de vous, alors on meurt à soi-même.
C’est bien sur le fil du rasoir que doit se délivrer la danse, jusqu’au jour de l’envol final.
04:52 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, société, livre, philosophie |  Imprimer
Imprimer
17/07/2011
Ivan Ivanovitch Kossiakoff, nouvelle de Jean Giono
C’est l’histoire d’une amitié de signes et d’entendement dans la même idée de l’homme et de la nature. Elle est au-delà de l’amitié des camarades de combat, bien qu’elle ait lieu en pleine guerre.
En 1917, Giono reçoit l’ordre de se rendre au fort de la Pompelle où il fait connaissance avec Ivan Ivanovitch kossiakoff, l'un des deux soldats russes dont il partage la chambrée dans une casemate du fort, et qui l'accompagne au poste de signalisation, où , à l'aide d'une lanterne, il communique en morse avec les batteries d'artillerie qui ont pris position de l'autre côté du canal.
De temps à autre, Giono sort de sa casemate : Calme plat. Un cycliste, machine en main, passe sans se presser sur la piste du canal. Le petit vent aux dents aiguës danse dans les maigres herbes jaunes. Une phrase de Spinoza me hante : « L'amour c'est l'accroissement de nous-mêmes » [...].
Bien que ne se comprenant pas, Giono et kossiakoff réussissent à se parler par signes. Ils sortent de leurs portefeuilles les photographies de leurs familles. Et progressivement, d’abord une camaraderie, puis une amitié réelle naît entre les deux hommes, si bien que Giono demande à ne pas être relevé comme cela était prévu. Et l'amitié, chaque jour, me lie plus étroitement à Kossiakoff [...] Nous allons sur le canal pêcher la carpe à la grenade ; à la coopé du moulin nous achetons des confitures, des provisions et nous les mangeons en route avec notre main comme cuiller. Je fume du tabac russe, des cigarettes comme le doigt, roulées dans du papier buvard. Kossiakoff m'a procuré une blouse pareille à la sienne ; il m'appelle Ivan et il tire sur ma pipe sans grande conviction [...]
Puis, un jour, un ordre arrive qui enjoint Giono de retourner à sa compagnie. Il dit rapidement adieu à Kossiakoff qui l'accompagne jusqu'au canal, et ils se quittent pour toujours : Kossiakoff me saisit aux épaules, m'embrasse légèrement sur la bouche, puis à grandes enjambées, sans un regard en arrière, il contourne le dépôt des obus et disparaît. Abasourdi, seul, vide, j'essaye d'appeler Kossiakoff et le nom s'embourbe dans la gorge [...] Ivan Ivanovitch Kossiakoff a été fusillé au camp de Châlons en juillet 1917.
Ecoutons aussi ce morceau de jazz assez extraordinaire et émouvant, intitulé du nom du héros de la nouvelle. Est-ce une musique écrite pour le film, est-ce en mémoire de la nouvelle de Giono ? Je ne sais, mais comme elle est belle et comme sont brillants et inventifs ces musiciens.
Michel Portal et Richard Galliano jouent Ivan Ivanovitch Kossiakoff, de Michel Portal :
http://www.youtube.com/watch?v=xF0adG2PPv8
C’est un chant de liberté pure, peut-être une ode à l’amitié, comme la nouvelle de Giono. Il commence par une sorte de plainte, puis très vite devient un hymne à l’entente, grâce à un passage assez classique au regard de l’ensemble. Il utilise ensuite une mélopée très balancée, faite d’envolées de notes montantes et descendantes dans un rythme propre, au gré des émotions.
Puis commence le duo avec l’accordéon, qui change dans un premier temps le style de la musique, la rendant argentine par moments, mais toujours très personnelle, faite de rires musicaux, de cris de la clarinette, de sourires de l’accordéon et de pleurs des deux instruments pour finir dans une envolée romantico-argentine.
07:03 Publié dans 41. Impressions littéraires, 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer
Imprimer
17/06/2011
La porte étroite, d’André Gide, 1909
C’est le titre qui nous donne la clef du livre : « Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite, car la porte large et le chemin spacieux mènent à la perdition, et nombreux sont ceux qui y passent : mais étroite est la porte et resserrée la voie qui conduisent à la vie, et il en est peu qui les trouvent. »
Elle pourrait sembler banale et mièvre cette histoire de Jérôme et d’Alissa, cet amour de deux êtres qui ne cessent de s’aimer sans pouvoir se rejoindre. Juliette, la sœur d’Alissa, qui aime aussi Jérôme, est le prétexte du développement du thème du livre.
C’est le procès, fait par André Gide, d’une vie pieuse et d’une morale chrétienne mal comprise que s’imposèrent beaucoup de jeunes filles de l’époque. Ne jamais vouloir sacrifier au plaisir terrestre et immédiat, mais toujours s’imposer une conduite plus haute qui refuse le bonheur de ce monde pour un bonheur plus lointain. Croyant faire leur bonheur, elles bâtissent de leurs propres mains leur malheur et souvent celui des autres. Alissa se sacrifie d’abord pour sa sœur Juliette, puis ce sacrifice devenant inutile, elle se force à jouer son rôle par orgueil et fausse piété. Car c’est de cela dont Gide fait le procès, une fausse éducation chrétienne entraînant au péché par orgueil et exaltation, orgueil de sainteté et de renoncement. Le drame d’Alissa est de ne pouvoir choisir entre sa morale et son amour. Elle meurt de cette ambigüité sans oser la résoudre.
Jérôme et Juliette vivent une même ferveur religieuse, approfondie par des lectures communes. Au fil des ans, Jérôme ne cesse de souhaiter épouser Alissa tout en se forçant avec elle et pour elle à une vertu sans faille : « Je ferais fi du ciel si je ne devais pas t’y retrouver. » Malheureusement, Alissa découvre l’amour de sœur Juliette pour Jérôme. Elle annule leurs fiançailles, et laisse le champ libre à sa cadette. Mais celle-ci, assurée que Jérôme n’éprouve rien pour elle, rivalise dans le sacrifice en épousant un tiers. Une longue séparation permet à Jérôme et Alissa de retrouver une certaine sérénité. Ils échangent à nouveau leur amour sans toutefois évoquer la possibilité d’un bonheur matériel. Séparer à nouveau, en raison de cette obsession d’un bonheur trop haut, il se retrouve peu avant les derniers instants d’Alissa, qui meurt d’un goût trop prononcé pour le sacrifice.
Les souvenirs de Jérôme, très bien écrits malgré ce qu’en dit Gide (flasque caractère […] impliquant la flasque prose), ne sont que l’histoire de leur vie dont l’explication est donnée par le journal d’Alissa :
_ Pourquoi me mentirais-je à moi-même ? C’est par un raisonnement que je me réjouis du bonheur de Juliette. Ce bonheur que j’ai tant souhaité, jusqu’à lui offrir de lui sacrifier mon bonheur, je souffre de le voir obtenu sans peine, et différent de ce qu’elle et moi imaginions qu’il dût être. Que cela est compliqué ! Si… Je discerne bien qu’un affreux retour d’égoïsme s’offense de ce qu’elle n’ait pas eu besoin de mon sacrifice pour être heureuse.
Je suis comme humilié que Dieu ne l’exige plus de moi. N’en suis-je donc point capable ?
_ Il me semble à présent que je n’ai jamais tendu à la perfection que pour lui. Et que cette perfection ne puisse être atteinte que ans lui, c’est, ô mon Dieu, celui d’entre vos enseignements qui déconcerte le plus mon âme.
_ Hélas, je ne le comprends que trop bien à présent, entre Dieu et lui, il n’est pas d’autres obstacles que moi-même. Si, peut-être, comme il me le dit, son amour pour moi l’inclina vers Dieu tout d’abord, à présent cet amour l’empêche ; il s’attarde à moi, me préfère et je deviens l’idole qui le retient de s’avancer plus loin dans la vertu. Il faut que l’un de nous d’eux y parvienne, et désespérant de surmonter dans mon lâche cœur mon amour, permettez-moi, mon Dieu, accordez-moi, la force de lui apprendre à ne m’aimer plus, de manière qu’au prix des miens, je vous apporte ses mérites infiniment préférables… Et si mon âme sanglote aujourd’hui de le perdre, n’est-ce pas pour que plus tard, je le retrouve en Vous…
Epilogue, Jérôme et Juliette dix ans plus tard :
_ Si j’épousais une autre femme, je ne pourrai faire que semblant de l’aimer.
_ Ah ! Alors tu crois qu’on peut garder si longtemps dans son cœur un amour sans espoir ?
_ Oui, Juliette.
_ Et que la vie peut souffler dessus chaque jour sans l’éteindre ?
La critique littéraire Pascale Arguedas explique que « Ce court roman écrit en 1905, paru en 1909 — premier vrai succès de librairie d’André Gide — est le négatif de L’Immoraliste qui célébrait le monde enivré des couleurs, des parfums, du corps humain, une aspiration à la « gloire célestielle ». […] Histoire d'un sacrifice, de l’adultère, du protestantisme et du puritanisme, ce roman d'apprentissage et de l'abnégation, d’inspiration fortement autobiographique, se présente telle une parabole et rend compte d'une société refoulée dont l’auteur s'attache à dénoncer les failles. […] Dans un style sobre et dépouillé, André Gide exploite l’intérêt dramatique, moral et didactique, en observateur, analyste et peintre de lui-même, présentant Alissa comme le symbole de l'amour impossible. »
06:29 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, littérature, roman, christianisme |  Imprimer
Imprimer
23/05/2011
Le partage de midi, de Paul Claudel
Le Partage de Midi est un drame en trois actes, écrit en vers libres, c'est-à-dire, comme le dit Claudel, des vers qui, « s'ils ne peuvent se scander », présentent une unité respiratoire, musicale, intelligible, émotive.
Il s’agit du drame séculaire de l’amour interdit, un mari, une femme et un amant, mêlé à un drame spirituel. Mésa, qui deviendra l’amant de Ysé, a voulu consacrer sa vie à Dieu et s’est retiré au fond du monde. Mais Dieu l’a refusé. Depuis, il erre à travers les continents à la recherche de son âme, pour l’instant sur un bateau, au milieu de l’océan, à midi. Il ne connaît pas de femme, il ne les aime pas et il rencontre Ysé, la femme idéale. Belle, elle est femme jusqu’au bout des ongles dans son désir de possession.
Mésa s’interdit de tomber sous son charme et pourtant il déclare à Ysé son amour. Ysé est liée à de Ciz par les liens sacrés du mariage, mais bientôt les deux amants passent outre. Alors Ysé et Mésa, vivant ensemble, s’aperçoivent qu’ils ne s’entendent pas. Le feu de leur amour les brûle et ils s’apportent l’un à l’autre la damnation. « Je ferai sortir de toi un feu qui te consumera. » Dans le mariage, il y a deux êtres qui consentent l’un à l’autre ; dans l’adultère, il ya deux êtres qui sont condamnés l’un à l’autre. Les deux amants se constatent irréductibles et se séparent. Mais l’amour les consumera toujours. Ysé est partagée entre la haine et l’ignorance qui lui prêche la raison, amis se laissera mourir pour l’amour que lui dicte son âme.
Ysé est une femme sensuelle et insaisissable. « Je pense que c’est une effrontée coquette », dit Mésa au début de la pièce. Almaric lui répond : « Vous n’y entendez rien ? C’est une femme superbe. » Il semble bien qu’ils ont raison tous les deux. Mesa est brisé lorsqu’il va céder à Ysé : « Pourquoi venez vous me déranger ? » Et elle lui répond : « C’est pour cela que les femmes sont faites. »
Mesa :
Tu es radieuse et splendide ! Tu es belle comme le jeune Apollon !
Tu es droite comme une colonne ! Tu es claire comme le soleil levant !
Et où as-tu arraché, sinon aux filières même du soleil, d’un tour de ton cou ce grand lambeau jaune de tes cheveux qui ont la matière d’un talent d’or ? Tu es fraiche comme une rose sous la rosée ! Et tu es comme l’arbre Cassie et comme une fleur sentante ! Et tu es comme un faisan, et comme l’aurore, et comme la mer verte au matin pareille à un grand acacia en fleurs et comme un paon dans le paradis.
Ysé :
Certes, il convient que je sois belle
Pour ce présent que je t’apporte.
01:05 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature |  Imprimer
Imprimer
13/05/2011
Détruire, dit-elle
"Détruire, dit-elle" est un roman de Marguerite Duras paru en mars 1969 aux éditions de Minuit.
1969 aux éditions de Minuit.
C'est aussi un film qu’elle a réalisé, avec Catherine Sellers et Michael Lonsdale.
Le décor : un périmètre dans la forêt où les gens viennent s’isoler, vivre eux-mêmes, s’apprendre à vivre eux-mêmes dans le repos. Ici les livres, qu’ils soient à lui, Max Thor, ou à elle, Elisabeth Alione, ne servent à rien, ils font partis du décor. Rien ne se passe dans cet hôtel, tout commence et rien ne s’achève, car aujourd’hui n’a plus de rapport avec hier. Le temps ne coule plus ou coule sans souvenirs, sans souvenirs d’impressions durables, sauf, peut-être, le souvenir de ce qui est et non pas de ce qui arrive.
C’est dans ce monde, où rien ne compte qu’être, que fonctionne la destruction comme cette musique des dernières pages, cette fugue de Bach qui s’arrête, reprend, s’arrête à nouveau, repart, jusqu’à ce qu’elle fracasse les arbres, foudroie les murs. Elle arrive en trois temps, trois actes du livre. Dans un premier temps, il n’y a rien, rien ne se passe, on regarde et Marguerite Duras pose le décor et ses personnages. Dans un deuxième temps, arrive Alissa qui est la destruction à l’œuvre et cette destruction place ses racines et les enfonce dans le décor subrepticement, imperceptiblement. Enfin, dans un troisième temps, les deux forces opposées, l’avenir avec le groupe d’Alissa, Stein et Max Thor et le passé avec Bernard et Elisabeth, s’affrontent et se déchirent, enracinant la destruction chez Elisabeth Alione sans qu’elle-même le perçoive, sans toutefois aller jusqu’au bout de l’acte, jusqu’à ce qu’il y a au bout de la destruction, c’est-à-dire la folie. La folie, c’est Alissa, l’inacceptation de tout état de fait, la destruction de tout le passé, donc de toutes les habitudes.
Les personnages maintenant : que sont-ils ? Il y a en fait deux forces en action, deux clans qui s’opposent. Ceux qui sont tournés vers l’avenir, qui savent ce que les autres ne savent pas, et ceux qui sont soumis au passé, qui ne savent rien, qui ne savent même pas qu’il y a à savoir, qui vivent de leur habitudes.
Stein sait. Il sait au-delà de la folie, vers ce vide qui est au-delà. C’est un sage, une sorte de moine, pourrait-on dire. Il se refuse à tout ce qui semble constituer la vie de chacun, le mariage, un métier, des projets. Il ne cherche rien, rien de ce que cherchent les autres. Il peut se permettre de faire des choses que les autres ne feraient pas, qu’ils appelleraient indiscrètes. Les autres ne l’intéressent pas vraiment, il les regarde comme on observe un troupeau. Lui-même ne l’intéresse pas. Il se contemple comme il examine les autres, sans retenue aucune (quelquefois j’entends ma voix, dit-il).
Alissa n’est pas encore allée au-delà de la folie, de cette folie apparente engendrée par la destruction. Elle est la destruction (détruire, dit-elle) et c’est en fait elle qui déclenche le drame, car rien ne serait survenu sans elle. Alissa sait, dit Max Thor. Mais que sait-elle ? se demande-t-il. Sans doute ne le sait-elle pas elle-même, n’est-elle pas capable de le formuler. Seul Stein pourrait le faire, mais Stein ne répond pas. Alissa comprend Stein d’instinct, intuitivement, elle le sent fémininement et Stein la comprend. C’est pourquoi l’amour naît aussitôt entre eux, ontologiquement, pourrait-on dire.
Max Thor n’est pas encore du même camp. Il cherche, il s’interroge, il observe à la manière dont regarde Elisabeth Alione. Quelque chose le fascine et le bouleverse dont il n’arrive pas à connaître la nature », aussi bien chez Elisabeth que chez Alissa. Il ne connaît pas Alissa, sa femme. Il la cherche, car il sait que c’est en elle qui doit être la réponse ; et ce problème, le seul qui le touche vraiment, s’effacera de lui-même, sans qu’il ait besoin d’en avoir la réponse, au cours du troisième temps du livre, au cours de l’affrontement. Alors il saura ce qu’est Alissa et Stein. Elisabeth Alione aussi le fascine. Il l’aime d’un amour différent de celui qu’il éprouve pour Alissa (amour inquiet et interrogateur, tourné vers l’avenir), d’un amour tourné vers ce passé qu’il ne peut encore quitter tout à fait, ne sachant pas l’avenir.
Enfin, il y a Elisabeth Alione, qui en fait n’existe pas en elle-même, c’est-à-dire en tant qu’être propre, individuel et personnel. Elle ne croit pas en elle-même. Elle croit à ce que les autres disent d’elle. « Elle est à celui qui la veut, elle éprouve ce que l’autre éprouve ». Elisabeth Alione, c’est le passé. Tout n’existe pour elle que par le passé et l’avenir lui fait peur, car aucun passé ne s’y rattache. Aussi a-t-elle peur des trois autres et surtout d’Alissa. Elle ne les comprend pas, parce qu’elle ne sait rien d’eux alors qu’eux savent tout d’elle. Une fois dans sa vie, Elisabeth Alione aurait pu être en tant que personne véritable, mais elle a eu peur de cette lettre du médecin qu’elle a montré à son mari parce que là encore elle avait peur d’un avenir différent du passé, inconnu. Puis elle a regretté son geste, parce que quelque chose en elle disait oui à la lettre. Sa maladie véritable venait en fait de cette contradiction entre ce qu’elle croyait être et e qu’elle était réellement, intérieurement. La destruction de l’ancienne Elisabeth commence le jour où elle rencontre Alissa, puis Stein. Elle découvre par l’intermédiaire d’Alissa la véritable cause de sa maladie. Elle ne peut plus redevenir ce qu’elle était auparavant, bien qu’elle ne s’en rende pas compte, et au delà de la peur qu’elle a d’abord éprouvé, elle découvre le dégoût (Ces nausées… Ce n’est qu’un début, dit Max Thor. Bien… Bien, dit Stein). « Il y a eu un commencement de… comme un frisson… non… un craquement de… du corps », dit Stein. « Ce sera terrible, ce sera épouvantable, et déjà elle le sait un peu ».
La destruction a fonctionné comme cette musique, cette fugue de Bach, qui s’arrête, reprend, s’arrête de nouveau, repart jusqu’à ce qu’elle passe la forêt, fracasse les arbres, foudroie les murs.
« Détruire dit-elle est le plus étrange des livres de Marguerite Duras. Il ressemble à une cérémonie dont nous ignorerions le rituel et suivrions néanmoins, fascinés, le déroulement. Comme l’indique le titre, c’est peut-être l’idée de destruction qui s’impose le plus directement à nous, et encore à condition que détruire ne signifie rien de brutal, de violent, d’explosif, mais soit plutôt synonyme de miner, saper, corroder... Il y a, bien entendu, dans l’œuvre de Marguerite Duras, nombre d’éléments qui portent en germe Détruire dit-elle. Mais l’essentiel serait plutôt dans un glissement, un décalage dans les mots ou dans l’image qui étaient parfois sensibles dans Moderato cantabile ou dans Le Ravissement de Lol V. Stein et qui, ici, nous entraînent dans un univers de folie, ou plutôt d’insidieux dérèglement mental : chaque mot, chaque geste pris séparément ont l’apparence de la logique, mais c’est l’enchaînement qui donne l’impression que l’esprit chavire. »
Anne Villelaur (Les Lettres françaises)
04:58 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, littérature, destin |  Imprimer
Imprimer
17/04/2011
Les cahiers d’André Walter, d’André Gide
André Walter, dont les cahiers ne sont pas seulement le journal de ses pensées, mais aussi de sa sensibilité, de ses souffrances et de ses joies, est ce personnage mythique que tout écrivain invente à ses débuts, imprégné de ses pensées et de sa sensibilité. Il est à la fois l’endroit et l’envers d’André Gide, adolescent ne sachant encore de quel côté pencher (il hésitera d’ailleurs longtemps), vers une complaisance envers lui-même ou un durcissement de lui-même.
Imparfait certainement dans le style et la pensée, le livre n’en décèle pas moins une surprenante sensibilité, certainement trop grande, car elle devient une obsession, pour un auteur qui n’a pas vingt ans. Ce n’est pas encore le style volontaire et dépouillé des nourritures terrestres, qui, bien qu’empreintes d’une même sensibilité, vibre plus dans sa simplicité.
04:00 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature |  Imprimer
Imprimer
14/04/2011
Patchouli ou les désordres de l’amour, pièce d’Armand Salacrou (1899-1989)
« Ce n’est pas une pièce de jeunes, c’est la pièce de la jeunesse. », a dit Jean Giraudoux de Patchouli. Oui, le propre de la jeunesse est bien de se poser milles questions et d’essayer de réaliser le rêve qu’elle s’est faite de la vie. Ce n’est que lorsque le rêve n’exalte plus que l’on devient adulte, pensent certains, avec tous les soucis que cela comporte puisque l’espoir s’est assoupi.
Ecoutons comment l’auteur, Armand Salacrou, définit Patchouli. « Il ne sait rien, pas même exactement qu’il n’est pas heureux. Il va l’apprendre. Puis, il ira à la recherche de son bonheur. Il n’a vécu que dans un rêve. Un jour, il voudra vivre dans la vie, mais se sera pour réaliser son rêve. Il lui semble que choisir, que délibérément écarter un sentiment, c’est fausser le problème et qu’on a trop beau jeu. Il met tout en question. Il ne sait pas se contenter d’un sentiment. Il lui faut le rattacher à un autre, jusqu’au dernier qui est le sentiment de son existence, de sa vie. »
Le sujet est grave, c’est la recherche de l’amour véritable ; ce que Patchouli trouvera, non pas matériellement, mais par raisonnement de ses sentiments. Il cherche avant tout à en être maître et il va s’efforcer de faire naître en lui les sentiments de l’amour par la raison. Il n’y arrivera pas, il ne vivra pas l’amour, mais il arrivera à le comprendre en s’incarnant dans le personnage d’un prince qui s’est, paraît-il, tué d’amour pour une comtesse. Il comprendra qu’en réalité le prince ne l’aimait pas, qu’il n’avait pas assez peur des femmes pour les aimer. Car telle est la conclusion de la pièce : aimer, c’est avoir peur de que l’on aime.
Il ne s’agit pas ici d’engager une discussion pour donner une réponse à la question et décider si l’amour c’est la crainte. Il s’agit de vivre avec Patchouli sa vie, sa recherche et sa découverte. Les critiques n’ont pu le faire. « Le rôle d’un auteur est un rôle assez vain. C’est celui d’un homme qui se croit en état de donner des leçons au public. Et le rôle des critiques ? Il est bien plus vain encore. C’est celui d’un homme qui se croit en état de donner des leçons à celui qui se croit en état de donner les leçons au public. » Voilà ce que pense Salacrou des critiques. Un critique ne devrait avoir le droit que de juger de l’adaptation de la pièce et non de décider par lui-même si la pièce est bonne ou mauvaise. C’est à chacun d’écouter vibrer en lui celle-ci et ce n’est pas à un seul d’avoir un cœur pour tous. Peut-être cela vient-il du public lui-même qui est rarement capable d’écouter battre son cœur et qui veut entendre battre celui du critique pour aller écouter battre le sien au théâtre. C’est là un des torts de notre civilisation où tout fonctionne par l’information et la contre-information. Si l’on affirme assez haut les choses, la majorité vous croît, que vous ayez raison ou tort. Or les critiques ont la voix qui porte. Après l’échec de Patchouli, Dullin fait passer dans les journaux d’énormes placards de publicité avec une seule phrase : « Je crois à Patchouli. Charles Dullin. »
Ce qui fait le charme de la pièce, ce n’est pas tellement le thème en lui-même, c’est la façon de le présenter avec poésie, lyrisme, jeunesse. La lecture laisse rêveur et suggère mille questions. C’est bien là sa profondeur.
Salacrou sait nous montrer l’homme à la recherche de sa vie. Comme le dit Patchouli : « Je veux tenter ma vie ! »
09:03 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théâtre, pièce, littérature, amour |  Imprimer
Imprimer
31/03/2011
Paludes, d’André Gide, publié en 1895
Paludes, c’est l’histoire du terrain neutre, celui qui est à tout le monde, l’histoire de la troisième personne, celle dont on parle, qui vit en chacun de nous, l’histoire de l’homme couché (dans Virgile, il s’appelle Tityre), homme ordinaire qui s’accommode de son petit domaine.
« La perception commence au changement de sensation, d’où la nécessité du voyage », dit André Gide. « On ne sort pas, c’est un tort. D’ailleurs on ne peut pas sortir. Mais c’est parce que l’on ne sort pas. On ne sort pas parce qu’on se croit déjà dehors. Si l’on se savait enfermé, on aurait du moins l’envie de sortir. »
Autre propos de l’homme qui ne peut pas voyager : « Il y a des choses que l’on recommence chaque jour simplement parce qu’on n’a rien de mieux à faire ; il n’ya là ni progrès, ni même entretien, mais on ne peut pas pourtant ne rien faire… C’est dans le temps le mouvement de l’espace des fauves prisonniers ou celui des marins sur les plages. »
« Etre aveugle pour se croire heureux. Croire qu’on y voit clair pour ne pas chercher à voir puisqu’on ne peut se voir que malheureux. »
Pourtant, il ne s’agit pas de voir ou d’être aveugle, mais bien d’ignorer la recherche de la lentille qui donnera la vue. On ne peut être que par rapport à quelque chose qui résonne en nous. « Je ne puis jamais arriver à me saisir moi-même sans une perception, dit Hume. Nous sommes seulement un faisceau ou une collection de différentes perceptions qui se succèdent avec une inconcevable rapidité, et qui sont dans un flux et un mouvement perpétuel. »
Paludes raconte la semaine d’un écrivain en mal de voyage. Y domine le personnage de Tityre, berger de tous les temps, habitant des marécages où fourmille une vie insolite. Qui est Tityre : Celui qui vit dans des marais, disposant d’un emploi du temps prédéfini dans un agenda et qui contraste avec le modèle de vie de son auteur qui fréquente les salons parisiens ? Hubert, qui chasse la panthère, imprégné de rationalité ? Richard, peut-être, l'orphelin qui épouse une femme sans amour ? Ou le narrateur qui voyage avec Angèle jusqu’à Montmorency ? Dans cette satire des salons littéraires de Paris, les descriptions sont ironiques. Gide qualifiait ce livre de sotie et réfutait le terme de roman. La caractéristique principale de cette œuvre de Gide est la modernité de son style et de son récit.
En juillet 1895, Camille Mauclair écrit à propos de Paludes dans le Mercure de France : « J’aime Paludes, comme tout ce qu'écrit M. André Gide, parce que cela vient d'une âme extrêmement fine, hautaine et souffrante, et qu'il y a éparses dans ses livres quelques unes des choses du cœur que nous aurions tous voulu dire aux grandes minutes passionnées de notre vie. C'est le caractère spécialement prenant de son œuvre, qu'elle naît du dedans, intensément. C'est très difficile, littérairement parlant, d'imaginer, de construire et d'écrire ce petit livre apologique, et il est fait avec un charme et une légèreté que peu d’entre nous ont connus. Mais on ne s'en aperçoit même pas, tant on va d’un bout à l'autre avec l'impression qu'il faut ici s'occuper non d'un talent, mais d'une âme. »
05:34 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman |  Imprimer
Imprimer
21/03/2011
La symphonie pastorale, d’André Gide, 1919
Ce n’est pas seulement l’histoire de l’éducation d’une aveugle que décrit André Gide, mais aussi la naissance d’un amour impossible. Un pasteur explique dans son journal intime comment il adopta Gertrude, une petite aveugle de quinze ans, qui vivait auparavant à la manière d’un animal. Nous assistons à la naissance des sensations, puis des sentiments de Gertrude, guidée par le pasteur qui lui dévoile un monde d’amour et de beauté dans lequel le mal, le péché et la mort n’ont pas de place.
Il emmène Gertrude au concert et c’est à l’écoute de la symphonie pastorale de Beethoven qu’elle découvre la nature et les couleurs :
_ Est-ce que vraiment ce que vous voyez est aussi beau que cela ?
_ Ceux qui ont des yeux ne connaissent pas leur bonheur.
Jacques, le fils du pasteur, s’éprend d’elle. Son père, implacablement, refuse cet amour et ce n’est que plus tard qu’il comprend qu’il aime Gertrude d’un amour moins pur qu’il ne le croyait. Gertrude aussi l’aime et le lui avoue, ne connaissant pas le mal, mais seulement le bonheur de vivre en communion avec la nature, les hommes et Dieu.
_ Vous savez bien que c’est vous que j’aime, pasteur… Je ne vous parlerais pas ainsi si vous n’étiez pas marié. Mais on n’épouse pas une aveugle. Alors pourquoi ne pourrions-nous pas nous aimer ? Dites, pasteur, est que vous trouvez que c’est mal ?
_ Le mal n’est jamais dans l’amour.
C’est dans l’ambigüité de l’amour envers Dieu et ses créatures et de l’amour envers un être que le pasteur se débat d’autant plus difficilement que Gertrude ignore le péché et ne connaît, comme il l’avait souhaité, que le bonheur.
Dans la deuxième partie du livre, Gertrude s’ouvre au monde des hommes et fait connaissance avec la tristesse, le malheur et le péché. Un médecin, ami du pasteur, lui rend la vue et, en découvrant le monde, Gertrude découvre son péché. Elle veut se suicider en se jetant à l’eau. Ce suicide manqué ouvre les yeux du pasteur qui découvre que ce n’est pas lui qu’elle aimait vraiment, mais Jacques. Celui-ci hélas ne peux plus l’épouser, étant rentré dans les ordres. Alors elle s’éteint doucement.
_ Quand vous m’avez donné la vue, mes yeux se sont ouverts sur un monde plus beau que je n’avais rêvé qu’il pût être. Mais non, je n’imaginais pas si osseux le front des hommes. Quand je suis entré chez vous, ce que j’ai vu d’abord, c’est notre faute, notre péché. Non, ne protestez pas. Souvenez-vous des paroles du Christ : « Si vous étiez aveugle, vous n’auriez point de péché. » Mais à présent, j’y vois… Quand j’ai vu Jacques, j’ai compris soudain que ce n’était pas vous que j’aimais, c’était lui.
Ecrit sous la forme du journal intime du pasteur, ce roman reste encore d’actualité malgré des tournures et des sentiments qui ne s’exprimeraient plus ainsi. A travers cette histoire, l’auteur peint les souvenirs de son enfance et dénonce, thème favori, une certaine hypocrisie religieuse. Il nous livre également un message : les aveugles ne sont pas toujours ceux que l’on croit. Au-delà de la morale de l’histoire, ce livre enchante par son atmosphère délicate et sa poésie. La fin malgré tout laisse une impression de tragique difficilement supportable après la beauté des premières pages.
Au-delà de l’histoire et de l’analyse psychologique qui l’accompagne, reconnaissons que le style d’André Gide contribue à faire de ce roman un livre exceptionnel. « On peut dire que le récit de La Symphonie Pastorale s’organise selon une structure complexe. Le style de cette œuvre est épuré, ciselé, raffiné et précis. La composition de La Symphonie Pastorale est plutôt unie, largement progressive, bien qu’on puisse constater une série de parallélismes entre les événements et leurs effets moraux. Les mots sont choisis avec soin par son auteur. Ce qui attire l’attention du lecteur c’est la densité du texte malgré sa brièveté, la pudeur des sentiments malgré leur intensité » (Marc Dambre, La symphonie pastorale d’André Gide, Paris, Gallimard, 1991).
Oui, cela peut sembler désuet de parler de romans qui datent de bientôt un siècle, mais la beauté est intemporelle. Les sentiments restent les mêmes depuis que les tragédies grecques ont tenté de les disséquer. Ils ne font que s'exprimer différemment. Le langage de Gide est magnifique, mais très probablement plus personne n'oserait écrire une histoire semblable.
06:56 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, psychologie, écriture |  Imprimer
Imprimer
10/03/2011
Le théâtre d'Armand Salacrou
Un dialogue sur la vie, tel est le théâtre de Salacrou dont l’œuvre pourrait se définir par les deux termes de « confession » et « passion ».
Son théâtre est obsessionnel :
_ Qu’auriez-vous aimé être ?
_ Dieu, pour comprendre l’univers et le sens de la vie.
Salacrou cherche à surprendre la réalité profonde. Le dieu qu’il évoque est le symbole d’une explication du monde dont elle dissiperait, à ses yeux, l’absurdité. Car ce qui domine son théâtre, c’est ce sentiment d’absurdité de la vie, d’irrévocable comme la mort ou l’amour. L’amour est ici une force irrésistible, fatale qui justifie tout dans une société sans morale. C’est un mystère, plus encore que la mort.
Aussi ses personnages semblent romantiques, par le regret du passé, des illusions perdues, d’une destinée espérée et qui a fui peu à peu, et par une recherche de l’évasion. « Je cherche quelque chose qui me dépasse, qui soit plus grand que moi, qui me surprenne, qui m’enlève. »
Mais ce romantisme aspire à un classicisme, à un ordre qui lui permette d’établir des principes. « Ce n’est pas la découverte psychologique qui m’intéresse, mais l’éclairage nouveau des objets présentés. Ce n’est pas la vérité, mais l’ordonnance. Son ambition est de promouvoir un ordre, d’apparence extravagante peut-être, mais un ordre enfin révélé qui explique et justifie l’univers personnel. »
Salacrou procède par le rapprochement d’éléments vrais, documentaires, et de visions imaginaires, d’envolées verbales, de morceaux de bravoures lyriques. Si son théâtre est plein de jeunesse et de pureté, il est aussi tragique : ses personnages, dans leur désir frénétique de justifier leur existence, refusent les facilités, les dérobades devant les vraies problèmes, la lâcheté surtout. Ils éprouvent trop cruellement le poids de fautes passées et de la vieillesse.
Toutefois, le théâtre de Salacrou est avant tout un théâtre de verbe et de réflexion. Les étonnantes visions qu’il propose au public ne sont pas tant dans le spectacle lui-même que dans le jeu individuel de l’imagination que son texte provoque chez le spectateur.
L’inconnue d’Arras
L’inconnue d’Arras est une des plus belles et plus puissantes inventions du théâtre moderne. La rencontre d’Ulysse mourant avec les figures de son passé atteint des moments extraordinaires. Ulysse se tue pour l’amour de sa femme Yolande qui le trompe avec son meilleur ami s’enfance, Maxime. Le temps de la pièce est le temps de la seconde qui précède sa mort, pendant laquelle il revit ses souvenirs un par un.
Si Ulysse a la surprise de découvrir en la personne d’un jeune soldat (son cadet) le grand père tué pendant la guerre de 1870, celui-ci a la désillusion de voir apparaître sous les traits d’un vieillard, la petite fille qu’il avait espéré avec sa femme enceinte.
L’opposition du Maxime de vingt ans au Maxime de 37 ans concrétise, avec une rigueur incroyable, l’antagonisme de l’adolescent plein d’un idéal intransigeant et de l’homme mûr complaisant qu’il est devenu, avec ce regret de Maxime 20 : « et penser que mes enfants ne me connaîtront jamais. »
Autre image poétique, celle du nuage bourdonnant qui environne Ulysse mourant, qui n’est que les paroles qu’il a prononcées durant sa vie qui reviennent et dont l’amoncellement a soudain quelque chose d’effrayant : « Chasse toutes ces petites mouches bavardes, crie Ulysse à Nicolas, écrase mes paroles… »
Nicolas, le serviteur d’Ulysse, est le raisonneur du théâtre de Salacrou : « Avez-vous jamais vu deux langoustes essayer de se caresser, puis partir bras dessus, bras dessous, comme à la noce ? Aussi grotesques, aussi maladroits sont deux êtres de notre race qui cherchent à s’aimer. »
Et cette inconnue rencontrée par Ulysse à Arras. Personnage fugitif, entrevu à peine une heure, mais dont la présence demeure la plus forte, la plus émouvante, la plus vraie. C’est que Salacrou a le génie d’exprimer dans la silhouette de cette jeune fille égarée avec son propre malheur, au milieu du malheur universel, toute la peine et tout l’espoir de l’homme. Il a imaginé un mythe de la fraternité.
L’archipel Lenoir
L’archipel, c’est la famille Lenoir et chaque membre une île isolée entourée de liqueur, comme le dit humoristiquement Victor. Chacun ne pense qu’à soi, à sa respectabilité et à celle de l’archipel. L’archipel, c’est la famille, le nom des Lenoir, indivisible bien que formée de petits morceaux. Qu’une des îles disparaisse pour que l’archipel reste en bonne place sur la carte mondaine, voilà qui ne dérange pas les membres de la famille. Le grand-père, ayant violé une gamine après soixante-treize ans de vie exemplaire, et appelé pour être jugé, se voit condamné par le reste de la famille qui ne veut pas voir ternir son nom.
Salacrou engage ici un dialogue sur l’absurdité de la vie, dont le raisonneur est le prince Boresku qui se trouve en dehors du drame. Il fait aussi le procès de la morale bourgeoise pour qui tout est autorisé si le monde n’en a pas connaissance. Et plutôt que de subir un procès infamant, elle préfère mettre fin au jour du fautif.
Le deuxième titre, il ne faut pas toucher aux choses immobiles, explique le déroulement du conseil de famille, plein d’humour et d’incidents, chacun reprochant à l’autre des actes qui jusqu’alors étaient restés dans l’ombre. Dans chaque famille, il est des eaux troubles et immobiles qu’il ne faut pas remuer.
Après des épisodes pleins de philosophie humoristique, les choses s’arrangent grâce au domestique qui parait le seul être raisonnable de la pièce.
Le prince :
_ Non, Monsieur Lenoir, vous n’êtes pas dans un cauchemar. A moins que vous en considériez la vie, l’ensemble de notre existence, le passage de l’homme sur terre, comme un cauchemar. Alors, là, nous sommes tous en plein cauchemar depuis l’instant où nous avons compris que nous étions vivants. Vous souvenez-vous de l’instant précis où tout à coup, petit garçon, vous avez eu cette révélation : Je suis vivant, j’aurais pu ne pas exister, et je vais mourir.
Non ? Moi si. Et je me suis évanoui. C’était une charge intolérable sur les épaules de ce petit garçon.
Le grand-père :
_ Quand on déroule ses sentiments à l’envers, on comprend que l’amour, çà s’invente.
La princesse :
_ Il y a des idées immobiles auxquelles il ne faut pas toucher, sinon elles se mettent à remuer et s’en est fini de notre repos. Personne ne peut plus les calmer.
Le prince :
_ Méfiez-vous d’en arriver à croire que les choses doivent être faites pour cette seule raison qu’il vous est difficile de les faire. La morale des courageux est aussi aveugle que la morale des lâches.
Le prince :
_ La vie est aussi dangereuse que le poker. On a toujours envie de parier, de tricher, de gagner. Regardez votre vie comme si vous regardiez pour la première fois des joueurs de cartes. Des fous, diriez-vous. Aussi, avec une grande énergie me suis-je efforcé de me désintéresser. Il y a une progression classique : on se désintéresse d’abord des hommes, ensuite des femmes. Enfin, les purs parviennent à se désintéresser d’eux-mêmes. Et j’aimerais le jour de ma mort, mourir totalement désintéressé. Que ce soit, même, le sens de ma mort.
04:18 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théâtre, littérature, sens de la vie, passion, réflexion |  Imprimer
Imprimer
17/02/2011
Fables et contes de Jean de La Fontaine (8 juillet 1621 - 13 avril 1695)
Avant leur aspect moraliste, on retient de ces fables et contes leur légèreté et leur diversité.
Cette diversité, dont La Fontaine assure qu’il en avait fait sa devise (voir Le pâté d’anguille, conte, 1674), communique le mouvement à sa pensée, la rend diverse, chatoyante, l’anime d’une souriante mobilité :
« Je suis chose légère et vole à tout sujet :
Je vais de fleur en fleur et d’objet en objet… »
La Fontaine soutient que « les vers doivent avoir du rapport avec la nature ». Non seulement la nature dans le paysage et l’animal, mais aussi la nature de l’homme. C’est à sa nature profonde qu’il pense, à ce qui meut ses actions et ses pensées.
Pour La Bruyère, La Fontaine « est le modèle des bons contes, il fait parler les animaux, les arbres, les pierres, tout ce qui ne parle point : ce n'est que légèreté, qu'élégance, que beau naturel et que délicatesse dans ses ouvrages. » Ce qui charme dans les contes, c’est l’expression sans détour, directe des vers. Tout est simple, bien dit, sans ornement.
Mais ce sont surtout les fables qui intéressent, car les contes, à part leur forme, rappelle les contes de cette époque, un peu comme les contes de Florian*. Les fables sont, au contraire, d’une fraicheur inégalée et d’une diversité qui ne fatigue pas, et l’on peut lire La Fontaine sans éprouver le moindre ennui.
C’est aussi un moraliste et sa force est de faire passer la morale avec attrait, presque sans qu’on s’en aperçoive :
« Les fables ne sont pas ce qu’elles semblent être.
Le plus simple animal nous y tient lieu de maître.
Une morale nue apporte de l’ennui ;
Le conte fait passer le précepte avec lui.
En ces sortes de feinte, il faut instruire et plaire,
Et conter pour conter me semble peu d’affaire. »
Comme le disait Fénelon, « La Fontaine a donné une voix aux bêtes pour qu'elles fissent entendre aux hommes les leçons de la sagesse. » Les fables sont des contes à leur manière, et même, des contes pour enfants. Or en tout conte pour enfant, on trouve un précepte moral, qu’il soit mis en exergue ou qu’il soit caché.
* « Ce gracieux écrivain s'est exercé avec succès dans plus d'un genre de littérature ; mais c'est surtout dans la fable qu'il a réussi… Il avait le privilège d’inspirer partout la joie par ses bons mots, ses contes, ses chansons… Point de langueur avec lui ; il faisait la guerre aux longues et tristes discussions par ses saillies, et quelquefois même, par ses jeux d’enfant », écrivait Pierre de Lacretelle à propos de Florian.
* Voir le site très bien fait : http://www.la-fontaine-ch-thierry.net/
04:19 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, auteurs |  Imprimer
Imprimer











