08/12/2012
Le démon et mademoiselle Prym, récit de Paulo Coelho
Le bien et le mal, éternels opposés, mais toujours tellement proches l’un de l’autre en un seul être humain, si bien que le problème permanent de l’homme, n’est pas de se comporter tantôt bien tantôt mal, mais de marcher sur la crête incertaine qui les sépare, sans jamais tomber d’un côté ou de l’autre.
Quelle idiotie, me direz-vous. Certes, je ne parle pas du bien à la manière de saint François d’Assise ou du mal à la manière d’Hitler (sans doute parce que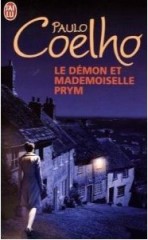 j’ai encore en souvenir le livre d’Eric-Emmanuel Schmitt). Je parle des petits biens et des petits maux qui sont à notre portée. Ils sont si opposés et si proches en même temps. On croît faire le bien, mais le résultat ou les conséquences deviennent des maux, et inversement. De plus, la frontière n’est jamais visible. Elle se faufile comme une ficelle tombée par terre, tantôt à gauche vers le mal, tantôt à droite, vers le bien. Et elle bouge. Alors cette instabilité est décourageante. Comme l’équilibriste sur son fil, il faut regarder au loin, et ne jamais baisser les yeux, sinon le vertige vous prend et vous conduit d’un côté ou de l’autre.
j’ai encore en souvenir le livre d’Eric-Emmanuel Schmitt). Je parle des petits biens et des petits maux qui sont à notre portée. Ils sont si opposés et si proches en même temps. On croît faire le bien, mais le résultat ou les conséquences deviennent des maux, et inversement. De plus, la frontière n’est jamais visible. Elle se faufile comme une ficelle tombée par terre, tantôt à gauche vers le mal, tantôt à droite, vers le bien. Et elle bouge. Alors cette instabilité est décourageante. Comme l’équilibriste sur son fil, il faut regarder au loin, et ne jamais baisser les yeux, sinon le vertige vous prend et vous conduit d’un côté ou de l’autre.
C’est l’histoire de Mademoiselle Prym, Chantal, serveuse de bar dans un village perdu et paisible qui, en un jour, ne regarde plus au loin et se laisse entraîner à droite et à gauche selon les circonstances. L’étranger, arrivé la veille, lui montre des lingots d’or qu’il a cachés dans la terre. Pour la séduire, pense-t-elle. Je ne me laisse pas prendre par un piège aussi grossier. Mais… Elle pourrait apprendre à l’aimer. Et l’homme lui dit : « C’est exactement ce que je veux savoir. Si nous vivons au paradis ou en enfer. » Il poursuit : « J’ai découvert que si nous avons le malheur d’être tentés, nous finissons par succomber. Selon les circonstances, tous les êtres humains sont disposés à faire le mal. » Enfin, il propose son marché : « Si au bout de sept jours, quelqu’un dans le village est trouvé mort, cet argent reviendra aux habitants et j’en conclurai que nous sommes tous méchants. Si vous volez ce lingot d’or mais que le village résiste à la tentation, ou vice versa, je conclurai qu’il y a des bons et des méchants, ce qui me pose un sérieux problème, car cela signifie qu’il y a une lutte au plan spirituel et que l’un ou l’autre camp peut l’emporter. (…) Si, finalement, je quitte la ville avec les onze lingots d’or, ce sera la preuve que tout ce en quoi j’ai voulu croire est un mensonge. Je mourrai avec la réponse que je ne voulais pas recevoir, car la vie me sera plus légère si j’ai raison – et si le monde est voué au mal. »
Et commence les tractations qui font l’objet du livre. Vers quoi Chantal, puis les habitants, vont-ils pencher ? Va-t-elle dire aux autres ce que l’étranger lui a dit ? Va-t-elle prendre au moins un lingot ? Les habitants vont-ils s’entendre pour tuer quelqu’un ?
C’est une fable que nous conte Paulo Coelho qui dévoile en même temps la nature humaine, ni ange, ni démon. Chantal explique : « Moi, je ne sais pas si Dieu est juste. En tout cas, Il n’a pas été très correct avec moi et ce qui a miné mon âme, c’est cette sensation d’impuissance. Je n’arrive pas à être bonne comme je le voudrais, ni méchante comme à mon avis je le devrais. »
06:30 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, spiritualité, religion, philosophie, bien et mal |  Imprimer
Imprimer
03/12/2012
La part de l’autre, roman d’Eric-Emmanuel Schmitt
– Adolf Hitler : recalé.
– Adolf H. ; admis.
Cette annonce de l’Académie des beaux-arts change le monde. On oscille entre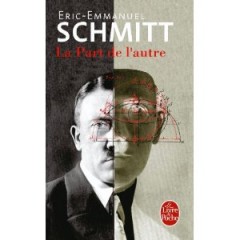 un monde réel, dans lequel le personnage d’Hitler se promène avec difficulté jusqu’à son suicide et un monde imaginaire où Hitler devient peintre. Pas le grand peintre qu’il souhaite devenir, mais un artiste acceptable qui finit par reconnaître qu’il n’a pas l’étoffe d’un grand maître et qui survit à cela.
un monde réel, dans lequel le personnage d’Hitler se promène avec difficulté jusqu’à son suicide et un monde imaginaire où Hitler devient peintre. Pas le grand peintre qu’il souhaite devenir, mais un artiste acceptable qui finit par reconnaître qu’il n’a pas l’étoffe d’un grand maître et qui survit à cela.
Toutes les deux ou quatre pages, on passe d’un personnage à l’autre, parfois en se demandant duquel il s’agit : Docteur Jekyll ou Mrs Hyde ?
Du nouveau chancelier de l’Allemagne, l’auteur écrit : « Ils ignoraient qu’ils n’avaient pas désigné un homme politique, mais un artiste. C’est-à-dire son exact contraire. Un artiste ne se plie pas à la réalité, il l’invente. C’est parce que l’artiste déteste la réalité que, par dépit, il la crée. D’ordinaire, les artistes n’accèdent pas au pouvoir : ils se sont réalisés avant, se réconciliant avec l’imaginaire et le réel dans leurs œuvres. Hitler, lui, accédait au pouvoir parce qu’il était un artiste raté. »
Du peintre, il imagine, dans un dialogue entre le professeur et un de ses élèves, la lutte de celui qui découvre qu’il n’est pas un grand peintre : « – Une vie, ça ne se fait pas tout seul. Ce n’est pas vous qui la donnez. Ce n’est pas vous qui choisissez vos dons. (…) A quarante ans, vous décidez de faire des enfants et vous décidez de ne plus peindre. En fait, ce que vous désirez, c’est décider. Maîtriser votre vie. La dominer. Fût-ce en étouffant ce qui s’agite en vous et qui vous échappe. Peut-être ce qu’il y a de plus précieux. Voilà, vous avez supprimé la part de l’autre en vous comme à l’extérieur de vous. Et tout ça pour contrôler. Mais contrôler quoi ? »
Eric-Emmanuel Schmitt se justifie et explique son roman dans son journal : « J’élabore un double portrait antagoniste. Adolf H. cherche à se comprendre tandis que le véritable Hitler s’ignore. Adolf H. reconnaît en lui l’existence de problèmes tandis qu’Hitler les enterre. Adolf H. guérit et s’ouvre aux autres tandis qu’Hitler s’enfonce dans sa névrose en se coupant de tout rapport humain. Adolf H. affronte la réalité tandis qu’Hitler la nie dès qu’elle contrarie ses désirs. Adolf H. apprend l’humilité tandis qu’Hitler devient le Führer, un dieu vivant. Adolf H. s’ouvre au monde ; Hitler le détruit pour le refaire. Non seulement La part de l’autre donne le principe du livre mais ce titre en suggère la dimension éthique : poursuite de l’altérité chez Adolf H., fuite de l’altérité chez Hitler. »
C’est un livre profond, parfois intéressant, mais qui devient lassant pendant sa lecture. Où veut-on en venir ? Cette question vous taraude tout au long des pages et la réponse ne se trouve pas dans le livre, mais dans le journal où l’auteur décrit ses interrogations. Vous êtes frustré lorsque vous fermez ce long roman de 500 pages, vous l’aimez lorsque vous le refouillez et retournez au point de départ. Que ce serait-il passé si l’Académie des beaux-arts en avait décidé autrement ? Adolf H. manque sans doute un peu de personnalité pour devenir la controverse d’un Hitler névrosé, mais sorcier des foules. A l’opposé d’Adolf Hitler, qui craint les femmes, Adolf H. réussit sa vie grâce aux femmes : Onze-heures-trente, sœur Lucie, Sarah, sa femme, juive.
05:18 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, histoire, psychologie, femme |  Imprimer
Imprimer
28/11/2012
La chambre à remonter le temps, roman de Benjamin Berton
L’histoire pourrait être passionnante. Une chambre qui, lorsqu’on y reste suffisamment longtemps, vous fait sortir deux ou trois jours plus tard ou, parfois, plus tôt. Benjamin a découvert cette propriété de la chambre après l’achat d’une maison au Mans. Le prologue du livre reprend sa fin, comme un retour sur le temps, un éternel recommencement. Mais quel recommencement ? La vie de Benjamin n’est ni drôle, ni passionnante. Celle d’un Français moyen qui côtoie des Français moyens. C’est long et ennuyeux de voir à quel point ces vies sont sans aucun idéal, aucune passion, ni même joie d’instants partagés. Céline, sa femme, n’arrange rien, elle est égale à lui-même et autoritaire : métro (mais on est au Mans), boulot (il le sèche de plus en plus souvent), dodo (ils ne dorment que rarement ensemble).
de la chambre après l’achat d’une maison au Mans. Le prologue du livre reprend sa fin, comme un retour sur le temps, un éternel recommencement. Mais quel recommencement ? La vie de Benjamin n’est ni drôle, ni passionnante. Celle d’un Français moyen qui côtoie des Français moyens. C’est long et ennuyeux de voir à quel point ces vies sont sans aucun idéal, aucune passion, ni même joie d’instants partagés. Céline, sa femme, n’arrange rien, elle est égale à lui-même et autoritaire : métro (mais on est au Mans), boulot (il le sèche de plus en plus souvent), dodo (ils ne dorment que rarement ensemble).
L’auteur est prolixe. On se demande comment il fait pour trouver tant de choses à dire pour traduire l’ennui et la grisaille. De toutes petites aventures avec des gens sans intérêt. Alors pourquoi poursuivre ce livre ? Parce que, malgré tout, l’histoire pourrait être passionnante. Ces allers et retours du temps sur l’échelle métrique ! Alors, on espère, on devance le moment où le quotidien sera dépassé par l’insolite, le fantastique, l’irrationnel. Mais on traîne ainsi jusqu’aux dernières pages qui vous ramène aux premières. Si l’on n’y prend pas garde, on recommence la lecture sans même s’en rendre compte. Le temps est circulaire pensent certains peuples. Oui, c’est vrai, ici il tourne en rond et on ne sait quand va s’arrêter cette dissociation entre personnages vrais et ectoplasmes comme ils finissent par s’appeler.
Mais pour ne pas rester sur une note pessimiste, je vous fais part de la critique de Bernard Quiriny : « D’un côté, c’est un tableau doux-amer de la vie des trentenaires, confortable et mesquine, avec ses petits événements (faire un enfant), ses petits engagements (s’acheter une maison), ses petits rites (recevoir à dîner) et ses petits drames (se séparer). D’un autre, une peinture des frayeurs de la classe moyenne : l’insécurité, le fantasme de la barbarie à nos portes, la tentation de l’autodéfense. D’un autre côté encore, une chronique conjugale drôle et effrayante (Céline n’est pas commode, il finit par ne plus la supporter, la trompe et, sommet de comique macabre, recourt à un marabout africain pour l’empoisonner) et un autoportrait du trentenaire mâle (fier et plein de doutes, consommateur de porno en ligne). Et, pour finir, c’est un récit fantastique bien mené, qui recycle le thème du voyage dans le temps pour en faire l’échappatoire d’un garçon qui s’ennuie, comme si seul l’irrationnel pouvait encore troubler le flux prévisible de la vie moderne. »
07:04 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, société, couple |  Imprimer
Imprimer
21/11/2012
Glacé, thriller de Bernard Minier
S’agit-il vraiment d’un thriller ? Il s’intitule ainsi, mais possède des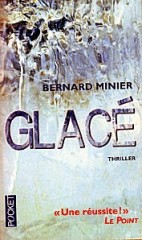 caractéristiques qui font penser à un roman : description de paysages montagnards, analyse psychologique de quelques personnages, citations latines, etc. Cependant, un roman est « une méditation sur l’existence vue au travers de personnages imaginaires », explique Milan Kundera. On ne peut parler de méditation pour ce livre, mais peut-être simplement de quelques considérations inhabituelles au roman policier.
caractéristiques qui font penser à un roman : description de paysages montagnards, analyse psychologique de quelques personnages, citations latines, etc. Cependant, un roman est « une méditation sur l’existence vue au travers de personnages imaginaires », explique Milan Kundera. On ne peut parler de méditation pour ce livre, mais peut-être simplement de quelques considérations inhabituelles au roman policier.
Je ne vous raconte pas de quoi il s’agit, vous le trouverez sans difficulté sur la toile qui abonde de description de l’atmosphère et des aventures du personnage principal, le commandant Servaz. Curieusement, le livre ne commence pas par son intervention, mais par l’arrivée de Diane Berg, psychologue, dans son poste à l’institut Wargnier qui abrite des psychopathes criminels. Comme souvent, la fin du livre, c’est-à-dire la découverte de l’auteur des crimes dévoilés au long du thriller, nous laisse sur notre faim, après nous avoir fait errer sur d’autres possibles, le capitaine Ziegler, l’ancien juge Saint Cyr, voir d’autres. Une fin embrouillée…
Il se lit, on le commence pour ce qu’il est, mais très vite, on le poursuit par routine, parce qu’il s’agit d’un thriller et que ceux-ci sont toujours organisés de telle sorte qu’ils vous contraignent à aller au-delà de que vous iriez si c’était un simple roman. C’est long, trop long parfois, si bien que l’on saute quelques descriptions. Mais c’est un bon thriller qui sort de l’ordinaire par ses aspects plus ou moins intellos.
07:25 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : polar, thriller, psychologie |  Imprimer
Imprimer
06/11/2012
Maîtres et ateliers, textes et photographies d’Alexander Liberman
L’idée de ce sculpteur et peintre connu, russe et américain, fut d’enquêter, après la guerre, sur ce que fut l’environnement des grands peintres de l’Ecole de Paris. Non pas l’environnement social, politique ou mondain, mais celui de leur atelier, de leur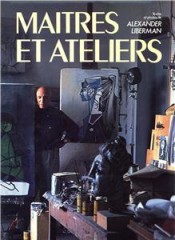 vie intime, et surtout les lieux où ils ont créé leurs chefs d’œuvre. On se promène ainsi dans l’atelier de Cézanne, Monet, Renoir, Picasso, Braque, Léger, Hartung, Manessier, et bien d’autres, significatifs de cette époque où la France était le centre des arts picturaux, le lieu d’inspiration d’une nouvelle peinture, révolutionnaire. Chacun des artistes cités ont inventé une nouvelle manière de peindre, d’aborder leur sujet, de le voir, de le transcrire sur la toile ou d’autres supports.
vie intime, et surtout les lieux où ils ont créé leurs chefs d’œuvre. On se promène ainsi dans l’atelier de Cézanne, Monet, Renoir, Picasso, Braque, Léger, Hartung, Manessier, et bien d’autres, significatifs de cette époque où la France était le centre des arts picturaux, le lieu d’inspiration d’une nouvelle peinture, révolutionnaire. Chacun des artistes cités ont inventé une nouvelle manière de peindre, d’aborder leur sujet, de le voir, de le transcrire sur la toile ou d’autres supports.
Et il écrit dans son introduction : « Après des années durant lesquelles j’ai vu et photographié longuement ces grands artistes, je demeure surtout frappé par leur obsédante dévotion au travail créateur. Selon le mot du poète, ils ont vécu leur vie en la brûlant ». Cette consécration à leur art, analogue à celle des religieux, ils se la sont imposés à eux-mêmes. Ce sont les prêtres d’une religion nouvelle : l’art. (…) Au XIVème siècle, Cennino Cennini définissait ainsi les vertus cardinales du peintre : Vous qui adorez peindre, parce que vous en avez la vocation, avant de vous engager dans notre art, commencez par vous revêtir des vêtements que voici : Amour, Révérence, Obéissance et Persévérance. »
Chaque peintre est défini par son approche de l’art. Ainsi de Cézanne l’auteur dit : « L’œuvre, l’œuvre d’abord, et l’œuvre seule. Cézanne vivait dans un cadre ascétique. (..) Tendu, éperdument, vers les sommets de l’art, Cézanne a connu bien des jours de désespoir. » De Renoir : « Classique, la recherche de l’artiste a consisté à intégrer l’homme dans la nature, car sans la fusion de l’humain et de l’inhumain opéré par l’artiste, la nature, si belle soit-elle, ne dégage pas le sentiment de la plénitude. » De Van Dongen : « Avec son béret incliné de côté, sa barbe blanche élégamment peignée, Kees Van Dongen fait l’effet du commandant de bord. Le capitaine, puissant et expérimenté, d’un immense vaisseau hollandais, le dernier capitaine d’une croisière de luxe. »
Et c’est une longue histoire de la création artistique que nous fait vivre Alexandre Liberman. Ainsi Picasso explique : « J’ai horreur des gens qui parle du beau. Qu’est-ce que c’est le beau ? Quand on parle peinture, il faut parler problèmes ! La peinture n’est que recherche et expériences. » Et Braque poursuit : « Une peinture n’est pas autre chose qu’une méditation ; c’est le produit de la contemplation. Le tableau se fait tout d’abord dans l’esprit, et il s’agit ensuite de le régurgiter. »
Dans sa postface, l’auteur explique : « Tout artiste espère que ces œuvres vivront longtemps après lui. Et lorsqu’elles deviennent immortelles dans la mémoire visuelle de l’humanité, cet espoir est parfois récompensé. Quant à nous, chaque fois que nous admirons une œuvre, nous sommes émerveillés par ce mystère, cette gloire et l’enfantement miraculeux qu’incarne l’art véritable. »
07:30 Publié dans 21. Impressions picturales, 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, dessin, école de paris, création, art, art pictural |  Imprimer
Imprimer
01/11/2012
Aral, roman de Cécile Ladjali
C’est un monde mouvant, tantôt effrayant, tantôt attendrissant, toujours chaud, plein de frémissement, comme ces vibrations qu’Alexeï, musicien sourd, entend. Il se marie avec son amie d’enfance, Zena. Ils ont grandi à Nadezhda, au bord de la mer d’Aral qui s’est retirée. Il n’y reste plus que le sable, la pollution et la misère. Mais ce monde est le leur et ils y trouvent le bonheur, chaud, envahissant, comme leurs corps qui se découvrent et se parlent en caresses.
Il se marie avec son amie d’enfance, Zena. Ils ont grandi à Nadezhda, au bord de la mer d’Aral qui s’est retirée. Il n’y reste plus que le sable, la pollution et la misère. Mais ce monde est le leur et ils y trouvent le bonheur, chaud, envahissant, comme leurs corps qui se découvrent et se parlent en caresses.
Mais un jour, après quelques années heureuses, Zena part travailler en France. Alexeï reste seul avec sa musique. Il prépare un opéra, il joue pour les orphelins de Nadezhda et découvre qu’il sort de cet endroit où les enfants n’ont pas d’histoire. Il rencontre Nulufar, jeune prostituée, belle comme un démon. Il s’installe chez elle, sans cependant la posséder. Mais elle boit l’eau de la ville et est atteinte d’une maladie qui la fait régresser. Elle est comme une enfant de dix ans et il assume cette paternité. Sa vie s’enfonce dans la boue laissée par la mer, près des bateaux gisant sur le flanc, rouillés. Un jour, pour la sainte Rita, Alexeï voit l’eau remonter. Il remarque une fille qui s’installe à côté de lui, sur sa serviette de bain. Zena se lève, entre dans l’eau, il la rejoint. Elle enlève son maillot pour être douce et nue dans ses bras. Dans l’eau elle boit mes larmes. Dans l’eau je bois ses larmes. La mer. Nos visages. Ils rient ensemble et le sel mord les minuscules égratignures que notre histoire a laissées sur nos corps qui se serrent. Une eau joyeuse remplit la vasque ouverte de nos deux vies.
Quelques très belles pages sur la musique : Du désir de musique, je dirai qu’il est très simple et demande à être immédiatement satisfait. Il vient comme la faim, la soif, l’excitation amoureuse. (…)
Moi j’entends la musique partout : dans le sable, dans l’eau, dans les arbres. Le long des falaises de craie, parmi les jupes des fillettes qui jouent à la marelle, ou sur la frimousse crasseuse des bambins qui volent des oranges au marché Saint-Hilarion. En fait je n’invente rien. Jamais. Je restitue. Mais ce que les gens ont du mal à concevoir c’est que ma perception des choses se traduise musicalement, alors que je suis sourd. Ils sont idiots : un artiste choisira toujours le mode d’expression qui annulera sa douleur. (…)
La musique est un souvenir. Une tension en direction de ce qui fut et qu’on rappelle. Les vagues. Les ondes. Le ressac. Voilà à quoi ressemble la musique. Elle et un fleuve Alphée qui retourne au mouvement qui l’a engendré. Elle est un antipoison à la disparition. Je n’ai jamais composé avec du temps mais avec de la durée. Avec des lignes brisées, dans des intervalles, au creux des interstices que le laisse la mémoire ou me confiait le hasard. Ma musique est une sorte d’anomalie.
La beauté du livre tient principalement à l’écriture de Cécile Ladjali. Déliée, sensuelle par l’évocation des perceptions autres que celles de l’ouïe, faite de phrases courtes, désossées. Elle nous donne l’envie de lire ses autres livres.
06:02 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, littérature, musique, femme |  Imprimer
Imprimer
27/10/2012
Le bruit de l'eau, nouvelle de Jacqueline de Romilly
J’écoute le bruit de l’eau qui coule patiemment dans la vasque et de la vasque dans le bassin ; et je me souviens.
Elle, celle qui se souvient, n’est pas l’auteur. C’est une certaine Anne qui évoque sa maison du Lubéron. Elle est n’importe qui, nous dit Jacqueline de Romilly, comme l’indéfini en anglais, an, any. Et comme savait si bien l’évoquer Marcel Proust, cette eau qui coule éveille milles souvenirs : l’achat de cette maison, les premiers instants seule dans le jardin, le jour où ce refuge commence à prendre une âme. Au-delà, c’est la vie elle-même qui est évoquée, une vie qui prend du poids, qui devient adulte à presque cinquante ans. Adulte, c’est-à-dire sereine, au moins pour un court moment, qui laisserait sa marque, en dépit des oublis et des transgressions.
J’ai eu l’impression que mon cœur gonflait, sans que je sache si c’était bien de gratitude ou de mélancolie, de plénitude ou bien de vide. Le bruit de l’eau était comme une chanson, toujours la même, présente, fidèle, secrète, interminable…
07:45 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philosophie, livre, écriture |  Imprimer
Imprimer
11/10/2012
Un amour, roman de Dino Buzzati
« Un matin de février 1960, à Milan, l’architexcte Antonio Dorigo, quarante-neuf ans, téléphona à Mme Ermelina. »
Ainsi commence le roman de Dino Buzzati. Il s’agit d’obtenir un rendez-vous avec une fille. Quand ensuite le rendez-vous avec une fille était pris son corps entier commençait à attendre, dans un état tout ensemble douloureux et superbe, difficile à expliquer, presque la sensation d’être une victime qui s’offrait sans restriction au sacrifice, de tout son corps dénudé, en un abandon et un débordement de languissantes ardeurs…
Il rencontre Laïde et se souvient, en un instant, d’avoir déjà vu cette fille : Ce fut à ce moment précis qu’un déclic se produisit au plus profond d’Antonio, une sorte de mystérieux coup de cloche ; il vécut ce qu’on peut ressentir quand – perdu dans une immense campagne déserte – on entend l’appel d’une voix très lointaine… Antonio s’aperçut soudain qu’une fille marchait devant lui…. Elle marchait un pas décidé, impérieux, presqu’arrogant, sans remuer les hanches, d’une allure splendide, orgueilleuse, faisant battre avec un aplomb remarquable ses talons hauts et fins sur le pavé. Le mouvement imprimait à ses jeunes jambes une sorte de trépidation interne, qui allait des chevilles à l’évasement des mollets, allant se perdre ensuite sous le jupon…
Une fillette du peuple, un de ces types physiques bien définis, sans tape à l’œil, en qui l’on découvre peu à peu une élégance naturelle totale.
La retrouve-t-il, en est-ce une autre ? Il ne sait. Elle se trouvait assise sur le divan long. Il en eut au premier regard une impression agréable, sans plus. Une frimousse pâle, qu’un nez bien planté et bien droit, une petite bouche, des yeux ronds et étonnés, rendaient spirituelle. Un ensemble frais, plébéien, mais sans vulgarité. Il la regarda, cherchant à mesurer le plaisir qu’il allait bientôt en retirer. Il s’aperçut que l’ovale du visage était fort beau, pur, sans rien de classique pourtant…
Dans quelques minutes cette créature fraîche et gracieuse, dont il avait toujours ignoré l’existence, qui possédait une famille, une enfance, une jeunesse, tout un monde peuplé d’une infinité de personnages, fait d’un tissu compliqué à l’extrême de souvenirs, d’habitudes, de connaissances, d’espoirs, de particularités physiques, de journées heureuses et de tristes instants, complètement ignorés par lui, cette créature tellement plus jeune que lui, dans quelques minutes il allait la tenir nue entre ses bras, étendue sur le lit.
Antonio reprend rendez-vous, une fois, deux fois, et devient amoureux de cette fille. C’est l’histoire de cette dépendance que nous conte Dino Buzzati et de tous les affronts que subit l’architecte. Elle est danseuse à la Scala. Elle lui raconte quelques brides de sa vie et très vite, il y avait bien des invraisemblances dans toute cette histoire… Que lui importait après tout ? Il allait encore la posséder une ou deux fois au maximum, cette Laïde. Et puis sa curiosité émoussée ; il s’en lasserait. En réalité, le voici embarqué dans une aventure sans limites dans laquelle elle tire les ficelles. Il n’a pas conscience de cette dépendance. Non. Il l’aimait pour elle-même, pour ce qu’elle représentait de féminin, de caprice, de jeunesse, de simplicité populaire, d’effronterie, de liberté, de mystère. Elle était le symbole d’un monde plébéien, nocturne, joyeux, vicieux, ignominieusement intrépide et sûr de soi qui fermentait d’une vie insatiable auprès de l’ennui et de la respectabilité des bourgeois.
Comment peut-on apprécier un livre qui ne parle que de rendez-vous avec une putain, me direz-vous ? Tout simplement parce que l’auteur écrit d’une merveilleuse façon, décrit les rapports entre les deux êtres ou plutôt ce que pense et ressent Antonio, avec tant de mélancolique volubilité, que l’on ne peut qu’être ébloui. On pense parfois au livre d’Albert Cohen « Belle du Seigneur » : même hymne éternel à la femme, symbolisé par la noblesse de cette fille du peuple (ce qui n’était pas le cas d’Ariane), et même fascination et désespoir de l’homme qui ne peut l’attendre réellement. On pense aussi, à la lecture d’autres passages, à Marcel Proust. Buzzati invente un style particulier lorsqu’il décrit impressions, sensations, sentiments d’Antonio, sans jamais non plus se mettre parler en son nom (je…). Un exemple : C’est celle-ci qui lui a pénétré l’âme, cette Laïde de cet instant précis, l’enfant qui croyant voir la brillante fortune de l’autre côté du fossé a plongé en frissonnant ses petites jambes dans l’eau pour passer, gluante terre glaise, la terrible vase mise en place par la grande ville où elle se sent absorbée peu à peu, ou de jour en jour elle s’engloutit davantage et pendant ce temps-là sur la rive opposée la lumière d’or s’éloigne s’éloigne devient un mirage inaccessible ; le fossé est un marais qui se perd à l’infini, sombre et boueux ; et rageuse entêtée elle continue d’avancer, on lui a dit que l’important était d’insister… Et alors elle se débat pour sortir de la fosse, elle veut faire voir aux autres qui lui sourient sur la berge mais ne la respectent plus, qu’elle aussi est une créature digne de vivre et, oubliant tout ce qui est arrivé, elle redevient enfant, comme pour tout reprendre dès le commencement.
Ce sont des moments de folie littéraire où le style qui se veut ne pas en être un, parce que débridé, sans ponctuation, comme sorti brut du cerveau. En réalité, il est d’une concision merveilleuse, d’une vérité pure, véritable enchantement non des phrases et de leur musique, mais de l’ambiance intérieure qu’il procure. Ainsi se perçoit et se vit l’emprise de cette fille sur Antonio. Ce n’est pas un roman social, ni même un roman sur les rapports entre la femme et l’homme. Non. C’est une histoire dont le seul plaisir est dans sa lecture, même si vers la fin, elle traîne un peu.
07:43 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, littérature |  Imprimer
Imprimer
20/09/2012
La vérité affective
Dans Ultime dialogue entre Jorge Luis Borges et Osvaldo Ferrari (Editions Zoé/éditions de l’aube, 1988), Osvaldo Ferrari parle de vérité affective et Borges lui répond :
– La vérité affective ? Oui. En d’autres termes, j’invente une histoire, je sais que cette histoire est fausse ; c’est une histoire fantastique ou une histoire policière (un autre aspect de la littérature fantastique), mais tout le temps que j’écris, je dois y croire. En cela je coïncide avec Coleridge, pour qui la foi poétique est la suspension momentanée de l’incrédulité.
Ces considérations sont à rapprocher de celles d’Alexandre Vialatte, dans « La porte de Bath-Rabbim » :
Tout ce qu’on invente est vrai, a dit Gustave Flaubert. (…) C’est le bon sens même. Il y a une vérité de la vie et une vérité littéraire. La vérité de la vie est vraie avant même qu’on la raconte, et elle reste vraie après ; elle est vraie avant, pendant, après. La vérité littéraire n’en demande pas tant. C’est pourtant elle qui survit aux faits ; on se rappelle les mots historiques qui sont presque tous apocryphes, mieux que l’histoire de ceux qui les ont prononcés. Qui ne se souvient du vase de Soissons ? (…) « Tout ce qu’on invente est vrai. » (Alexandre Vialatte, La porte de Bath-Rabbim, Presses Pocket, Julliard, 1986, Fictions et réalités, p. 33-34).
Au-delà de ces considérations sur la vérité de la littérature, dont la réalité tient à l’angle d’attaque que l’on se donne, il est sûr que l’écrivain doit croire à ce qu’il écrit. Qui pourrait y croire si lui-même n’y croit pas.
Mais croire à quoi ? Croire à sa fiction ? Croire qu’elle va devenir vraie parce qu’il aura des lecteurs ? Croire enfin qu’il est vrai parce qu’il a écrit cette fiction ? C’est sans doute la dernière assertion qui transforme la fiction en réalité. L’écrivain, comme tout artiste, doit ressortir transformé par son œuvre, devenir plus détaché. Sinon, il reproduira sans cesse ce premier écrit et ne saura se renouveler. Il doit croire à sa possibilité de se renouveler.
08:01 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écriture, littérature, vérité |  Imprimer
Imprimer
18/09/2012
Le Talisman, nouvelles de Vaikom Muhammad Basheer (Zulma, 2012)
« Vaikom Muhammad Basheer (1908-1994) est né à Vaikom, au Kerala (côte sud-ouest de l'Inde). À l'adolescence, il s'échappe de chez ses parents afin de participer au mouvement de lutte pour l'Indépendance de l'Inde. Il connaît la prison pour ses positions et activités politiques, puis passe de nombreuses années à voyager à travers toute l'Inde, côtoyant sages hindous et mystiques soufis. Il est l'un des écrivains les plus importants de la littérature malayalam contemporaine. Et l'auteur de très nombreuses nouvelles et plusieurs romans courts. Le gouvernement indien lui a attribué le prestigieux prix Padmashri en 1982. »
(from : http://www.zulma.fr/auteur-vaikom-muhammad-basheer-281.html )
Surnommé le Maupassant indien, Basheer nous entraîne dans la vie quotidienne, mais poétique de son Kerala natal. Avec simplicité, il nous conte de courtes et fraiches histoires d’amour (L’empreinte, La maison vide, La faim, Les cœurs accordés) et met en valeur l’intelligence des femmes et leur discrétion. Autre thème : les luttes raciales et les systèmes ancestraux (Par une nuit de lune, Les cœurs accordés). Mais tout ceci est dit de manière drôle, vivante, tendre.
Il termine quelques nouvelles par ces mots :
– Que la chance vous sourit.
– Que tous les bonheurs vous sourient.
Et c’est une invitation à la poésie et l’élégance du vivant, dont le symbole est La Femme.
07:21 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, nouvelles, inde |  Imprimer
Imprimer
06/09/2012
La Centrale, d’Elisabeth Filhol
« Trois salariés sont morts au cours des six derniers mois, trois agents statutaires ayant eu chacun une fonction d’encadrement ou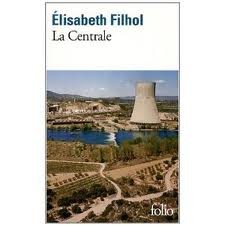 de contrôle, qu’il a bien fallu prendre au mot par leur geste, et d’eux qui se connaissaient à peine on parle désormais comme de trois frères d’armes, tous trois victimes de la centrale et tombés sur le même front. »
de contrôle, qu’il a bien fallu prendre au mot par leur geste, et d’eux qui se connaissaient à peine on parle désormais comme de trois frères d’armes, tous trois victimes de la centrale et tombés sur le même front. »
Ainsi commence La Centrale, un roman consacré aux centrales nucléaires et aux travailleurs saisonniers qui vivent des arrêts de tranche (moment de grand nettoyage d’un réacteur), les DATR pour Directement Affecté aux Travaux sous Rayonnements. On ne s’ennuie pas au cours des cinquante premières pages. Le DATR qui joue le rôle de narrateur a eu un incident au cours d’une séquence de son travail et a pris des doses supplémentaires. On nous décrit les procédures, les impressions, voire les sentiments de l’homme surexposé. On décrit également sa vie quotidienne, en caravane avec quelques copains. Progressivement on se sent englué dans ces rayonnements et la protection qu’il faut porter. « Chair à neutrons. Viande à rem. On double l’effectif pour les trois semaines que dure un arrêt de tranche. Ce que chacun vient vendre c’est ça, vingt millisieverts, la dose maximum d’irradiation autorisée sur douze mois glissants. Et les corps peuvent s’empiler en première ligne, il semble que la réserve soit inépuisable. »
Mais bientôt on se lasse de ces descriptions de procédures, de bouffe dans la caravane, d’incidents sur le circuit primaire, du professionnalisme des uns, du manque de compassion des autres. Page 75, on change de CNPE (une Centrale Nucléaire de Production d’Electricité, pour les initiés). On passe de la centrale de Chinon, à tours réfrigérantes, à la centrale du Blayais : agence d’intérim, formation à la charge de l’embauché, hébergement dans un mobile home, puis la centrale avec explication sur son fonctionnement et un détour par Tchernobyl et les erreurs des opérateurs. Enfin, un des intérimaire pète un plomb, quitte son travail sans l’achever et finit en dépression ou en suicide, on ne sait pas exactement.
Que reste-t-il de cette histoire et est-ce une histoire ? Ce n’est pas un roman au sens où un roman raconte justement une histoire. Il n’y en a pas. Ce sont des impressions, des incidents, des événements, des explications techniques, mais sans suite, sans commencement ni fin. On débute le livre avec intérêt pour un contexte insolite, mais on s’épuise faute de carburant motivant. C’est un pâté constitué d’ingrédients trop divers qui ne vous nourrit pas ou si peu. Certes, on a appris quelque chose sur les centrales nucléaires et la vie des saisonniers. Mais ceci ne permet pas de constituer une intrigue.
07:03 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, centrale nucléaire |  Imprimer
Imprimer
02/09/2012
Chers disparus, de Claude Pujade Renaud
Leurs chers disparus sont Jules Michelet, Robert Louis Stevenson,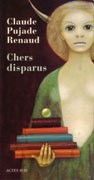 Marcel Schwob, Jules Renard ou Jack London. Les héroïnes sont les veuves de ses écrivains. Elles décrivent leur vie au côté du grand homme et ont en commun de poursuivre le travail de leur mari. Non, il ne s’agit pas de poursuivre ses écrits, mais de les trier, classer, organiser, publier les œuvres inédites, voire les œuvres complètes. Non, ce n’est pas un livre de bibliothécaire, ni de chercheur. C’est la vie de plusieurs femmes, subjuguées par leur cher mari, grand écrivain.
Marcel Schwob, Jules Renard ou Jack London. Les héroïnes sont les veuves de ses écrivains. Elles décrivent leur vie au côté du grand homme et ont en commun de poursuivre le travail de leur mari. Non, il ne s’agit pas de poursuivre ses écrits, mais de les trier, classer, organiser, publier les œuvres inédites, voire les œuvres complètes. Non, ce n’est pas un livre de bibliothécaire, ni de chercheur. C’est la vie de plusieurs femmes, subjuguées par leur cher mari, grand écrivain.
Au-delà de cette sommaire description de ce que représente le livre, je n’ai aimé que le premier récit, intitulé La jolie morte. Athénaïs Mialaret ose adresser une lettre à l’historien connu dans toute l’Europe. Très vite, elle se retrouve mariée, entre l’auteur et sa famille, une belle-mère, une fille et son mari. Ce n’est pas un récit organisé chronologiquement. Ce sont des impressions, des événements qui ont marqué soit leur vie en commun, soit sa vie après la mort de Michelet, dont la rencontre d’Emile-Antoine Bourdelle, sculpteur, soit aussi des événements de sa vie de jeune fille. Elle parle de l’amour de Michelet, parfois de manière crue, voire érotique. Elle raconte ses recherches sur les manuscrits de son mari. Elle découvre que dans son journal, Michelet parle d’elle et de leur vie intime :
A soixante-quatre ans, il se livre à une étude comparée de ses deux épouses. Pauline faisait jouir en jouissant beaucoup. Avec Athénaïs, il goutte l’exquise volupté qu’on a d’entrer dans un esprit. A-t-il rêvé d’une femme alliant les deux registres ? Je n’en suis pas certaine. Ma pureté, ma perpétuelle virginité, voire mon air de première communiante lui plaisaient, le stimulaient, je crois.
Elle déclare à ses amis qu’elle est moins la veuve de Jules Michelet que son âme attardée, un prolongement de lui-même qui veille à la publication intégrale de son œuvre. Enfin, elle signe le bon à tirer du quarantième volume. Sa tâche est achevée.
Le récit est intéressant, ses souvenirs sont vifs, amusants parfois, malgré les répétitions voulues concernant ses maux et leurs conséquence sur leur rapport avec Michelet.
Les autres récits de chacune des femmes des auteurs cités sont une répétition de ce premier récit. Certes différents, mais qui racontent leur histoire avec les mêmes détails, les mêmes thèmes. L’ennui s’installe assez vite. Toutes ses vieilles femmes entourées de leurs chats, parlant de leurs maux, finissent par lasser.
L’histoire de la femme en elle-même disparait devant les histoires de famille et l’évocation du grand homme. La femme s’annihile, malgré ses souvenirs.
Dommage !
07:19 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écrivains, littérature, écriture, histoire |  Imprimer
Imprimer
29/08/2012
Qu'est-ce que la poésie ?
Qu’est-ce que la poésie ?
Si on ouvre le dictionnaire, on lit que la poésie est un genre littéraire associé à la versification et soumis à des règles prosodiques particulières, variables selon les cultures et les époques, mais tendant toujours à mettre en valeur le rythme, l’harmonie et les images (Centre national des ressources textuelles et lexicales : http://www.cnrtl.fr/definition/po%C3%A9sie).
Belle définition, mais qui ne nous fait pas rêver. Or la poésie, c’est une chimère mise en bouteille. Peu importe le genre d’écriture, ce qui compte c’est l’évocation surgie de l’imagination d’un fait, d’une sensation, d’une attitude, d’un sentiment ou toute autre chose. En un mot, une phrase, l’événement évoqué revient à l'esprit alors que la mémoire factuelle l’avait complètement oubliée.
Mais considérons que la poésie est comprise différemment par le poète et ses lecteurs. Dans le premier cas, c’est en lui qu’a surgi la formule mystérieuse qui rappelle l’événement, ce poème, cette petite phrase, ce petit mot, qui sous la seule force d’une image, une comparaison ou toute autre litote poétique évoque un instant particulier empli d’un charme distinctif. Il est évident que sa relecture lui permet aussitôt d’enchaîner sur le souvenir. Dans le second cas, celui du lecteur, celui-ci n’a rien à quoi se raccrocher pour évoquer l’événement que l’auteur cherche à lui faire partager. Seule la pudeur de l’expression lui permet d’évoquer l’événement. C’est là que se trouve l’alchimie véritable de la poésie, la transmission de l’intimité de l’auteur, la vision nue de son âme, comme si le lecteur chaussait des lunettes de vérité et que la brume de la relation sociale s’estompait pour faire place à une communion jusque-là impossible. Certes cette communion varie selon de nombreux critères : la culture commune, le thème abordé, l’humeur du moment, l’affinité entre deux êtres, l’auteur et le lecteur.
Tout ceci pour vous dire que toutes les définitions de la poésie qui n’évoquent que les aspects purement techniques de la poésie ne sont que des façades qui affichent une indifférence du genre littéraire pour se lancer dans l’intellectualisme cher aux Français. Oui, reconnaissons-le ces définitions sont vraies, mais disent-elles la vérité ? Quelle question idiote, me direz-vous. Eh bien, peut-être pas. Il y a l’apparence et la consistance, la forme et le fond, la construction conceptuelle et l’âme évocatrice. Or, avec la poésie, nous sommes à la recherche non pas du temps perdu, mais d’un événement sensible qui nous a donné une nouvelle vision de nous-même, de la vie, du monde. Cet événement est perdu pour le souvenir factuel et il resurgit à travers l’évocation d’une image qui ne nous permet certes pas de revivre l’événement, mais de revivre l’impression ressentie ce jour-là et de faire vivre l'événement à ceux qui ne l’ont pas vécu.
C’est la magie de la poésie, sa folie et le bonheur qu’elle engendre. Elle conduit à l'intimité totale : je suis celui qu’était l’auteur au vécu de l’événement. D’une vie, je vis plusieurs vies et celles-ci me comblent du bonheur de l’intimité réelle. Mieux même, je n’ai nullement la sensation de ce dédoublement, l’auteur n’existe pas indépendamment de moi, je vis ce qu’il a vécu et c’est bien moi qui le vit. L’auteur a disparu.
Alors remercions-le de cette évaporation voulue qui nous laisse pantelant et émerveillé.
07:14 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, poésie, écriture, poème |  Imprimer
Imprimer
25/08/2012
Pour la poésie
Je reprends à mon tour cet article qui me semble intéressant au delà de la polémique actuelle. Il est diffusé dans le blog de Trsitan Horde, intitulé Littérature de partout, excellent blog pour qui aime la poésie et la littérature.
Je reprends ci-dessous le texte paru dans la page « Rebonds » de Libération du 17 août 2012. À diffuser !
À l’heure où certains imaginent fondre la poésie dans un vaste ensemble réunissant le roman et le théâtre (1), il est peut-être bon de rappeler la place que peut occuper la poésie au sein de la littérature. Et ce dont, pour nous, «poésie» est le mot.
En ces temps de crise inédite, alors que les désastres ne sont plus seulement derrière nous ou à côté de nous, mais bien devant nous, est-il encore temps de s’arrêter au vieux mot «poésie» ? Les modernités littéraires successives ont, chacune à leur manière, déclaré la caducité de ce terme, son invalidité, en même temps qu’elles en refondaient les puissances. La mort répétée de la poésie, l’adieu qu’elle ne cesse de se faire à elle-même, inscrivent sa dynamique dans une interrogation et une incertitude qui, paradoxalement, lui redonnent légitimité aujourd’hui.
D’autres l’ont dit avant nous, dans la saturation des discours et des mots usés qui opacifient le réel de leurs fausses évidences, l’écriture poétique ouvre parfois une brèche. Par une sorte d’arrêt dans le flux continu de la prose du monde, elle peut faire disjonction. «Autres directions» est le panneau qu’elle invite à suivre au sortir du chemin à sens unique que semble indiquer le langage usuel.
Une politique de la poésie est peut-être à imaginer sous le rapport de son «idiorythmie», par quoi elle oppose à la normalisation des manières d’être et de penser un hiatus inacceptable. Cependant, il ne s’agit pas d’idolâtrer nos singularités, mais bien plutôt, affrontant la faillite de nos certitudes et de nos représentations, de nous engager dans ce que nous ignorons de nous-mêmes et du monde.
Entendons-nous bien : nous ne voulons pas opposer la poésie au roman, à tout le reste, ni l’enfermer dans quelque cercle des poètes en voie de disparition, mais bien plutôt interroger la littérature à partir de cette «littérature de la littérature», en quoi consiste le poème, cet «effort au style», «taux de densité cruelle», qui de la poésie fait une expérience à l’extrême pointe du langage et de la pensée. En cet échec possible du langage et de la pensée, en cet espoir aussi bien.
La poésie est le plus souvent une tentative de construction, même précaire, de formes incertaines. Elle peut prendre le risque d’autres agencements dans la langue, d’autres configurations de pensée, d’émotions. Qu’elle soit du côté du chant ou du côté de la «littéralité de la littérature», selon Derrida, elle ose quelque chose et, pour cela, doit avoir du courage : «Le courage, le cœur, le courage de se rendre, au travers du refoulement, à ce qui se passe ici dans la langue et par la langue, aux mots, aux noms, aux verbes et finalement à l’élément de la lettre […].»
Il s’agit pour nous de prendre ce qui a nom «poésie» assez au sérieux pour y chercher - pourquoi pas ? - d’autres manières de vivre et de penser. Construire une cabane à l’instant du désastre ? Non. En ces temps inconnus où nous entrons, pouvons-nous continuer de toujours écrire et lire ce que nous connaissons déjà, toujours la même histoire ?
Prétention excessive ? C’est juste l’attention à un mot que nous proposons, loin des infantilisations bienveillantes mais néfastes auxquelles la réduisent trop souvent des actions de «promotion». Le courage dont nous parlons n’appelle nulle condescendance. De sorte qu’au-delà de l’estompement d’un mot du fronton du Centre national du livre (CNL), c’est le sens même de l’action culturelle dans le champ de la «littérature de recherche» qu’on pourrait aujourd’hui interroger.
Des éditeurs, des libraires et des bibliothécaires, des journalistes, des critiques et des lecteurs de tous âges, des écrivains et des artistes, de multiples acteurs de la vie littéraire continuent de prêter attention aux écritures poétiques. Que le Centre national du livre fasse place dans sa réforme à ce qui les anime est la moindre des choses.
Notre souhait est que les Assises du livre et de l’écrit, dont la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, vient de confirmer la mise en œuvre, prennent en compte les résonances du mot «poésie» et, par lui, ce qui fait notre dignité d’êtres de langage, à travers les saisons.
Cette concertation donne espoir aux écrivains, qui se sont mobilisés pour dénoncer la manière dont le processus était imposé et les risques qu’il faisait courir au champ poétique. Qu’il ait pu être question d’estomper le mot «poésie» pour, aux dires de l’actuel président du CNL, obéir aux préconisations de la Cour des comptes, n’est pas insignifiant.
(1) Prévue dans le projet de réforme du Centre national du livre (CNL) datant du 12 mars, la suppression de la commission Poésie du CNL a été suspendue en juillet par la ministre de la Culture et de la Communication, Aurélie Filippetti, qui doit lancer prochainement une concertation sur le sujet.
07:02 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, littérature, poème |  Imprimer
Imprimer
21/08/2012
Le livre de l’oubli et du rire, de Milan Kundera
Extraits de la 6èmepartie, Les anges, chapitre 8 :
Tout ce livre est un roman en forme de variations. Les différentes parties se suivent comme les différentes étapes d’un voyage qui conduit à l’intérieur d’un thème, à l’intérieur d’une pensée, à l’intérieur d’une seule et unique situation dont la compréhension se perd pour moi dans l’immensité.
parties se suivent comme les différentes étapes d’un voyage qui conduit à l’intérieur d’un thème, à l’intérieur d’une pensée, à l’intérieur d’une seule et unique situation dont la compréhension se perd pour moi dans l’immensité.
C’est un roman sur Tamina et (…) c’est un roman pour Tamina. Elle est le principal personnage et le principal auditeur et toutes les autres histoires sont une variation sur sa propre histoire et des rejoignent dans sa vie comme dans un miroir.
C’est un roman sur le rire et sur l’oubli, sur l’oubli et sur Prague, sur Prague et sur les anges…
J’avoue cependant que pendant de nombreuses pages je me suis demandé ce qu’on pouvait trouver de bien dans ce roman. Des personnages incompréhensibles, au milieu d’événements historiques liés au communisme, le tout entre Papa et Maman qui sont également des personnages du roman.
Kundera nous donne quelques éclaircissements dans son autre livre "l’art du roman". Si j’avais écrit sept romans indépendants, je n’aurai pu espérer saisir la complexité de l’existence dans le monde moderne. L’art de l’ellipse me paraît donc une nécessité. Elle exige : d’aller toujours directement au cœur des choses.
Il définit "Le livre du rire et de l’oubli" comme un roman en forme de variations. Pour lui, ce qui lui enlève l’apparence d’un roman, c’est l’absence d’unité d’action. (…) La cohérence de l’ensemble est créée uniquement par l’unité de quelques thèmes et motifs qui sont variés. Est-ce un roman ? Oui, selon moi. Le roman est une méditation sur l’existence vue au travers de personnages imaginaires.
Ainsi Kundera traite le roman comme une composition musicale. Il crée l’histoire romanesque, mais la traite par thèmes, sous forme de digression, c’est-à-dire en abandonnant pour un moment l’histoire romanesque. Chaque thème est une interrogation sur l’existence. Cette interrogation est fondée sur quelques mots fondamentaux, semblables à la série de notes chez Schönberg. Dans "Le livre du rire et de l’oubli", ce sont l’oubli, le rire, les anges, la litost (état tourmentant né du spectacle de notre propre misère soudainement découverte), la frontière, tous mots définis par approfondissement progressif, analyse et synthèse.
Cependant, ne nous y trompons pas. Ce n’est pas parce que l’auteur nous explique son livre et nous en montre la complexité, que ce livre, s’éclaircissant, nous paraît tout à coup un excellent livre. Je le répète, le problème, pour le lecteur, est de s’y retrouver ou, au contraire, de se laisser aller. Je n’ai pu faire l’un ou l’autre, alors j’ai pataugé, même si je suis allé au bout.
Kundera nous a, sans aucun doute, mis en évidence la complexité de l’existence dans le monde moderne avec un livre autant apprêté.
07:27 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, écriture |  Imprimer
Imprimer
14/08/2012
Une forme de vie, roman d’Amélie Nothomb
« Chère Amélie Nothomb, Je suis soldat de 2ème classe dans l’armée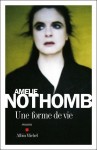 américaine, mon nom est Melvin Mapple, vous pouvez m’appelez Mel. Je suis posté à Bagdad depuis le début de cette fichue guerre, il y a plus de six ans. Je vous écris parce que je souffre comme un chien. J’ai besoin d’un peu de compréhension et vous, vous me comprenez, je le sais. Répondez-moi. J’espère vous lire bientôt. »
américaine, mon nom est Melvin Mapple, vous pouvez m’appelez Mel. Je suis posté à Bagdad depuis le début de cette fichue guerre, il y a plus de six ans. Je vous écris parce que je souffre comme un chien. J’ai besoin d’un peu de compréhension et vous, vous me comprenez, je le sais. Répondez-moi. J’espère vous lire bientôt. »
Ainsi commence le roman dont le prétexte est l’obésité et l’objet réel l’art de la correspondance et ses inconvénients.
Se dévoilant peu à peu, Melvin annonce sa corpulence, réconfort permettant de lutter contre la terreur du combat : Je me suis enrichi d’une personne énorme depuis que je suis à Bagdad. Puisqu’elle m’est venue ici, je l’appelle Schéhérazade. (…) Elle parle des nuits entières. Elle sait que je ne peux plus faire l’amour, alors elle remplace cet acte par de belles histoires qui me charment. (…) Lorsque je rentre à fond dans cette fiction, j’entends sa douce voix féminine qui murmure à mon oreille des choses ineffables. Alors mes gros bras étreignent cette chair et la conviction est si puissante qu’au lieu de sentir mon gras, je touche la suavité d’une amoureuse. Et Amélie s’extasie : Qui veut faire l’ange fait la bête, on le sait depuis Pascal. Melvin Mapple ajoutait sa version : qui veut faire la bête fait l’ange.
Au fil des jours, elle apprend que cette obésité est devenue l’œuvre de Mel. Elle lui propose d’être sa marraine pour une exposition de body art. Elle lui demande une première photo. C’était une boursouflure en expansion : on sentait cette chair en continuelle recherche de possibilités inédites de s’étendre, d’enfler, de gagner du terrain. La chair fraiche devait traverser des continents de tissus adipeux pour s’épanouir à la surface, avant de s’encrouter en barde de rôti, pour devenir le socle du gras neuf. C’était la conquête du vide par l’obésité : grossir annexait le néant.
Elle poursuit néanmoins sa correspondance jusqu’au jour où elle demande une photo en uniforme. Pas de réponse. Après de nombreuses recherches, elle renoue et apprend que Mel n’est pas soldat et qu’il vit à Baltimore dans la grange de ses parents qui ne savent que faire de lui. Il menace de se suicider. Alors Amélie prend l’avion sans réfléchir. Mais elle finit par trouver un subterfuge pour éviter cette rencontre désolante, celle d'une victime devenue bourreau d’Amélie, trop faible pour se révolter de tant d’impudence.
Au-delà de l’histoire et du prétexte, Amélie se livre à une réflexion sur la correspondance et son intérêt. D’abord la forme : J’ai développé une théorie instinctive et expérimentale de l’art épistolaire. Ainsi, j’ai observé que les meilleures lettres ne dépassent jamais deux feuilles A4 recto verso.
Puis, l’intérêt : On rencontre quelqu’un, en personne ou par écrit. La première étape consiste à constater l’existence de l’autre : il peut arriver que ce soit un moment d’émerveillement. (…) Et soudain, l’autre est là, devant la porte. Dessoulé d’un coup, on ne sait comment lui dire qu’on ne l’y a pas invité. (…) Les gens sont des pays. Il est merveilleux qu’il en existe tant et qu’une perpétuelle dérive des continents fasse se rencontrer des îles neuves. Mais si cette tectonique des plaques colle le territoire inconnu contre votre rivage, l’hostilité apparaît aussitôt.
Enfin, le fond du livre : Le langage est pour moi le plus haut degré de réalité. – Le plus haut degré de réalité, c’est de retrouver dans un entrepôt à pneus de Baltimore un obèse mythomane. Compagnie et destination du rêve. Tout çà pour une absence de prétérition.
Et la confession sublime : Depuis que tu as commencé à écrire, quelle est ta quête ? Que convoites-tu avec une si remarquable ardeur depuis si longtemps ? Pour qui écrire, qu’est-ce que c’est ? Tu le sais : si tu écris chaque jour de ta vie comme une possédée, c’est parce que tu as besoin d’une issue de secours. Être écrivain, pour toi, cela signifie chercher désespérément la porte de sortie. La porte de sortie choisie cette fois-ci par l’auteur est assez surprenante : un pied de nez à l’administration américaine.
Pour finir, le livre est-il aussi passionnant et drôle que les livres qu’elle a écrits sur sa jeunesse ? Non, il faut bien le dire. Il y a certes de nombreux traits d’esprit : Je pensais qu’on était en guerre contre l’Irak, je découvre qu’on est en guerre contre le latex. Mais les descriptions de bouffe et d’engraissement rendent le livre un peu indigeste. On finit le livre en voulant se mettre à la diète. C’est d’ailleurs peut-être le cas d’Amélie, vu sa tête sur la couverture de son livre. Donc, appréciation mitigée : belle performance littéraire, mais sur un sujet qui manque de fond.
07:51 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, écriture, obésité, armée |  Imprimer
Imprimer
07/08/2012
Le roman pour Milan Kundera
Ces réflexions sont issues de la deuxième partie intitulée "Entretien sur l’art du roman", du livre L’art du roman, de Milan Kundera.
Le romancier n’est ni historien ni prophète : il est explorateur de l’existence. Ainsi se termine l’entretien. Cette phrase résume la vision de Kundera sur l’art du roman. Le roman est un morceau d’existence. Son but n’est pas d’examiner la réalité ou simplement de créer une réalité imaginaire. Il est d'explorer toutes les possibilités humaines, tout ce qu’un homme peut devenir et de voir ces possibilités se transformer en réalité en étant dans le monde. Le roman met face à face les intentions fondamentales de l’homme avec la réalité dans l’action. Le caractère paradoxal de l’action, c’est une des grandes découvertes du roman, nous dit Kundera. C’est en cela que l’écriture romanesque est passée d’un descriptif de ce que fait l’homme à la description de ce qu’il pense et vit intérieurement. Mais cette description n’est ni morale, ni philosophique. Elle est confrontée aux aléas de la vie et des situations. Dans le roman, l’intention et l’action sont le nœud de l’intrigue, comme Dante le dit : « En toute action, l’intention première de celui qui agit est de révéler sa propre image. »
Kundera explique cette évolution : Richardson a lancé le roman sur la voie de l’exploration de la vie intérieure de l’homme. (…) Joyce analyse quelque chose d’encore plus insaisissable que le temps perdu de Proust : le moment présent. (…) Mais la quête du moi finit, encore une fois, par un paradoxe : plus grande est l’optique du microscope qui observe le moi, plus le moi et son unicité nous échappent. (…) C’est Kafka qui ouvre une nouvelle orientation (…) : quelles sont encore les possibilités de l’homme dans un monde où les déterminations extérieures sont devenues si écrasantes que les mobiles intérieurs ne pèsent plus rien ? C’est en cela que Kundera écrit dans L’insoutenable légèreté de l’être : Le roman n’est pas une confession de l’auteur, mais une exploration de ce qu’est la vie humaine dans le piège qu’est devenu le monde.
Sans qu’il le dise ouvertement, Kundera tente d’aller plus loin. Rendre un personnage vivant signifie : aller jusqu’au bout de sa problématique existentielle. Ce qui signifie : aller jusqu’au bout de quelques situations, de quelques motifs, voire de quelques mots dont il est pétri. Rien de plus. Kundera cherche à décrire l’essence de la problématique existentielle de ses héros. En écrivant L’insoutenable légèreté de l’être, je me suis rendu compte que le code de tel ou tel personnage est composé de quelques mots-clés. Pour Teresa : le corps, l’âme, le vertige, la faiblesse, l’idylle, le Paradis. (…) Je me demande : qu’est-ce qui se passe avec elle ? Et je trouve la réponse : elle est saisie d’un vertige. Mais qu’est-ce que le vertige ? Je cherche la définition et je dis : un étourdissement, un insurmontable désir de tomber. Mais tout de suite je me corrige, je précise la définition : « … avoir le vertige c’est être ivre de sa propre faiblesse. On a conscience de sa faiblesse et on ne veut pas lui résister, mais s’y abandonner. »
Pour Kundera, le propre du roman est de se pencher sur l’énigme du moi : qu’est-ce que le moi ? Par quoi peut-il être saisi ? Et sa réponse est : par son code existentiel qu’il faut décortiquer dans diverses situations que le roman met en scène.
Peu importe les descriptions de ces situations, la netteté du passé du héros, les informations qui sont données sur sa personne. Seuls compte les quelques mots qui le définissent définitivement.
On peut cependant se demander si cette vision de ce que recherche le roman est la seule. Sûrement pas, même si l’évolution du genre romanesque semble s’arrêter, pour Kundera, au code des quelques mots qui caractérise ses personnages. On peut aussi considérer le roman comme une description poétique de l’homme confronté à une réalité incompressible et une rêverie, ou au moins une vision imagée, dans laquelle son esprit se meut. Ce décalage permanent constitue également une somme poétique qui elle-même met en évidence la confrontation du moi avec la réalité.
07:19 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, écriture, philosophie |  Imprimer
Imprimer
28/07/2012
Journal d’hirondelle, d’Amélie Nothomb
Amélie Nothomb est imprévisible, et une fois de plus, elle sur prend. L’avant-dernier paragraphe du livre nous dit qu’il s’agit d’une « histoire d’amour dont les épisodes ont été mélangés par un fou. », mais cela ne correspond pas à ce qui y est abordé. J’avoue que je n’ai pas aimé cette histoire abracadabrantesque d’un narrateur qui devient tueur à gages en écoutant un album de Radiohead, tout cela suite à un pseudo chagrin d’amour.
prend. L’avant-dernier paragraphe du livre nous dit qu’il s’agit d’une « histoire d’amour dont les épisodes ont été mélangés par un fou. », mais cela ne correspond pas à ce qui y est abordé. J’avoue que je n’ai pas aimé cette histoire abracadabrantesque d’un narrateur qui devient tueur à gages en écoutant un album de Radiohead, tout cela suite à un pseudo chagrin d’amour.
Certes elle reste toujours aussi acerbe, inventive de bons mots.
Tirer à deux reprises dans la tête était la règle. Le crâne, parce qu’il valait mieux détruire la centrale. Dans l’immense majorité des cas, la première balle tuait. La deuxième, c’était par sûreté. Ainsi, il n’y a avait pas de rescapé. (…) Pour ma part, je bénissais cette loi du deuxième coup, qui redoublait ma jouissance. En appuyant sur la détente une seconde fois, je m’aperçus même que celle-ci était meilleure : la première sentait encore son huile de doigt.
Mais tout ceci ne fait pas une histoire qui émeut, une histoire qui nous parle. Les dialogues restent, mais l’ambiance décourage. Quel intérêt porter aux meurtres d’un tueur qui lui-même s’ennuie à tirer dans la tête de quidam qu’il ne connait pas. Il se dit insensible, mais à quoi ? L’auteur nous met en présence d’un sadomasochiste et cherche à nous passionner sur ses aventures qui se terminent en arroseur arrosé.
Tout cela confirme ma métaphysique : le corps n’est pas mauvais, c’est l’âme qui l’est. Le corps c’est le sang : c’est pur. L’âme c’est la cervelle : c’est de la graisse. C’est le gras du cerveau qui a inventé le mal. Mon métier consistait à faire le mal. Si j’y parvenais avec tant de désinvolture, c’est parce que je n’avais plus de corps pour entraver mon esprit. Du corps, je n’avais que la minuscule prothèse de perceptions nouvelles découvertes à la faveur des meurtres. La souffrance n’y était pas encore apparue : mes sensations n’avaient aucune notion de morale.
La fin du livre est à la hauteur de son déroulement, le narrateur, qui est le tueur à gages, meurt de constipation. Mourir de constipation est une chose difficile à comprendre. L’esprit humain, qui se représente facilement le trépas diarrhéique, est incapable de concevoir l’inverse. Je me console en pensant que je saurai bientôt en quoi cela consiste. J’ai accompli mon acte d’amour : j’ai mangé les écrits d’Hirondelle. (Je ne dévoile pas de qui il s’agit, sinon le livre n’aurait plus lieu d’être lu).
Bref, ce n’est pas digne d’Amélie Nothomb qui nous a donné bien meilleur.
07:22 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, nothomb |  Imprimer
Imprimer
21/07/2012
Œuvres complètes (1954-2002) de Tomas Tranströmer
Tomas Tranströmer est prix Nobel de littérature (2011). En Fra nce, qui parle de lui ? Peu de personnes, car c’est un poète et il n’écrit pratiquement que des vers. Et encore, aucun de ces vers ne versifient. Ils viennent dans la pensée et s’échappent avant qu’on ait le temps de les mettre en boite. C’est du bouillonnement premier, un jus de chaussette qui sent l’escapade rafraichissante, la pinte de bière fleurie, le sel de mer un jour de pluie.
nce, qui parle de lui ? Peu de personnes, car c’est un poète et il n’écrit pratiquement que des vers. Et encore, aucun de ces vers ne versifient. Ils viennent dans la pensée et s’échappent avant qu’on ait le temps de les mettre en boite. C’est du bouillonnement premier, un jus de chaussette qui sent l’escapade rafraichissante, la pinte de bière fleurie, le sel de mer un jour de pluie.
Ce qui frappe chez lui : l’art de la métaphore ! Elle est audacieuse, précise, bouleversante lorsqu’on l’a comprise. C’est ainsi que les paysages de Turquie scintille « dans la lunette du vautour », que « l’éveil est un saut en parachute hors du rêve ». Alors chaque objet se met à danser de sa musique particulière, à chatoyer de son existence solitaire. Et le poète tente de préciser l’impénétrabilité des choses : « Je suis couché sur mon lit, les bras en croix. Je suis une ancre confortablement enfouie qui retient l’ombre profonde au-dessus d’elle, cette grande inconnue dont je participe et qui est certainement plus importante que moi ».
Son traducteur, Jacques Outin, l’appelle le poète du silence.
Las de tous ceux qui viennent avec des mots,
Des mots, mais pas de langage,
Je partis pour l’île recouverte de neige.
L’indomptable n’a pas de mots.
Ses pages blanches s’étalent dans tous les sens !
Je tombe sur les traces de pattes d’un cerf dans la neige.
Pas des mots, mais un langage.
L’écriture de Tomas Tranströmer est sobre, faite de courtes phrases, parfois sans verbe, un mot, une idée qui se laisse deviner. Mais la métaphore est toujours juste, évocatrice, belle, même si elle surprend par sa hardiesse. Il marche sans faiblesse sur le fil de l’évocation imperceptible et tout ce qu’il voudrait « dire reluit, hors de portée, comme l’argenterie chez l’usurier ». Les souvenirs l’observent :
Un matin de juin, alors qu’il est trop tôt
pour s’éveiller et trop tard pour se rendormir.
Je dois sortir dans la verdure saturée
de souvenirs, et ils me suivent des yeux.
Ils restent invisibles, ils se fondent
dans l’ensemble, parfaits caméléons.
Ils sont si près que j’entends leur haleine,
bien que le chant des oiseaux soit assourdissant.
Tomas Tranströmer choisit d’explorer « la banale vétusté-modernité des choses, le monde ordinaire-extraordinaire de tous les instants que l’on vit » (Alain Jouffroy, Le manifeste de la poésie vécue, Gallimard, 1995). Et ce présent concret et naturel devient un jardin secret, illuminé de mille feux, sorti du jeu des mots et des comparaisons. Pour lui, l’observation crée la réalité. Les situations l’intéressent plus que la chose en elle-même. Il le dit : « Deux vérités s’approchent l’une de l’autre. L’une de l’intérieur, l’autre de l’extérieur, et on a une chance de se voir en leur point de rencontre. »
Eau qui croule qui croule fracas vieille hypnose.
Le torrent inonde le cimetière de voitures, rutile
derrière les masques.
Je serre fort le parapet du pont.
Le pont : ce grand oiseau de fer qui plane sur la mort.
07:39 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, poème |  Imprimer
Imprimer
11/07/2012
L’arpenteur, roman de Marie Rouanet
L’auteur, Marie Rouanet, un beau nom de France qui fleure la terre paysanne et qui nous entraîne dans ces champs, prairies et bois du Rouergue qui sont le véritable sujet du livre. Elle évoque la vie campagnarde, simple, large, dans le souffle des vents qui brossent les collines. On s’étonne même qu’une femme puisse écrire ainsi sur cette fascination des hommes à rassembler la terre, à se l’approprier, à en connaître tous les mètres carrés par un arpentage quotidien, revêtu d’une bonne vieille veste paysanne en velours. Elle évoque ces instants qui marquent la vie d’un rural : la cuisson du pain, l’odeur particulière d’un lieu, un enterrement. Tous ces moments qui relient l’homme à la terre et lui font apprécier la force de sa possession. Elle explique sa vision du bonheur : Voilà encore le chardon, dont les petites graines sèches volent dans l'air de l'été. Le grand jeu consiste à essayer de les rattraper en faisant un vœu. C'est autre chose que tous ces jouets électroniques qui coûtent une fortune et tombent en panne, non ? Je trouve que transformer dès son jeune âge un enfant en consommateur tient à une mauvaise intention des adultes : le faire entrer de force dans un monde où il lui faudra tout acheter, du voyage, des voitures, de l'amour peut-être aussi.
campagnarde, simple, large, dans le souffle des vents qui brossent les collines. On s’étonne même qu’une femme puisse écrire ainsi sur cette fascination des hommes à rassembler la terre, à se l’approprier, à en connaître tous les mètres carrés par un arpentage quotidien, revêtu d’une bonne vieille veste paysanne en velours. Elle évoque ces instants qui marquent la vie d’un rural : la cuisson du pain, l’odeur particulière d’un lieu, un enterrement. Tous ces moments qui relient l’homme à la terre et lui font apprécier la force de sa possession. Elle explique sa vision du bonheur : Voilà encore le chardon, dont les petites graines sèches volent dans l'air de l'été. Le grand jeu consiste à essayer de les rattraper en faisant un vœu. C'est autre chose que tous ces jouets électroniques qui coûtent une fortune et tombent en panne, non ? Je trouve que transformer dès son jeune âge un enfant en consommateur tient à une mauvaise intention des adultes : le faire entrer de force dans un monde où il lui faudra tout acheter, du voyage, des voitures, de l'amour peut-être aussi.
Le livre conte, par l’intermédiaire du narrateur, la vie d’un notaire qui arpente la campagne chaque après-midi. Avec ses cartes, il fouille chaque recoin, débusque de vieilles ruines et ravive l’histoire des gens du pays qu’il connaît mieux que personne. Il savait les roches tendres ou dures, les érosions, les sols stériles, la terre qui descend les pentes avec la pluie ruisselante, les terres lourdes, les terres fines sous le pied nu, les moulins, les cultures, le grand rut des animaux de ferme, la lune dont, même en pension, il surveillait les phases : croître, arrondir son visage, décroître et mourir trois jours, la course estivale ou hivernale du soleil, les ubacs, la neige qui couvre et protège, la bénédiction de la pluie.
L’auteur connaît et défend âprement la vie des paysans, y compris leur manière de manger : Après avoir bu, ils passent le dos de leurs mains ou le bas de la manche sur leurs lèvres. Ils rassemblent les miettes tombées dans le creux de la paume et les avalent. Vous êtes-vous demandé pourquoi ? Ils ne salissent pas plus de vaisselle et de linge que nécessaire parce qu’ils n’ont pas des tripotées de domestiques pour nettoyer et laver. Ils savent ce que chaque miette, chaque goutte, chaque bouchée leur a demandé de sueur et que rien ne les assure de ce pain quotidien dont vous avez plein la bouche dans vos prières. Si vous aviez seulement vu combien leurs gestes sont respectueux de la nourriture, vous sauriez qu’il s’agit là de vraies manières de table. Plus vraies que les nôtres. A la fin du repas, leur assiette est nette – on n’irait pas gaspiller une fraction de ce qui se mange. Ils font du bruit en mangeant ! C’est qu’ils manifestent leur plaisir.
Les cartes permettent au notaire de s’approprier le paysage, avec tous ces recoins. Mais le but d’une carte n’est pas la beauté. Et quoi alors ? L’utilité administrative, les impôts à lever, les possessions de l’église. Le pouvoir. S’il y a des révoltes il est important de savoir la hauteur des montagnes, les bois fourrés, les forteresses. Ce sont des cartes pour régner, rançonner. Une coupe réglée du Royaume de France. L’arpenteur en possède de nombreuses : celle de Cassini bien sûr, une carte d’état-major sur laquelle il a tracé un cercle rouge autour de son village, son territoire qu’il arpente chaque jour, jusqu’à vingt kilomètres, mais aussi des cartes de l’Institut géographique national dont la 1/250.000ème qu’il étale sur une lit de feuilles ou de terre nue. Savoir, ce n’est pas la moindre de ses jubilations, c’est sa richesse cachée, donc incommunicable. Vrai trésor d’avare. Il est comme les collectionneurs qui possèdent un Botticelli ou un Picasso dans un coffre de banque, ils le contemplent. Personne n’en sait rien. Son trésor ne sert l’arpenteur pour rien de visible. Son savoir ne lui sert que pour un bonheur solitaire – il peut dire le mot de bonheur. Il est son épaisseur d’homme et ne durera que le temps de sa vie.
Et le temps passe, la vie s’écoule, faite de petits instants d’attention à la terre, aux tâches quotidiennes du terrien, aux relations profondes avec les hommes, à l’amitié abrupte, jusqu’aux moments de la fin. L’arpenteur meurt, puis c’est le tour d’Amans, que l’arpenteur appelait son seul ami, et le narrateur se prépare à mourir, à laisser tous ces trésors s’ensevelir, comme les ruines visitées par l’arpenteur.
C’est un beau livre, évocateur de cette campagne profonde qui disparaît peu à peu pour des manières de ville. Et, dans le même temps, il fait naître en nous une tristesse indissoluble de ce temps qui passe et qui efface, qui transforme un hameau en ruines branlantes, puis en un tas de pierres que l’on redécouvre sous les ronces. La campagne reste irascible comme l’arpenteur qui a été laid, orgueilleux, mais infatigable pour rassembler ces mille souvenirs qui font le trésor d’une vie.
Une remarque : Marie Rouanet parle de l’amour de la terre, celle qui est lourde, qui sent la feuille ou la fenaison, et non de la nature, expression écologique qui dénote une vision complètement différente de nos rapports avec le territoire. C’est elle qui aurait dû écrire « La carte et le territoire ». Elle aurait donné du poids aux élucubrations de Michel Houellebeq (Voir le 20 janvier 2012, dans Impressions littéraires). Mais l’une et l’autre n’ont rien à voir ensemble.
07:55 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, écriture, culture |  Imprimer
Imprimer
06/07/2012
La liste de mes envies, roman de Grégoire Delacourt
On se ment toujours.
Ainsi commence le premier chapitre qui est époustouflant. Il résume la psychologie et la vie de Jocelyne Guerbette, mercière à 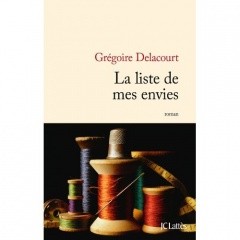 Arras :
Arras :
Je sais bien, par exemple, que je ne suis pas jolie. Je n’ai pas les yeux bleus dans lesquels les hommes se contemplent ; dans lesquels ils ont envie de se noyer pour qu’on plonge pour les sauver. Je n’ai pas la taille mannequin ; je suis du genre pulpeuse, enrobée même. Du genre qui occupe une place et demie. J’ai un corps dont les bras d’un homme de taille moyenne ne peuvent pas tout à fait faire le tour. Je n’ai pas la grâce de celles à qui l’on murmure de longues phrases, avec des soupirs en guise de ponctuation ; non. J’appelle plutôt la phrase courte. La formule brutale. L’os du désir, sans la couenne ; sans le gras confortable.
Je sais tout çà.
Et pourtant, lorsque Jo (Jocelyn, son mari) n’est pas encore rentré, il m’arrive de monter dans notre chambre et de me planter devant le miroir de notre armoire-penderie…
Je ferme les yeux et je me déshabille doucement, comme personne ne m’a jamais déshabillée. J’ai chaque fois un peu froid ; je frisonne. Quand je suis tout à fait nue, j’attends un peu avant d’ouvrir les yeux. Je savoure, je vagabonde. Je rêve. Je revois les corps émouvants alanguis dans les livres de peinture qui trainaient chez nous ; plus tard, les corps plus crus des magazines.
Puis je relève doucement mes paupières, comme au ralenti. Je regarde mon corps, mes yeux noirs, mes seins petits, ma bouée de chair, ma forêt de poils sombres et je me trouve belle, et je vous jure qu’à cet instant, je suis belle, très belle même.
Cette beauté me rend profondément heureuse. Terriblement forte. (…)
Nue, si belle devant ce miroir, il me semble qu’il suffirait juste de battre des bras pour que je m’envole, légère, gracieuse. Que mon corps rejoigne ceux des livres d’art qui traînaient dans la maison de mon enfance. Il serait alors aussi beau qu’eux ; définitivement.
Mais je n’ose jamais.
Ce premier chapitre est un condensé de l’esprit du livre, au-delà de toute l’histoire que je vous laisse découvrir. Elle est racontée avec des mots simples, simplistes même diraient certains. Mais c’est cette naïveté apparente qui donne au livre son charme et à la narratrice sa savoureuse matérialité. Jo semble banale, et pourtant, elle s’inscrit dans la lignée des femmes méconnues, qui laissent s’enfuir leur rêve de jeune fille pour vivre leur vie de femme. Elles sont tenaces dans la vie de tous les jours, avec des accès de mélancolie. Alors elles dressent la liste de leurs besoins, insignifiants : deux poêles Tefal, un nouveau micro-ondes, un couteau pour le pain, une nouvelle pince à épiler, Belle du Seigneur (vous connaissez ! Le roman d’Albert Cohen) et bien d’autres choses encore, dont des cadeaux pour son homme. Mais cette liste est bien loin de la liste de ses envies, dressée un peu plus loin : couper mes cheveux, faire un régime, danser un slow avec Jo sur l’Eté indien au prochain 14 juillet, un sac Chanel, être enviée (enfin !!!) (C’est drôle d’écrire être enviée dans ma liste d’envies). Et elle finit par : Qu’on me dise que je suis belle.
"Les besoins sont essentiels, ce sont eux qui nous maintiennent en vie. Mais ce sont les envies qui nous permettent de nous sentir vivants", explique Grégoire Delacourt.
Sa vie était simple. Mais le billet de tombola qu’elle a gagné fait s’écrouler ce monde, mélange de réalité et de rêverie. Le livre finit par ces trois phrases, désolantes : Je chante pour moi, en silence, le visage tourné vers la mer obscure. Je suis aimée. Mais je n’aime plus.
Jo, serais-tu devenue adulte et si près de la mort ?
07:26 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman |  Imprimer
Imprimer
29/06/2012
Fanfan, roman d’Alexandre Jardin
Depuis que je suis en âge d’aimer, je rêve de faire la cour à une femme sans jamais céder aux appels de mes sens. J’aurais tant voulu rencontrer une jeune fille vertueuse qui m’eût à la fois adoré et obligé à contenir ma passion. Hélas, les femmes de ce siècle ont oublié l’art de faire piaffer les désirs. Il me fallut donc, au cours de mon adolescence, apprendre à me brider moi-même.
Ainsi commence le livre, et, pendant toute son adolescence, Alexandre Crusoé se retient. Jusqu’au jour où il rencontre Laure de Chantebise animée de désirs simples, posséder une belle maison et engendrer une grande famille. Laure l’a séduit. Il jura de n’épouser aucune autre femme.
Un jour, il rencontre Fanfan, une jeune fille qui vingt ans, mais en porte dix-huit. Il n’imaginait pas une fille capable de produire autant de désirs. Ne disposant que d’une seule chambre, elle lui propose de dormir ensemble, en tout bien tout honneur. Ce qu’ils font. Deux jours plus tard elle lui donne rendez-vous à minuit pour calmer leur faim. Mais la vie continue avec Laure et sa famille, très bon chic bon genre, trop, manquant de perspective. Alexandre se partage entre Laure, sa maîtresse, future femme, et Fanfan, son élu, qu’il s’efforce de rendre inaccessible. Il ne lui avoue pas sa passion et lui fait la cour sans le dire, d’une façon bien personnelle, drôle. Il cherche à lui faire croire qu’elle est plus une amie, une sœur, qu’une femme désirable. Il lui fait passer une soirée à Vienne où ils dorment dans un hôtel, mais elle découvre qu’il s’agit d’un décor de cinéma.
Il loue l’appartement côte à côte du sien, l’aménage à l’identique et la regarde dans un miroir sans tain. Elle lui présente son fiancé, en réalité un homme qu’elle a embauché pour lui faire la cour et rendre jaloux Alexandre. Mais il surprend leur empoignade et écarte ce faux rival. Il se glisse sous son lit et dort près d’elle. Le lendemain, elle lui parle :
Hier soir, j’ai perçu quelque chose de bizarre dans ce studio… J’ai été réveillé par un ronflement. Je n’étais donc pas seule… Ce qui serait merveilleux, ce serait que tu viennes enfin t’allonger près de moi.
Elle fait semblant de se noyer. Il la retrouve dansant avec des bohémiens, en jarretelles : Tous, ils seront tous à moi ce soir, lui dit-elle. Alors il lui dit : D’accord, je serai ton amant. Mais une seule fois dans notre vie. Je désire pour nous un amour parfait. Mais elle ne lui donne que son bras.
Enfin, son vieil ami de quatre-vingt ans, lui explique qu’il ne peut rester un éternel adolescent : L’amour exige le risque. C’est le prix à payer. Et la vie de couple est la seule véritable aventure de notre temps… Qu’as-tu fait jusqu’à présent de tes talents ? La seule chose importante en ce bas monde est de rendre heureuse une femme. Tout le reste n’est que vanité.
Le vendredi soir, Fanfan rentra chez elle, s’allongea sur son lit sans un regard en direction du miroir, et ferma les yeux. Je me tenais derrière la glace… Je me collais contre la vitre et, soudain, la fis voler en éclats à l’aide d’un tabouret. Nos deux studios se trouvaient réunis. Fanfan ne bougeait pas. Je pénétrai chez nous, m’approchai de son visage et lui baisais les lèvres. Ma princesse ouvrit les yeux. Veux-tu m’épouser ? murmurai-je. Oui, me répondit Fanfan.
Un livre plein de charme, d’espièglerie, de bonheur d’un amour naissant, cocasse, enjoué, insolite dans ces approches, résolument hors norme.
De ce beau roman a été fait un film que vous pouvez voir sur Youtube. Mais, il est décevant après avoir lu le livre.
07:37 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, film |  Imprimer
Imprimer
25/06/2012
La mort est un nouveau soleil, d’Elisabeth Kübler-Ross, Edition du Rocher, 1988 (suite et fin)
La troisième partie du livre est assez complète et se suffit à elle- même. Voici ce qu’en dit Elisabeth Ross : « Chaque jour des hommes meurent partout. Et néanmoins dans notre société qui a réussi à envoyer un homme sur la lune et à le faire revenir sain et sauf, aucun effort n’est entrepris pour étudier la mort et arriver à une définition actualisée et universelle de la mort humaine. N’est-ce pas étrange ? »
même. Voici ce qu’en dit Elisabeth Ross : « Chaque jour des hommes meurent partout. Et néanmoins dans notre société qui a réussi à envoyer un homme sur la lune et à le faire revenir sain et sauf, aucun effort n’est entrepris pour étudier la mort et arriver à une définition actualisée et universelle de la mort humaine. N’est-ce pas étrange ? »
Alors elle nous raconte comment dans son équipe médicale, les expériences au seuil de la mort se multiplient. Elle constate même qu’au cours des dix dernières années on a rapporté dans le monde entier plus de vingt-cinq mille cas. Qu’on-t-il vécu ?
Au moment de la mort, nous vivons tous la séparation du vrai moi immortel de sa maison temporelle, c’est-à-dire du corps physique. On se voit mort physiquement et on se sait entité intégrale malgré tout. (…) On perçoit la présence de nos guides spirituels, généralement un être mort que nous avons particulièrement aimé. (…) On passa alors par une transition symbolique qui est le plus souvent décrite comme une sorte de tunnel et on approche d’une source lumineuse dans laquelle nous réalisons ce que nous aurions pu être, la vie que nous aurions pu mener. (…) Nous devons juger nos pensées, nos paroles et nos actes.
Elisabeth Ross fait alors part de sa propre expérience. Cette expérience a changé sa vie. Alors ne jouons pas les sceptiques à priori. Interrogeons-nous sur ces expériences qui furent suffisamment nombreuses pour qu’elles disposent d’une certaine légitimité. Nous ne trouverons pas la réponse tout de suite, mais cette méditation ne sera pas inutile.
C’est un beau défi, ne trouvez-vous pas ?
07:27 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, spiritualité, société, livre |  Imprimer
Imprimer
17/06/2012
Nos vies désaccordées, roman de Gaëlle Josse
On met du temps pour entrer dans ce roman. Il traîne en longueur au départ et ne finit pas réellement. Sophie, l’héroïne involontaire de l’histoire, ne prends pas de décision. On ne sait si elle retournera avec son pianiste ou non.
l’histoire, ne prends pas de décision. On ne sait si elle retournera avec son pianiste ou non.
L’écriture est parfois banale, mais la forme du roman implique pour chaque chapitre un final en italique qui devient une méditation, avec des réflexions intéressantes sur ce qui s’est passé. C’est à la fois impersonnel et très intérieur, à la surface de l’âme. Ces récitatifs, à la manière d’un opéra, sauvent le livre, car l’histoire en elle-même manque d’intérêt.
François Vallier, pianiste célèbre, part retrouver Sophie, celle qu’il a aimée, qu’il aime toujours et qui est internée dans un service psychiatrique. Elle ne parle pas et ne fait que peindre en noir un immense tableau blanc, puis en blanc l’immense tableau noir. Et pourtant, elle était vive, drôle, inattendue, imprévisible. Mais un jour, elle fut enceinte. Elle en fut heureuse, jusqu’au moment où elle apprit qu’elle attendait un enfant trisomique. Ils décident d’interrompre la grossesse.
Nous sommes entrés costumés dans le bloc opératoire où nous attendaient médecin, anesthésiste et infirmières. Oui, nous étions sûrs de notre décision. Un appareil relié au ventre de Sophie par deux électrodes faisait entendre le cœur de l’enfant. Un staccato léger, rapide. Sophie accoucha d’une pauvre vie que l’on déroba à notre vue derrière le champ opératoire. Le staccato ralentit. Cessa. Il y eut un silence. (…) Quelques jours plus tard, Sophie sortit dans la rue, entièrement nue, couverte de peinture rouge, en hurlant qu’on lui rende son enfant. Il fallut l’interner d’urgence.
L’histoire, les péripéties, l’après cet incident, tout cela est dit de manière intimiste, mais détachée, dans la musique des mots qui traduit la musique des notes.
Hier, pour la première fois depuis mon départ, j’ai eu envie de jouer. Pas seulement dans ma tête, ou en feuilletant une partition. Envie de jouer avec les doigts, les bras, avec le souffle qui s’applique à suivre chaque phrase. Mes doigts ont recommencé à chercher quelque chose. (…) Qu’as-tu fait de ton talent ? J’ai joué, Seigneur, j’ai joué. Je voudrais aussi pouvoir répondre que j’ai aimé, et au-delà de moi-même, lorsque la question me sera posée, le jour de la pesée des âmes.
On ne sait si Sophie est revenue à la vie, à l’amour. On ne sait ce que devient ce couple qui n’en est plus un.
C’est une femme qui a écrit ce livre et qui fait parler un homme. Cela commence difficilement. Cela finit difficilement. Entre les deux, il y a la musique et c’est sans doute pour cela que le livre et la romancière finissent par toucher le lecteur.
14:30 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, roman |  Imprimer
Imprimer
12/06/2012
La mort est un nouveau soleil, d’Elisabeth Kübler-Ross, Edition du Rocher, 1988
« Beaucoup de gens disent : « Le Dr. Ross a vu trop de mourants. Maintenant elle commence à devenir bizarre. » L’opinion que les gens ont de vous est leur problème et non pas le vôtre. Il est très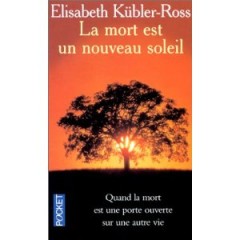 important de le savoir. Si vous avez bonne conscience et que vous faites votre travail avec amour, on vous crachera dessus, on vous rendra la vie difficile. Et dix ans plus tard, on vous donnera dix-huit titres de docteur honoris causa pour le même travail. » Ainsi commence le livre d’Elizabeth Kübler-Ross et cela me plaît : l’indépendance d’esprit est le seul moyen d’innover réellement. Et elle a réellement innové dans un milieu où les préjugés scientifiques sont aussi, sinon plus forts que dans les autres milieux. Un médecin qui sort de la science médicale, laquelle se résume à la vie physique, c’est inconcevable, même si ses recherches se font de la manière la plus scientifique possible.
important de le savoir. Si vous avez bonne conscience et que vous faites votre travail avec amour, on vous crachera dessus, on vous rendra la vie difficile. Et dix ans plus tard, on vous donnera dix-huit titres de docteur honoris causa pour le même travail. » Ainsi commence le livre d’Elizabeth Kübler-Ross et cela me plaît : l’indépendance d’esprit est le seul moyen d’innover réellement. Et elle a réellement innové dans un milieu où les préjugés scientifiques sont aussi, sinon plus forts que dans les autres milieux. Un médecin qui sort de la science médicale, laquelle se résume à la vie physique, c’est inconcevable, même si ses recherches se font de la manière la plus scientifique possible.
Le livre est composé de trois conférences qui se font suite de manière logique : vivre et mourir ; la mort n’existe pas ; la vie, la mort et la vie après la mort.
L’homme vit dans un cocon, son corps. Il utilise pour cela l’énergie physique. Mais il dispose également de l’énergie psychique, et il peut les utiliser de manière positive ou négative. L’énergie psychique s’utilise au moment de la mort, lorsque l’homme sort de son cocon avec son corps éthérique comme le fait le papillon. Lorsqu’on lui pose la question de la mort des enfants, elle explique que ceux-ci ont appris ce qu’ils avaient à apprendre et que cette vie lui suffit. La mort permet de faire la synthèse de sa vie, de voir en quoi nous avons réussi ou non ce pourquoi nous sommes venus sur terre. Et ce pourquoi est différent d’une personne à l’autre.
La mort n’existe pas, dit le Dr. Ross. Elle n’est qu’un passage. Elle le tire de ses constatations de Near Death Experience. Alors il faut prendre la vie comme un défi. Nous sommes là, sur terre, pour découvrir quelque chose de personnel qui importe pour notre être tout entier. Alors mettons-nous au travail ! Peu importe si nous sommes connus ou inconnus, si ce que l’on a à découvrir apportera quelque chose à l’humanité ou sera insignifiant. L’essentiel est de le faire avec amour, sans jamais se décourager, sans recherche de profit personnel.
07:57 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, spiritualité, société, livre |  Imprimer
Imprimer
04/06/2012
Menus abîmes, poèmes d’Emily Dickinson, traduit par Antoine de Vial (2ème partie)
« Le rivage est plus sûr, mais j’aime me battre avec les flots
Un mot peut vous inonder quand il vient de la mer »

Emily Dickinson est une femme restée adolescente dans l’esprit, spirituellement toujours en mouvement. Mais ses interrogations ne se disent pas ouvertement, elles se laissent deviner au fil des vers. En cela, elle se laisse laver chaque matin par son inspiration et peut alors déclamer fortement sa vision du monde.
Les mots prolongent sa pensée, la rythment au fil du jour et s’éteignent le soir après les avoir couchés sur le papier. Et chaque jour est un émerveillement de tout, bien qu’elle n’ait jamais que vécue dans sa maison familiale. Vide de toute pensée utilitaire et personnelle, elle se laisse griser par la toute-puissance de la nature, s’enivre du soleil, du vent et des couleurs de l’univers.
N’en disons pas plus et laissons-nous porter par ce poème :
Ce fut un chemin de silence –
Il demanda si j’étais sienne –
Je répondis sans mots –
Mais du regard –
Alors – il m’emporta si haut
Avant même ce bruit mortel
De la fougue d’un Char –
Loin – comme le ferait des roues –
Notre monde avait disparu –
Comme les champs au pied
De qui se penche d’un ballon
Pour scruter une rue d’éther –
Le gouffre – derrière nous – n’était plus –
Les continents étaient nouveaux
C’était l’éternité avant –
L’éternité prévue –
Plus de saisons pour nous –
Ni nuits et ni matins –
Mais un soleil – qui en ce lieu –
S’était fixé en son aurore –
Merci, Emily, pour cette bouffée de fraicheur et votre délicate espérance.
06:20 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, amérique |  Imprimer
Imprimer
01/06/2012
Jeune fille, roman d’Anne Wiazemsky, Gallimard, 2007
A sa lecture, je me suis étonné qu’Anne Wiazemsky ose écrire un livre qui met en scène un grand cinéaste, Robert Bresson, et un grand écrivain, François Mauriac, ainsi qu’un certain nombre d’autres personnages tels que Jean-Luc Godard ou encore Pierre Lazareff. On y découvre une jeune fille, presqu’une enfant, face à un Robert Bresson, attirant et tyran, qui la choisit pour le rôle principal dans son film « Au hasard Balthazar ». Il hésite, la fait parler, puis lire quelques pages du manuscrit, puis tente un essai cinématographique, pour, finalement, la choisir.
grand écrivain, François Mauriac, ainsi qu’un certain nombre d’autres personnages tels que Jean-Luc Godard ou encore Pierre Lazareff. On y découvre une jeune fille, presqu’une enfant, face à un Robert Bresson, attirant et tyran, qui la choisit pour le rôle principal dans son film « Au hasard Balthazar ». Il hésite, la fait parler, puis lire quelques pages du manuscrit, puis tente un essai cinématographique, pour, finalement, la choisir.
Je dus lire et relire la même scène des Anges du péché. Les indications claquaient, brèves et sèches ; « Pas de sentiment », « Plus vite », « Encore plus vite », « Ne pensez à rien ». L’homme assis en face de moi ne me lâchait pas des yeux. Il me donnait la réplique comme on joue au ping-pong, avec un automatisme parfaitement rodé. Je croyais en avoir fini ? Non, il fallait reprendre. Nos respirations s’étaient vite accordées. Laquelle s’était adapté au rythme de l’autre ? Peu importait. Ce qui comptait, c’était la relative facilité avec laquelle je me pliais à ses directives, hypnotisée par le débit monotone de sa voix, la puissance de son regard, le silence autour de nous.
Et le tournage commence, en été. Il la veut toujours à côté de lui, attentive à ce qu’il fait. Ils logent presqu’ensemble, chez un habitant du lieu. Et au cours de cet été, elle se prend un amant d’un jour, son premier jour de femme ; dans le même temps, elle se refuse au metteur en scène qui la traitait comme une petite fille ; enfin, elle découvre la vie, si différente de ce qu’elle connaissait. Bref, Anne sort de sa chrysalide, devient femme, avant de reprendre ses études en septembre. C’est ce rite initiatique, inconsciemment vécu, qui est décrit par Anne Wiazemsky.
Le roman parait juste, tout simplement parce qu’Anne a réellement joué le rôle et vécu ce qu’elle décrit. Elle est bien la petite-fille de l'écrivain François Mauriac. Sa carrière cinématographique commence bien en 1966 avec le rôle principal (avec l'âne) d'Au hasard Balthazar de Robert Bresson. Elle épouse bien Jean-Luc Godard le 21 juillet 1967 avec lequel elle tournera plusieurs films. Elle dépeint Robert Bresson comme un cinéaste exigeant, uniquement préoccupé de son film, mais aussi une sorte de séducteur qui tente de passer du rôle de parent protecteur à celui d’amoureux, voire d’amant, mais qui finit par y renoncer. L’histoire du film, on ne la connaît pas. Voici ce qu’en dit Robert Bresson : « Je voulais que l'âne traverse un certain nombre de groupes humains qui représentent les vices de l'humanité. Il fallait aussi, étant donné que la vie d'un âne est très égale, très sereine, trouver un mouvement, une montée dramatique. C'est à ce moment que j'ai pensé à une fille, à la fille qui se perd. »
Cependant, quelque chose m’interdit de dire que c’est un très bon livre comme beaucoup de critiques l’ont proclamé. Ils nous parlent de l’émoi de l’adolescence, et Anne Wiazemsky elle-même nous dit : « Pour prendre une image assez simple, c’est une espèce de chenille qui, au cours d’un été un peu particulier, se transformera en papillon – un cas assez banal. » Elle ajoute : « J’espère que c’est une jeune fille qui est assez représentative d’autres jeunes filles ».
C’est sans doute cette dernière affirmation qui me gêne. Son entrée dans l’âge adulte est pour ainsi dire unique. Elle la décrit sans réellement y inscrire le combat que vit chaque adolescent entre son enfance et la vie qui se profile, pleine d’incertitude. Elle n’a pas de doute, elle semble vivre cela comme le lui a appris Bresson, presqu’indifférente, sans sentiment, monocorde comme la voix exigée par le metteur en scène, à l’image de cet extrait du film :
http://www.dailymotion.com/video/x3rj9q_au-hasard-balthazar_shortfilms
Oui, c’est un livre atone malgré de nombreuses qualités : où est la foi de l’adolescence, quelles sont ses références ? Rien de tout ceci n’apparaît. L'histoire est sortie de son contexte. Le plat est bon, mais il manque un peu de sel. Cette jeune fille, même adolescente, est trop vieille.
06:04 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, cinéma, film, adolescence |  Imprimer
Imprimer
30/05/2012
Menus abîmes, poèmes d’Emily Dickinson, traduit par Antoine de Vial (1ère partie)
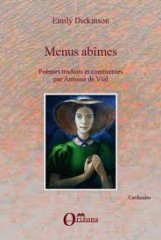 Emily Dickinson a écrit près de mille huit cent poèmes, dont seuls moins de dix furent publiés. Née en 1830, elle est morte à 55 ans.
Emily Dickinson a écrit près de mille huit cent poèmes, dont seuls moins de dix furent publiés. Née en 1830, elle est morte à 55 ans.
A sa demande son « cercueil ne fut pas conduit, mais porté à travers un champ de renoncules ». Elle ne s’éloigna d’Amherst, sa maison natale, où elle disait tant se plaire, que pour passer une année au collège de Mount Holyoke à South Hadley ou lors de rares séjours, à Washington ou à Boston. Elle n’a guère quitté le cercle de cette petite communauté puritaine de Nouvelle-Angleterre. Elle a vécu entre son père juriste et homme politique, admiré et craint, et sa mère plus effacée ; entre sa sœur Lavinia, qui ne partit jamais non plus et son frère Austin, installé dans la maison voisine avec sa femme Susan, amie de cœur de la poétesse.

On se plonge dans la poésie et l’on en sort transformé. C’est un grand bol d’air frais qui vous descend dans la gorge et vous fait voir le monde autrement. Emily vit de sa poésie, elle est poésie. Chaque instant est l’occasion d’un poème, mais sa faveur va à la nature, chantée, dite, criée, sans jamais se lasser. Et son monde de vers est bouleversant d’humanité, non de sentimentalité, de sensibilité sociale, mais de viril abord de la grandeur de la vie.
Mon cocon me serre –
Les couleurs m’agacent –
Je ressens – avec un besoin d’air –
Une obscure aptitude à voler –
Que mon habit entrave –
----
Je donne à entendre et déconcerte –
Je déchiffre jusqu’au signe –
Mais de bévues en bévues – enfin –
Je pressens l’indice du divin –
Elle utilise le tiret et non la ponctuation habituelle. Il lui permet de donner une résonance nouvelle aux mots, de les isoler de leur contexte et mettre en valeur telle ou telle idée. Il donne également l’eurythmie du poème, fait d’élans et de pauses dans la cadence pointilliste de l’anglais.
J’ai plongé et nous y replongerons bientôt. C’est tellement enchanteur !
Merci à Alice de m’avoir donné ce livre qui renferme de tels trésors de l’âme.
08:29 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, poème |  Imprimer
Imprimer
26/05/2012
L’après-guerre 1945-1950, vu par Stick caricaturiste, écrit par Jeanne de Gérin-Ricard
Voici ce que dit l’auteur de S’tick caricaturiste :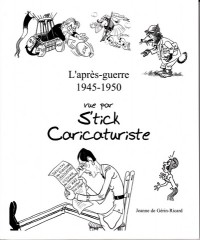
Le dictionnaire des Marseillais nous apprend que S’Tick se nommait Raoul Garcin… On peut dire qu’il était un dessinateur de grand talent. Il avait une solide connaissance de l’actualité, s’intéressant au monde dans lequel il vivait… Il avait aussi une bonne culture classique… S’Tick dessine sur des bouts de papier, à l’encre de Chine, après un dégrossi à la mine de plomb… Vivant à Marseille, il n’a probablement pas eu l’occasion d’avoir une audience méritée.
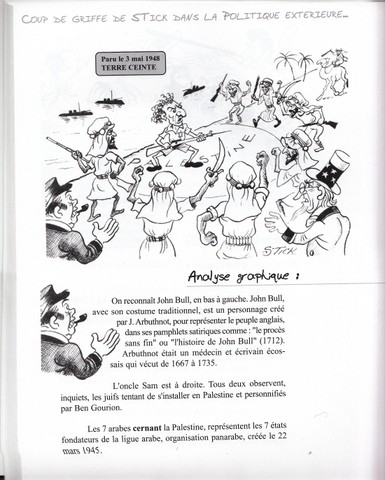
Au premier abord, le texte semble brouillon. Cela tient d’une part à la forme du livre, les titres étant en police cursive, c’est-à-dire proche de l’écriture manuscrite, et aux explications historiques qui ne sont que des résumés des événements de cette période.
Cependant, si l’on convient d’aller au-delà de cette première impression, il apparaît que le livre, alternant dessins et textes, est bien fait. Son objectif n’est pas de faire un livre d’histoire, mais de mettre en valeur les moments historiques saisis par un dessinateur de talent. Les grands personnages du moment sont caricaturés et une petite biographie accompagne l’image, donnant du relief à l’explication de l’événement. De plus, si l’on fait l’effort d’analyser de plus près l’organisation du livre, on se rend compte que chaque période de ces cinq années est découpée en un zoom sur l’histoire qui en donne les grands événements, une analyse graphique du ou des dessins de S’Tick sur le ou les évènements du moment, et enfin les biographies des personnages politiques clés. C’est, au final, une bonne approche des faits et des personnages de ces années d’après-guerre, ainsi que de l’ambiance qui régnait à cette époque : politique des prix, problèmes de ravitaillement, marché noir et scandales à répétition.
mettre en valeur les moments historiques saisis par un dessinateur de talent. Les grands personnages du moment sont caricaturés et une petite biographie accompagne l’image, donnant du relief à l’explication de l’événement. De plus, si l’on fait l’effort d’analyser de plus près l’organisation du livre, on se rend compte que chaque période de ces cinq années est découpée en un zoom sur l’histoire qui en donne les grands événements, une analyse graphique du ou des dessins de S’Tick sur le ou les évènements du moment, et enfin les biographies des personnages politiques clés. C’est, au final, une bonne approche des faits et des personnages de ces années d’après-guerre, ainsi que de l’ambiance qui régnait à cette époque : politique des prix, problèmes de ravitaillement, marché noir et scandales à répétition.
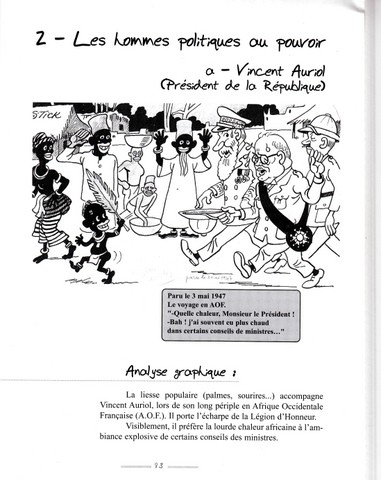
Sous des dehors assez anodins, ce petit livre met en évidence l’intelligence du dessinateur caricaturiste, sa compréhension des épisodes successifs de ces cinq années, sa truculence et son humour au service de l’histoire.
L’auteur écrit : Pour conclure, merci à mon père qui m’avait demandé d’effectuer ce travail. Nous pouvons de même lui dire merci pour l’avoir bien effectué.
06:42 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, société, dessin, écriture, littérature |  Imprimer
Imprimer
13/05/2012
Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran
Pour poursuivre sur l'Islam et y puiser de la sagesse, malgré l'ambiance actuelle, ou peut-être à cause d'elle :
Parce que son père pense qu’il lui vole de l’argent, Moïse, dit Momo, jeune juif, casse sa tirelire et décide de devenir un homme en se payant une fille, rue de Paradis, à côté de chez lui. Peu après, il fait la connaissance de Monsieur Ibrahim, épicier musulman ouvert de huit heures du matin au milieu de la nuit. Le commerçant sait celui-ci malheureux. Il lui apprend en premier lieu à sourire, sourire de tout et à tous. C’est bête, mais ça marche. Ils s’apprécient et après le départ et le suicide de son père, Momo devient le fils adoptif d’Ibrahim. Pour fêter cela, ils décident de partir dans le Croissant d’Or, en Méditerranée. Ils achètent une voiture et Momo prend le volant. Tout au long du voyage, Ibrahim l’initie à la vie, la vraie vie, celle des sentiments, de l’amour et de la spiritualité. Il lui apprend comment distinguer les riches des pauvres. « Lorsque tu veux savoir si tu es dans un endroit riche ou pauvre, tu regardes les poubelles. Si tu vois ni ordures ni poubelles, c’est très riche. Si tu vois des poubelles et pas d’ordures, c’est riche. Si tu vois des ordures à côté des poubelles, c’est ni riche ni pauvre ; c’est touristique. Si tu vois les ordures sans les poubelles, c’est pauvre. Et si les gens habitent dans les ordures, c’est très très pauvre. »
En Turquie, ils s’arrête dans un village de montagne et Ibrahim emmène Momo danser. C’est la danse des soufis. Comme le lui explique Monsieur Ibrahim, ils tournent sur eux-mêmes, ils tournent autour de leur cœur qui est le lieu de la présence de Dieu. C’est comme une prière. Essaie, Momo, essaie.
Quant aux filles, lorsque Momo demande s’il sera assez beau pour leur plaire sans payer, Monsieur Ibrahim répond :
- Dans quelques années ce seront-elles qui paieront pour toi ! »
Et il poursuit :
- Tu les fixes en ayant l’air de dire : « Vous avez vu comme je suis beau. » Alors, forcément, elles rigolent. Il faut que tu les regardes en ayant l’air de dire : « Je n’ai jamais vu plus belle que vous »… Ta beauté, c’est celle que tu trouves à la femme.
Mais Monsieur Ibrahim a un accident. Il meurt tranquillement, heureux d’avoir si bien vécu. Momo médite un poème du soufi Rumi : Ce qui n’existe pas, produis-le : c’est l’intention.
Et il tourne. Je tourne une main vers le ciel, et je tourne. Je tourne une main vers le sol, et je tourne. Le ciel tourne au-dessus de moi. La terre tourne au-dessous de moi. Je ne suis plus moi mais un de ces atomes qui tournent autour du vide qui est tout.
Le livre se termine ainsi :
Voilà, maintenant je suis Momo, celui qui tient l’épicerie de la rue Bleue, la rue Bleue qui n’est pas bleue.
Pour tout le monde, je suis l’arabe du coin.
Arabe, ça veut dire ouvert la nuit et le dimanche, dans l’épicerie.
Oui, il faut le dire, Eric-Emmanuel Schmitt est un grand romancier. Sous des dehors d’une petite littérature pour midinette, il enseigne la vie à ceux qui ne peuvent entendre le langage savant. Et ses récits sont plein d’humour, les dialogues délicats, les personnages fantasmagoriques, hauts en couleur, inhabituels malgré leur extrême manque de connaissances intellectuelles. Alors on referme le livre avec un rien de regret qu’il soit lu si vite, et l’on rouvre les pages en cherchant les plus belles, mais toutes vous font vibrer et vous enrichissent d’une pointe d’humanité et de spiritualité.
07:22 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, roman, spiritualité, islam |  Imprimer
Imprimer











