16/04/2014
Place des Vosges
Avril ! Mais… Plein été ! Heureusement l’eau coule des fontaines et ce bruissement continu rafraîchi l’atmosphère. Peu de promeneurs vont et viennent. La plupart ne sont plus passants, mais hommes (ou femmes) à l’horizontal, au ras des pâquerettes, le plus souvent deux par deux, parfois trois ou quatre.
L’herbe est encore jeune, d’un vert tendre. Devant moi, une jeune femme, les bras nus, les mains croisées derrière la nuque, le ventre à l’air, le pull remonté sur les seins. Elle se caresse l’estomac, comme si le soleil méritait une attention sur cette partie du corps. Pas un nuage. Les promeneurs passent, leur veste, voire manteau, sur le bras comme un poids mort. Un père et son jeune fils s’assoient dans l’herbe. Ils dégustent une glace comme deux jumeaux attentifs à ne pas en perdre une miette. Une jeune fille traverse la pelouse d’un pas alerte, souple, coulant. Elle glisse sur l’herbe avec aisance et une certaine nonchalance malgré l’ampleur de ses foulées. Quelle belle mécanique elle développe.
Il me semble que tous se parlent par l’intermédiaire d’un téléphone portable. La main sur l’oreille ou l’écouteur dans les ouïes, ils parlent, ils parlent, consultent, jouent. Voient-ils les autres ? Peu leur importe ; ils communiquent, sans un regard pour leurs voisins. Le jardin est un réseau miniature fermé par une cage de Faraday que forment les grilles qui l’entourent.
L’ombre se déplace, empiète sur le coin d’herbe, obligeant à une migration progressive jusqu’au moment où l’on se lève, on prend ses affaires et on fait une dizaine de pas pour se rassoir épuisé derrière l’ombre qui poursuit sa course imperturbablement.
Comme elle est belle, d’une valeur sentimentale inestimable, cette humanité nonchalante, fondue au soleil, liquéfiée comme une motte de beurre parmi l’oseille dans la poêle qui chauffe. La chaleur brouille la vue, suscitant de légers tremblements lorsqu’on regarde au loin, dans les trous noirs des arcades. Une classe d’écoliers traverse le jardin, soulevant un nuage de poussière. Tout se trouble, tout devient gris, noire, sans forme. J’erre dans l’absolu. Oui, j’ai dû rester trop longtemps au soleil…
07:15 Publié dans 14. Promenades | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : printemps, chaleur, été, société, homme, femme |  Imprimer
Imprimer
14/04/2014
La danse de la Parisienne
Certaines femmes marchent comme les hommes, engoncées dans leurs pensées, pressées de préoccupations. D’autres, les vraies parisiennes, marchent avec l’élégance d’une danse au ralenti.
Le teint frais, poudré, pas trop, la poitrine haute, elles propulsent leur corps avec chatoiement sans toutefois vouloir être remarquée. Et, bien sûr, on les remarque. On les voit de loin, se déplaçant dans la foule des promeneurs, montées sur leurs échasses, les jambes longues, le bras plié, la main presque fermée, les ongles tournés vers le ciel, le sac au creux de la jointure du coude, l’autre bras balançant au rythme des pas, légèrement tourné vers l’extérieur. Elle se sourit à elle-même, ne prêtant attention à personne, heureuse, volant sur le pavé, pas trop haut pour ne pas se faire dévisager. Elle danse imperceptiblement. Ce n’est pas une danse sautante, mais plutôt une sorte de valse en ligne droite, un ballet rectiligne qu’elle conduit seule, en douceur, avec une sûreté extraordinaire, comme l’envol d’un faisan vénéré qui sort du bois et monte dans les airs avec lenteur et magnificence. Elle passe devant vous, ne vous voit pas, absorbée par son apparence, inconsciente de l’atmosphère qu’elle délivre. Elle poursuit sa route, indifférente aux regards, poupée fragile dans la broyeuse de passants. « Roule ta caisse, ma fille, et vis ta vie ! », entendez-vous derrière vous.
avec chatoiement sans toutefois vouloir être remarquée. Et, bien sûr, on les remarque. On les voit de loin, se déplaçant dans la foule des promeneurs, montées sur leurs échasses, les jambes longues, le bras plié, la main presque fermée, les ongles tournés vers le ciel, le sac au creux de la jointure du coude, l’autre bras balançant au rythme des pas, légèrement tourné vers l’extérieur. Elle se sourit à elle-même, ne prêtant attention à personne, heureuse, volant sur le pavé, pas trop haut pour ne pas se faire dévisager. Elle danse imperceptiblement. Ce n’est pas une danse sautante, mais plutôt une sorte de valse en ligne droite, un ballet rectiligne qu’elle conduit seule, en douceur, avec une sûreté extraordinaire, comme l’envol d’un faisan vénéré qui sort du bois et monte dans les airs avec lenteur et magnificence. Elle passe devant vous, ne vous voit pas, absorbée par son apparence, inconsciente de l’atmosphère qu’elle délivre. Elle poursuit sa route, indifférente aux regards, poupée fragile dans la broyeuse de passants. « Roule ta caisse, ma fille, et vis ta vie ! », entendez-vous derrière vous.
Oui, c’est une parisienne, une vraie, réelle comme la luxueuse Mercédès qui passe lentement devant elle. Tiens ! Elles s’arrêtent l’une et l’autre, se reconnaissent, se regardent, puis s’écartent avec majesté, chacune marchant vers son destin.
 D’autres apparaissent plus sages ou plutôt moins sûres d’elles. Plus classiques, elles errent également parmi la foule, mais on ne les remarque pas. Il n’empêche. Elles sont également remarquables. Plus libres dans leurs mouvements, plus simplement décontractées, elles n’en restent pas moins aériennes, comme une libellule se promenant au-dessus de l’eau et se posant parfois auprès d’un magasin non pour se regarder dans la glace, mais pour s’occuper les yeux et les emplir de belles choses. Ces femmes-là sont cependant plus rares. Il faut quasiment être princesse pour se déplacer avec autant d’aisance, la courroie du sac entre les deux seins. Quel naturel ou quel apprentissage. Danse-t-elle ? Oui, bien sûr, un lent tango discret, presqu’invisible, en hommage à la vie, qui l’entraîne elle ne sait où, avec ferveur.
D’autres apparaissent plus sages ou plutôt moins sûres d’elles. Plus classiques, elles errent également parmi la foule, mais on ne les remarque pas. Il n’empêche. Elles sont également remarquables. Plus libres dans leurs mouvements, plus simplement décontractées, elles n’en restent pas moins aériennes, comme une libellule se promenant au-dessus de l’eau et se posant parfois auprès d’un magasin non pour se regarder dans la glace, mais pour s’occuper les yeux et les emplir de belles choses. Ces femmes-là sont cependant plus rares. Il faut quasiment être princesse pour se déplacer avec autant d’aisance, la courroie du sac entre les deux seins. Quel naturel ou quel apprentissage. Danse-t-elle ? Oui, bien sûr, un lent tango discret, presqu’invisible, en hommage à la vie, qui l’entraîne elle ne sait où, avec ferveur.
07:14 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, femme, paris |  Imprimer
Imprimer
29/03/2014
Autre peinture
Elle se tient debout, perchée sur l’échelle. Rien ne saurait la déranger. Elle manie son pinceau avec sérieux, enduisant de noirceur le portail défraichi. Il la revoie jeune fille, riante, le regardant d’un air effronté, comme disant : « Moi aussi, je peux faire ! » Elle y met tout son cœur, décidée à aller jusqu’au bout, à ne pas abandonner son pinceau à la main secouriste. Il la regarde et admire cette volonté subite, ce retour pour éblouir et danser ensuite de joie à l’idée d’un enjolivement dû à elle seule.
Elle se tient debout, perchée sur l’échelle. Ses cheveux flottent autour de sa tête. Elle écarte d’un geste de l’avant-bras ceux qui lui tombent dans les yeux. Elle vient de voir un barreau sans peinture, avance une main agile et presse les poils barbouillés sur la partie encore vierge. Elle est comme un dentiste devant une bouche ouverte. Elle glisse son instrument entre les dents du portail et lui assène sa couche de noir luisant jusqu’à l’étouffement. « Voilà, c’est fini ! »
Alors elle le regarde et il voit sa souffrance dans son corps. Perchée sur l’échelle, elle s’est donnée sans retenue. La main ankylosée, les reins vrillés, les pieds compressés par la minceur des barreaux, elle réserve encore sa fatigue pour tout à l’heure, lorsque pinceaux nettoyés, bidon de peinture rangé, échelle remisée, elle pourra enfin se laisser tomber sur une chaise et contempler son œuvre qui la comblera de bonheur.
Elle se tient assise et il est debout devant elle, attendri de sa constance et de sa joie enfantine. Elle a les larmes aux yeux, de fatigue, de satisfaction, d’amour aussi. Quel beau cadeau lui a-t-elle fait ! Il lui prend la taille et l’entraine vers la maison. Qu’il est bon de rentrer chez soi, ensemble, après l’épreuve et les preuves d’un amour toujours vivant.
07:35 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : amour, société, écriture, femme |  Imprimer
Imprimer
03/03/2014
Je te reparlerai d’amour, roman de Pascal Jardin (Julliard, 1975)
Un livre sans commencement ni fin. Des pages magnifiques et d’autres sans intérêt. On glisse dessus comme dans un rêve, laissant de côté certains passages, relisant trois fois d’autres.
Pascal Jardin est le père d’Alexandre Jardin, un auteur dont plusieurs livres sont de petites merveilles : voir Le petit sauvage (voir le 7 janvier 2013) ; Fanfan, le 29 juin 2012 ; Bille en tête, le 22 février 2013 ; Les coloriés, le 6 janvier 2014 ; Chaque femme est un roman, le 1er mai 2013 ; Le Zubial, le 3 mai 2012. Il est le fils de Jean Jardin, personnage truculent qui lui inspira La guerre à neuf ans et Le nain jaune. Il fut scénariste, dialoguiste et écrivain. Il fut aussi le héros de nombreuses pages des livres de son fils, dont Le Zubial.
sont de petites merveilles : voir Le petit sauvage (voir le 7 janvier 2013) ; Fanfan, le 29 juin 2012 ; Bille en tête, le 22 février 2013 ; Les coloriés, le 6 janvier 2014 ; Chaque femme est un roman, le 1er mai 2013 ; Le Zubial, le 3 mai 2012. Il est le fils de Jean Jardin, personnage truculent qui lui inspira La guerre à neuf ans et Le nain jaune. Il fut scénariste, dialoguiste et écrivain. Il fut aussi le héros de nombreuses pages des livres de son fils, dont Le Zubial.
Le livre commence dans un bistrot, avec le souvenir de Clara, il finit un matin de juillet lors d’un retour de Clara. Les mêmes phrases : Faut-il donc être fou pour avoir tout misé sur une simple femme, une bête qui mord autant qu’elle caresse, avec une petite tête dure comme le fer où les idées des hommes n’entreront jamais, une bête, belle comme un dieu païen, et si vulnérable avec son ventre qui saigne toujours une fois par mois.
C’est un livre circulaire, avec des dérivations, des impasses et de longs cheminements comme ces descriptions splendides de personnages extraordinaires. Ainsi Clara, nue, et Julien le mari de Clara : Ils étaient des animaux. Il n’avait plus que des corps. Encastrés l’un dans l’autre, ils fonctionnaient avec la joie dite de la première fois, et qui, tout bien pesé, ne vient qu’après longtemps, quand on a tout exploré de l’autre, qu’on est rodé, usé, poli, frotté à l’autre. L’amour fort, le contraire des premiers bafouillages, l’anti-puberté, la femme avec des hanches, la femme qui sent la femme et l’homme comme un chien. Sur elle le poids de lui, le poids de sa vie. Ils se connaissaient, ils se reconnaissaient.
Mais tout ne tourne pas autour de Clara. D’autres femmes sont le prétexte de portraits tendres et virulents. Ainsi de Frédérique : Elle avait des cheveux roux et se faisait par coquetterie un regard de myope pour mieux paraître étonnée. Dans le mode le plus fabriqué, le spectacle, elle était restée une paysanne. Les coudes sur la table, elle tartinait son pain avec des gestes bibliques. Elle ne prenait sa douche qu’en mettant de l’eau partout. Toujours elle s’habillait trop vite, et sortait dans la rue à demi boutonnée. « Il faut que j’aille », disait-elle, désireuse et pressée de courir le monde. (…) Elle avait vingt-cinq ans. Les hommes lui courraient beaucoup après. Elle courrait assez peu. C’était un petit prince. Une enfance difficile lui avait appris à survivre. Jamais elle ne se plaignait, ni du temps, ni des dents, ni de rien.
Ou encore l’Oiseau : Le nez était fin et petit, et les narines ouvertes laissaient voir en leur base une veine minuscule dont le rouge foncé tranchait avec la peau blanche de noctambule. Les yeux étaient importants, fendus en amande, très mobiles, le front bombé et haut était particulièrement masqué par une coiffure bouclée. La bouche sensuelle, aux lèvres fortes, contenait un sourire sans cesse retenu sur des dents de loup assez peu régulières, mais fort enviables. Les pommettes hautes, le cou long et les épaules carrées évoquaient les Olympiades ou quelque dieu du stade. Les mains potelées, comme chez les enfants, s’ornaient sur les ongles d’un rouge très foncé et récemment posé. Les seins accrochés haut sur le buste possédaient des points admirablement dressées. La taille d’une minceur évidente était le contrepoint à des hanches superbes, un beau passage pour une naissance. Les cuisses étaient musclées, les jambes fines et longues s’appuyaient sur des pieds un peu grands pour l’ensemble. Ils avaient cependant un attrait profond. Cambrés, ils donnaient leur assise au personnage…
A la fin du livre, la phrase du début qui se poursuit ensuite : ... Et pourtant, ceux qui voient le soleil dans les yeux d’une maîtresse, et lisent leurs blessures sur les lèvres peintes en rouge, et la houle du large dans les hanches d’une femme, ceux-là voient bien plus loin que la plupart des autres.
Alors laissez vous tenter. Vous y trouverez des pages charmantes et vous sauterez celles qui vous ennuient.
07:14 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, roman, femme, amour, société |  Imprimer
Imprimer
26/12/2013
La chute des anges, chorégraphie du Nederlands Dance Theater
http://www.youtube.com/watch?v=VFcJ0a3aBJs
Le rythme et l’association-dissociation.
Des insectes dans une boite s’auto-affolant ou des grâces prises parfois de folie ?
Le combat de fourmis dans la forêt équatoriale !
Une beauté insolite, extra-planétaire, en rupture avec l’habituelle idée de l’harmonie. Et ce rythme obsédant, percutant, épuisant qui vous envoûte.
La chute des anges : Telles des mécaniques, elles déroulent un incessant ballet que l’on ne peut prévoir, tantôt dans un ensemble parfait, tantôt en dissociation complète. C’est surprenant, insolite, d’une beauté loufoque, mais raisonnable. Un équilibre en permanente rupture.
07:04 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : danse, rythme, femme, art, musique |  Imprimer
Imprimer
17/12/2013
Le premier baiser
Et vint le jour du premier baiser.
La première sensation qu’il éprouva fut le parfum du buste de l’autre, comme un aimant qui entraînait à l’ivresse inconnue et le plongeait encore et encore dans le cou féminin, empli de senteur de fleurs, de bruissement des cheveux. Etincelles fulgurantes qui attaquaient son émerveillement pour le transformer en volcan. Le paradis à portée de main, offert dans cette apparence mouvante et délicate appelée femme.
Elle était belle, d’une beauté naissante, encore fille, presque jeune fille et sans doute déjà femme par son affirmation de soi. Elle ne s’offrait pas. Elle ne se refusait pas. Elle consentait à expérimenter ce dont ils avaient rêvé séparément, sans le dire. Tout ceci avec pudeur, n’osant regarder l’autre dans les yeux, donnant sa nuque encombrée de mèches de cheveux sauvages. Il se laissait griser par cette courbe merveilleuse, déposant des baisers furtifs sur la chair délicate et parfumée. Il ne sentait pas qu’elle faisait de même dans le creux de sa clavicule, éprouvant les mêmes sensations, la même émotion et les mêmes sentiments. Ils ne parlaient pas, n’osant exprimer ce qu’ils ressentaient, emmagasinant dans leur mémoire les perceptions, interrogeant leurs émois, construisant leur représentation de l’autre comme un géomètre dessine sa carte sur le terrain.
Jérôme découvrait la complémentarité de la vie et c’était une fête sans fin, sans bruit, comme une cérémonie sérieuse et envoûtante qui méritait toute leur attention. La féminité se dévoilait sous ses lèvres et les émanations de ce jeune buste le conduisaient dans une éternité chaude et lumineuse.
Elle se grisait de son odeur d’adolescent vif, se laissait aller dans les profondeurs de son cou, caressant ses cheveux courts, respirant lentement la peau masculine comme si elle étreignait un arbre vert. Quel embrasement stupéfiant !
07:45 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : adolescence, société, amour, femme, homme |  Imprimer
Imprimer
16/12/2013
Les Yeux Bleus Cheveux Noirs, de Marguerite Duras
 Est-ce un roman ? On ne sait. C’est au moins un livre. Les personnages : un homme, une femme. Ils n’ont pas de nom, pas d’adresse, pas de métier, pas d’état civil, presque pas de personnalité. Ils dorment la plupart du temps. Ou ils parlent de leur sommeil. Cela se passe dans une chambre presque nue : un lit, des draps, des corps… Le rêve se mélange avec la réalité. Y en a-t-il même une ? On ne sait. Si. Ils pleurent. Ils ont cette faculté unique. Ils pleurent, elle… et lui… Et leurs larmes les rapprochent inexorablement, même s’ils se refusent l’un l’autre.
Est-ce un roman ? On ne sait. C’est au moins un livre. Les personnages : un homme, une femme. Ils n’ont pas de nom, pas d’adresse, pas de métier, pas d’état civil, presque pas de personnalité. Ils dorment la plupart du temps. Ou ils parlent de leur sommeil. Cela se passe dans une chambre presque nue : un lit, des draps, des corps… Le rêve se mélange avec la réalité. Y en a-t-il même une ? On ne sait. Si. Ils pleurent. Ils ont cette faculté unique. Ils pleurent, elle… et lui… Et leurs larmes les rapprochent inexorablement, même s’ils se refusent l’un l’autre.
Il a laissé la porte ouverte. Elle dormait, il est part, il a traversé la ville, les plages, le port des yachts du côté des pierres.
Il revient au milieu de la nuit.
Elle est là, contre le mur, dressée, elle est loin de la lumière jaune, habillée pour partir. Elle pleure. Elle ne peut d’arrêter de pleurer. Elle dit : je vous ai cherché dans la ville.
Elle a eu peur. Elle a vu la mort. Elle ne veut plus venir dans la chambre.
Il va près d’elle, il attend. Il la laisse pleurer comme s’il n’était pas la cause des leurs.
Elle dit : Même de ces chagrins-là, de ces amours dont vous dites qu’ils vous tuent, vous ne savez rien. Elle dit : Savoir de vous, c’est ne rien savoir du tout. Même de vous, vous ne savez rien, même pas que vous avez sommeil ou que vous avez froid.
Il dit : C’est vrai, je ne sais rien.
Elle répète : Vous ne savez pas. Savoir comme vous, c’est sortir dans la ville et toujours croire qu’on va revenir. C’est faire des morts et oublier.
Il dit : C’est vrai pour les morts.
Il dit : Maintenant je supporte votre présence dans la chambre même quand vous criez. Ils restent là, à se taire, un long moment tandis que le jour vient, et, avec lui, le froid pénétrant. Ils se recouvrent des draps blancs.
Est-ce un roman érotique ? Non. Quelques phrases par-ci, par-là, pourraient le faire penser. Mais rien en fait ne permet de le dire. C’est le roman d’une quête inatteignable : celle de l’autre moitié de soi-même. Et il s’agit de les réconcilier. Comment ? Sans parole, presque sans geste, sans caresse, par des allées et venues hors de la chambre jusqu’au jour de la rencontre espérée, mais non avouée.
Ils sont deux acteurs d’un théâtre de l’oubli qui obéissent à un metteur en scène qui n’existe pas :
Un soir au bord de la scène, de la rivière, dirait l’acteur, elle dirait : il pourrait se produire comme un changement de l’équipe des acteurs (…)
Eux, ils viendraient jusqu’à elle, jusqu’à son corps couché dans les draps, comme il est maintenant, avec le visage caché sous la soie noire. Et elle, elle l’aurait perdu, elle ne le reconnaîtrait plus dans ces nouveaux acteurs et en serait désespérée. Elle dirait : Vous êtes très près d’une idée générale de l’homme, c’est pourquoi vous êtes inoubliable, c’est pourquoi vous me faites pleurer.
Ils se vouvoient. Ils s’allongent l’un contre l’autre, sans se toucher. Ils se parlent ou se taisaient. Ils sont recouverts du drap ou découverts de leurs rêves.
C’est beau, mais on ne sait pourquoi.
07:15 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, livre, femme, homme, société |  Imprimer
Imprimer
06/12/2013
Félix Vallotton, trois aspects parmi d’autres
Vallotton, un peintre oublié, un très grand peintre, réanimé par cette exposition. Allons droit au but. Voici le plus beau tableau de l’exposition : Derniers rayons, peint en 1911. Ce n’est bien sûr que mon opinion, mais je la maintiens. Une luminosité exceptionnelle du ciel, un dessin qui transforme les branches en bras de femmes élevés vers la pureté, une robe de feuillages qui recouvre chastement ces membres nus, des troncs poilus comme une jambe masculine, ce rouge splendide du départ des branches comme un feu de joie qui semble danser sous la frondaison. Le symbole de la beauté pudique, de l’enchantement de l’univers, du mystère impalpable de la création. On sent vibrer l’âme même du peintre, sa réalisation par cette fusion entre lui-même et son motif. Si je devais garder un seul tableau de lui, c’est celui-ci qui me permettrait de conserver l’unique que le peintre représente.

Mais revenons à l’expo du Grand Palais. Une très charmante présentation réaliste et romantique de celle-ci. Elle est originale et dépeint bien l’ambiguïté de sa peinture :
http://www.grandpalais.fr/fr/article/felix-vallotton-la-bande-annonce
Ses objectifs ne sont pas la séduction par la beauté. Ils sont variés. Il peut être charmeur, classique, attiré par les femmes, enchanteur de la nature, voyeur, voire pervers. Il a toutes les qualités qui enchantent par leurs aspirations et tous les défauts qui déplaisent parce que trop proches de nous-mêmes. Cest en cela qu’il est un grand peintre.

Trois présentations de cette personnalité multiple permettent de saisir cette ouverture exceptionnelle au monde qu’il apporte au spectateur :
Le regard érotique de Vallotton :

L’inconscient de Vallotton :

Le dessin, la peinture elle-même ne sont pas beaux. Le visage de l’homme laisse à désirer. Mais tout dans ce tableau traduit l’ambiguïté du mensonge. Tout est rouge, dont bien sûr la femme qui murmure quelque chose à l’oreille de l’homme. Celui-ci semble ressentir ce mensonge, il sait qu’elle ment. Mais il l’accepte au nom de ces instants de fièvre et d’intimité. Il en est aigri. Mais malgré son blindage noir devant ce mensonge rouge il se ment à lui-même et entre en osmose avec sa compagne. Qui ment au final : le rouge féminin ou le noir masculin ?
Les paysages de Vallotton :

Oui, il s’agit bien pour lui de poser un regard nouveau, comme celui de la mouette sur le paysage des Andelys. Le vol d’une mouette et l’envol de l’âme derrière le réalisme de la peinture.

07:31 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, dessin, nabis, femme, société |  Imprimer
Imprimer
26/11/2013
La lune, dansée par Yang LiPing
http://www.youtube.com/watch?v=ZkLrFpo0lHA
Elle se dévoile comme un diamant dans cette lune qui apparaît quartier par quartier. Elle semble s’envoler sur ses petites ailes, comme un moulin dont on aurait rogné les pales.
Elle devient l’eau ondulante, la femme grecque des vases funéraires, Shiva aux mille bras, la danseuse de flamenco, la statue prise de tremblements, le feu et ses flammes, le ying et le yang. Elle endort les perceptions, elle crée le brouillard dans la nuit, elle trouble la vue de ses tressaillements. Elle vit et cette vie est la vie, mystérieuse, envoûtante, donnant un aperçu de toutes ses facettes.
C’est la lune, l’envers de la lumière et pourtant lumineuse. On la distingue, mais lointaine, passant à travers les nuages, inatteignable et pourtant si proche. Une belle facétie de l’astre légendaire.
07:14 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : danse, femme, mystère |  Imprimer
Imprimer
15/11/2013
Homme et femme
La mort est la seule façon pour un homme d’être beau. La splendeur des femmes est à chaque seconde dans l’affirmation de la vie, prometteuse, orgueilleuse, superbe. Celle des hommes ne peut être que dans l’ultime seconde, qui se voit clairement sur le visage de certains.
(Pascal Jardin, Je te reparlerai d’amour, Julliard, 1975)
Sous des apparences légères, Pascal Jardin nous livre une vérité humaine qui tient à la nature de l’homme et de la femme.
La nature féminine se caractérise par l’ouverture. La femme a besoin d’être admirée, aimée. Elle s’épanouit dans l’admiration et le don de soi. Ce don affirme sans cesse la nature glorieuse de la vie, sa beauté, sa magnificence. La femme est procréation. Elle laisse agir en elle les forces de la nature et s’épanouit dans cette mécanique céleste.
La nature masculine est profondément différente. Elle est tension vers. Et c’est dans cette tension que l’homme se réalise. L’homme est acte et cet acte l’accomplit. L’homme est créateur et cette création lui donne sens. Sans création, sa vie n’a pas de sens.
Cependant, la véritable réalisation de soi pour les deux natures humaines s’accomplit par l’assimilation de la nature de l’autre. C’est dans cette symbiose que chacun se trouve. Alors, la beauté transparaît : naturelle pour la femme, conquise pour l’homme.
07:26 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, philosophie, femme, culture, réalisation |  Imprimer
Imprimer
26/08/2013
Musica vini
 L’entrée est longue et noble, loin de toute habitation. On prend le bateau de l’errance et c’est le départ pour une aventure unique. Rien dans les mains, rien dans les poches, presque rien dans la tête. Et défilent les champs et les arbres jusqu’à l’arrivée. L’atmosphère y est différente. Tout est tamisé : le regard erre de l’eau, de l’herbe, du ciel et des pierres aux sensations les plus insolites, la couleur des robes, le sourire des enfants, les plaisanteries des hommes, la vie qui passe, qui demeure et qui persiste.
L’entrée est longue et noble, loin de toute habitation. On prend le bateau de l’errance et c’est le départ pour une aventure unique. Rien dans les mains, rien dans les poches, presque rien dans la tête. Et défilent les champs et les arbres jusqu’à l’arrivée. L’atmosphère y est différente. Tout est tamisé : le regard erre de l’eau, de l’herbe, du ciel et des pierres aux sensations les plus insolites, la couleur des robes, le sourire des enfants, les plaisanteries des hommes, la vie qui passe, qui demeure et qui persiste.

Musique ! Mais aussi le vin liquoreux (presque, mais pas tout à fait), ample, d’or transparent, aux reflets onctueux, à garder de la main dans son contenant au doux chatoiement. Admire sa toison telle le velours d’un chat. Elle te caresse la joue et danse pour toi avec une tranquille assurance : danse lente et majestueuse, ornée de broderies, du clavecin ouvert devant les yeux clairs de l’assemblée. Le son est étouffé. Il se fraye un passage parmi les cris des oiseaux, les craquements du bois, le raclement des chaises, la plainte d’un enfant. Les notes s’égrainent, une par une, deux par deux, puis trois contre deux, jusqu’à trois contre trois. Un violon entame la mélodie, courbe, ensorcelante, délurée, mais reposante, parfumée, au goût de miel et de myrrhe. Et danse devant tes yeux les bras dorés des femmes ensorceleuses et des enfants endiablés. Tu te laisses aller. L’arôme du vin active tes sens. Ils s’échauffent en toi comme l’eau du ruisseau sort de son lit. L’enivrante boisson te prend à la gorge, gouleyante, primesautière, insidieuse et, comme la fumée de l’innocence, te vole la primeur de la rationalité. Pourquoi chercher, te questionner, encombrer ta machine à penser ?
Laisse errer ton corps : écoute l’odeur ineffable des pas sur les feuilles, goûte l’ombre de la valse lente décrite par les notes caillouteuses de la guitare, vois le toucher rugueux du vin de Cristal qui palpite dans ton cerveau et l’enchante de mille sons et senteurs subtiles. Tu souris enfin, sans arrière-pensée. Le vide céleste t’envahit, ton regard ne se pose plus sur les faits, mais sur l’étincelle d’un sourire, la caresse d’une main, l’éclat d’une chevelure vibrante, la courbe d’une épaule dénudée. Alliance magique de l’ouïe et du goût, mais aussi de l’odorat, du toucher des cordes par l’archet et de la vue dansante d’une après-midi enchanteresse sous le soleil tardif, mais réel.
Le soir, retour aux réalités de la normalité, tu entrevois ce songe béat : l’archet du vent caresse les grappes de la félicité et emplit l’air de senteurs boisées qui te font tourner la tête. Folie de l’imagination (et de la boisson).
Merci à tous les organisateurs de cette après-midi. Un rayon de soleil sur une planche à repasser qui danse la gigue !
Et si vous avez l’esprit curieux (de quoi parle-t-il ?), entrez par la porte virtuelle dans la magie de cet événement :
06:38 Publié dans 12. Trouvailles diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : université d'été, musique, chanson, écriture, femme, vacances |  Imprimer
Imprimer
07/08/2013
La magie d'un instant
Ce matin, elle est descendue à la cuisine comme tous les jours. Après avoir allumé, elle mit la hauteur d’eau nécessaire dans le réservoir de la cafetière, retira l’ancien filtre, en inséra un nouveau et versa dedans ce qu’elle estimait être la bonne proportion pour obtenir un café ni trop fort, ni eau de vaisselle. Elle n’utilisait pas de doseur, estimant qu’elle devait seule en face de la machine à café prendre ses responsabilité en ce qui concernait le dosage. Elle s’assit, ouvrit son livre du moment et se plongea dans un autre monde déconnecté des tracas quotidiens comme des indigences du corps. Pendant ce temps, l’eau, réchauffée par les résistances, s’infiltrait dans le café en poudre bien tassé dans le filtre, le faisait gonfler, puis suintait en quelques gouttes dorées au-delà du papier blanc, et passait dans l’étroit goulet permettant à chaque goutte de la précieuse liqueur de tomber en gerbe au fond de la carafe. Progressivement, celle-ci se remplissait d’abord en étincelles giclant sur l’intérieur de la carafe, puis, dès l’instant où la surface du fond fut recouverte d’une couche de liquide d’une dorure rougeâtre, tendant vers le brun, en cercles concentriques s’écartant du centre pour se perdre sur le rivage de l’enveloppe et revenir amoindri à la rencontre d’un autre cercle émis par les jets de liquide venant du haut.
Ça y est, le café est prêt ! Elle avait sous les yeux ce breuvage délicat, non plus doré, mais presque noir, qui avait des reflets plus clairs si on sortait la carafe de son logement. En tendant le bras et ouvrant la main pour saisir la poignée, elle vit un éclair de l’œil droit, une sorte de feu interne, rouge comme une pivoine, qui ne dura qu’un très bref instant. Il venait de la fenêtre derrière la cafetière.
– Un reflet dans la vitre, c’est tout, pensa-t-elle.
Elle tendit à nouveau la main vers l’anse et cette fois-ci perçut un reflet bleu nuit, comme un scintillement dans la pâleur de la nuit qui devint vert. Curieuse et étonnée, elle se pencha vers ce feu tonifiant qui semblait la narguer. C’était maintenant un petit point rouge vif, incroyablement lumineux, comme une virgule suspendue dans l’air, avertissement d’une journée différente, comme un signe de bonheur ouvert sur le monde. Le jour était là, mais la lueur continuait son embrasement, resplendissante. Elle bougea un peu la tête, montant le menton de quelques millimètres et la flamme s’allongea, prenant des teintes successivement de rouge, jaune, vert et bleu. C’était un ruban qui s’étirait, n’émettant qu’une seule couleur, mais qui se transformait au fil du déplacement de la tête. Voulant en avoir le cœur net, elle se pencha vers la fenêtre, cherchant quel était cet éclat qui se propageait sur la vitre. Elle comprit que ce n’était pas celle-ci qui émettait le reflet. Au-delà, sur l’évier de pierre, se trouvait un petit panier contenant divers objets, dont un disque d’ordinateur de couleur acier qui créait la lueur fascinante. L’ampoule électrique du plafond se reflétait sur le disque, créant une réfraction et dispersant chaque couleur l’une après l’autre et non ensemble comme pour l’arc-en-ciel habituel. Bougeant précautionneusement la tête, elle ne se lassait pas de faire surgir d’abord un rouge brillant, chaleureux, chaud comme un incendie, puis un orange lumineux, ensoleillant, puis un jaune paille étincelant, à lécher, puis un vert plus pâlot, émeraude pure, enfin un bleu nuit éblouissant, pur, qui s’éteignait en améthyste sombre. Quelle merveille que ce reflet unique qui se contorsionnait sous ses yeux, prenant sur la largeur du disque un spectre irréel qui lui chatouillait l’œil et entrait dans son cerveau en feu follet. Pas d’autre pensée. Pas la moindre distraction. Le feu sacré de la lumière décomposée pour elle, ce matin. Surprise d’un jour nouveau, la main sur la cafetière, le regard fixé, qui rendait son corps transparent. Elle devenait l’esprit du feu. Elle était la lumière pure, franche, vivante en elle-même, irradiant sur le monde sa nouvelle virginité.
Quel instant ! Elle dut se forcer à se détacher, à remplir sa tasse de café, à y mettre une goutte de lait qui s’élargissait en nuage dans le liquide noir et lui donnait une teinte plus claire, virant à l’ocre. Elle but le breuvage chaud comme à une source vive, pensant intérieurement à un bain nettoyant son être intérieur pour lui donner l’aspect d’une glace réfléchissante sans l’ombre d’une poussière. Après avoir bu, elle quitta sa place, abandonnant le reflet magique et alla éteindre la lumière, mettant fin à un moment d’éternité.
08:21 Publié dans 12. Trouvailles diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : éternité, réfraction, lumière, enchantement, femme |  Imprimer
Imprimer
26/07/2013
Les hérons
Ce matin, courant près du canal Saint Martin, je tombai en arrêt face à une devanture dans laquelle les mannequins étaient semblables à des hérons. Leurs pattes étaient tellement fines qu’ils semblaient sortir de l’eau, l’air sérieux, une main en l’air, la taille étroite, la cuisse moulée, le mollet gainé. Telle est la mode. Il faut un chausse-pied pour enfiler ce pantalon de toile non élastique qui est une double peau. Aussi fais-je maintenant attention au profil des jeunes hérons qui se promènent dans la rue. Ne pas les bousculer, le pantalon risque de craquer sous la pression psychique et même physique d’un effort inconsidéré.
Le terme héron est un terme générique désignant de nombreuses espèces d'oiseaux appartenant à différents genres d’une même famille. Il y a des Hérons Cendrés, très courants, habillés de gris foncé, mal engoncés dans leur costume de commercial. Il y a de Grands Hérons, espèce moins fréquente, mais en augmentation. Ils croissent en taille et en nombre. Il y a également des Hérons Coiffés, de panama de préférence. On trouve aussi des Hérons Impériaux, la tête haute, le corps stylisé, se tenant sur une patte, étroite bien sûr, élégamment vêtus d’un pantalon rouge débordant largement sur des chaussures bateau aux lacets roses, mais toujours serré sur le mollet.
Le héron est toujours du sexe masculin avec ses petits héronneaux. Il n’y a pas de héronne. C’est normal. Elle porte le même pantalon étroit et fume les mêmes cigarettes. Seule différenciation : le sac pendule, plein à craquer de trésors cachés dans lequel il convient de fouiller longuement avant de trouver l’objet désiré, un téléphone, qui s’arrête de sonner lorsqu’on met la main dessus. Son aigrette a du charme et lui donne l’œil égrillard. La cendre qu’elle revêt est plus lumineuse. Elle marche souvent en héronnière, devisant avec ses compagnes, voire même quelques hérons. Elle marche sur la pointe des pieds disposant d’un ergot spécifique lui permettant de montrer un mollet avantageux aux hérons. Parfois, et souvent même, elle s’arrête, prise d’une inspiration, et se repose sur une jambe étirée, l’autre paisiblement croisée pour mettre en évidence le galbe de son avant-jambe. Et si le héron lui plaît elle bat des ailes comme pour s’envoler. Elle se soulève de quelques centimètres, en lévitation, avant de redescendre près des jambières du mâle choisi. On ne sait plus alors quelle patte appartient à qui.
C’est une mode bien plaisante. Elle met de la couleur à défaut d’épaisseur : rouge, nous l’avons dit, mais également jaune canari, vert pistache, bleu azur, orange et autres ravissements de mélange bizarre. Mais cela sera rangé à la fin de l’été, lorsque les hérons redeviendront de simples citoyens vêtus bien sûr de noir, y compris la chemise. Employés des pompes funèbres sont-ils ?
07:19 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mode, société, animaux, femme |  Imprimer
Imprimer
14/05/2013
L’étudiant étranger, roman de Philippe Labro
Mais pourquoi ai-je éprouvé le besoin de commencer par Buck Kuschnik ? se demande Philippe Labro au début de ce roman autobiographique. Qu’est-ce que ça voulait dire, ce corps de dix-huit ans, vêtu seulement d’un long p antalon de pyjama à rayures classiques, les chevilles attachés aux barres de métal des deux extrémités du lit de sa chambre dans le freshmen dorm, aile ouest du dortoir, rez-de-chaussée, à droite quand on entrait dans la cour ?
antalon de pyjama à rayures classiques, les chevilles attachés aux barres de métal des deux extrémités du lit de sa chambre dans le freshmen dorm, aile ouest du dortoir, rez-de-chaussée, à droite quand on entrait dans la cour ?
Français, il découvre, grâce à une bourse, un collège américain très classique en même temps qu’il fait, adolescent, l'expérience de la vie. C’est un tourbillon d’incertitudes, d’affirmations de soi, d’épreuves nouvelles, d’apprentissage des « date ». C’est un verbe, c’est aussi un mot, ça veut dire un rendez-vous avec une fille, mais ça désigne la fille elle-même ; je vais boire un verre avec une date. Une fille vous accorde une date et elle devient votre date régulière si vous sortez plus d’une fois avec elle. (…) C’est un rite, et je me suis aperçu ici, sans le formuler de façon aussi claire, que tout est rite, tout est cérémonie, signe, étape d’un immense apprentissage. Il y a un Jeu et des jeux à l’intérieur de ce grand Jeu de la vie américaine et tout mon être aspire à les jouer.
Invité à Noël chez un ami américain, il fait connaissance avec une noire, April : Les Américains ont du mal à regarder une Noire en face, surtout si elle est belle, vous n’avez pas remarqué cela ? Il se découvre sensuel. L’enfant ne redonnait pas tout simplement aux sens le rôle qui leur avait été partiellement confisqué, et se libérait donc et se délivrait et se révélait avec toute la violence d’une seconde venue au monde. Il fait l’amour avec elle, dans sa voiture. Elle avait ôté le pantalon de son survêtement, m’offrant la peau brune et velours de ses jambes et ce qu’elle m’avait offert m’avait paru plus beau que ce dont j’avais pu rêver.
Il tombe amoureux d’Elisabeth, d’abord entrevue dans toute sa splendeur attirante d’une héritière de Boston, puis découverte au travers de ses humeurs fantasques. Les conseils de Vieux Zach, doyen de son collège, le détourneront de cette merveille. Vieux Zach est dur, mais il lui enseigne que les choses n’arrivent pas comme ça, simplement parce qu’on les énonce. Agir ! L’Amérique lui avait enseigné qu’il est naturel et facile d’agir, alors que le continent d’où il était arrivé, lourd d’une éducation ancienne, privilégiait l’acte de compréhension. Et il avait appris ceci : que la compréhension et l’action ne doivent pas être posés comme irréductibles l’un à l’autre.
Un livre initiatique. Il met en évidence les joies, les difficultés, les erreurs et le bonheur d’être adolescent. Ce fut bien un passage rituel de l’enfance à l’âge adulte, période aléatoire où la personne se construit, heureusement protégée par un entourage attentif.
07:41 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, société, femme |  Imprimer
Imprimer
07/05/2013
Le marché aux puces de Saint Ouen
Les puciers de Saint Ouen accueillent les chineurs dans de bien étranges demeures. Certains stands font moins de deux mètres carrés. L’homme y tenait debout, mais ne pouvait bouger qu’en sortant sur le trottoir. On peut presque se perdre dans ces marchés multiples. En 1920, Robert Vernaison, concessionnaire de droit de stationnement aux Halles de Paris, puis loueur de chaises des jardins publics parisiens, et propriétaire d’un terrain à Saint-Ouen, installe des baraques en bois préfabriquées sur ce morceau de zone appelé lieu dit "les 26 arpents". Devenu le marché Vernaison, il reste l’empreinte et l’enseigne de la chine de Paris et est le plus attrayant.
Un stand au coin d’une de ses minuscules rues. Il est fermé. C’est normal. Il est habité de squelettes. Le stand est propre cependant et ses locataires sont bien tenus, même s’ils datent d’un siècle écoulé. Ils surgissent de ce décor maladroit et font la fête avec entrain. Regardez ce couple élégant qui tourne avec aisance et dignité. N’est-il pas racé ?
Et cette femme au regard d’acier qui vous appelle : « Venez dans mon monde, entrez dans la boutique, participez à notre fête ! » Vêtue de plumes, elle rit de toutes ses dents en attirant le client.
Et si vous vous laissez tenter, vous vous retrouvez exposé en habit à la curiosité des passants qui admirent votre solennité. Alors vous buvez un verre de cognac pour vous consoler de ne pouvoir bouger. La cigarette reste autorisée dans ce lieu d’avant la loi anti-tabac.
Attention. la boutique est gardée par une femme de tête, chauve et tenace, qui vous barre le chemin. Cela vaut peut-être mieux !
Quel séjour ! Heureusement, je croise quelques mètres plus loin des moines bouddhistes qui marchent en procession, graves, portant la lumière du monde. Ils viennent de loin et de deux monastères différents. Merci, petits frères, d’accompagner au royaume des morts le vivant que je suis !
07:02 Publié dans 12. Trouvailles diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, femme, culture, chine |  Imprimer
Imprimer
01/05/2013
Chaque femme est un roman, roman d’Alexandre Jardin
Extrait du prologue :
Parfois, il me semble que les femmes sont des tremplins vers le fabuleux. Ecrivaines pour la plupart non pratiquantes, elles produisent de la prose intérieure destinée à tromper leurs déceptions et à soigner leurs rêves. Changent-elles de métier, d'amant ou d'opinion ? C'est d'abord une césure, un rebond de style, un chapitre qui se tourne. Adressent-elles une œillade à un passant ? C'est un best-seller qui débute. Depuis mon plus jeune âge, je sais que chaque femme est un roman. Voici en quelque sorte mes études littéraires, blondes et brunes.
Alexandre Jardin se penche sur les femmes par l’intermédiaire de scénettes croustillantes d’imagination et de verve. Chacune d’elle se termine par une sorte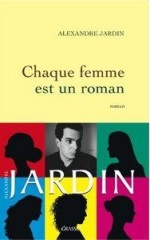 de leçon de chose. Ainsi une erreur sur la personne (féminine bien sûr) fait conclure : Je dois à cette voisine du dessous, avide de cajoleries plurielles, de m’avoir fait sentir combien je suis l’auteur de mes sentiments. Aimons-nous des êtres réels ou l’opinion que nous faisons d’eux ? Ou encore : Alexandre, sommes-nous ce que nous paraissons ? Poser la question, c’était y répondre. Eperonnée d’un vif appétit de vérité, elle aspirait alors, je le suppose, à plus d’authenticité et à redescendre des sommets où je l’avais placée. Miner la perfection, ça use. Notre histoire, asphyxiée de pétrarquisme, ne pouvait plus durer.
de leçon de chose. Ainsi une erreur sur la personne (féminine bien sûr) fait conclure : Je dois à cette voisine du dessous, avide de cajoleries plurielles, de m’avoir fait sentir combien je suis l’auteur de mes sentiments. Aimons-nous des êtres réels ou l’opinion que nous faisons d’eux ? Ou encore : Alexandre, sommes-nous ce que nous paraissons ? Poser la question, c’était y répondre. Eperonnée d’un vif appétit de vérité, elle aspirait alors, je le suppose, à plus d’authenticité et à redescendre des sommets où je l’avais placée. Miner la perfection, ça use. Notre histoire, asphyxiée de pétrarquisme, ne pouvait plus durer.
Les croquis de personnages insolites sont drôles et acidulés. Il décrit ainsi son producteur : J’aime qu’en lui se combattent mille singularités incompatibles et je raffole de l’obstination qu’il met à paraître ce qu’il n’est pas. Romanesque à l’excès, cet animal hors-série s’affiche raisonnable. Suraffectif, il se présente volontiers froid ou blasé en public. Doté d’une curiosité omnidirectionnelle, il raille volontiers les éparpillés et s’il s’installe dans le brillant de l’actualité je l’ai toujours vu passer très au large des modes. Pourquoi pavoise-t-il dans les atours de la réussite alors qu’il n’est qu’aventure ?
Alexandre Jardin campe chaque personnage dans des situations baroques. C’est ainsi qu’il va séjourner dans un hôtel où il est interdit de parler. Et il en tire une conclusion saugrenue : Pendant onze jours, allégé de tout babil, j’ai pu observer qu’on favorise mieux la communication en l’interdisant qu’en la prônant ; car s’obliger à ne pas parler n’a que peu de choses à voir avec le vide. Et encore moins avec le dessèchement de l’indifférence. Vidangé de son trop-plein de mots, le monde devient alors transparent. Comme si la parole empêchait les dialogues de grande amplitude. Jamais je n’ai eu autant le sentiment d’échanger avec celle que j’aime. Dans le vacarme de notre mutisme, au bord du grand soupir de l’océan, chaque regard de Liberté (sa femme) se mit à compter. Tout gémissement avait valeur de discours incandescent. Le moindre devenait colossal. C’est là-bas, épargné par la dérobade du langage, dans cet ermitage des tempêtes tropicales, que j’ai appris ma femme. En la dessinant bouche cousue, je l’ai mieux sue.
Les hommes ont toujours à apprendre des femmes. De plus, ils aiment se laisser surprendre pour se retrouver dans l’inconnu imprévisible, l’univers féminin. Madame Equal, professeur de maths, a adopté un système éducatif radical, elle vire les bons élèves. La semaine suivante, je savais mes cours par cœur avant d’entrer en classe : pour pouvoir sortir au plus vite et jouer au foot avec vacarme. Et nous fîmes tous de même, nous les « virés » afin de ne pas moisir parmi les « inclus » condamnés à végéter devant un pupitre. Mme Equal est la seule prof de maths qui ait jamais su me motiver indirectement, comme si elle avait compris que le plus court chemin entre deux points reste le zigzag. (..) Mais à la fin de l’année, c’est elle qui fut virée !
Alexandre Jardin ne manque pas d’imagination et d’observation. En observant les femmes, il se construit lui-même. La plupart d’entre nous ne tirent que peu de conclusions à nos habitudes de penser. Lui, d’un coup d’œil, croque le comportement féminin et lui rend sa puissance imaginative. Alors le regard sur les femmes change l’homme et ouvre en lui la porte de l’amour. Peut-être sommes-nous essoufflés dans la dernière partie du livre. Trop, c’est trop ! La verve devient lassante. Il termine sur un pied de nez : A ma montre, celle de papa, il est exactement huit heures vingt du matin à l’instant où je tape ces mots ; l’heure où j’ai aperçu Liberté pour la première fois il y a sept ans, d’un coup d’œil dilaté. Parviendrai-je à épouser cette femme qui, déjà, m’apprend à mourir en dansant sur les tables ? Elle sait si bien me mettre en demeure de rencontrer l’inattendu ; à son bras, je consens à vieillir.
07:23 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, femme, récit |  Imprimer
Imprimer
27/04/2013
Lorsque j’étais une œuvre d’art, roman d’Eric-Emmanuel Schmitt
Tazio non seulement a raté sa vie, mais rate également ses  suicides. Il est laid et inintelligent au contraire de ses deux frères, les plus beaux hommes du monde. Il trouve enfin le lieu idéal pour en finir, la falaise de Palomba Sol. Au moment où il va prendre son appel, une voix lui demande vingt-quatre heures. L’artiste Zeus-Peter Lama lui propose de changer de vie en lui abandonnant sa volonté pour qu’il devienne une sculpture vivante dénommé Adam bis.
suicides. Il est laid et inintelligent au contraire de ses deux frères, les plus beaux hommes du monde. Il trouve enfin le lieu idéal pour en finir, la falaise de Palomba Sol. Au moment où il va prendre son appel, une voix lui demande vingt-quatre heures. L’artiste Zeus-Peter Lama lui propose de changer de vie en lui abandonnant sa volonté pour qu’il devienne une sculpture vivante dénommé Adam bis.
Zeus-Peter est un artiste contemporain très médiatique, qui manipule les gens et dispose d’une grande autorité. Opéré, Adam devient une sculpture que tous s’arrachent.
– Suis-je beau demande-t-il à Zeus-Peter.
– Je t’ai créé pour embellir le monde.
– Suis-je beau ? Cesse ces banalités.
– Je n’ai pas voulu que tu sois beau, je t’en avais prévenu, j’ai voulu que tu sois unique, bizarre, singulier, différent ! Quelle réussite grisante.
Tazio a interdiction de se regarder dans une glace et de parler. Il se soumet. Tous veulent le voir et particulièrement les femmes, car l’artiste a transformé son sexe en sonomégaphore, la plus réussie des métaphores, prototype unique. Mélinda s’essaye, le démaillote et s’exclame :
– Incroyable !
Elle s’approcha, le contempla et le manipula avec légèreté.
– Une idée de génie !
Ses paupières et sa bouche en restèrent grandes ouvertes. (…)
Au troisième moment de repos, alors que nous reprenions notre souffle en fixant le plafond, Mélinda bondit à califourchon sur moi pour recommencer.
– Ah non, ça suffit ! Je n’en peux plus !
Les mots avaient jailli de ma bouche sans que je m’en rendre compte. (…) Elle me regarda avec effroi et poussa un cri de bête.
– Qui a-t-il Mélinda ?
Elle courut au fond de la pièce et se réfugia derrière un fauteuil, épouvantée. (…)
– Tu parles ?
– Naturellement je parle.
– C’est horrible. Je ne le savais pas.
Il se met à boire. Il fuit Zeus et se retrouve sur la plage et voit un groupe de silhouettes. Devant lui, un homme et une femme. Lui, assis. Elle debout. Ils regardaient le monde – ciel, mer, nuages, oiseaux – à travers la fenêtre du tableau. Inconscients de constituer eux-mêmes un tableau par la noblesse de leur attitude, attentifs, immobiles, elle se tenant derrière lui en appuyant ses mains sur ses épaules, ils fixaient le carré de toile dans lequel l’univers tout entier accourait pour se figer et s’organiser. Ils semblaient attendre devant le cadre que le tableau se fît.
Et cette rencontre va transformer Tazio. Zeus le vendra comme une œuvre d’art, de nombreux péripéties lui arriveront, mais tout se joue à cet instant, la rencontre d’un homme avec la beauté naturelle et la beauté artistique, si loin des beautés artificielles des femmes et de l’art médiatique de Zeus : Sa carrière ; il ne la fait pas dans son atelier, il la fait dans les médias ; ses pigments, ce sont les journalistes, et là, il est, sinon un grand artiste, un grand manipulateur. Avec cette sculpture, sa dernière, il se poursuit et en même temps il se dépasse, il franchit une frontière, il s’installe dans le terrorisme, il devient criminel.
Histoire de Faust qui conclut un pacte avec Méphistophélès, inspirée à l’auteur par un homme qui se faisait opérer sans cesse pour devenir plus beau. Histoire drôle, inquiétante et malgré tout romantique grâce à Fiona, la femme rencontrée sur la plage.
07:47 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, art, média, femme |  Imprimer
Imprimer
25/04/2013
Papier et parfum
Une fois encore, le jardin du Palais royal et ses galeries s’efforcent de relancer l’attention des passants par d’extravagantes présentations. Malgré la beauté et l’élégance de son péristyle, il n’offre que peu de promeneurs à ses boutiques. Seuls les clients fortunés ou curieux ouvrent la porte de celles-ci pour découvrir divers objets attrayants ou fanés.
Admirons aujourd’hui ce parfumeur qui a trouvé le moyen d’attirer l’œil avec des décors insolites et gracieux. Peu de moyens, de l’imagination à revendre, des éclairages tamisés, qui conduisent le spectateur dans un monde féérique.
La première devanture, de boules et de papier journal, vous introduit dans la peau d’une princesse inca. Pourquoi inca ? Me demanderez-vous. Ah, je me souviens, elle me rappelle la sculpture bouchant l’entrée d’une galerie dans Le temple du soleil, une des aventures de Tintin. Ce regard fixe et inquiétant de la princesse aide à mieux sentir les délices olfactifs de son parfum.
La seconde devanture rappelle les corridas espagnoles et les señoritas qui cachent leur visage à l’ombre des plis de leur éventail. La chaleur aidant, ceux-ci vous voilent la réalité jusqu’à ne vous montrer que des frémissements de plis et de ronds. Le parfum aidant, vous succombez à leurs charmes.
La troisième, que l’on pourrait intituler « l’information », est bien aussi une charmante. Mais elle est enfouie dans la profusion médiatique et ne respire que l’encre et le papier. Elle n’a pas droit au parfum qui pourtant se sert d’elle pour se vendre.
Enfin la dernière ouverture sur ce magasin magique est cubiste tout en restant informationnelle. Mourir enfouie sous les paquets-cadeaux, quelle belle fin, n’est-ce pas ?
06:48 Publié dans 12. Trouvailles diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : magasin, décoration, parfum, femme |  Imprimer
Imprimer
22/02/2013
Bille en tête, roman d’Alexandre Jardin
Chaque famille a son vilain petit canard. A la maison, ce rôle me revenait de droit. J’y voyais une distinction. En contrepartie de cet avantage, je fus expédié à Evreux en pension. Evreux, ville où l’on est sûr de n’avoir aucun destin. Véritable banlieue de l’histoire, les réussites y sont lentes. La province a toujours fait de l’ombre aux ambitieux.
Décidé à lutter contre la tyrannie de son père, Virgile, le narrateur, ne demande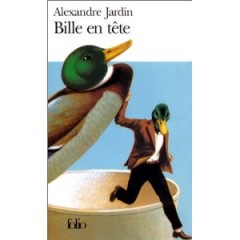 pas la permission de grandir. Il se sacre adulte lui-même. Son premier essai est malheureux : fuir la pension en prenant le train pour Paris avec un camarade et se retrouver au commissariat. Heureusement, l’Arquebuse, grand-mère et personnage de poids, vient l’en délivrer.
pas la permission de grandir. Il se sacre adulte lui-même. Son premier essai est malheureux : fuir la pension en prenant le train pour Paris avec un camarade et se retrouver au commissariat. Heureusement, l’Arquebuse, grand-mère et personnage de poids, vient l’en délivrer.
Il fait connaissance avec Clara, une femme mariée, lors d’un diner auquel son père l’emmène. Il ose lui dire : « Clara, j’ai quelque chose à vous demander. A table, je voudrais être assis à votre droite, pas à la table des enfants. » Puis il lui donne rendez-vous à la sortie de son collège. Et elle y est : « Clara s’est avancé vers moi. Elle m’a regardé. Je lui ai pris la main. Nous étions seuls. Les oiseaux chantaient pour nous. Le soleil aussi brillait pour nous. Dieu qu’elle était belle dans sa robe qui laissait voir ses jolies jambes. » Tout alla très vite. Le soir même, il est à l’hôtel guidé par Clara pour ses premiers pas dans l’amour. Le lendemain, se promenant avec sa conquête sur la plage de Deauville, il rencontre son père et lui annonce : « Je suis venu avec Clara, je l’aime. » Elle éclate de rire, tentant de faire croire à une mauvaise plaisanterie.
Virgile fait la connaissance de Jean, le mari de Clara. Avec Clara et Jean notre vie à trois dura encore quelques mois. Il l’emmène chez sa grand-mère. Ils font de la barque sur l’étang. Ils redeviennent enfants. Mais son père à nouveau les rattrape.
Exilé à Rome, dans une pension prison, il trouve le moyen de faire venir Clara. L’apprenant par une photo sur un magazine, son père finit par le mettre à la porte : « Virgile, je ne te jette pas hors de chez toi. Tu es déjà parti. » Il devient coursier dans un journal.
La mort de l’Arquebuse met fin à cette errance d’adolescent. Virgile prend conscience de ses avancés dans la vie. De retour à Paris, après l’enterrement, il se précipite chez Clara : « Clara, il m’arrive quelque chose de formidable. Je vais quitter mon enfance. Je vais te quitter. » En la quittant, je rompais le dernier lien qui me rattachait à ces longues années de souffrances ; je mettais fin à mon infinie tristesse d’être petit. Haut les cœurs !
Vous me direz que tous les livres d’Alexandre Jardin sont semblables. Oui, c’est vrai. Mais quelle fraicheur d’invention pour fêter l’amour, la jeunesse, la liberté. C’est une bouffée d’oxygène dans un monde asphyxiant, un remède à la mélancolie, voire à la dépression. « Chaque fois que tu vis, que tu écris ou que tu dis avec légèreté quelque chose de grave, tu gagnes en grandeur », dit l’Arquebuse à Virgile.
07:07 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, femme |  Imprimer
Imprimer
19/02/2013
Les êtres aimés n’ont pas d’âge
Dans le livre d’Alexandre Jardin, « Bille en tête », on trouve cette très belle phrase que dit Virgile à Clara : « Tu peux devenir vieille, folle ou malade, tu seras toujours Clara. Je verrais toujours ta vraie figure, tes cheveux superbes, ta peau blanche, tes hanches pour les enfants et tes seins pour l’amour. » Miracle de l’amour.
On voit vieillir ses parents ou ses amis. On ne voit pas vieillir celui ou celle qu’on aime (sauf si bien sûr on ne l’aime plus). Il ou elle est toujours mon ou ma fiancé(e), auréolé(e) du visage aimé(e), du corps que l’on tient délicatement dans ses bras.
Le soir, lorsqu’on se retrouve seuls, on s’approche de la tendresse et de la chaleur de l’autre, qu’elle se manifeste par la douceur pour elle ou la force pour lui, et on monte au paradis, dans une bulle de sensations maintes fois éprouvées, mais toujours nouvelles. Alors les jours n’existent plus, l’éternité est commencée sur terre. Nous sommes enfermés dans notre bulle et le monde habituel nous paraît lointain. Ses bruits sont estompés comme si l’on plongeait la tête sous l’eau, légèrement. Il ou elle est présent(e). Nous sommes seuls sur terre et cette seule présence nous suffit pour vivre dans l’éternité.
Oui, nous sommes dans notre bulle, prison rêvée, entretenue, encouragée, dans laquelle toi et moi ne font que nous comme un seul soi. Cet être à deux, devenu un et unique, flotte au-dessus des contingences. Je ou tu regarde(s) le visage aimé(e) et l’histoire s’arrête, l’osmose s’effectue. Tu es ma ou mon fiancé(e) pour toujours. Et cet engagement dure, dure, comme une promesse d’immortalité, au-delà du temps qui coule.
Nous le savons, la durée nous rejoindra, mais nous aurons vécu notre rêve jusqu’au bout, jusqu’à cet instant où l’un de nous partira en disant : « Je t’attends de l’autre côté ». Et même s’il ne pouvait le dire, nous le savons, il ou elle y sera.
06:34 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : amour, société, femme, couple, mariage |  Imprimer
Imprimer
06/02/2013
Bélard et Loïse, roman de Jean Guerreschi
Un roman, un récit de mœurs, un livre érotique ? On ne sait comment qualifier ce livre de Jean Guerreschi et, de plus, on ne sait comment le lire. Doit-il être lu vite, en impatience de nouveaux incidents palpitants, ou doit-il être savouré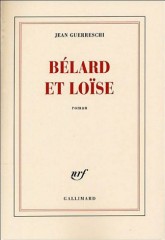 lentement, avec toute l’attention qu’il réclame, en raison de la qualité du style et de la narration ? Ce fut selon les moments. Mais plus l’on avance, plus on tente de profiter de cette lecture, s’intéressant plus à l’écriture de l’auteur qu’à l’histoire qui s’allonge, sans doute un peu trop.
lentement, avec toute l’attention qu’il réclame, en raison de la qualité du style et de la narration ? Ce fut selon les moments. Mais plus l’on avance, plus on tente de profiter de cette lecture, s’intéressant plus à l’écriture de l’auteur qu’à l’histoire qui s’allonge, sans doute un peu trop.
C’est une histoire qui pourrait être banale. L’amour d’une étudiante pour son professeur qui pourrait être son père. Elle a choqué certains critiques : « Jean Guerreschi a beaucoup d'imagination. On ne saurait le lui reprocher. On ne peut pas non plus lui reprocher de nous livrer ses frustrations en décrivant ses fantasmes. » (François Jardin, Pour les amateurs de mélo, A-lire.info)
Mais les prémices de cet amour sont enchanteresses : e-mail à double-sens, messages codés, et le désir qui monte intensément : Ils se trouvèrent soudainement tout près, trop proches l’un de l’autre. Loïse l’éprouva la première. Je suis trop près de lui, se dit-elle, je sens la rétraction de sa zone intime, mais je ne peux faire autrement que de rester là. Elle ne bougea donc pas. (…) Il était si près d’elle qu’il voyait le duvet de ses phalanges. Elle était si proche de lui qu’elle serra la main sur l’étagère pour ne pas verser. S’il me touche, je crie, pensa Loïse. S’il ne me touche pas, je hurle, pensa-t-elle l’instant d’après. Si je la touchais, songeait Bélard, elle ne me repousserait pas. De cela il était sûr. Puis il pensa au futur simple. Si je la touche, je l’aurai dans les bras toute la vie.
La narration de leurs aventures amoureuses est hors du commun : tendre, extatique, mais aussi érotique, sinon pornographique. Mais écrit avec une langue merveilleuse, pleine de justesse, de délicatesse également : Bélard vit Loïse nue. Il oublia son âge. Bélard oublia son âge. Il s’étonna de sa jeune faim. Loïse goûta au corps de Bélard. Elle le trouva bon. Son appétit d’elle surprit Loïse. Son appétit de lui la troubla. Bélard s’étonna de sa jeune faim. Que si jeune faim eût appétit de lui le surprit.
Lorsqu’il se retrouve seul, Bélard s’extasie : Je suis comme un bœuf amoureux… Elle répondit qu’elle serait volontiers sa génisse. Il protesta qu’ils étaient au milieu du carrefour, que la morale publique les écraserait plus vite et plus certainement qu’un semi-remorque. (Il pensait : m’écrasera moi, mais il ne l’écrivit pas.) Elle répondit que, sous lui, elle ne sentirait pas le semi-remorque.
Ne poursuivons pas ce récit. Laissons au futur lecteur le soin de le découvrir. Il se tire un peu en longueur, en étrangeté (mêler l’actualité du 11 septembre à cette histoire forte). Le livre ne vaut en fait que par la langue, le style, la justesse des comparaisons. La crudité du compte-rendu des ébats des deux amants pourra choquer, mais c'est écrit avec une telle délicatesse.
Le livre fait penser à « Belle du Seigneur » d’Albert Cohen. Même art de la narration juste, même hymne à la femme, même délectation de ces rencontres, étreintes, tensions et détentes amoureuses. Mais : Le plus étrange, c’est qu’un tel roman fasse aujourd’hui scandale — au point qu’une œuvre constamment maîtrisée, souvent admirablement écrite, soit boycottée par des journalistes plus pressés de rendre compte des pauvretés nothombiennes ou houelbecquiennes, écrit Jean-Paul Brighelli sur le site de Marianne.
07:27 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, littérature, femme |  Imprimer
Imprimer
29/01/2013
Manuella, roman de Philippe Labro (Gallimard, 1999)
Une collégienne, sympathique, qui ne sait si elle va avoir son bac. Quoi de plus classique ! Mais, j’ai revu la libellule de mon rêve et je me suis dit qu’une fille qui commençait la matinée la plus horrible de sa vie avec une libellule dans un carré d’espace bleu ne pouvait pas être entièrement foutue.
Pourtant, elle est vierge et la plupart de ces amies ne le sont plus. Lorsqu’un garçon veut coucher avec elle, elle répond : « Je t’aime bien, mais je ne t’aime pas. » Quand une fille dans le train, assise en face d’elle, lui demande : « Est-ce que vous êtes vierge ? » Elle la regarde, stupéfaite : « Ça va pas bien, non ? Ça te regarde ? »
garçon veut coucher avec elle, elle répond : « Je t’aime bien, mais je ne t’aime pas. » Quand une fille dans le train, assise en face d’elle, lui demande : « Est-ce que vous êtes vierge ? » Elle la regarde, stupéfaite : « Ça va pas bien, non ? Ça te regarde ? »
En fait l’intérêt du livre n’est pas dans l’histoire, mais dans les réflexions et les anecdotes concernant la vie d’une adolescente qui se dit ratée.
Ainsi l’auteur consacre un chapitre à la mode du noir : Dehors dans la rue, j’ai l’impression que tout est en noir, que tout le monde s’habille de noir. Le deuil de qui ? Ils portent le deuil de quoi, les gens ? Ils vont à l’enterrement de quoi ? C’est une cérémonie, c’est une manif ou c’est un film ? (…) Oh ! Les mecs, les filles, vous affichez quoi exactement, là ? Vous avez peur de quoi ? Parce que si vous vous ressemblez tous autant les uns les autres, c’est que vous avez peur de quelque chose ? La couleur du jour, pour vous, c’est ça ? C’est la couleur de la nuit ?
Sa mère lui fait remarquer qu’elle utilise le terme pur très souvent : un pur film, un pur chanteur, une pure note de classe, une pure soirée, un pur plat de spaghettis, un pur CD. _ Qu’est-ce que tu préfères, lui ai-je répondu, que je dise pur ou putain ?
Et, malgré ses impressions, elle est reçue au bac : une profonde sensation de plénitude, jouissance, gaité, plaisir sensuel qui ne s’affaiblissait pas et qui allait, au contraire, grandir, grandir, pousser toute la journée dans mon corps (…) Question : Peut-être que l’amour, ça ressemble à ça, la légèreté totale du corps et de l’esprit ?
Mais elle revient souvent sur l’amour tel qu’elle le conçoit : On sait tout ça, maman. On a tout lu, on a tout vu, on a tout entendu. Du cul, du cul, du cul, au cinéma, sur les affiches, dans les bouquins qui se vendent bien, les magazines, à la télé, c’était incroyable ce que les gens pouvait parler de cul et montrer du cul. Ils préféraient utiliser le mot sexe, ça faisait plus noble et plus technique, d’ailleurs, sexe, en soi, il faut bien le dire, c’est un mot irrésistible. C’est pas vulgaire. (…) Je voulais bien être comme les autres, Yami, Daph, Nade, je voulais bien connaître l’amour au moins une fois, mais j’aurai souhaité que ce ne soit pas… banal. Plus la société avait trivialisé l’amour, plus j’attendais autre chose que du trivial.
Elle le rencontre ce garçon qui la fait frissonner. Il est frimeur, mondain, une machine à sortir des aphorismes (cette salade est incongrue, mais digne d’intérêt), à citer des auteurs (on peut rêver qu’un jour la vérité soit à la mode. C’est du Raymond Queneau). Mais, au loin, le grand bateau bleu et blanc prenait le large, et moi, Manuella, j’étais gagnée par une sorte de gaité rêveuse, une petite joie intérieure, comme en attente d’un événement.
Et, à la fin du livre : j’avais toujours souhaité que la première fois me change, que ça se passe de façon telle que j’en sorte différente, transformée. Le suis-je ? Quand j’y pense, ce n’est pas une courte nuit avec un garçon en été qui a modifié ma vision des choses. Je m’étais donnée à lui parce que c’était plus qu’un geste, mais ce n’était aussi que cela, une série de gestes. Aimer sans amour n’est pas aimer.
07:17 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, adolescence, littérature, femme, amour |  Imprimer
Imprimer
31/12/2012
La femme qui attendait, roman d’Andreï Makine
Une femme si intensément destinée au bonheur (ne serait-ce qu’à un bonheur purement physique, oui, à un banal bien-être charnel) et qui choisit, on dirait avec insouciance, la solitude, la fidélité envers un absent, le refus d’aimer…
Ainsi commence ce roman qui tourne autour du corps de la femme, une femme qui refuse de croire à la mort de son fiancé plus de trente ans plus tard. Et ce refus est parfois synonyme de mort. Il se traduit par le froid des paysages, les changements de temps, le bruit de la glace qui tombe des toits. Et d’autres fois, il devient pleine vie, au-delà des apparences, grâce au soleil d’un printemps qui met du temps à venir, à une fleur ramassée dans la campagne.
Et c’est bien à une retraite que nous convie l’auteur, retraite au-delà de la vie, dans cette après-vie, avec de vieilles personnes près de la mort : Elle dort dans une sorte de mort anticipée, au lieu du temps qu’elle a suspendu à l’âge de seize ans, marchant en somnambule parmi ces vieilles qui lui rappellent la guerre et le départ de son soldat… Elle vit un après-vie, les morts doivent voir ce qu’elle voit…
Peu à peu, il apprivoise cette femme, avec douceur, mais désir de son corps. Elle est belle malgré son âge. Elle semble pleine de désirs cachés. Il apprend ses rêves : J’ai attendu le train de Moscou… Cela m’arrive de temps en temps. Toujours presque le même rêve : la nuit, le quai, il descend, se dirige vers moi… Cette fois, c’était peut-être encore plus réel qu’avant. J’étais sûre qu’il viendrait. J’y suis allée, j’ai attendu. Tout cela est déraisonnable, je sais. Mais si je n’y étais pas allée, un lien se serait rompu… Et ce ne serait plus la peine d’attendre… Il apprend à la connaître doucement : Ses paupières battaient lentement, elle leva sur moi un regard, vague et attendri, qui ne me voyait pas, qui allait me voir après le passage des ombres qui étaient en train de traverser. Je devinais que durant cette cécité, je pouvais tout me permettre. Je pouvais lui prendre la main, je touchais déjà cette main, mes doigts remontaient sans peser sur son avant-bras. Nous étions assis côte à côte et la sensation d’avoir cette femme en ma possession était d’une force et d’une tendresse extrêmes.
Elle finit par se donner à lui, égarée, enfantine en amour, fière de sa condition féminine : Cette femme sûre disparut dès les premières étreintes. Elle ne savait pas qui elle était en amour. Grand corps féminin aux inexpériences adolescentes. Puis une véhémence musculeuse, combative, imposant sa cadence au plaisir. Et de nouveau, presque l’absence, la résignation d’une dormeuse, la tête renversée, les yeux clos, la lèvre fortement mordue. Un éloignement si complet, celui d’une morte, qu’à un moment, me détachant d’elle, je lui empoignais les épaules, la secouait, trompé par sa fixité. Elle entrouvrit les yeux, teintés de larmes, me sourit et ce sourire se mua, respectant notre jeu, en un rictus trouble de femme ivre. Son corps remua.
C’est un roman poétique, empli de la féérie des saisons de glace, des forêts immenses, des villages sans âme. Et progressivement se déroule l’histoire, dans laquelle l’imagination a autant d’importance que le réel vécu. Un rêve que l’auteur vit de manière très concrète, attaché à de petits riens qui sont autant de construction de la réalité. Il se prépare à repartir, sortir de cette après-vie qui semble la vie normale de ce village de vieilles femmes sur laquelle veille une femme plus jeune, encore désirable. Oui, c’est un beau roman !
07:10 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, femme, vie, féminité, solitude, philosophie |  Imprimer
Imprimer
23/12/2012
L'odeur personnelle
Chaque humain, homme ou femme, possède une odeur personnelle. Je ne parle pas des odeurs que d’autres produits, touchés ou projetés, laissent sur la peau, tels le savon, les liquides de vaisselle ou même les parfums. Non, il s’agit de cette odeur indéfinissable qui irise chaque personne et qu’elle cache sans s’en rendre compte, dans ses recoins, ses plis, ses cheveux et j’en passe. Vous ne la percevez pas, même lorsque vous êtes près de cette personne. Mais si déjà vous lui faites un baiser, vous la discernez, infinie et légère. Et si vous épanchez encore plus, si vous l’embrassez réellement, alors vous entrez dans son intimité et faites connaissance avec son odeur. Désormais, vous la reconnaîtrez à son odeur et plus seulement à sa vue. Et si bien sûr vous l’aimez, cette odeur restera pour vous ce lieu de repos et de bien-être qui vous berce tout au long de la vie. Vous vous en enivrez, bien au-delà de la vue et du toucher.
Peut-être est-ce pour cela que depuis une trentaine d’années, et même plus, les gens ont pris l’habitude de s’embrasser au lieu de se tendre la main : les hommes embrassent les femmes, les femmes embrassent les hommes et les femmes. Auparavant, à certaines heures de la journée et selon les lieux, les hommes baisaient la main des femmes et, parfois, arrivaient à percevoir leurs phéronomes. Désormais, ils sont conviés à faire mieux, sous des prétextes de camaraderie ou d’amitié ou parce qu’ils ont le même âge. En est-il de même pour les femmes ? Elles embrassent des personnes des deux sexes. C’est sans doute parce que les femmes se lient d’amitié plus facilement que les hommes. Les amitiés de jeunes filles se marquent également d’une autre manière que les amitiés masculines.
L’odeur, plus encore que le toucher, vous fait entrer dans le monde intime de la personne. Vous ne formez plus qu’un, seuls dans votre bulle commune, ne voyant le monde qu’au travers de cette membrane déformante de l’amour ou de l'amitié. Et vous y êtes bien.
Mais est-ce seulement réservé aux êtres vivants (l’on connaît bien sûr l’importance des odeurs pour les animaux) ? Chaque maison a également une odeur. Lorsque vous entrez, vous la respirez sans vous en rendre compte. Mais elle est là. Lors d’un déménagement, il faut du temps pour que votre maison dégage l’odeur de la famille. Ce n’est que lorsque vous croyez ne rien sentir des effluves antérieurs que votre maison a pris votre exhalaison.
06:51 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : homme, femme, société, amour |  Imprimer
Imprimer
20/12/2012
Du domaine des murmures, roman de Carole Martinez
« On gagne le château des Murmures par le nord. Il faut connaître le pays pour s’engager dans le chemin qui perce la forêt épaisse depuis le pré de la Dame Verte. (…) Nous passons l’énorme huis de chêne et de fer, aujourd’hui disparu, et foulons l’herbe haute du parc en friche qui s’étend devant la façade nord du château. (…) La forteresse entière vacille sous nos yeux. Car ce château n’est pas seulement de pierres blanches entassées sagement les unes sur les autres, ni même de mots écrits quelque part en un livre, ou de feuilles volantes disséminées de–ci de-là (…) Non, ce lieu est tissé de murmures, de filets de voix entrelacées et si vieilles qu’il faut tendre l’oreille pour les percevoir. De mots jamais inscrits, mais noués les uns aux autres et voir qui s’étirent en un chuintement doux. »
Prologue du livre, il en donne le ton : un voyage au XIIème siècle dans un monde de folie, hanté par l’urgence de la vie courte et le fait de Dieu qui domine les vies et les prend dès leur naissance. La première page poursuit :
« Je suis l’ombre qui cause. Je suis celle qui s’est volontairement clôturée pour tenter d’exister. Je suis la vierge des Murmures. A toi qui peux entendre, je veux parler la première, dire mon siècle, dire mes rêves, dire l’espoir des emmurées.
En cet an 1187, Esclarmonde, Damoiselle des Murmures, prend le party de vivre en recluse à Hautepierre, enfermée jusqu’à sa mort dans la petite cellule scellée aménagée pour elle par le père contre les murs de la Chapelle qu’il a bâtie sur ses terres en l’honneur de sainte Agnès, morte en martyre à treize ans de n’avoir pas accepté d’autres époux que le Christ.
(…) Je suis Esclarmonde, la sacrifiée, la colombe, la chair offerte à Dieu, sa part. J’étais belle, tu n’imagines pas, aussi belle qu’une fille peut l’être à quinze ans, si belle et si fine que mon père, ne se lassant pas de me contempler, ne parvenait pas à se décider à me céder à un autre. (…) Mais les seigneurs voisins guettaient leur proie. J’étais l’unique fille et j’aurais belle dot. »
Mais elle dit non devant l’ensemble des invités de la noce et se coupe l’oreille pour montrer sa détermination.
Avant de se laisser enfermer, elle se fait violer et se retrouve enceinte dans son réduit. Elle met au monde un garçon, Elzéar. Elle est recluse, mais en fait elle vit ce siècle avec toute la puissance de son imagination et la vigueur de la réalité.
Etait-elle sainte ou était-elle une fille perdue malgré elle ? A vous de juger, de marcher sur ce fil où l’on tombe d’un côté ou de l’autre en un rien de temps, sur une impression, un murmure qui fait pencher la balance.
Un siècle où également on passe du réel aux contes :
« Le monde en mon temps était poreux, pénétrable au merveilleux. Vous avez coupé les voies, réduite les fables à rien, niant ce qui vous échappait, oubliant la force des vieux récits. Vous avez étouffé la magie, le spirituel et la contemplation dans le vacarme de vos villes, et rares sont ceux qui, prenant le temps de tendre l’oreille, peuvent encore entendre le murmure des temps anciens ou le bruit du vent dans les branches. Mais n’imaginez pas que ce massacre des contes a chassé la peur ! Non, vous tremblez toujours ans avoir pourquoi. »
Un livre lent, méditatif, et, dans le même temps, violent, hurlant les conventions, la mort et, enfin, le mystère de la vie. A lire, mais surtout à relire, car c’est en le relisant, par bribes, que l’on y prend goût. On le ferme en rêvant d’un monde où l’on n’aurait probablement pas aimé vivre. Mais l’imagination permet d’oser ce que l’on ne ferait probablement pas dans la réalité.
07:49 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, littérature, femme, poésie, mariage |  Imprimer
Imprimer
03/12/2012
La part de l’autre, roman d’Eric-Emmanuel Schmitt
– Adolf Hitler : recalé.
– Adolf H. ; admis.
Cette annonce de l’Académie des beaux-arts change le monde. On oscille entre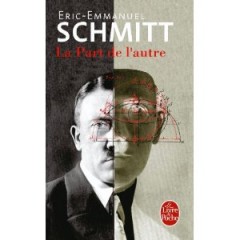 un monde réel, dans lequel le personnage d’Hitler se promène avec difficulté jusqu’à son suicide et un monde imaginaire où Hitler devient peintre. Pas le grand peintre qu’il souhaite devenir, mais un artiste acceptable qui finit par reconnaître qu’il n’a pas l’étoffe d’un grand maître et qui survit à cela.
un monde réel, dans lequel le personnage d’Hitler se promène avec difficulté jusqu’à son suicide et un monde imaginaire où Hitler devient peintre. Pas le grand peintre qu’il souhaite devenir, mais un artiste acceptable qui finit par reconnaître qu’il n’a pas l’étoffe d’un grand maître et qui survit à cela.
Toutes les deux ou quatre pages, on passe d’un personnage à l’autre, parfois en se demandant duquel il s’agit : Docteur Jekyll ou Mrs Hyde ?
Du nouveau chancelier de l’Allemagne, l’auteur écrit : « Ils ignoraient qu’ils n’avaient pas désigné un homme politique, mais un artiste. C’est-à-dire son exact contraire. Un artiste ne se plie pas à la réalité, il l’invente. C’est parce que l’artiste déteste la réalité que, par dépit, il la crée. D’ordinaire, les artistes n’accèdent pas au pouvoir : ils se sont réalisés avant, se réconciliant avec l’imaginaire et le réel dans leurs œuvres. Hitler, lui, accédait au pouvoir parce qu’il était un artiste raté. »
Du peintre, il imagine, dans un dialogue entre le professeur et un de ses élèves, la lutte de celui qui découvre qu’il n’est pas un grand peintre : « – Une vie, ça ne se fait pas tout seul. Ce n’est pas vous qui la donnez. Ce n’est pas vous qui choisissez vos dons. (…) A quarante ans, vous décidez de faire des enfants et vous décidez de ne plus peindre. En fait, ce que vous désirez, c’est décider. Maîtriser votre vie. La dominer. Fût-ce en étouffant ce qui s’agite en vous et qui vous échappe. Peut-être ce qu’il y a de plus précieux. Voilà, vous avez supprimé la part de l’autre en vous comme à l’extérieur de vous. Et tout ça pour contrôler. Mais contrôler quoi ? »
Eric-Emmanuel Schmitt se justifie et explique son roman dans son journal : « J’élabore un double portrait antagoniste. Adolf H. cherche à se comprendre tandis que le véritable Hitler s’ignore. Adolf H. reconnaît en lui l’existence de problèmes tandis qu’Hitler les enterre. Adolf H. guérit et s’ouvre aux autres tandis qu’Hitler s’enfonce dans sa névrose en se coupant de tout rapport humain. Adolf H. affronte la réalité tandis qu’Hitler la nie dès qu’elle contrarie ses désirs. Adolf H. apprend l’humilité tandis qu’Hitler devient le Führer, un dieu vivant. Adolf H. s’ouvre au monde ; Hitler le détruit pour le refaire. Non seulement La part de l’autre donne le principe du livre mais ce titre en suggère la dimension éthique : poursuite de l’altérité chez Adolf H., fuite de l’altérité chez Hitler. »
C’est un livre profond, parfois intéressant, mais qui devient lassant pendant sa lecture. Où veut-on en venir ? Cette question vous taraude tout au long des pages et la réponse ne se trouve pas dans le livre, mais dans le journal où l’auteur décrit ses interrogations. Vous êtes frustré lorsque vous fermez ce long roman de 500 pages, vous l’aimez lorsque vous le refouillez et retournez au point de départ. Que ce serait-il passé si l’Académie des beaux-arts en avait décidé autrement ? Adolf H. manque sans doute un peu de personnalité pour devenir la controverse d’un Hitler névrosé, mais sorcier des foules. A l’opposé d’Adolf Hitler, qui craint les femmes, Adolf H. réussit sa vie grâce aux femmes : Onze-heures-trente, sœur Lucie, Sarah, sa femme, juive.
05:18 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, histoire, psychologie, femme |  Imprimer
Imprimer
01/11/2012
Aral, roman de Cécile Ladjali
C’est un monde mouvant, tantôt effrayant, tantôt attendrissant, toujours chaud, plein de frémissement, comme ces vibrations qu’Alexeï, musicien sourd, entend. Il se marie avec son amie d’enfance, Zena. Ils ont grandi à Nadezhda, au bord de la mer d’Aral qui s’est retirée. Il n’y reste plus que le sable, la pollution et la misère. Mais ce monde est le leur et ils y trouvent le bonheur, chaud, envahissant, comme leurs corps qui se découvrent et se parlent en caresses.
Il se marie avec son amie d’enfance, Zena. Ils ont grandi à Nadezhda, au bord de la mer d’Aral qui s’est retirée. Il n’y reste plus que le sable, la pollution et la misère. Mais ce monde est le leur et ils y trouvent le bonheur, chaud, envahissant, comme leurs corps qui se découvrent et se parlent en caresses.
Mais un jour, après quelques années heureuses, Zena part travailler en France. Alexeï reste seul avec sa musique. Il prépare un opéra, il joue pour les orphelins de Nadezhda et découvre qu’il sort de cet endroit où les enfants n’ont pas d’histoire. Il rencontre Nulufar, jeune prostituée, belle comme un démon. Il s’installe chez elle, sans cependant la posséder. Mais elle boit l’eau de la ville et est atteinte d’une maladie qui la fait régresser. Elle est comme une enfant de dix ans et il assume cette paternité. Sa vie s’enfonce dans la boue laissée par la mer, près des bateaux gisant sur le flanc, rouillés. Un jour, pour la sainte Rita, Alexeï voit l’eau remonter. Il remarque une fille qui s’installe à côté de lui, sur sa serviette de bain. Zena se lève, entre dans l’eau, il la rejoint. Elle enlève son maillot pour être douce et nue dans ses bras. Dans l’eau elle boit mes larmes. Dans l’eau je bois ses larmes. La mer. Nos visages. Ils rient ensemble et le sel mord les minuscules égratignures que notre histoire a laissées sur nos corps qui se serrent. Une eau joyeuse remplit la vasque ouverte de nos deux vies.
Quelques très belles pages sur la musique : Du désir de musique, je dirai qu’il est très simple et demande à être immédiatement satisfait. Il vient comme la faim, la soif, l’excitation amoureuse. (…)
Moi j’entends la musique partout : dans le sable, dans l’eau, dans les arbres. Le long des falaises de craie, parmi les jupes des fillettes qui jouent à la marelle, ou sur la frimousse crasseuse des bambins qui volent des oranges au marché Saint-Hilarion. En fait je n’invente rien. Jamais. Je restitue. Mais ce que les gens ont du mal à concevoir c’est que ma perception des choses se traduise musicalement, alors que je suis sourd. Ils sont idiots : un artiste choisira toujours le mode d’expression qui annulera sa douleur. (…)
La musique est un souvenir. Une tension en direction de ce qui fut et qu’on rappelle. Les vagues. Les ondes. Le ressac. Voilà à quoi ressemble la musique. Elle et un fleuve Alphée qui retourne au mouvement qui l’a engendré. Elle est un antipoison à la disparition. Je n’ai jamais composé avec du temps mais avec de la durée. Avec des lignes brisées, dans des intervalles, au creux des interstices que le laisse la mémoire ou me confiait le hasard. Ma musique est une sorte d’anomalie.
La beauté du livre tient principalement à l’écriture de Cécile Ladjali. Déliée, sensuelle par l’évocation des perceptions autres que celles de l’ouïe, faite de phrases courtes, désossées. Elle nous donne l’envie de lire ses autres livres.
06:02 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, littérature, musique, femme |  Imprimer
Imprimer
31/10/2012
Le sacre du printemps, ballet de Maurice Béjart, musique d’Igor Strawinsky
Un ballet de Maurice Béjart créé en 1959. Ce film date de 1970. Les deux élus du sacre sont interprétés par Tania Bari et Germinal Casado.
http://www.youtube.com/watch?v=ooi7eomsTuc
Quels sont ces insectes mâles qui, collectivement, tentent d’approcher leur reine, elle-même protégée par ses fidèles ? Est-ce une danse rituelle africaine, une parade de fourmis ou une évocation d’extra-terrestres. Ils sont impressionnants ces guerriers exaltés qui, mus par un instinct viscéral envahissent l’espace autour du bouton fermé sur lui-même. Leurs pattes et leurs ailes se meuvent ensemble pour se donner plus d’impact. Oseront-ils approcher ? Ils se scindent en paquets, tournent autour de cette forme insolite, approche peu à peu jusqu’à l’apparition de la reine. Celle-ci tout à coup se dresse et s’offre dans toute sa beauté, seule face aux mâles. Puis, très vite, par peur ou pudeur, ou peut-être parce que ses protectrices ont-elles-mêmes peur, elle se montre borgne pour que les mâles se détournent. Les deux entités, mâles et femelles, se regroupent, se serrent, se regardent avec fureur, se haïssent et se désirent.
La reine s’impose alors, majestueuse et animale. Elle vit sa vie propre, dans son monde à elle, rythmée par une horloge puissante qui imprime à son corps des attitudes tantôt terrifiantes, tantôt érotiques. Mais elle dévoile derrière ces attitudes un désir de rapprochement des entités. Et ce désir qu’évoque les allées et venues entre les deux groupes, éclate tout à coup. Elle s’est rendue désirable et cherche à les rendre désirables entre eux par une démonstration de sa propre envie. Jeu de la séduction qui tout à coup déchaîne les deux groupes. L’humain se retire, ni homme, ni femme, l’animal se dévoile, c’est une sorte d’ensorcellement qui, tout à coup, fait sortir du groupe des hommes un être.
Aussitôt, la reine cherche à séduire cet homme. Elle parvient vite à ses fins. Et c’est le déchaînement des corps, la confusion. Tous s’y mettent dans une extase sans limite. C’est la consécration de la femme et de l’homme dans une passion exacerbée. Derrière l’animalité de la danse se dévoile l’humain et le mystère de cette division en deux groupes sexués qui se cherchent et n’ont de cesse de s’unir. L’un et le tout.
Ce ballet fit scandale lors de sa première représentation. Stravinsky en fut malade. Il en voulut aux ballets russes de Diaghilev et à Nijinski, le chorégraphe. Il ne connut le triomphe que l’année suivante. C’est un ballet mythique qui réunit à la fois le scandale, le fait qu’il ne fut joué que 5 fois dans les années 1913, un chorégraphe célèbre et une musique moderne fondée sur le rythme, la dissonance et le discontinu. La mélodie et même l’harmonie importent peu.
Merci à Maurice Béjart de cet instant magique qui fouille au cœur du mystère de la vie humaine : homme et femme, semblables et différents, une différence qui ne cherche qu’une chose : l’unité.
07:56 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : danse, musique, modernisme, homme, femme |  Imprimer
Imprimer
28/10/2012
Femme et homme
Les femmes ont un besoin naturel d’être désirables et désirées pour atteindre la sécurité. A cette fin, elles se donnent, puis se refusent. Elles passent par la séduction, jeu de contradiction qu’elles maîtrisent, mais que l’homme a du mal à comprendre.
Les hommes veulent être reconnus pour assoir leur sentiment d'exister. Le seul moyen qu’ils ont pour montrer ce qu’ils sont, passe par ce qu’ils font, dans tous les domaines, social, professionnel, familial, loisir, etc.
Dans le jeu de la conquête, l’homme et la femme cherchent à contrôler leur relation, soit de manière directe pour le premier, soit de manière indirecte pour la seconde. Une fois une véritable relation établie, les vrais couples n’ont plus besoin de ce type d’attitudes, mais certains couples le poursuivent après le mariage.
Ce constat n’est pas nouveau. Ces relations existent depuis le début des temps. Ce qui est nouveau, c’est, avec l’apparition de la publicité et des médias, l’exaltation de ces caractéristiques. Utilisant ces variations psychologiques, ceux-ci les utilisent à d’autres fins, pour les reporter sur d’autres sujets. Ainsi la publicité utilise le corps féminin pour vendre des produits. Ainsi également, le sportif de haut niveau, l’artiste médiatique, le politique charismatique sont magnifiés et détruits en cas de faux pas. Aucun regard, ni pour l’homme de tous les jours ou même le chercheur ou le philosophe qui font avancer le monde, ni pour la femme qui est au centre de la vie sociale et familiale. Les médias et la communication consolident ces stéréotypes : pour vivre et être, la femme doit séduire, l’homme doit maîtriser.
Ne nous laissons pas imposer ces stéréotypes par des professionnels des médias et du marketing qui les amplifient et les utilisent à des fins différentes. Et si je parle de stéréotype, c'est bien qu'au delà de ces attitudes générales, chaque femme et chaque homme a des attitudes personnelles qui font que c'est cette personne spécifique qu'on aime et non le stéréotype. Alors, cultivons nos trésors personnels et réalisons-nous à travers eux.
07:52 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, femme, homme, psychologie, médias |  Imprimer
Imprimer
19/10/2012
Cindy Sherman, à la galerie Gagosian (1ère partie)
En entrant dans la galerie Gagosian, on ne sait ce que l’on va trouver. Les fenêtres sont obturées, une sorte d’appariteur, tout de noir vêtu, ouvre la porte et l’on est englouti par l’immensité des pièces. Les tableaux ou objets exposés sont également immenses, à la mesure, ou démesure, du lieu. Qui est donc cette Cindy Sherman ?

Deux grandes toiles, imposantes… Un paysage, beau certes, dans lequel on trouve une femme, différente chaque fois, posant de manière tantôt grotesque, touchante, insolite, effrontée. Elle est plantée au milieu du décor, vêtue de tenues extravagantes, venant de la collection Chanel. On s’interroge. On regarde à nouveau le paysage, est-il peint ou photographié ? On ne sait pas exactement. Chaque paysage est particulier, le plus souvent grandiose. Tous sont désolés, d’une solitude démesurée, avec la beauté de la nature vierge. Que vient faire cette femme au milieu de ces scènes de nature brute ? La contradiction entre celle-ci et le fond est flagrante, voulue, obscène.

Tout d’un coup, on se demande s’il s’agit de peinture ou de photo. On s’approche de plus près, on ausculte le tableau, on croit dans un premier temps à la peinture. Quel réalisme et quelle précision des traits ! Trop, sans doute pour que ce soit vrai. Alors on penche pour la photographie. Oui, certainement, mais pourtant. En fait c’est de la photographie remaniée, tant pour les paysages que pour les portraits. Les paysages viennent de Capri, du Stromboli, de l’Islande de New York (Shelter Island). Ils ont été manipulés numériquement et rappellent maintenant les peintures de Turner ou de l’école de Barbizon. Elle s’est photographiée dans des robes ou des atours sophistiqués, comme au théâtre. Les tenues sont très variées : Coco Chanel, vêtements des années 1920, d’autres plus modernes (Karl Lagerfeld). Elles sont baroques, avec broderies, plumes, volants, et font dire : « Mais que vient-elle faire dans cette galère ? »

Est-ce beau ? Certes, le contraste est saisissant. Les paysages sont déshumanisés, la femme est désocialisée, voire dés-efféminée. On sent dans sa gorge une impression bizarre, c’est trop théâtral, trop organisé pour faire vrai. C’est comme manger de la soupe pour chien dans un restaurant quatre étoiles !
On ressort de la galerie avec un certain malaise : est-on trompé ou ne voit-on pas ce que la photographe a voulu dire ?
07:33 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, art contemporain, femme |  Imprimer
Imprimer






















