07/05/2015
Un couple insolite (6)
Damien n’avait qu’une obsession : serrer une femme dans ses bras. La douceur féminine lui manquait. Il avait connu l’exaltation de l’union au cours de ces cinq mois de mariage. Il éprouvait des tremblements nerveux en imaginant le bonheur de ces rapprochements. Il se remémorait l’entrée dans la bulle de l’amour lorsqu’il pouvait enfouir son visage dans le cou de sa bien-aimé, respirer son exhalaison, caresser ses épaules arrondies jusqu’à ces instants sublimes où ils devenaient un, dans un même rêve fait réalité. La nuit, depuis cet instant où il ne put toucher Isabelle, il lui arrivait de pleurer sans bruit dans son lit. Elle est là, se disait-il, mais elle n’est pas là non plus. Qu’est-elle devenue ? Pourquoi faut-il que ce soit à nous à qui cela arrive ? Je t’aime Isabelle, mais où es-tu ?
Il voulait à tout prix en avoir le cœur net. Le problème tenait-il à Isabelle ou à toutes les femmes dès l’instant où il s’approchait d’elles. Il ne savait plus que croire et n’en pouvait plus. Il avait besoin de savoir. Après, il prendrait une décision. Laquelle ? Il ne savait.
Il n’alla pas loin. Il prit une chambre dans un hôtel du quartier des Champs-Elysées, s’habilla avec élégance et se rendit au drugstore, lieu de fréquentation d’hommes et de femmes en mal de connaissance, du moins le pensait-il. Il commanda un whisky, histoire de se mettre dans l’ambiance et d’envisager cette nouvelle vie à laquelle il n’avait jamais pensé jusqu’à maintenant. Il se laissa bercer par le bruit monotone des chaises remuées, des conversations alentour, de la très légère musique de fond et des commandes des garçons qui passaient devant lui la main à plat sur leur plateau contenant de nombreux verres et bouteilles. Quel spleen ! Il voyait la foule circulant au dehors, des petits, des gros, des fines, des grassouillettes, des élégantes et des sportives, des souriantes ou des revêches. Il se prit à rêver. Celle-ci qui marchait avec élégance, engoncée dans un léger manteau, le minois souriant, regardant sa montre et accélérant sa marche. Celle-là, petite brune, serrant un paquet, de chocolat probablement, se réjouissant de le déguster une fois rentrée chez elle. Il fut tiré de sa rêverie par une jeune femme qui s’installa à une table à côté de lui. Son regard avait fui, mais il l’avait vu un instant auparavant le regardant avant de s’assoir. C’était une assez grande femme, blonde, les traits bien dessinés, portant une petite bague moderne à l’auriculaire de la main droite. Elle tenait son petit sac à main contre elle et cherchait le garçon d’un œil attentif. Lorsqu’elle le vit, elle leva la main et lui fit un signe. Elle commanda d’une voix souple et posée, mélodieuse, presque musicale. Il croisa à nouveau son regard et lui fit un sourire. Elle n’y répondit pas, mais ne parut nullement gênée par cet échange subliminal. Elle attendait sa commande regardant dehors, comme lui. Celle-ci arriva enfin, un gin tonic avec deux glaçons. Elle se détendit ave un affaissement du haut du corps, très léger, non pas un avachissement, mais une simple détente des épaules et des avant-bras, un léger abandon des mains posées sur ses cuisses et un sourire voilé d’une timidité de bon aloi. Elle trempa ses lèvres dans le liquide transparent et reposa son verre, heureuse de ce moment de relaxation. Il ne put s’empêcher de lui faire la remarque :
– Vous semblez si bien !
Elle le regarda, sourit et lui répondit :
– C’est si bon de se détendre après une journée de travail épuisante. Regardez ces gens qui courent dans tous les sens. Ils ne prennent même pas le temps de profiter de l’heure sereine avant de rentrer chez eux.
– C’est vrai. Nous oublions tous la douceur de vivre. Préoccupés par des pensées futiles au lieu de contempler les minutes qui passent sans penser à rien.
Ils bavardèrent tranquillement et cela lui fit du bien. Il fut distrait de son idée fixe. Plus de démangeaisons nerveuses, plus d’envies de fuir n’importe où. Il profitait de cette heure sans aucune arrière-pensée. Il rapprocha sa table, une petite table ronde, et se retrouva bientôt à côté d’elle. Elle n’était pas réellement belle, le visage jeune, mais un peu empâté au niveau de l’attache du cou. Elle avait un regard vif, presqu’étincelant par moment. Elle savait rire en racontant une anecdote, il sut l’écouter sans forcer son rôle, heureux de cette entente rapide.
– L’autre jour, j’étais allé faire des courses près de l’Opéra. J’ai vu sortir d’un magasin chic une sorte de princesse arabe accompagnée de deux autres femmes également élégantes et chargées de paquets qu’elles engloutirent dans le coffre ouverte d’une luxueuse voiture. Le sol était inégal, fait de ces pavés très parisiens, traitres parce que cachant des interstices invisibles. Elle se prit un talon dans un de ceux-ci et tomba durement sur le sol. Les deux autres jeunes femmes qui l’accompagnaient ne firent pas un mouvement pour l’aider à se relever. Elles se jetèrent un coup d’œil et sourirent en tournant la tête, heureuse de voir que leur patronne était comme elle et pouvait avoir des défaillances. Il fallut qu’un homme aide la belle à se relever malgré la gêne que cela procurait à celle-ci. Qui veut faire l’ange fait la bête, conclut-elle en riant.
– Oui, ce sont des instants de joie que d’assister à de tels changements de situation. Elle n’était pas blessée au moins ?
– Non, pas du tout. Mais furieuse, ça, oui !
Il ne put s’empêcher de lui toucher le coude en répliquant :
– Cela se comprend, imaginez-vous dans une situation semblable, par exemple transportant dans un sac en papier des pots de confiture achetés dans une bonne épicerie et ceux-ci tombant à terre parce que le papier du fond a lâché. Eclaboussée par la confiture rependue sur le trottoir, que feriez-vous ?
Peu lui importait ce qu’il disait. Seul comptait le contact qu’il avait eu avec cette femme élégante et charmante. « Elle existe », pensa-t-il aussitôt qu’il sentit une certaine résistance au bout de ses doigts. Il eut envie de crier de joie et de la prendre dans ses bras. Il ne put s’empêcher de sourire plus que de raison, voire de rire d’émerveillement d’avoir le contact avec ce coude de femme, quelle qu’elle soit. Elle le regarda, surprise de sa réaction décalée par rapport à l’histoire qu’elle avait racontée. Tout en souriant, il se dit qu’il était plus simple de tout lui raconter, Isabelle, son mariage, sa « maladie » et l’effet que cela lui avait fait de la toucher et de la sentir consistante.
07:15 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, récit, rêve, réveil, couple, peur |  Imprimer
Imprimer
05/05/2015
Un couple insolite (5)
Le scanner ne leur donna aucun éclaircissement. Tout était normal. Dépités, ils rentrèrent chez eux, sans même pouvoir se jeter dans les bras l’un de l’autre. Ils retournèrent consulter le professeur, mais celui-ci avoua son incompétence. Il n’avait jamais vu ni entendu parler d’un tel cas. L’enfer commençait, à petites doses, s’infiltrant lentement dans l’esprit de Damien et d’Isabelle. Ils n’avaient rien à se reprocher, rien à redire de leur vie en commun. Mais cette situation les laissait impuissants. Que faire quand l’adversité vous frappe sans qu’il soit possible de riposter ou de la contourner ? Rien. Rien, c’est-à-dire l’inertie et la non-action ; bref, une attitude déprimante parce qu’incontournable. Et cette attitude entraîne des divergences de perception, donc d’émotions.
Isabelle laissait de temps à autre transparaître sa peine, quelques larmes qui suffisaient à énerver Damien. « A quoi cela sert-il de pleurer sur notre situation ? Mieux vaut trouver des solutions. » Malgré ces reproches voilés, elle ne pouvait s’empêcher de penser aux mois précédents lorsqu’ils se réjouissaient de se retrouver le soir ensemble dans leur lit. Dorénavant ils retardaient ce moment. Ils regardaient la télévision sans parler, une première émission, puis une deuxième jusqu’à ce que l’un d’entre eux s’endorme à moitié sur le canapé. Ils allaient se coucher par la force des choses. Il fallait travailler le lendemain. Ils leur étaient même arrivés de s’endormir tous les deux et de se réveiller à quatre heures du matin, ne sachant plus s’ils devaient attendre le lever du jour ou aller se coucher. Elle ne pouvait alors s’empêcher de reverser quelques larmes. Elle pleurait chaque jour, malgré les reproches de Damien.
Celui-ci avait des moments de découragement qui s’exprimaient par des départs impromptus de l’appartement. « Où va-t-il encore ? se demandait Isabelle. Elle ne comprenait pas qu’il puisse avoir besoin de moments de solitude. Il marchait une heure ou deux, traversant la moitié de Paris et rentrait épuisé. Il allait directement se coucher. Isabelle le rejoignait, mais il était déjà endormi. Elle le caressait alors, rêvant aux tendres attouchements qu’il lui prodiguait auparavant. Il était devenu sec comme un bois mort.
Un jour, n’en pouvant plus, ils convinrent qu’ils pourraient prendre quelques jours chacun de leur côté et essayer de faire un point. Ils ne sentaient plus leur corps, n’avait plus d’émotions positives, plus de sentiments l’un envers l’autre et encore moins de capacité de raisonnement. Ils firent leur valise chacun de leur côté, emportant quelques vêtements inutiles, un livre qu’ils ne liraient ni l’un, ni l’autre et leur trousse de toilette. Ils fermèrent la porte à clé, se regardèrent, descendirent l’escalier à petits pas, elle l’embrassa sur le palier de l’immeuble, il lui dit à dimanche soir et ils partirent, l’un à droite, l’autre à gauche. Trente pas plus loin, ils se retournèrent quasiment ensemble, se firent un signe de la main, puis poursuivirent leur route. Chacun se demandait s’il reverrait l’autre, s’il aurait le courage de revenir pour à nouveau affronter cette situation inimaginable.
07:36 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, récit, rêve, réveil, couple, peur |  Imprimer
Imprimer
02/05/2015
Un couple insolite (4)
Une minute plus tard, il rentra, s’assit à son bureau, sortit une feuille d’ordonnance et commença à écrire. Il s’interrompit comme s’il avait une nouvelle idée et il leur avoua sa perplexité.
– J’avoue ne pas comprendre. Vos deux examens sont tout ce qu’il y a de plus normaux. J’ai besoin que vous me montriez ce qu’il se passe lorsque vous, Monsieur, essayez de toucher Madame. Allez-y, je vous en prie.
Damien avança sa main vers le buste d’Isabelle. Il ne sentit rien. Isabelle ne semblait pas là. Voulant en avoir le cœur net, le professeur leur demanda de se dévêtir tous les deux en ne gardant que leur dessous. Damien avança à nouveau sa main vers le corps d’Isabelle. Celle-ci disparut lorsqu’elle pénétra sa peau. Le professeur écarquilla les yeux et lui demanda de poursuivre plus profondément pour que sa main ressorte de l’autre côté du corps d’Isabelle. Ce fut le cas. Il voyait une coupure entre l’épaule et la main que comblait le corps d’Isabelle. Il eut alors une idée surprenante. Donnant à Damien son stéthoscope, il lui demanda de se séparer d’Isabelle. Impossible. Damien ne pouvait extraire sa main qui tenait l’appareil. Il était comme ces enfants qui, la main dans un pot de bonbons, ne peuvent la ressortir parce qu’ils ne veulent pas les lâcher. Isabelle ne sentait rien. Le médecin reprit son stéthoscope et Damien sortit sa main sans aucune difficulté, comme si sa femme n’avait pas de corps.
– Nous avons donc appris quelque chose. Aucun corps étranger ne peut pénétrer votre personne. Seule la peau contre la peau crée le problème.
– Ce n’est pas tout à fait exacte, le reprit Isabelle. N’oubliez pas que dans le lit je porte une chemise de nuit et que, tout à l’heure, j’étais habillée.
– Madame, vous avez raison. Mais cela me donne une idée. Que se passe-t-il si c’est vous qui voulez toucher votre mari.
– Mais rien du tout. Je le touche, tout simplement. Tenez.
Joignant le geste à la parole, elle s’approcha de Damien, avança la main et ne put aller au-delà d’un simple toucher.
– Il est bien là, présent, comme d’habitude.
– Essayons autre chose. Monsieur, entrez votre bras et ne bouger plus. Maintenant, Madame, dégagez-vous de ce bras, c’est-à-dire marchez comme s’il n’était pas là.
Isabelle fit deux pas de côté, sans rien ressentir. Le bras de son mari restait à l’horizontal, désormais seul, entièrement visible. Il le laissa tomber.
– J’avoue ne pas comprendre pour quelle raison lorsque c’est vous, Monsieur, qui cherchez à toucher votre femme, vous ne le pouvez pas, mais qu’inversement votre femme vous touche tout à fait normalement. Ma seconde interrogation vient de l’origine de votre mal. Tient-elle au corps de Madame ou aux mains de Monsieur ? Madame, pourriez-vous vous approcher de Monsieur et tenter de le toucher avec votre pied ?
Isabelle, malgré le comique de la situation, fit ce que lui demandait le praticien. Elle prit la pause d’un karatéka portant un yoko geri. Son mari la regarda étonné en faisant un Ah signifiant qu’elle lui avait fait mal. Il ne dit rien de plus, se massant la poitrine un court instant.
– A vous Monsieur, maintenant.
Il prit plus de précaution et lui toucha une cuisse avec la pointe de son pied. Celui-ci passa au travers sans aucune hésitation.
Aucune des trois personnes présentes n’étaient conscientes du comique de la situation : un homme et une femme, en tenue légère, qui semblaient se battre devant un homme en blanc qui les regardait, perplexe. Ils étaient tous préoccupés par cette énigme incompréhensible et qui risquait de porter ombrage à leur relation. Le professeur s’interrogeait : « Que faire ? Pour quelle raison lorsque c’est Monsieur qui veut toucher Madame cela n’est pas possible, alors que lorsque c’est Madame qui veut toucher Monsieur il n’y a aucune difficulté. La réponse survint au professeur en un instant : c’est une question de volonté et de circonstances psychiques. Monsieur est volontaire. Il aime prendre sa femme dans ses bras et la caresser. Madame aime se laisser prendre et ne pense pas à volontairement prendre son mari dans ses bras. Oui, c’est possible, mais comment leur expliquer ? »
– Je vous remercie de vous être prêtés aimablement à ces différents exercices qui n’avaient d’autre but que de me permettre de comprendre. Vous pouvez maintenant vous rhabiller.
Ils se rendirent derrière le paravent, se regardèrent, se sourirent, allèrent naturellement l’un vers l’autre. Damien arrêta son mouvement, se rappelant son incapacité à la toucher. Isabelle l’embrassa sur la bouche, confiante. Décidément, quel drôle de situation, pensaient-ils tous les deux. Mais cela ne peut durer.
Habillés, assis devant le bureau du professeur, ils attendaient le diagnostic. Mais celui-ci était bien en peine d’en donner un. Alors, pour se donner bonne contenance, il leur expliqua :
– Je commence à entrevoir ce qui se passe. Mais j’ai besoin d’examen complémentaire. Je vous prescris à tous les deux un scanner complet avant de me prononcer.
Il téléphona au centre qui disposait d’un scanner, écrivit une lettre au médecin qui examinerait les résultats et les laissa partir. Il continuait à se demander ce que pouvaient avoir ce couple qui semblait heureux et sans problème.
07:55 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, récit, rêve, réveil, couple, peur |  Imprimer
Imprimer
01/05/2015
Un couple insolite (3)
Ils se retrouvèrent chez eux vers 19 heures. Isabelle, arrivée la première, mit beaucoup de soin à préparer ces retrouvailles. Elle avait décidé de se battre pour que leur mariage ne pâtisse pas de cet événement. Elle prépara un apéritif avec des friandises et attendit, légèrement inquiète. Lorsque Damien introduisit sa clé dans la serrure, Isabelle secoua la tête, se massa le front et commanda son plus beau sourire.
– Bonjour mon chéri. Ta journée s’est-elle bien passée ?
Damien, lui, n’avait de cesse de revoir Isabelle pour la serrer dans ses bras. Mais dans les circonstances actuelles, il n’osait pas se rapprocher d’elle dans la crainte d’être déçu. Il commença par répondre en posant sa serviette sur une chaise, se tenant derrière comme en retrait.
– Pas bien, il faut le dire. Je n’ai cessé de penser à notre aventure et aux moyens d’y faire face. Et toi, comment s’est passée ta journée ?
– J’ai bien travaillé. J’ai téléphoné à Sylvie qui m’a donné l’adresse d’un professeur spécialiste du toucher à l’hôpital Saint Louis. Nous avons rendez-vous demain à 15 heures.
– Quelle bonne nouvelle, dit Damien. J’avoue ne pas comprendre ce qui nous arrive exactement. Je te vois, je t’entends, je sens même ton odeur si douce dans mes narines, mais je ne peux te toucher. C’est comme si tu n’étais pas là. Mes mains passent à travers toi sans même que je sente la moindre résistance. Je pourrai m’assoir sur ton siège, toi présente, comme si tu n’étais pas là ! Je ne connais plus la douceur de ta peau, la courbe de tes seins, et pourtant je sens la caresse de tes cheveux sur mon cou. C’est inexplicable et inextricable.
Elle lui prit la main, la caressa, la porta à sa joue et ne put s’empêcher de laisser quelques larmes s’échapper de ses paupières. Il ne sentait rien. Ils tentèrent de regarder la télévision, assis côte à côte sur le canapé, chacun de son côté, comme deux célibataires. Mais aucun programme ne put retenir leur attention. L’agitation de ces gens sur l’écran n’avait plus de sens pour eux. Ils se couchèrent tôt et ne purent s’embrasser avant de fermer les yeux.
Le lendemain, après une matinée morne et un déjeuner pendant lequel ils ne se parlèrent pas, ils furent introduits dans le bureau du professeur Jean Sédoux, dermatologue, supposé spécialiste du toucher. Il soignait l’acné, l’eczéma, les mélanomes, les mycoses, le psoriasis, les allergies cutanées, les verrues, les angiomes, le lupus, la gale, les corps et durillons et bien d’autres maladies encore liées à l’enveloppe corporelle. Il avait l’assurance des grands professeurs de médecine, l’air gentil, mais sûr de lui, comme s’il savait d’avance ce que le patient a et comment le guérir.
N’ayant pas l’habitude de voir deux patients en même temps, il s’étonna tout d’abord de cette double présence.
– Alors, qui de vous deux est malade ?
Ils ne surent répondre. Certes, Damien semblait à l’origine du mal. Mais Isabelle souffrait aussi de ne pouvoir être touchée. Elle ne sentait rien lorsqu’il passait sa main au travers de son corps. Pourtant, elle n’était pas transparente, elle pouvait se toucher, pincer son bras, enfiler ses collants.
A ces premières explications, le professeur ne comprit rien. De quoi leur parlaient-ils ? Il sourit d’un air incrédule, hocha la tête et leur demanda de recommencer, l’un après l’autre. Damien raconta comment ils avaient constaté cette étrange maladie, sa peur de ne rien sentir dans le lit de la présence de l’autre alors qu’il la voyait. Isabelle détailla ses sensations et ses impressions, sans toutefois arriver à expliquer en quoi elle était atteinte par ce même mal. Elle finit par fondre en larmes sans que Damien puisse la prendre dans ses bras et la consoler.
Le professeur ne souriait plus. Il ne comprenait pas cette étrange maladie qui n’était probablement pas une maladie, mais qui n’était pas non plus d’ordre purement psychique puisqu’elle avait des manifestations très concrètes physiquement. Il demanda à Damien de passer derrière le paravent et de se déshabiller. Après un examen rapide de sa peau, il ne put que dire qu’il ne voyait rien à signaler. Il le frappa avec son marteau à réflexe. Rien à signaler non plus. Il lui demanda de le toucher et même de le pincer. Il ressentit aussitôt les doigts du patient, le pincement normal entre le pouce et l’index. Rien à signaler non plus. Il lui demanda de se rhabiller. Il était perplexe. Peut-être l’examen de sa femme lui apporterait quelques éléments de compréhension.
Il pria donc Isabelle de passe derrière le paravent et de ne garder que ses sous-vêtements. Il la fit s’étendre sur le divan médical et entreprit les mêmes examens que ceux qu’il avait pratiqués sur Damien. Le constat fut le même : rien à signaler. Il lui demanda de se rhabiller, se lava les mains pour se donner une contenance et revint s’assoir à son bureau. Il n’avait aucune idée de ce qu’il se passait. Le temps lui sembla arrêté. Sa tête n’arrivait plus à réfléchir. C’était un grand vide dans ses pensées de praticien qui fit monter en lui une telle transpiration qu’il dut sortir son mouchoir pour garder son sang-froid. Il leur demanda de l’excuser quelques instants et il sortit précipitamment de son cabinet. Ils se regardèrent en souriant. Le praticien était perdu.
07:35 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, récit, rêve, réveil, couple, peur |  Imprimer
Imprimer
29/04/2015
Un couple insolite (2)
Le lendemain, ils se réveillèrent difficilement, chacun restant un moment dans la brume du sommeil avant de se tourner vers l’autre. Damien, le premier, tendit un bras vers Isabelle et se réveilla instantanément. Rien. Isabelle n’était pas là. Il ne rencontrait que du vide. Il se tourna vers elle et la vit. « C’est bien vrai. Ce n’est pas un cauchemar ! Je la vois et je n’arrive pas à la toucher », se dit-il, atterré. Isabelle, quant à elle, ne réalisa la situation qu’en voyant la tête de Damien. Un fossé les séparait dorénavant, l’amour devenait sans objectif puisqu’il était impossible d’étreindre l’amour de sa vie comme il était également impossible de recevoir des caresses de l’être aimé. Isabelle venait en un instant de percevoir l’étendue du désastre. Non seulement Damien ne peut étreindre Isabelle. Mais en contrepartie, Isabelle ne peut recevoir la douceur d’une main sur son corps. « Mutilés, nous somme mutilés », murmura-t-elle pour elle-même. Alors elle se leva, s’approcha de son mari, lui prit la main, le forçant à se lever. Elle le débarrassa de son pyjama et le contempla, nu. Puis elle se déshabilla et s’offrit à son regard, les mains ouvertes, rayonnante de beauté. Ils communièrent ensemble du regard de l’autre et l’espoir revint.
– Ce n’est pas possible. Nous allons tout faire pour guérir, se promirent-ils.
– Dès demain, prenons plusieurs jours de congé et cherchons celui ou celle qui nous guérira, déclara Isabelle.
– Oui, et dès aujourd’hui, je regarde sur Internet ce que l’on peut trouver sur cette maladie, répliqua Damien.
Ils firent leur toilette et s’habillèrent sans rien dire, chacun étant préoccupé par cette situation inextricable. Leur petit déjeuner fut pénible. Isabelle ne put retenir quelques larmes, malgré sa volonté de paraître enjouée comme d’habitude. Damien ne sut comment lui manifester sa déconvenue, puis sa peine. Ils revêtirent leur manteau, descendirent l’escalier et se dirent au revoir sans pouvoir ni s’embrasser, ni même se serrer la main. Se quitter comme deux étrangers leur serrèrent le cœur. Ils réalisèrent en une seconde l’immense solitude dans laquelle ils se trouvaient. Ils firent trois pas, se retournèrent, se regardèrent, les yeux noyés de larmes, se sourirent, impuissants, puis partirent chacun de leur côté.
Arrivé au bureau, Damien se plongea dans son ordinateur. Il chercha toutes sortes de mots-clés et commença par « manque de toucher ». Il tomba sur une note de lecture du Dr Lucien Mias intitulé Je me sens moi…parce que tu me touches. Pour lui, le toucher est le sens le plus « spécifiquement humanisé, le moins candide, le seul réaliste comme le savait Thomas et comme l'apprend très vite l'enfant ». Il poursuit : Il y a 2 500 ans, Anaxagore a dit : « L'homme est intelligent parce qu'il a des mains. » J. Piveteau renversa la formule : « L'homme a des mains parce qu'il est intelligent. » Saint Thomas d'Aquin les met d'accord : « L'homme possède par nature la raison et la main. Cette raison raisonne mal si elle n'engage pas la main. Cette main travaille en vain si la raison ne s'engage pas dans son travail. » Il apprit que certaines personnes ne supportent pas qu’on les touche : « Le contact physique, c’est pire que d’être vue toute nue. Je me sens dévoilée, j’étouffe, j’ai l’impression que c’est le début de la fin. » Mais cette recherche lui parut bientôt vaine. Rien n’est dit sur l’absence bien concrète de toucher, car ce cas-là n’existe pas avec un corps valide et en bonne santé.
Isabelle, en tant que femme, s’enferma dans son bureau et téléphona aussitôt à sa meilleure amie, Sylvie, qu’elle connaissait depuis l’enfance. Elle lui raconta prudemment leur aventure, sans toutefois s’étendre sur leur constat. Sylvie, qui était kinésithérapeute, fut bien sûr étonnée d’une telle affliction. Elle se souvint que pendant ses cours, un professeur leur avait parlé de quelques cas curieux et elle promit de la rappeler après avoir trouvé ses coordonnées. Une heure plus tard, elle rappela Isabelle et lui donna le numéro de téléphone du professeur à l’hôpital Saint Louis. Aussitôt un rendez-vous fut pris avec la secrétaire du médecin pour le lendemain. Isabelle était ravie, elle allait enfin pouvoir reporter sur quelqu’un d’autre leur souci. Son moral ravivé lui permit de passer une journée de travail à peu près normal malgré la pression psychologique de la nuit.
La journée de travail de Damien fut traversée de moments de désespoir. Il n’arriva pas à se concentrer, participa à deux réunions sans pouvoir dire un mot et partit du bureau dès 18 heures. Il n’avait qu’une hâte, retrouver Isabelle et lui demander si elle avait une solution.
07:45 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, récit, rêve, réveil, couple, peur |  Imprimer
Imprimer
28/04/2015
Un couple insolite (1)
Damien est un homme heureux. Il a épousé Isabelle il y a cinq mois. Il l’aime et elle l’aime. Ils travaillent tous les deux, mais rien ne vient troubler leur entente.
– Isabelle, Isabelle, où es-tu ? cria Damien en pleine nuit. Il venait de se réveiller. Il devait être trois heures ou quelque chose comme ça. Il avait étendu son bras droit comme il le fait habituellement. Mais il ne rencontra que le vide.
– Isabelle, Isabelle ?
– Mais je suis là, mon chéri. Pourquoi cries-tu si fort ?
– Mais où ?
– Et bien, dans le lit, à côté de toi.
Damien fouilla de son bras droit l’étendue du lit à la place où elle était censée se tenir. Mais en vain. Il se dit qu’elle avait peut-être changé de place dans la nuit. Il étendit son autre bras, jusqu’au bord du matelas, sans rien rencontrer. Doucement il fouilla des deux pieds le fond du lit. Rien. Pourtant la place était chaude.
– Isabelle, arrête de te moquer de moi !
– Mais je ne moque pas de toi, je suis là, à côté de toi.
– Mais non, tu n’es pas là, je ne touche rien. Oui, je t’entends, tu es surement dans la pièce et même pas loin du lit, mais tu n’es pas dedans. Reviens vite, je t’en supplie, la blague n’est pas drôle à cette heure.
– Je t’assure que je suis là, dans notre lit, à côté de toi. Tiens je touche ta main. Me sens-tu ?
– Oui, c’est vrai. Je sens ta caresse sur ma peau. Comment se fait-il que je ne puisse te toucher ?
– Je ne sais. Tu dois être encore endormi ou mal réveillé. Veux-tu que j’aille te faire un café ?
–Mais non, cela n’a rien à voir ! En tout cas, je ne peux te toucher. Pourtant, je t’entends et le drap est chaud de la chaleur de ton corps. Je veux ton corps. Qu’en as-tu fait ?
– Rien, il est là, près de toi.
– Mais je ne peux le toucher. Que se passe-t-il ?
Isabelle commençait à s’inquiéter : « Qu’est-ce que c’est que cette histoire. Je n’ai jamais entendu parler d’une telle situation ».
– Mais enfin, Damien, cesse de plaisanter. Je viens de me réveiller et je ne suis pas prête à ce genre de blague. Je te touche, je te caresse et tu ne sens rien. Aurais-tu perdu toute sensibilité. Je n’ai jamais entendu une telle idiotie. Un mari qui ne peut saisir sa femme alors qu’elle est dans son lit. C’est absurde !
– C’est pourtant la réalité, je t’assure. Me permets-tu d’allumer. Ferme les yeux de façon à ne pas être aveuglé, puis ouvre-les progressivement.
Isabelle fit ce que Damien lui demandait. Elle le voyait à côté d’elle, l’air inquiet, blanc comme un linge. Il la voyait, elle était bien là, mais il ne pouvait la toucher. Il ne rencontrait que le vide. Il avança le bras, tendant son index avec douceur, mais rien. Comme si sa femme n’était pas là. Et pourtant il la voyait, parlait avec elle, sentait le poids de ses mains sur son corps. Elle s’approcha de lui et lui fit un baiser sur la joue, puis sur la bouche. Il les sentit, s’en trouva mieux, mais dès qu’il essaya de la prendre dans ses bras, il ne rencontra que le vide. Rien, un trou d’air.
– Ce n’est rien, mon chéri. Rendors-toi. Demain matin tout ceci sera passé. Je serai à toi et tu seras à moi, comme d’habitude.
Ne pouvant rien faire de plus, il finit par se laisser persuader que ce n’était qu’une impression passagère qui cesserait dès qu’il aurait à nouveau dormi. « Le réveil laisse parfois des restes de mauvais rêves qui sont longs à évacuer. Et puis, elle est là malgré tout. Elle me parle, elle me caresse, je la vois, je l’entends. Ah ! Est-ce que je sens toujours son parfum chanel N°5 ? » Il se pencha sur elle, ou plutôt sur l’endroit où il croyait qu’elle se trouvait. Oui, il retrouvait ce parfum élégant qui faisait sa personnalité. Il s’y était habitué. Mais aujourd’hui cette fragrance lui tournait la tête, réveillait en lui la chaleur de l’amour, l’association entre le toucher et l’odorat.
– Ma chérie, où es-tu ? Je te sens comme lorsque je j’enfouissais mon visage dans le creux de ton cou, mais je n’ai plus cette sensation d’appartenance qui fait de l’amour un don suprême. Comment allons-nous nous aimer maintenant que je ne peux te toucher ?
– Rendors-toi, attends demain. Tout ceci n’est qu’un mauvais rêve.
Elle se tourna sur le côté, gardant la main sur la cuisse de son mari qui, lui-même, se laissa réchauffer par ce geste féminin. Il eut du mal à s’endormir. Il fermait un œil et se réveillait en sursaut. Enfin, il se laissa glisser dans un rêve sans fin le long d’un tunnel qui l’isolait de la réalité. Ce fut le noir jusqu’au matin.
07:47 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, récit, rêve, réveil, couple, peur |  Imprimer
Imprimer
06/03/2015
L'île Maurice
Il se promenait sur l’esplanade des Invalides quand une femme, encore jeune, élégante et vêtue de vert, se heurta à lui. Peut-être était-il distrait ? Il s’excusa de bonne grâce, dénonçant sa distraction. Elle le regarda et s’exclama :
– Emmanuel, je ne m’attendais pas à te trouver ici.
Il la regarda sans la reconnaître. « Mais qui donc est cette femme ? » Incapable du moindre souvenir, il leva son chapeau et lui dit :
– Désolé, mais je ne crois pas que nous nous connaissions.
– Voyons, tu es bien Emmanuel Lissacre. Nous nous sommes rencontrés à l’île Maurice, il y a quatre ans. Nous avons même déjeuné ensemble, nous sommes baignés et avons fini la soirée à Grand Baie.
– Mais, je ne suis jamais allé à l’île Maurice.
Elle avait pourtant bien prononcé son nom. Il la regarda plus attentivement. Elle jouait de ses yeux de manière instinctive. Elle souriait aimablement, tout à fait à l’aise, inconsciente du malaise qui s’infiltrait en lui. Elle lui posa même la main sur l’avant-bras comme pour attester d’habitude de camaraderie, voire peut-être plus. Elle sortit son portefeuille, fouillant dans un tas de photos sans cependant arriver à retrouver celle-ci qu’elle désirait lui montrer. Il la regardait d’un air quelque peu égaré, cherchant toujours en sa mémoire des souvenirs d’un séjour à l’île Maurice. Certes, il en avait bien entendu parlé, mais ce n’était que par amis interposés. Pour se rassurer, il se dit que cette personne qu’elle croyait reconnaître était probablement un sosie. Cependant… Son nom… prononcé clairement devant lui… Peut-être l’avait-elle entendu peu avant dans la conversation qui avait précédé son départ du café où ses amis et lui-même se détendaient. Mais pourquoi serait-elle venue ensuite se heurter à lui ?
– Puis-je vous demander votre nom ?
– Je suis Claire Parfaite. Souvenez-vous, nous avons dansé ce soir-là et vous m’avez même sérieusement pris dans vos bras, puis nous avons marché le long de la côte en parlant si longtemps que vos amis sont partis à notre recherche. Ecoutez, si vous avez le temps, venez, j’habite à deux pas et je vous montrerai les photos que je croyais avoir sur moi.
– Pourquoi pas, répondis-je, intrigué par cette femme que je ne connaissais pas il y a cinq minutes.
Tout en me guidant dans les petites rues proches de l’esplanade, elle papotait sans arrêt, évoquant ces instants à Grand Baie où elle s’était sentie si bien, prétendait-elle. Arrivé à la porte de son immeuble, je croyais déjà la connaître, sa faconde faisant merveille. Claire monta au quatrième étage, sortit sa clé, ouvrit sa porte, entra, puis me fit pénétrer dans une grande salle encombrée de meubles hautains. Elle retira son manteau et se mit aussitôt à fouiller une sorte de coffre, fort beau d’ailleurs, qui contenait une multitude de photos entreposées en vrac. Elle en sortit moins d’une dizaine, ficelées ensemble, entourées d’un papier sur lequel était marqué « Ile Maurice, printemps 2004 ».
– Regardez, me dit-elle d’un ton convaincu.
En effet, la première photo qu’elle me montra laissait apparaître un groupe de jeunes gens où elle apparaissait au premier plan et moi, oui, c’était bien moi, derrière elle, une main sur son épaule. Une seconde photo nous montrait étendus sur la plage, riant et nous tenant la main. Aucun doute, non seulement nous nous connaissions, mais nous avions fait plus que connaissance. Elle me fit assoir sur le canapé, me dit de regarder à nouveau les photos et sortit préparer du café. J’étais troublé. Je n’avais aucun souvenir de cette femme, de l’île Maurice, de la plage exotique présente sur chaque photographie. Je cherchais à me rappeler ce que je faisais au printemps 2004. Oui, j’étais en Suède, en mission pour ma boîte, très pris et ne pouvant disposer de mon temps comme je l’aurais souhaité. Pourtant c’était bien moi, là à côté d’elle, lui souriant et semblant répondre à ces caresses. Elle revint, portant un plateau avec deux tasses et un présentoir contenant des petits gâteaux. Oui, elle était belle, ou plutôt mignonne avec son visage rond, les yeux mobiles, les lèvres charmeuses. Je me dis que j’aurai très certainement tenté de la séduire si je l’avais rencontré. Alors je me laissais tenter après l’avoir entendu me dire :
– Pour te prouver que je te connais, je peux même te dire que tu as sur le haut de la cuisse droite une tache brune qui m’avait intrigué et séduite. Ai-je raison ?
Effectivement, cette tache se transmettait dans ma famille depuis plusieurs générations sans que nous en comprenions les raisons. Plutôt que de répondre, je me penchais sur ses lèvres et y déposais un baiser.
– Doucement, me fit-elle. Nous ne nous étions pas jurés fidélité et longue vie ensemble. Il convient de tout reprendre à zéro.
Mais rien ne se passa ainsi. J’eus beau chercher dans ma mémoire les instants évoqués par cette femme, j’étais sûr de ne pas la connaître, ni même de l’avoir déjà vue. Elle semblait persuadée du contraire. Je lui demandais comment nous nous étions connus.
– C’est très simple. Je me promenais sur Quay street lorsque je me suis heurté à un homme. Celui-ci m’accueilli d’un air enchanté : « Claire, que fais-tu là, je te croyais à Paris ! » J’étais pressé ayant un rendez-vous chez un marchand de biens et voulant conclure l’affaire assez vite. Je lui donnais rendez-vous en début d’après-midi. Nous nous revîmes et c’est ainsi que je fis ta connaissance, car cette personne, c’était toi.
– Pourriez-vous me remontrer les photos, s’il vous plaît.
Elles étaient là, sur la table basse. L’une d’elle avait été prise à l’aéroport. Je me souvenais subitement avoir vu sur le tarmac la queue d’un A380. En examinant à nouveau la photo je constatais qu’il en était bien ainsi. Or les A380 ont été mis en service en 2007. Nous étions en 2008 et elle m’avait dit que nous nous étions rencontré il y a quatre ans. C’était invraisemblable. Elle m’aurait rencontré dans le futur en évoquant une rencontre passée il y a quatre ans et nous devisions ensemble dans le présent de 2008, l’une persuadée de m’avoir connu dans le passé, moi-même certain de ne l’avoir jamais rencontrée. Ma tête allait exploser. Je me sentis mal et lui demandais un verre d’eau fraiche. En buvant, je la regardais. C’est vrai qu’elle est belle, me dis-je. Elle se pencha sur moi pour reprendre le verre, inquiète, mais rassurée de me voir reprendre vie. Elle portait un parfum fort qui imprégnait ses cheveux et je fus ensorcelé par cet arrière-goût d’ambre et de fruits verts. Je plongeais ma tête dans sa chevelure. Elle rit et se dégagea sans protestation.
Je ne lui fis pas part de ma découverte. Je l’avais connu dans un futur proche et c’est pour cela que je ne pouvais la reconnaître. Mais comment se retrouvait-elle dans ce présent qui, pour elle, était du passé ? Deux solutions s’offraient à moi. Soit elle seule avait été propulsée dans un avenir proche (ou encore avait-elle rêvé cet avenir ?), soit c’était moi-même qui était resté enfermé un moment dans le passé, peut-être au cours d’une nuit de sommeil plus longue que de coutume.
Je décidais de rien lui dire et de faire comme si nous nous connaissions réellement. Deux jours plus tard, avec quelques amis, nous partîmes pour Grand Baie en voiture. L’un de ceux-ci disposait d’un appareil photographique polaroid et ne cessait de prendre des clichés. A un moment, il me montra une photo de Claire et de moi-même que j’avais déjà vu. Mais je ne souvenais plus où. Etait-ce à Port Louis, était-ce ici, à Paris ? Fidèle à ma promesse, je ne dis rien. Nous sommes bien, je contemple Claire, je lui tiens la main, nous regardons nos compagnons se baigner. Je pose sur ses lèvres un baiser.
– Que le temps présent est bon, me dit-elle. Profitons-en !
– Oui, profitons-en, car on ne sait de quoi demain sera fait, lui répondis-je.
07:48 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écriture, récit, nouvelle |  Imprimer
Imprimer
03/03/2015
Matinale 5
Avant de reprendre le chemin de la piscine, Emilie décida de faire de nouvelles recherches. Elle s’intéressa aux univers parallèles découverts par le physicien américain Hugh Everett en 1957. Elle se souvenait d’avoir lu un jour que quelques savants se posaient la question de savoir de quel lieu notre propre univers était issu et laissaient tomber la question plus subtile de l’existence d’une créateur démiurge. Le continuum se poursuivrait-il au-delà de ce que nous connaissons ? Y aurait-il des relations entre notre espace-temps-matière et d’autres spatialités-temporalités-matérialités ? Elle imaginait des trous noirs constituant des entrées dans ces autres univers, elle se sentait tout à coup prise dans le tourbillon attractif d’un grand vide qui conduisait vers un au-delà inimaginable, peuplé de créatures étranges ou même d’êtres humains semblables à nous ou sans doute nous-mêmes. Après un séjour sur terre, ils poursuivent leurs vies multiples en d’autres lieux et d’autres temps, peut-être sans matérialité. Insaisissable cette vision ! Mais elle aimait s’interroger sur cet aspect des choses. Feuilletant les pages d’Internet, elle découvrit que l’univers n’est plus seul et unique comme son nom l’indique. Grâce aux sciences mathématiques, nos savants ont découvert qu’il est très probable que l’univers soit multivers. De plus, elle lut que l’on commence à avoir des preuves de cette géniale intuition. Ainsi la bulle de notre univers, qui s’étend de plus en plus dans l’espace (mais peut-on encore parler d’espace ?), en expansion constante, côtoie d’autres univers qui naissent et meurent à côté de nous (tout est relatif, ce sont des milliards et des milliards d’années-lumière, immesurables !).
Andrei Linde, un des théoriciens de l’inflation, explique que notre univers est une bulle d’espace-temps noyée dans une mousse d’autres univers. Ainsi le big-bang n’est pas la naissance du cosmos à partir du rien, mais une expansion dans un « faux vide ». Ce faux vide se caractériserait par une énergie très élevée et un champ gravitationnel répulsif, une sorte de gravitation " négative " ou antigravitation : remplissez un ballon de faux vide, il se dégonfle ! Cette expansion de bulles donne naissance à des bébés univers possédant leur propre temps, espace et matière.
Elle dut arrêter sa lecture. La tête lui tournait, d’autant plus qu’elle se sentait à l’aise avec ces mondes multiples, ces temps qui se superposent, ces espaces qui gravitent ensemble, ces particules mouvantes qui arrivent à ne pas trébucher. Elle était attirée par ces champs gravitationnels, voire par des champs qui au contraire rejettent ce qui passent à proximité. Déjà, lorsqu’elle était petite, elle rêvait (mais était-ce du rêve ou une remémoration venant d’autres horizons ?) qu’elle pouvait se dédoubler, voler à hauteur du plafond, voire tenter de s’évader par la fenêtre fermée et voguer dans d’autres cieux, un monde différent qu’elle ne parvenait pas à reconstituer. Ce n’était qu’une question de volonté et d’entraînement. Mais ces rêves s’estompèrent au fil des ans jusqu’à ne plus être qu’un vague souvenir. Ils restaient au fond de ses souvenirs, tenaces et semblant toujours aussi réels.
Poursuivant ses investigations, elle s’intéressa à l’exploration de l’infiniment petit qui permettrait de comprendre l'infiniment grand. La théorie des cordes prétend que les particules fondamentales de l’univers sont des sortes de cordes vibrantes sous tension, à la manière d’un élastique. Leur degré de vibration engendrant des particules élémentaires qui sont à l’origine de notre univers. Dans ce concept (qui reste pour l’instant théorique), le monde serait non pas tridimensionnel, mais multidimensionnel. Et ces dimensions s’enroulent les unes dans les autres dans un tissu spatial dit espace de Calabi-Yau qui constitue une forme complexe de 6 dimensions. Ainsi, l'univers observable à quatre dimensions (la quatrième étant le temps) serait une sous-partie d’une Totalité disposant de dimensions supplémentaires, pouvant aller jusqu’à 11 pour certains.
La théorie des cordes suppose que l’univers est fondamentalement constitué de cordes d’énergie en vibrations constante. Elle voit l’univers comme une immense symphonie. Et cette comparaison sembla assez bonne à Emilie. Les dimensions de notre univers sont normalement décrites dans un système décimal (multiple et sous-multiple de dix) alors que la musique fonctionne autrement, de façon beaucoup plus complexe, et permet des variations et harmonies impossibles dans un système décimal.
Dans sa recherche, elle tomba sur un livre qui traitait de l’uchronie. Ce terme utilisé dans la fiction littéraire, fait appel à une réécriture de l’histoire à partir d’une modification d’un événement passé. Ce néologisme repose sur la similitude avec l’utopie, c’est-à-dire un U négatif et chronos. C’est donc un non-temps qi permet d’imaginer les différences conséquences possibles issues d’un effet domino influant sur le cours de l’histoire. C’est une histoire refaite logiquement telle qu’elle aurait pu être qui commence au point de divergence choisi par l’auteur. Mais elle se rendit compte que cette diversion ne pouvait l’intéresser dans ses recherches. Le problème n'est pas le fait d’une uchronie qui survient à un moment donné, mais le fait de l’existence de deux mondes parallèles qui se retrouvent présents au même moment et en un même lieu. J’y réfléchirai plus tard, se dit-elle.
La sonnerie indiquant la fermeture de la bibliothèque retentit. Elle mit un certain temps à la percevoir, l’esprit trop occupé par toutes ces hypothèses aussi insolites que bizarres. Elle se leva à regret, rangea son bloc-note et ses crayons, l’œil vague, le corps engourdi, le cerveau flottant dans une mare d’impossibles réflexions. Elle rentra chez elle, reprenant peu à peu conscience du monde qui l’entourait, sursautant lorsqu’une voiture la frôlait ou lorsqu’un camion klaxonnait. Elle se coucha tôt, la tête encore pleine d’univers s’entrechoquant et d’humains sautant dans le vide pour atterrir elle ne savait où.
07:27 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, nouvelle, écriture, littérature, fiction |  Imprimer
Imprimer
08/02/2015
Acédie
L’homme n’en pouvait plus. Il avait marché toute la journée et le soir tombé. Il s’assit sur la pierre et prétendit n’en point bouger. Elle tenta vainement de l’entraîner à sa suite, sans succès.
Il lui confia son mal : le noir de la nuit correspondait en lui à un noir de l’entendement. Il ne savait ni où il était, ni quel jour il était. Plus rien ne lui permettait de se rattacher à l’espace et au temps. Il attendait la fin de cette acédie avec patience, pensant dans le vide de son encéphale jusqu'au lever du jour.
Errer sans fin dans les plis de son cerveau, parmi les vagues délirantes et blanchâtres, s’enrouler sans tomber entre les neurones, n’est pas une promenade de santé. Il poursuivait en rêve son voyage de la journée, mais sans ressentir la fatigue liée à la pesanteur. Il était dans un état de grâce dans lequel tout devient charme. Le sourire aux lèvres, la pipe à la bouche, il allait sans fatigue, sans prendre garde aux voleurs d’idées à un carrefour de rues. Plus rien dans la caboche et un corps frêle et harassé qui n’offre aucun refuge aux âmes qui errent sans savoir où elles vont. Il poursuivit longtemps ce double de la vie jusqu’au moment où il se sut évadé.
Flash ! Que fait-il dans cette galère ? Il se retourna, ne vit rien que le vide, fit à nouveau demi-tour et ne vit toujours que le vide. C’est sur cette tête d’épingle qu’il persista dans son existence, loin du monde et des hommes, enlacé des circonvolutions du temps et de l’espace.
Bienheureux cet homme qui sut ne pas se poser de question devant l’absurdité de la destinée.
07:14 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, poème, destin, existence, société |  Imprimer
Imprimer
27/01/2015
Les dix enfants que madame Ming n’a jamais eus, d’Eric-Emmanuel Schmitt
La Chine, c’est un secret plus qu’un pays. Madame Ming, l’œil pointu, le chignon moiré, le dos raidi sur son tabouret, me lança un jour, à moi, l’Européen de passage : nous naissons tous frères par la nature et devenons distincts par l’éducation. Elle avait raison… Même si je la parcourais, la Chine m’échappait. (…)
La tête ronde 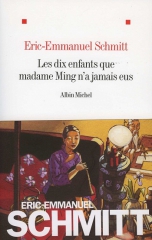 d’une couleur éclatante, des plis nets sur la peau, des dents, aussi fines que des pépins, madame Ming évoquait une pomme mûre, sinon blette, un brave fruit, sain, savoureux, pas encore desséché. Mince, son corps semblait une branche souple. Sitôt qu’elle s’exprimait, elle s’avérait plus acidulée que sucrée car elle distillait à ses interlocuteurs des phrases aigrelettes qui piquaient l’esprit. En cette province de Guangdong, madame Ming trônait sur son trépied, au sous-sol du Grand Hôtel, entre les carreaux de céramique blanche et les néons éblouissants, dans ces toilettes à l’odeur de jasmin où elle exerçait la charge de dame pipi.
d’une couleur éclatante, des plis nets sur la peau, des dents, aussi fines que des pépins, madame Ming évoquait une pomme mûre, sinon blette, un brave fruit, sain, savoureux, pas encore desséché. Mince, son corps semblait une branche souple. Sitôt qu’elle s’exprimait, elle s’avérait plus acidulée que sucrée car elle distillait à ses interlocuteurs des phrases aigrelettes qui piquaient l’esprit. En cette province de Guangdong, madame Ming trônait sur son trépied, au sous-sol du Grand Hôtel, entre les carreaux de céramique blanche et les néons éblouissants, dans ces toilettes à l’odeur de jasmin où elle exerçait la charge de dame pipi.
C’est à la suite d’un mensonge qu’il fit véritablement connaissance de madame Ming. Il avait laissé tomber une photo et elle lui demanda : Ce sont vos enfants, monsieur ? Par vanité, fierté ou pour rire, il répondit oui. Et vous ? J’en ai dix. Connaissant les conditions imposées par le gouvernement sur les naissances (un par famille), il n’en croyait pas ses yeux. Et au long de ces 44 pages, elle va raconter l’histoire de ses dix enfants : la sixième Li Mei, un peu voyante ; les jumeaux, Kun et Kong, acrobates au cirque national ; la petite Da-Xia, qui rêve d’assassiner madame Mao ; Ho, le joueur ; Ru, un monstre de mémoire, et Zhou, un monstre d’intelligence ; Wang qui fabrique des jardins chimériques, jardins de mots ; Shuang, le dixième, qui ne peut s’ »empêcher de claironner la vérité. Mais madame Ming se fait renverser par une voiture et c’est à l’hôpital qu’il fait la connaissance de Ting Ting, sa fille ainée. Celle-ci lui dévoile qu’elle n’a ni frère, ni sœur. Pour entretenir son rêve, sa fille met ses proches à contribution. Ils écrivent à madame Ming. Aussi celle-ci, croyant à ces derniers jours, lui demande de réunir ses frères et sœurs. Et sa fille y arrive : ils sont tous venus.
C’est un conte magnifique, écrit remarquablement, par petites touches, entrecoupé de séjours dans les toilettes et interrompu par les clients pressés. Chaque enfant y est dépeint en quelques mots bien placés, comme un tableau mobile où sa vie apparait en arrière-fond. Madame Ming reste la même, semblable à son pays, énigmatique. Et peu à peu, il se construit une personnalité chinoise qui devient réalité lorsque sa maîtresse parisienne lui annonce la naissance d’un fils. Elle avoue qu’elle ne sait de qui réellement. Mais sa réponse la surprend : la vérité m’a toujours fait regretter l’incertitude.
07:55 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : liver, littérature, récit, chine |  Imprimer
Imprimer
04/07/2014
Qui ai-je rencontré ?
Hier, il m’est arrivé une chose bien étrange. En route pour le quartier latin, en vélo comme à mon habitude, je me suis aventuré dans une petite impasse en pensant gagner du temps. Elle était joyeuse, emplie de restaurants et de magasins sympathiques. J’y croisai d’ailleurs quelques connaissances dont Madeleine que je n’avais pas vue depuis un moment. Enfourchant mon vélo, je repartais vers la sortie lorsque je fus brusquement projeté à terre par un choc entre les deux yeux. J’avais heurté un poteau signalétique portant l’inscription « Interdit aux cycles ». Encore égaré par ma chute, nageant dans un brouillard épais, je décidai de laisser mon vélo et de poursuivre à pied. Je reviendrai le chercher demain.
L’attachant au poteau, je me redressai pour me diriger vers la droite dans une étroite ruelle menant vers la sortie de l’impasse. Quelle ne fut pas ma surprise de voir un cycliste s’engager dans la ruelle de gauche, très décontracté, une main dans la poche, l’autre tenant de manière désinvolte son guidon. Il était habillé comme moi, ce qui m’intrigua. Je le regardai de manière plus détaillée. Même coupe de cheveux, même air un peu détaché et ahuri, mais décidé et allant de l’avant. Mais… Je ne comprends pas… On dirait que c’est moi… Mais oui, il n’y a pas de doute. Je tentai de courir derrière lui, mais il était déjà loin. Revenant sur mes pas, je réfléchis. Un sosie probablement. La chance de rencontrer son sosie est très faible. Je n’avais jusqu’à présent pas vu quelqu’un qui me ressemblait. Cette idée m’amusa. Je refis demi-tour et, en courant, essayai de rattraper l’homme. Peine perdu. Il avait disparu. J’interrogeai un garçon de café. Mais comment lui expliquer que je me cherchais moi-même ? Un client cependant pu me renseigner : « Il est passé là il y a deux minutes. Je l’ai regardé parce qu’il marchait bizarrement. Il semblait glisser sur le macadam. Ça m’a intrigué et puis j’ai pensé à autre chose ! » Je le remerciai et poursuivis dans la ruelle, courant à moitié. Il ne s’était pas trompé. Je le vis à cinquante mètres de là regardant une vitrine. Celle-ci était lumineuse. Un bouddha trônait en devanture, plantureux, doré à souhait. Je me dis : « Il me copie ! Il aime ou fait semblant d’aimer la tranquille sérénité de Siddhārtha Gautama, le plus grand éveillé. »
Il poursuivit sa route, regardant à droite et à gauche les curiosités des boutiques et les passants. Il tenait son vélo à la main et ne semblait pas importuné par son volume et son poids. Ah, il l’attache à une grille. Que va-t-il faire ? Il entra dans une boutique. Je me postai devant la sortie, bien décidé à lui poser la question de sa présence sur les lieux. Il sortit tenant à la main un petit paquet. « Excusez-moi, mais est-il possible d’acheter un double de ce que vous tenez dans la main ? » Il me regarda tranquillement, ne semblant pas comprendre ce que j’entendais par un double. « Oui, bien sûr. Il suffit de le demander. Entrez donc ! » Je l’observais avec curiosité, trouvant la ressemblance étonnante. Il ne semblait pas s’en apercevoir. J’étais pour lui quelqu’un croisé dans la rue avec qui on échange quelques mots anodins. Je voulais en être sûr, aussi lui posai-je la question qui me taraudait : « Excusez-moi, mais j’ai l’impression que nous connaissons. Pas vous ? » « Je ne crois pas. Votre tête ne me dit rien. Peut-être confondez-vous avec quelqu’un d’autre. » Là-dessus il me salua d’une inclinaison de tête et poursuivis sa route. J’en restai interloqué. Comment n’avait-il pas remarqué cette ressemblance extraordinaire entre lui et moi ?
Il reprit sa bicyclette et poursuivit en la tenant par le guidon, tranquillement. Je le regardais, étonné, ébahi même, car c’était bien moi. Certes, me voir sous le jour d’un autre me donna une nouvelle vision de moi-même. Je ne pensais pas ainsi pencher la tête légère chaque fois que je regardais quelque chose qui me plaisait. Je ne pensais pas non plus être si mobile dans mes attitudes, tantôt en ayant l’air fatigué, tantôt complètement éveillé et vif. Une vraie girouette ! Ah, il passe près d’un mendiant. Il poursuit son chemin comme si de rien n’était. Quel chien, pourtant il a de l’argent ! Cette fois il laisse passer une vieille femme qui marche avec lenteur et qui ne le remercie pas. Mais son sourire me dit qu’il n’en est en rien affecté.
Arrivé au bout de l’impasse, il entra dans une sorte de tunnel percé dans une maison et qui permettait de ressortir dans la rue. Je hâtai le pas pour ne pas le perdre de vue, mais à la sortie je le vis qui pédalait avec célérité, semblant prendre le chemin de mon appartement. Je ne vais tout de même pas le retrouver chez moi ! Je pris le métro, laissant mon vélo attaché, car je n’étais pas encore très sûr de mon équilibre. J’arrivai à mon adresse, montai quatre à quatre les escaliers, ouvris la porte de l’appartement. Rien ! J’étais bien seul. J’avoue que je me suis étendu sur mon lit, j’ai fermé les yeux et me suis endormi, épuisé et encore secoué par ma chute.
J’ai même rêvé que je rencontrais mon double, quel drôle de rêve !
07:33 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, nouvelle, écriture |  Imprimer
Imprimer
05/05/2014
Une femme
Elle se tut. Plus rien ne pouvait la faire parler. Elle le regardait, horrifiée. Pourquoi lui parlait-il de César, cet homme qui fit le tour du monde sur un canot pneumatique. Il était mort une nuit d’été, sur une plage, après avoir traversé le Pacifique. On ne le retrouva que quinze jours plus tard, quasiment momifié par le soleil ardent. Il s’était étouffé avec sa langue qui avait grossi par manque d’eau potable. Au bord de la mer !
Elle l’avait connu à San Francisco, plus exactement à Sausalito. Il jouait de la guitare sur la plage, seul, chantant parfois ou plutôt fredonnant, à la manière de Glenn Gould, pour se donner du sentiment. Il l’avait vu, s’était levé, était allé vers elle, l’avait regardé dans les yeux et avait déposé sur ses joues deux baisers tendres. Ils s’étaient assis, il avait repris sa guitare et joué une passacaille de Bach. Elle avait été conquise et était restée avec lui.
Cet homme, César, jouait sans cesse. Le jour, la nuit, il faisait entendre sa complainte et les larmes montaient aux yeux de ceux qui l’écoutaient. Il faisait surgir dans la tête des auditeurs des images captivantes d’îles lointaines, aux falaises inaccessibles, où chacun se trouvait seul face à lui-même, sans peur. Quel réconfort, se voir tel que l’on est sans avoir crainte de souvenirs pénibles. Etait-ce des souvenirs d’ailleurs ? Sûrement pas ! Plutôt une nostalgie d’un passé révolu, une ombre sur la réalité qui doublait le vrai souvenir. Cette musique transformait les pensées, donnait de l’intelligence à ceux qui n’avait pas fait d’étude, rendait beau les hommes et les femmes médiocrement chatoyants, accordait à chacun un plus indéfinissable qui le transformait.
Mais César, un jour, sans crier gare, s’arrêta de jouer. Il perdit la délicatesse de son toucher, l’arrangement des notes entre elles qui charmait ceux qui l’écoutait, ce pincement au cœur qu’il apportait à tout un chacun, gratuitement. Que s’était-il passé ? Il ne sut le dire. Il pleura longuement sur cette perte, mais rien n’y fit. Il partit même en pèlerinage, espérant une faveur du ciel. Mais celui-ci resta muet et inactif. Elle vécut difficilement ces moments de découragement. Elle tentait de l’accompagner, de le soutenir, lui racontant des histoires d’amour et de bonheur. Mais rien ne consolait le musicien de la perte de son talent. Un matin, il lui dit :
– Je vais partir loin d’ici. Dieu m’a abandonné. Je dois tenter de le retrouver, même si j’y perds ma vie.
Elle aurait bien voulu le retenir, mais rien n’y fit. Il acheta un canot pneumatique, fit quelques provisions et un soir, alors que la nuit commençait à tomber, il lui dit au revoir de deux baisers tendres sur les joues, fermant ainsi les instants de bonheur dans une boucle du temps, une bulle intègre qui ne s’ouvrirait plus.
Elle apprit par le journal télévisé qu’il avait traversé l’Atlantique à bord de son zodiac et avait essuyé une tempête. Elle avait regardé sa photo, celle d’un homme usé, presqu’hagard, mais encore jeune et vert. Elle avait pleuré, mais elle savait qu’il était inutile de vouloir renouer. Il cherchait Dieu et il ne le trouvait toujours pas.
Il erra longuement le long des côtes d’Afrique, descendant jusqu’au Cap en plusieurs mois de mer. La photo montrait un homme amaigri, les cheveux rares, mais le regard toujours aussi brûlant. Comment fit-il pour gagner l’Australie ? Personne ne le sait. Un jour, elle vit César, à moitié nu, la peau tannée et parcouru de crevasses, à côté de son canot à Peppermint Grove Beach au sud de Bunbury, entouré de personnes qui le regardaient d’un air admiratif. Bien qu’affaibli, il gardait sa fierté rude qui le distinguait des autres. Il dut cependant se reposer plusieurs mois avant de reprendre la mer pour la grande traversée. La télévision annonça son départ. On le vit monter dans son canot, donner des coups de rames et s’enfoncer dans la brume. On n’entendit plus parler de lui pendant plusieurs mois, jusqu’au jour où le petit écran montra son cadavre desséché, les yeux ouverts sur le monde, raide et beau d’insolite et de désespoir.
Elle pleura quelques jours cet amour qui l’avait entraîné à partager avec lui plusieurs années. Elle rêva de plages inaccessibles, de mers démontées. Elle entendit la nuit des cris d’épouvante, elle eut soif chaque soir avant d’aller dormir, ou, au moins, se reposer sur un lit de fortune. Elle entendit une voix qui lui criait : « Viens, viens, viens… » Elle rencontra celui qui avait connu César lors de son périple. Elle l’écouta, le regarda et sa décision fut prise. Le lendemain, elle acheta un canot pneumatique, dit adieu à quelques amis, regarda une dernière fois le Golden Gate Bridge, et rama sans un regard en arrière, la musique plein la tête, les yeux rougis et le cœur léger. On ne la revit plus. Aucune trace d’elle ne fut retrouvée. Qu’est-elle devenue ? A-t-elle trouvé ce que César cherchait ? Nul ne le sait. Une chapelle fut érigée sur un promontoire. Une plaque gravée annonçait : « Elle n’a cru qu’à Lui, en un homme ou en Dieu ? »
07:14 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, nouvelle, littérature, insolite |  Imprimer
Imprimer
19/03/2014
Le prix de mon âme, notes pour servir à la vie d’un sculpteur, de Vincent Batbedat (Editions Alain Gorius, 2012)
 Un livre écrit par un sculpteur, pour les sculpteurs et… les autres, ceux qui s’intéressent à la sculpture. C’est son sang, son combat contre l’adversité, le manque d’argent, la fête malgré tout et la réflexion sur la vie d’artiste. Cela semble ennuyeux au début, il se répète, s’étend sur sa vie et celles de ces amis, sculpteurs évidemment. Mais, en se forçant un peu (il m’a fallu deux mois !), on découvre la destinée d’un sculpteur, sa hargne à sculpter envers et contre tous, sa peine, ses joies et le respect de l’œuvre, infinie.
Un livre écrit par un sculpteur, pour les sculpteurs et… les autres, ceux qui s’intéressent à la sculpture. C’est son sang, son combat contre l’adversité, le manque d’argent, la fête malgré tout et la réflexion sur la vie d’artiste. Cela semble ennuyeux au début, il se répète, s’étend sur sa vie et celles de ces amis, sculpteurs évidemment. Mais, en se forçant un peu (il m’a fallu deux mois !), on découvre la destinée d’un sculpteur, sa hargne à sculpter envers et contre tous, sa peine, ses joies et le respect de l’œuvre, infinie.
Une anecdote nous raconte qu’un amateur (un amateur est pour nous : celui qui aime), dans l’atelier de Giacometti, remarqua une sculpture sous une table et demanda au Sculpteur pourquoi elle était placée là. En était-il moins satisfait que des autres ? Pourquoi la reléguer, la dissimuler presque ? Là ou ailleurs, dit Giacometti, cela n’a aucune importance. Si cette sculpture possède assez de pouvoir, elle trouvera bien le moyen de se faire remarquer et de sortir de là. Oui la sculpture pouvait attendre et même attendre longtemps dans la poussière sous la table. Mais elle était prête, accomplie, finie, définitive. Une laborieuse finition de venait son accomplissement. De corvée, l'acte s'anoblissait. Ce travail ingrat, qui pouvait être accompli par n’importe lequel des hypothétiques manœuvres ou assistants que je n’aurai jamais, devenait essentiel. Ce n’était plus du temps perdu, du talent perdu. Le vieux disait : « Le prix de ton âme », et je commençai à saisir le sens de sa boutade. Et la lime devint véritablement mon amie.
Et moi aussi, j’appris alors le sens du retour à la tâche, au geste simple, tel que reprendre un livre pour en extraire son âme. Et peu à peu, à force de reprendre ce livre par petites phrases, j’en vins à l’apprécier, à y trouver des perles de vie, de petites choses qui semblent sans intérêt, mais qui font une vie de sculpteur ou de tout métier. Les petits riens sont l’essentiel d’une vie. Ils répondent de manière directe (mais cela se fait indirectement) à la question : Que cherches-tu ? Cette question fut un des phénomènes étranges de mon existence. D’où venait-elle ? Qui ou quoi me l’avait insufflée ? Elle vint se ficher dans ma tête comme un piquet, depuis mon enfance, je crois. Mais dans ma jeunesse, je ne lui prêtais guère attention car je croyais avoir trouvé la réponse : la Sculpture.
(…) Que cherches-tu, sinon à transgresser les limites de ton esprit à travers le moment où, dans le travail, ta pensée se dilue dans l’œuvre ? Su tu limes, ta pensée devient lime (…) C’est le moment où l’homme et l’œuvre s’unifient et ne font qu’un, où celui qui fait et celui qui est fait ne se distinguent plus ? Mais en réalité tu ne transgresses rien car l’esprit n’a pas de limites et les obstacles que tu trouves, ce sont ceux que tu dresses toi-même au devant de toi, parce que tu crains de découvrir un pan d’inconnu. Et l’inconnu est ce qui effraie le plus l’homme. Mais la liberté n’est qu’au prix de ce dépassement-là.
07:48 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, récit, littérature, sculpture, artiste leçons de vie, impression |  Imprimer
Imprimer
26/02/2014
Sauf les fleurs, de Nicolas Clément (Buchet-Chastel, Paris, 2013)
Dans nos besaces, il y a avait toujours une tartine en plus. (…) Nous ouvrions nos besaces, les chevaux se régalaient dans nos mains gantées de souffles chauds. Aujourd’hui, il me reste peu de mots et peu de souvenirs. J’écris notre histoire pour oublier que nous n’existons plus.
Ainsi commence le récit de Marthe, une petite fille, puis jeune fille, étonnante d’innocence et de maturité. Elle raconte le calvaire de sa famille : un père qui boit et qui bat sa femme et ses enfants. Une mère qui supporte tout pour les protéger, des enfants conscients, mais qui restent des enfants.
boit et qui bat sa femme et ses enfants. Une mère qui supporte tout pour les protéger, des enfants conscients, mais qui restent des enfants.
Le récit est frais, anodin, empli du présent plein de terreur et d’un avenir imaginaire et consolateur : Je ferai des études pour être professeur de grenier et de livres anciens. Chaque chapitre égraine les ans. Ils se terminent par J’ai douze ans. J’ai seize ans… Elle découvre l’amour : Dans la chambre apprivoisée, ses mains me trouvent après m’avoir cherché caresses. J’oublie le filet percé qui me juge. Des paroles me poussent dans la bouche, que ne trompe plus mon vœu de silence. La douceur de ses hanches me suspend à la barre de ses yeux, puis je retombe ses jambes plus légères que le vide. A l’odeur de ses mots fous dans mes cheveux, je sais que Florent a souci du puzzle que je suis, tandis que s’estompe l’image clouée à l’envers de ma boite. Né d’un fil entre deux paysages, nous vivons d’une bouchée d’équilibre, notre envol, notre saut rattaché.
J’ai dix-huit ans… Le grec ancien lui tient lieu de refuge comme l’amour de Florent. J’ai hâte de ses yeux, je l’écoute respirer. Avant d’aller jouer, Florent m’appelle, nous nous fouillons, j’ai juste assez de place pour jouir. Sur le piano, il y a "Les plus belles chansons du temps passé", ouvert à la page huit. Il joue ma partition toute blanche et n’est lui chaque fois que j’écris, trois soupirs par seconde.
J’ai dix-neuf ans… L’année terrible où elle tue son père qui a tué sa mère. Tout ceci est conté d’une voix tranquille, comme détachée des évènements. Elle flotte dans un monde où rien ne marche et ne semble pas troublée. Papa visse le journal dans la bouche du mannequin. Le juge ordonne "Recommencez, plus lentement". Je recule. Je les vois attroupés, affairés à comprendre. Je m’approche du buffet. J’arme et je tire. Papa s’écroule. J’essuie mes jambes plaquées au sol. Un gendarme me ceinture. Nous n’avons plus rien à craindre. Je suis étrangement calme.
Une histoire terrible, contée du bout des lèvres par un mélange de franchise et de naïveté : Je voulais une mère avec des épaules pour poser mes joues brûlantes. Je voulais un père avec une voix pour m’interdire de faire des grimaces à table. Je voulais un chien avec un passé de chat pour ne pas oublier qui j’étais. Je voulais un professeur pour me surprendre…. Je n’ai pas eu tout ce que je voulais, mais je suis là, avec mes zéros, ma vie soldée du jour qui vaut bien ma vie absente d’avant. Je tombe rond ; mon compte est bon.
07:02 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, récit, poésie |  Imprimer
Imprimer
21/01/2014
L’amant de la Chine du Nord, de Marguerite Duras
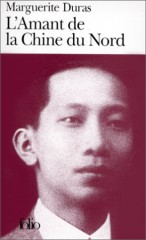 Est-ce un roman, un récit, un film, un scénario ? On ne sait trop, tout au moins au début du livre. Mais la forme importe peu. Ce qui compte c’est l’ambiance créée par la forme. Ajoutons-y le style. Un style descriptif, neutre apparemment, qui permet de poser le décor :
Est-ce un roman, un récit, un film, un scénario ? On ne sait trop, tout au moins au début du livre. Mais la forme importe peu. Ce qui compte c’est l’ambiance créée par la forme. Ajoutons-y le style. Un style descriptif, neutre apparemment, qui permet de poser le décor :
C’est un livre.
C’est un film.
C’est la nuit.
(…)
La voix qui parle ici est celle, écrite, du livre.
Voix aveugle. Sans visage.
Très jeune.
Silencieuse.
Les personnages principaux n’ont pas de nom, ou presque. Ils sont désignés par il ou elle ou encore, pour cette dernière, l’enfant.
Devant nous quelqu’un marche. Ce n’est pas celle qui parle.
C’est une très jeune fille, ou une enfant peut-être. Ca a l’air de ça. Sa démarche est souple. Elle est pieds nus. Mince. Peut-être maigre. Les jambes… Oui… C’est ça… Une enfant. Déjà grande.
La jeune fille s’arrête. Elle écoute. On la voit qui écoute. (…) La jeune fille dans le film dans ce livre ici, on l’appellera l’enfant.
Puis, la rencontre. Un chinois, jeune, imposant, riche, mais simple et humain en même temps. Ils lient conversation. Il s’interroge, elle est si jeune. Elle monte dans son auto, une Léon Bollée :
Elle a envie de l’embrasser. Il le voit. Il lui sourit. Elle prend sa main, embrasse sa main.
(…) Le chinois ne pose pas la question, il dit : « l’amour, tu n’as jamais fait ». L’enfant ne répond pas. Elle cherche à répondre. Elle ne sait pas répondre à ça. Il a un mouvement cers elle. A son silence il voit qu’elle aurait quelque chose à dire. Quelque chose qu’elle ne saurait pas encore dire et elle ne connaît sans doute que l’interdit. Il dit : « Je te demande pardon ».
Elle arrive à sa pension. Le chauffeur sort sa valise et elle part sans se retourner. Quelques jours plus tard, sur le chemin de son lycée, elle retrouve l’auto du bac, très longue, très noire, tellement belle, tellement et chère aussi, tellement grande. (…) Il est là. (…) Elle pose sa main sur la vitre. Puis elle écarte sa main et elle pose sa bouche sur la vitre, embrasse là, laisse sa bouche rester là. Ses yeux sont fermés comme dans les films. C’est comme si l’amour avait été fait dans la rue, elle avait dit. Aussi fort. Le Chinois avait regardé. A son tour, il avait baissé les yeux. Mort du désir d’une enfant. Martyre.
L’enfant avait retraversé la rue. Sans se retourner, elle était repartie vers le lycée.
Et très vite elle devient sa maîtresse. Une maîtresse jeune, pleine d’inexpérience, ingénue, mais qui sait ce qu’elle veut et qui l’obtient. Le livre raconte cette passion jusqu’au départ de l’enfant pour la France. Une passion partagée, qui devient peu à peu torturée. Qui passe du rire aux larmes, mais toujours dans une dignité réelle, comme des personnages qui jouent leur rôle de loin, sans entrer complètement dedans.
Un livre à la Duras, merveilleux de sensibilité et de froideur conjuguées, une sorte de rêve éveillée, des voix off, des images, des sons, de la musique, bref un film écrit, qu’on ne peut voir que dans sa tête, mais avec vérité et intimité.
Oui, c’est un livre remarquable tant par la forme et le style que par le récit lui-même.
07:31 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, indochine, amour, récit |  Imprimer
Imprimer
18/01/2014
La planche et le canoë
Un jour fut ramené de chez les grands-parents un canoë, vaste embarcation à fond plat, très instable, qui prenait plaisir à se renverser au milieu de la rivière, en hiver plus particulièrement. Jérôme se souvient encore d’une messe de minuit pendant les vacances de Noël où il ne portait qu’une culotte courte, ses deux pantalons étant trempés par des explorations brutales du fond de la rivière en crue, dans une Amazonie inhospitalière. Ils partaient à deux sur cette périssoire, l’un tenant son arme vers l’avant, prêt à frapper quelque ennemi qui se présenterait, l’autre pagayant sans bruit, faisant glisser l’embarcation entre les branches d’arbres, remontant ainsi le canal clôturant l’île, étroite de deux mètres maximum et encombré de racines de saules, d’aulnes ou de frênes qui s’enchevêtraient pour ne laisser qu’un étroit passage au canot. Il suffisait d’une mauvaise manœuvre de l’embarcation pour que celle-ci, déséquilibrée, laisse tomber leurs voyageurs dans une eau boueuse et froide.
De façon à pouvoir jouer à leurs jeux dans lesquels il y a toujours un personnage ou un groupe contre un autre, ils avaient découvert une grande planche de quatre mètres de long sur trente centimètres de large, qui, grâce à son épaisseur tenait sur l’eau. Un enfant tenait debout au milieu et pouvait ainsi naviguer plus ou moins à son gré. Mais quelle instabilité ! Au moindre faux mouvement, c’était la chute assurée et redoutée. Mais cette embarcation improvisée, extraordinaire de délicatesse d’utilisation, permettait de conduire de véritables batailles navales en aval du moulin, là où les flots se font plus calmes et la profondeur moindre. Ceux qui tombaient ne se mouillaient que jusqu’à la taille, donc de manière insignifiante, sauf s’ils devaient empêcher la pirogue (c’était un terme plus authentique que planche) de partir avec le courant vers l’entrée dans les marais. Alors, ils devaient courir dans l’eau pour la rattraper et remonter dessus. Des après-midis entiers pouvaient se passer sans avoir besoin de se changer. Miracle du sens de l’équilibre ou miracle du jeu qui, malgré un bain forcé, continuait comme si de rien n’était.
Ils s’amusèrent longtemps avec ces deux engins jusqu’au jour où une crue plus importante les emporta. Leurs recherches restèrent vaines. Ils partirent avec leurs jeunes années, au moment de l’adolescence où les préoccupations prennent des orientations différentes. Mais Jérôme, en fermant les yeux, conserve dans sa mémoire trouée, l’odeur de marais qui imprégnait leurs vêtements en fin de journée, le bruit sourd de la pagaie contre la coque de bois du canoë, les gouttes de rosée qui coulaient dans son cou au passage d’un arbre dont il fallait soulever les branches pour poursuivre leur chemin, les battements de son cœur à l’approche de l’ennemi qui lui-même les cherchait dans leur canot pour une bataille finale et définitive. Quelle journée de cris, de fureur, de courage et d’amertume lorsqu’ils étaient perdants. Le soir, le repas se faisait en silence et aussitôt ils allaient se coucher pour s’endormir en s’imaginant toujours pirates, explorateurs ou guerriers. Une des belles images que Jérôme garde dans sa mémoire défaillante est celle d’un nid de poules d’eau déniché près d’une racine, dans lequel reposait quatre petits œufs dorés, à ne toucher sous aucun prétexte. C’était l’écologie de l’époque, qui valait bien celle de maintenant : respecter la nature et non la restaurer, comme le disent les écologistes des villes qui la détruisent pour la reconstruire à leur vision.
07:51 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, écriture, souvenirs |  Imprimer
Imprimer
16/01/2014
Quand reviennent les âmes errantes, drame de François Cheng
 L'épopée se passe en Chine, au temps des royaumes combattants, dans la seconde moitié du troisième siècle avant notre ère. Trois personnages, une femme, Chun-niang, et deux hommes, Gao Jian-li, le joueur de zhou, et Jing Ko, le belliqueux, se rencontrent dans une auberge. Elle, une beauté discrète, secrète, touchant pour ainsi dire à l’essence, d’une telle simplicité que devant elle tombent tous les qualificatifs. (…) Pureté des lignes, noblesse du port, harmonie innée du mouvement et des gestes ? Foncièrement innocente, elle ne fait pas usage de ses atouts : son regard teinté de mélancolie trahit au contraire quelque expérience douloureuse. Tout son être invite l’homme à abandonner ses mesquins calculs, ses pénibles artifices. Quiconque prétend l’aimer ne saurait me faire qu’humblement et totalement.
L'épopée se passe en Chine, au temps des royaumes combattants, dans la seconde moitié du troisième siècle avant notre ère. Trois personnages, une femme, Chun-niang, et deux hommes, Gao Jian-li, le joueur de zhou, et Jing Ko, le belliqueux, se rencontrent dans une auberge. Elle, une beauté discrète, secrète, touchant pour ainsi dire à l’essence, d’une telle simplicité que devant elle tombent tous les qualificatifs. (…) Pureté des lignes, noblesse du port, harmonie innée du mouvement et des gestes ? Foncièrement innocente, elle ne fait pas usage de ses atouts : son regard teinté de mélancolie trahit au contraire quelque expérience douloureuse. Tout son être invite l’homme à abandonner ses mesquins calculs, ses pénibles artifices. Quiconque prétend l’aimer ne saurait me faire qu’humblement et totalement.
Ils se lient d’amitié et d’amour chaste : Amitié vivifiante, comme entre plante et pluie. Singulier trio que nous formons, singulier, mais évident, mais inébranlable ! En son sein, amitié affichée et amour inavoué crée un équilibre lumineux, exaltant, que personne ne souhaite rompre.
Cette amitié insolite dure jusqu’au jour où elle doit partir pour la cour, sa beauté ayant été reconnue. Peu de temps après, Jing Ko est chargé par son souverain de mettre à mort le roi ennemi qui menace le royaume. Aussi le roi lui accorde pleinement l'autorisation de vivre à la cour avant son sacrifice. Il retrouve Chun-niang, l’aime d’amour jusqu’au moment où il doit partir dans le royaume ennemi. Il mourra. Chun-niang reporte son amour sur Gao Jian-li qui lui aussi mourra d’avoir cherché à tuer le roi ennemi. Chun-niang devient une vieille femme, mais elle conserve un cœur pur et échange avec les âmes de ses bienaimés : L’indicible, dont la part de mystère restera mystère, on ne peut l’approcher, Jian-li nous l’a appris, que par le chant. L’indicible, dans notre cas, c’est donc ce chant ininterrompu à trois voix. Trois voix à la fois distinctes et confondues, trois voix propres à chacun mais toutes trois à l’unisson. Chaque voix raisonne, de toute éternité, en écho aux deux autres. Voix de l’amitié, voix de l’amour, mamelles équilibrantes, nourrissantes, transformantes d’une unique passion. (…) Que s’élève le chant des âmes retrouvées :
Plus rien ne subsiste, à part le désir
Pur désir inaccompli
Mûr désir inassouvi…
Toi et toi, vous deux en un
En un vous deux, toi et toi
En un nous trois !
C’est bien un drame à la manière antique. Il déroute le lecteur occidental d’aujourd’hui. Il sent la poussière des jours passés où la vie était semblable à la mort. Un rien les séparait. Comment comprendre cette indifférence à la mort et cet acharnement à vivre malgré tout. La Chine est le pays du mystère et François Cheng nous en donne une définition vivante à travers ce récit. Au-delà de l’histoire, les âmes se rejoignent et continuent à s’aimer d’amitié et d’amour. C’est la vie qui se poursuit, avant ou après la mort. Peu importe. La pensée et les sentiments sont plus forts que l’existence.
07:20 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, récit, épopée, drame, roman, chine, amour, mystère |  Imprimer
Imprimer
10/01/2014
Les insomnies de François Ducassier
François Ducassier se leva brusquement, dit à peine bonsoir et sortit dans la nuit. Il avait hâte de se coucher. Arrivé chez lui, il se changea et s’offrit aux dieux de la nuit.
A deux heures quarante-cinq, il se réveilla. Il ne reconnut pas sa chambre au papier de fleurs mauves. Il tendit la main vers la petite table où se trouvaient ses lunettes et trouva le flanc de bois massif d’un meuble important, une commode probablement. Il chercha vainement le fil électrique et le commutateur. Alors il se dressa sur son lit. Il lui sembla plus haut, plus large, plus imposant. La lumière lunaire permettait de distinguer la masse des objets qui peuplaient la chambre. Lourdeur, pensa-t-il. Il sortit ses jambes, les laissant pendre sur le bord du lit sans qu’elles touchent par terre. Ses pantoufles étaient encore là. Il sauta, les enfila, passa une robe de chambre et, tendant les bras en avant, marcha vers ce qui était auparavant la fenêtre. Il n’y avait qu’une glace qui reflétait les pâles rayons diffusés par une autre ouverture, à gauche. Il trouva enfin un commutateur électrique. Hésitant, il alluma et poussa un cri étouffé.
Ce n’était pas sa chambre. Plus solennelle, elle était large, revêtue d’un épais tapis, chargée de meubles imposants, un bureau empire, une commode Louis XVI, une table entourée de quelques chaises. Elle était ornée de miroirs encadrés richement et de tableaux représentant des campagnes foisonnantes. La fenêtre s’entourait de rideaux lourds, surchargés de perroquets opulents. Il se rassit sur le bord du lit, plongeant en lui-même pour essayer de se souvenir de ce qu’il avait fait la veille. Oui, il s’était bien couché dans sa chambre. Alors que faisait-il là ? N’ayant pas de réponse, il entrouvrit la porte et contempla le long couloir sur lequel s’ouvraient de nombreux seuils, tous semblables. Il sortit, laissant ouverte la porte de cette chambre insolite et fit quelques pas. Pas un bruit, pas un mouvement signalant une présence. Un tombeau ! Il courut jusqu’au bout du couloir, un escalier s’ouvrait montant et descendant autour de son axe central. Il monta un étage. Même couloir encadré de portes imposantes. Il poursuivit un étage plus haut, puis deux, puis trois. Même désolation opulente et silencieuse. Alors, il redescendit cinq étages, toujours le même couloir. Se penchant par-dessus la rampe, il vit une interminable descente d’escalier qui s’enfonçait dans la terre, sans fin, comme une illusion d’optique. Levant la tête, même impression, une hélice tourbillonnante sans limite. Il remonta d’un étage, traversa le couloir et retrouva la porte de sa nouvelle chambre, entrouverte sur son opulence. De guerre lasse, il se recoucha, réfléchissant à ce qui lui arrivait. Mais à peine s’était-il installé confortablement, qu’il s’endormit.
Le lendemain matin, il se réveilla dans sa chambre, la vraie, celle qu’il connaissait depuis toujours, plus modeste et familière. Il se rappela ce réveil inconfortable, son errance dans les couloirs, l’escalier sans fin. L’impression d’infini lui serra à nouveau le cœur, lui laissant une vague nausée dans la gorge. Sa journée se déroula normalement, mais il ne se sentait pas réel. Un léger décalage s’était emparé de sa vision habituelle. Il se regardait travailler, déjeuner, converser, se promener. C’était un autre lui-même, en tout point semblable, mais il n’était pas au centre de ce personnage, au centre de son monde et même du monde en général. Cet imperceptible décalage n’était pas véritablement gênant en soi, mais il le mettait mal à l’aise. Il allait comme s’il avait un caillou dans sa chaussure, claudiquant dans sa présence face au temps qui coule.
Le soir, il rentra plus vite que d’habitude. Il se coucha, songeant à mettre à portée de main une boite d’allumette, une lampe électrique et ses lunettes. Il s’endormit sans appréhension, comme chaque jour. A deux heures quarante-cinq, il se réveilla. Même changement de chambre, même impression de grandiloquence et même silence. Il se leva, marcha vers la porte, l’entrouvrit. C’était le même couloir avec les mêmes portes et, au fond, la cage d’escalier. Il parcourut sa longueur pour se retrouver devant la vertigineuse montée ou descente. Il se sentit suffoquer. Une odeur de mort semblait l’engloutir. Il regagna péniblement sa chambre, se recoucha et n’eut à nouveau aucun mal à s’endormir.
Pendant presqu’un mois, la même aventure se renouvela. Il dépérissait. Ses yeux rougis par l’insomnie ne reflétaient qu’une immense inquiétude. Il marchait à côté de lui-même, regardant son ombre vivre, manger, rire et parfois pleurer. Il entama une liaison avec une jeune femme drôle et enjouée qui lui permit de survivre. Lorsqu’il la serrait dans ses bras, il avait l’impression d’exister. Son parfum sucré remplaçait la senteur de mort qui l’habitait toutes les nuits. Il revivait, prenant un certain intérêt à pétrir la chair tendre et ferme du corps de cette femme qui tous les matins le sortait de sa prison imaginaire ou réelle.
Un jour, le trentième du mois, il lui parla de ce rêve réel qui l’assaillait. Elle eut l’air étonné, mais sans plus. La première nuit, elle s’efforça de se tenir éveillée, mais s’endormit à deux heures. La deuxième nuit, elle mit un réveil sous son oreiller, ouvrit un œil et s’assit sur le lit sans faire de bruit. Elle attendit. A deux heures quarante-cinq, il se leva d’une manière tout à fait naturelle, et sortit. Il rentra trois-quarts d’heure plus tard et se recoucha comme si de rien n’était. Au petit déjeuner, dans l’intimité du matin, elle lui raconta ce qu’elle avait vu. En fait rien d’autre que cette sortie qui lui semblait normale. Elle le serra contre elle, l’enfermant dans ses effluves qui l’enivraient joyeusement et accepta un retour dans les draps froissés. Chaque matin, elle écoutait le récit de la nuit, toujours le même et à chaque fois elle l’emportait dans l’ivresse de l’amour jusqu’à lui faire oublier l’épisode nocturne qui le faisait dépérir. Enfin vint le jour où il dormit sans être réveillé. Le lendemain, il n’eut rien à raconter si ce n’était sa délivrance. Alors elle se leva, revêtit avec lenteur sa robe blanche qui lui tombait sur les pieds, se maquilla, rangea ses quelques affaires dans une petite mallette, l’embrassa sur la bouche et sortit en laissant la porte ouverte. Pas un mot ne fut échangé, pas un geste qui pouvait dire « ne pars pas ». Et d’un coup, le décalage devenu habituel s’interrompit.
L’esprit de François avait retrouvé sa place dans son corps, au centre de lui-même. Une vague nostalgie restait en lui. Elle se manifestait le soir avant de se coucher. Mais dès qu’il fermait les yeux tout s’évanouissait. Il ne resta bientôt rien de cette division du temps et de l’espace qu’il ne comprit jamais, et qu’il finit par oublier.
07:55 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, littérature, écriture, rêve |  Imprimer
Imprimer
06/01/2014
Les coloriés, roman d’Alexandre Jardin
 Une civilisation fondée sur le jeu. Le sérieux est banni, de même que le passé et l’avenir. Le présent seul existe. Quel puissant motif d’intérêt pour l’ethnologue qu’est le conteur du roman, Hippolyte Le Play. Une culture de l’enfance, avec ses règles, ses tabous et ses interdits. Une organisation improvisée, fondée sur le plaisir et l’imagination d’où les adultes sont exclus. « Au départ, il s'est produit un événement fondamental : les garçons se sont battus entre bandes. Les filles ont eu peur et se sont réfugiées dans les arbres. Quand la puberté est arrivée, les garçons sont venus sous les arbres et se sont demandés comment faire descendre les filles des branches ! Tandis que les filles se demandaient comment faire grimper les garçons… C'est cela qui a donné naissance à une culture complète où l'amour est devenu le jeu préféré. »
Une civilisation fondée sur le jeu. Le sérieux est banni, de même que le passé et l’avenir. Le présent seul existe. Quel puissant motif d’intérêt pour l’ethnologue qu’est le conteur du roman, Hippolyte Le Play. Une culture de l’enfance, avec ses règles, ses tabous et ses interdits. Une organisation improvisée, fondée sur le plaisir et l’imagination d’où les adultes sont exclus. « Au départ, il s'est produit un événement fondamental : les garçons se sont battus entre bandes. Les filles ont eu peur et se sont réfugiées dans les arbres. Quand la puberté est arrivée, les garçons sont venus sous les arbres et se sont demandés comment faire descendre les filles des branches ! Tandis que les filles se demandaient comment faire grimper les garçons… C'est cela qui a donné naissance à une culture complète où l'amour est devenu le jeu préféré. »
Une adulenfant qui charme Hippolyte et qui l’entraîne dans une aventure salace, dans un premier temps en plein Paris, puis sur l’île de la Délivrance, celle dont les culottés (les adultes) sont bannis. Dafna découvre le monde des adultes avec une certaine aisance malgré une absence totale d’éducation et de conscience. Hippolyte découvre le monde des coloriés (ils se peignent des vêtements sur la peau) avec difficulté. Il ne peut s’empêcher de revenir à des raisonnements et des sentiments édulcorés d’adulte civilisé malgré toute sa bonne volonté. Inversement, la culture des enfants semble considérer la stabilité des caractères comme une pathologie, une infirmité réservée aux grandes personnes encroutées. Pour eux, vivre c’est changer sans cesse. Moi, je jubilais en secret d’assister à ses écarts qui me dédommageaient d’années trop strictes. Dans les grandes surfaces, dès qu’une musique l’envoutait, Dafna zigzaguait entre les ménagères en improvisant des ballets qui mêlaient claquettes, marelles frénétiques et entrechats. Jouir de bouger lui était nécessaire. Sa licence enfantine et débridée me grisait. Quand tant d’êtres se contentent d’exister, Dafna osait vivre !
Ce livre invite chacun de nous à réveiller sa part la plus authentique, à tourner le dos à cette société « raisonnable » qui aspire en permanence à la « cohérence ». Il nous renvoie à la place que nous laissons à nos désirs.
On s’amuse bien, la fable est comique et conduit à des quiproquos drolatiques. Mais on finit par se lasser de ces « on dirait qu’on serait », « jouer à être invisible » grâce à une couche de peinture blanche, etc. Ce n’est plus une guerre de civilisation, mais un combat contre la bêtise des adultes dans leurs partis pris serrés et celle des coloriés enfoncés dans leur rêverie excédée. Et l’auteur, près de rejoindre les culottés, exécute au dernier moment un plongeon : En prenant plaisir à nager vers la Délivrance, je laissai derrière moi un sillage de couleurs dans les eaux du Pacifique. Ma trace était une palette. L’amour vécu comme une récréation m’attendait. Protégé de l’Occident, j’allais oublier le triste scepticisme, le garrottage des émotions et l’esprit de gravité qui corrompt tout. Vivre ne serait plus l’art de cultiver un héritage, mais l’occasion unique de foncer vers soi, en échappant à la noyade du vieillissement.
(…) Il faisait très beau, un temps à zouaver sur une plage, à ne pas sérieuser avec cette fille inespérée. Après tout, la vie valait d’être vécue si l’on avait la maturité de la colorier. Je recommençais mon enfance, pour toujours.
10:47 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : roman, littérature, conte, récit |  Imprimer
Imprimer
23/12/2013
La servante du Seigneur, ouvrage de Jean-Louis Fournier
J’ai égaré ma fille.
Je suis retourné à l’endroit où je l’avais laissée, elle n’y était plus.
J’ai cherché partout.
J’ai fouillé les forêts, j’ai sondé les lacs, j’ai passé le sable au tamis, j’ai cardé les nuages, j’ai filtré la mer.
Je l ‘ai retrouvée.
Elle a bien changé.
Je l’ai à peine reconnue.
Elle est grave, elle est sérieuse, elle dit des mots qu’elle ne disait pas avant, elle parle comme un livre.
Je me demande si c’est vraiment elle.
Jean-Louis Fourier a perdu sa fille, celle qu’il avait toujours connue, charmante et drôle, habillé de couleurs vives, excentrique, même parfois extravagante.
Pourtant dix ans avant, déjà, elle lui demande ce qu’il penserait si elle était religieuse. Pourquoi pas ? Donner ce que nous avons de mieux à Dieu ! Mais ce n’était qu’un mauvais rêve. Un jour, elle partit dans la pénombre avec Monseigneur. Il a étudié la théologie à la Faculté. Il écrit une histoire de la philosophie. Il parle le grec et le latin.
Le livre est la méditation enragée d’un père face à son incompréhension d’une vie autre. Elle veut être sainte. Lui veut l’aimer et la croire encore vivante.
Elle pratique maintenant l’humour rose, pasteurisé, avec de vrais morceaux de fraise.
Elle est tombée dans la layette mystique.
L’humour bleu ciel et rose bonbon, ça n’existe pas.
L’humour, c’est noir.
L’humour c’est une parade, un baroud d’honneur devant la cruauté, la désolation, la difficulté de l’existence.
Ils se téléphonent :
– Jean-Louis, tu sais que tu vas mourir prochainement ?
– Mais oui, ma fille, je le sais.
– Tu as raté ta vie.
– Certainement, si tu le dis.
– Tu as été un vieil égoïste, tu as fait du tort aux autres.
– J’ai quand même quelques amis qui m’aiment bien.
– Ils ne t’aiment pas. Ils sont intéressés par ton argent. Tu dois normalement être damné, aller en enfer. Mais Dieu est miséricordieux et infiniment bon, il te laisse une chance.
– Enfin une bonne nouvelle.
Peut-être fut-elle réellement malheureuse avec ce père riche et content de lui. Mais il ne comprend pas :
Sectaire, ça commence comme sécateur, ça coupe. Ça coupe des parents, ça coupe des amis, ça coupe du monde professionnel, ça coupe du monde tout court.
Elle s’extasie devant les cathédrales :
C’est vrai que les artistes doivent beaucoup à Dieu. Si Dieu n’avait pas créé les pommes, Cézanne était condamné à peindre des compotiers vides.
Les souvenirs sont la seule bonne chose qui lui reste :
Tu es encadrée dans le bureau vert, une vieille photo, tu dois avoir douze ans. Je te regarde souvent. (…)
J’ai la nostalgie du passé.
On s’entendait bien avant.
Pourquoi maintenant c’est si difficile ?
On est tous les deux orgueilleux et pudiques.
On ne dit rien, on ne montre rien.
Nos sentiments sont classés secret défense.
Il crie sa rage :
Pourquoi, depuis que tu es à Dieu, tu es odieuse ?
Et Dieu lui fait peur :
La conversion, c’est un brutal éblouissement. Après un éblouissement, on ne voit plus clair, on est aveuglé, on se retrouve dans le noir, comme les lièvres éblouis par les phares d’une automobile.
Crois-tu que je sois attiré par le Dieu qui t’a éblouie ?
Il me fait peur.
Il finit :
Dépêche-toi, tout va refroidir.
Je t’attends depuis plus de dix ans.
Pour une foi, j’ai de la patience. Tu vas revenir. (…)
Dépêche-toi, tout va refroidir.
Reviens, avant que je m’en aille.
Et sa fille conclut dans une lettre :
Je faisais de l’humour noir parce que ma vie était noire, de désespoir. Maintenant, je fais de l’humour rose parce que ma vie est rose d’espérance, avec de vrais morceaux de fraise bio, de mon jardin.
L’humour rose, pas morose.
In médite et on médit des autres. Toi, pardonne-moi de le dire, tu médis et tu édites. Nous on médite et on mérite. Ça irrite ?
Un livre sévère et tendre, au gré de l’humeur de l’auteur. Il y a de curieux nuages sur ce ciel bleu : qui est Monseigneur ? Un gourou, un responsable de secte, un illuminé ou un amant théologien ?
07:05 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, récit, méditation, religion, génération |  Imprimer
Imprimer
12/11/2013
La nostalgie heureuse, récit d’Amélie Nothomb
« Tout ce que l’on aime devient une fiction. La première des miennes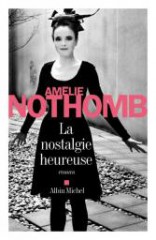 fut le Japon. (…) A aucun moment je n’ai décidé d’inventer. Cela s’est fait de soi-même. Il ne s’est jamais agi de glisse le faux dans le vrai, ni d’habiller le vrai des parures du faux. Ce que l’on a vécu laisse dans la poitrine une musique : c’est elle que l’on s’efforce d’entendre à travers le récit. Il s’agit d’écrire ce son avec les moyens du langage. Cela suppose des coupes et des approximations. On élague pour mettre à nu le trouble qui nous a gagnés. » (Prologue du récit)
fut le Japon. (…) A aucun moment je n’ai décidé d’inventer. Cela s’est fait de soi-même. Il ne s’est jamais agi de glisse le faux dans le vrai, ni d’habiller le vrai des parures du faux. Ce que l’on a vécu laisse dans la poitrine une musique : c’est elle que l’on s’efforce d’entendre à travers le récit. Il s’agit d’écrire ce son avec les moyens du langage. Cela suppose des coupes et des approximations. On élague pour mettre à nu le trouble qui nous a gagnés. » (Prologue du récit)
S’agit-il de nostalgie ? Et celle-ci est-elle heureuse ? Rend-elle heureux le lecteur ?
Quant à moi, je suis sorti du livre déçu. Amélie retourne au Japon avec une équipe de télévision, en charge de trouver les impressions qu’elle a décrites dans ses livres, dont Stupeurs et tremblements, Métaphysique des tubes. C’est un compte-rendu de voyage écrit par une midinette en mal de souvenirs. Certes, quelques bons mots, quelques réflexions amusantes (et encore, assez peu). Mais l’on passe dans ce nouveau Japon, celui des brisures de la vie, sans y retrouver la magie de l’ancien, celui où s’agitait une petite fille, puis une jeune fille, avec le charme de la découverte du monde. On la sent d’ailleurs gênée de jouer son rôle d’écrivain à la recherche du temps perdu. Elle écrit mal ce qu’elle a bien écrit. L’inspiration n’est plus là. Le texte devient presque radotage.
Elle tente de retrouver la maison de son enfance et voit une femme étendre du linge dans son jardin. Je pense que, depuis l’âge de dix-sept ans, c’est moi qui m’occupe de la lessive. L’unique continuité de mon quotidien à part l’écriture, c’est le linge, au point que je me fâche si quelqu’un s’en charge à ma place. (…) La vérité m’apparaît grâce à cette inconnue : pour moi, être lingère, c’est prouver que je suis la fille de Nishio-san. Je contemple avec intensité cette femme qui pend des chemises mouillées. La caméra en conclut que c’est important et filme la femme.
Après sa visite à Nishion-san, sa nounou, elle pleure. Une joie de rescapée circule en moi. J’ai réussi l’épreuve. (…) Je mesure le miracle : Nishio-san et moi, nous nous sommes revues, je lui ai dit ce qui devait être dit, j’ai laissé circuler entre elle et moi un si terrible amour, et nous avons survécu.
Il lui arrive de se moquer d’elle-même : Pour reprendre la formulation génialement méchante de Balzac, à vingt ans, j’étais une jeune fille d’une beauté modérée. Cela ne s’est guère arrangé par la suite.
Elle retrouve Rinri, son ex-fiancé japonais raconté dans Ni d’Eve, ni d’Adam. Elle conclut cette retrouvaille par cette réflexion : En le retrouvant, j’ai aussi retrouvé un élément de ce qui fut mon quotidien avec lui : la gêne. (…) La gêne est un étrange défaut du centre de gravité : n’est capable de l’éprouver qu’une personne dont le noyau est demeuré flottant. Les êtres solidement centrés ne comprennent pas de quoi il s’agit. La gêne suppose une hypertrophie de la perception de l’autre, d’où la politesse des gens gênés, qui ne vivent qu’en fonction d’autrui. Le paradoxe de la gêne est qu’elle crée un malaise à partir de la déférence que l’autre inspire.
Elle finit sur une considération digne du pays du soleil levant : la grâce de ressentir le vide : A vingt ans, avec Rinri, j’ai vécu une belle histoire. Cette beauté implique que ce soit fini. C’est ainsi. (…) Ressentir le vide est à prendre au pied de la lettre, il n’y a pas à interpréter : il s’agit, à l’aide de ses cinq sens, de faire l’expérience de la vacuité. C’est extraordinaire. En Europe cela donnerait la veuve, la ténébreuse, l’inconsolée ; au Japon, je suis simplement la non-fiancée, la non-lumineuse, celle qui n’a pas besoin d’être consolée. Il n’y a pas d’accomplissement supérieur à celui-ci. (…) Une épiphanie de cet état espéré, où l’on est de plain-pied avec le présent absolu, l’extase perpétuelle, la joie exhaustive.
07:54 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, récit, japon, souvenir |  Imprimer
Imprimer
03/08/2013
Un début à Paris, récit de Philippe Labro
On aime ce livre parce qu’il nous livre les impressions, déboires, passions, bévues, sentiments d’un jeune homme des années 60 qui commence son apprentissage dans la vie de journaliste. Celle-ci débute comme assistant de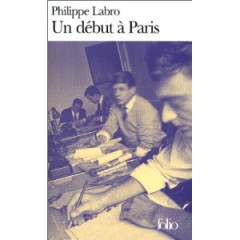 relations publiques d’une compagnie maritime américaine, ce qui consiste à publier un court portrait de personnalités arrivant en France.
relations publiques d’une compagnie maritime américaine, ce qui consiste à publier un court portrait de personnalités arrivant en France.
– C’est de toi, çà ? C’est pas mal. Si tu as une idée, quelque chose d’un peu plus étoffé, amène-le-moi. Je suis toujours preneur d’un bon portrait.
C’est bien sûr sa jeunesse que raconte l’auteur. Est-ce arrangé, probablement un peu, mais pas trop. On est vite pris par le récit. Ce n’est pas une histoire au vrai sens du terme, mais plutôt une série de portraits successifs dont chacun est un petit chef d’œuvre. Et cela commence dès le chapitre 2 avec l’interview de Blaise Cendras, haut en couleurs et empli de conseils de l’interviewé : – Soyez optimiste. Faites vite. Restez près de la vie.
Philippe Labro s’explique dans le prologue sur cette période : – Il n’y a pas de chiffre étalon pour mesurer la durée d’un apprentissage. Deux ans, dix ans, vingt ans ? A partir de quand peut-on affirmer que l’apprentissage est terminé, que l’on domine son métier ? Les sages vous répondent que cela n’a pas de fin et vous les écoutez en souriant devant une telle platitude.
Il y a la rencontre avec Wence, journaliste, puis écrivain : Il était élancé, mince, avec de longues jambes sur un corps souple. Il avait un petit nez court et pointu, une bouche délicate aux lèvres fines, des lèvres troublantes pour un homme, presque trop sensuelles. D’une description physique du personnage, il passe imperceptiblement à un portrait moral : – Il était le seul à posséder cette sorte de lunettes. C’eût été un détail si cette monture et ces verres n’avaient pas fait ressortir l’éclat singulier des yeux de Wenceslas, son regard enjôleur et presque câlin lorsqu’il décochait son interrogation favorite, empruntée, selon lui, à Mozart : – M’aimez-vous ? M’aimez-vous vraiment ? La question revenait comme une antienne, une véritable litanie. C’était la phrase clé de Wence. Ce portrait se poursuit sur plusieurs pages, entrecoupées d’anecdotes plus ou moins longues, de diversions sur d’autres personnages tout aussi hauts en couleurs.
La baronne avait les seins nus sous sa blouse. Cela m’épatait, j’en restais ahuri quelques instants ; ce qui m’étonnait le plus, c’est que j’étais le seul à avoir repéré ce charmant, cet affolant, cet extraordinaire détail. C’est ainsi qu’il fait la connaissance avec Béatrice de Sorges, la trentaine. Il en tombe amoureux comme on peut l’être à cet âge : Béatrice de Sorges suscitait chez moi une brusque poussée de désir physique, alliée à l’intuition d’un danger. Mais ce danger ne me faisait nullement peur. (…) – Madame, la mouche dont vous parlez n’est pas une mouche. C’est le plus beau des papillons. C’est vous ! C’est vous qui me mettez dans cet état-là.
Il fait connaissance avec une très jeune fille, extraordinaire, dont la beauté constitue une insulte faite aux femmes autour d’elle. Lumière de Moralès, une sorte de voyante, d’une sagesse bien au-dessus de son âge, au comportement étonnant. Et puis, que voulez-vous, je vais vous dire, je suis un peu devin. Je devine les choses. Je vous regarde, je vois votre façon de conduire. (…) Vous voulez tout, mais vous ne savez pas ce que vous voulez, ni dans quel ordre. Elle lui vole un baiser. Ils s’écrivent, échangent leurs pensées. Elle disparaîtra de sa vie, mais il la reverra plus tard, plus vieille, plus mûre encore.
Festival d’étincelles, de personnages mythiques tel ce petit homme, patron de presse, lors d’un déjeuner au Berkeley, de rencontres insolites, telle cette vieille dame, mère d’un meurtrier, qu’il serre dans ces bras avant de la quitter. Un livre que l’on quitte avec regret, non pour le récit, mais pour le charme des descriptions, l’acidité des peintures, l’envoûtement du détail, l’humilité du narrateur. Un livre à relire dans le désordre, au fil des personnages, en comparant l’art et la manière d’en faire l’effigie.
07:30 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, récit, journalisme, portrait |  Imprimer
Imprimer
27/05/2013
La mort est mon métier, de Robert Merle
Ce n’est pas un roman, plutôt un récit : la vie de Rudolf Hoess, le commandant d’Auschwitz, racontée sous le pseudonyme de Rudolf Lang. Ecrit en 1952, Robert Merle a utilisé les notes du psychologue américain Gilbert. Le plus curieux est l’absence presque totale d’impression et de sentiments du narrateur Rudolf. Il n’a qu’un seul leitmotiv : les Allemands sont des soldats et les soldats obéissent sans discuter, ni même réfléchir.
Son enfance pourrait expliquer cette vie sans pensée propre. Il est complètement dominé par son père qui est lui-même excessif dans tous ses actes, dont sa pratique religieuse. – Rudolf, depuis que tu es en âge de commettre des fautes, je les ai prises, l’une après l’autre, sur mes épaules. J’ai demandé pardon à Dieu, pour toi, comme si c’était moi qui était coupable, et je continuerai à agir ainsi tant que tu seras mineur. Je fis un mouvement, et il cria : – Ne m’interromps pas !
Après un drame à l’école et devant l’attitude de son père, il tombe malade. Allant mieux, il prend un premier repas avec sa famille et son père dit : – Et maintenant on va faire la prière. Père entama un Pater. Je me mis à imiter le mouvement de ses lèvres et sans émettre un seul son. Il me fixa, ses yeux creux étaient tristes et fatigués, il s’interrompit et dit d’une voix sourde : – Rudolf, prie à haute voix. Tous les yeux se tournèrent vers moi. Je regardai Père un long moment, puis articulai avec effort : – Je ne peux pas.
Il perd la foi. Mais il devient brancardier et fait connaissance avec un Rittmeister (capitaine). Il finit par s’engager. Se bat, est blessé et découvre l’amour avec une infirmière. Rendu à la vie civile, il fait de nombreux petits boulots. Il découvre les S.A. et prête serment au führer pour sauver l’Allemagne.
Il est engagé par un colonel pour s’occuper de ses chevaux. Il se marie. Il poursuit ses activités chez les SS. Désormais, par conséquent, tout était parfaitement simple et clair. On n’avait plus de cas de conscience à se poser. Il suffisait seulement d’être fidèle, c’est-à-dire d’obéir. Et grâce à cette obéissance absolue, consentie dans le véritable esprit du Corps noir, nous étions sûr de ne plus jamais nous tromper, d’être toujours dans le droit chemin. Il s’installe à Dachau avec sa famille, puis est muté à Auschwitz : Je vous ai choisi, vous, à cause de votre talent d’organisation… et de vos rares qualités de conscience. (…) Dans quatre semaines exactement, vous me ferez tenir un plan précis à l’échelle de la tâche historique qui vous incombe. (…) Pour les six premiers mois, vous devez prendre vos dispositions pour un chiffre global d’arrivages se montant environ à 500 000 unités.
Rudolf Lang se pose la question le plus rationnellement possible : comment faire pour éliminer des milliers d’unités ? Il trouve des solutions sans penser un seul instant qu’il s’agit d’êtres humains. Vint la fin de la guerre. Il apprend qu’ils ont arrêté Himmler et qu’il s’est suicidé au cyanure. La douleur et la rage m’aveuglaient. Je sentis Georg me secouer vivement le bras et je dis d’une voix éteinte : – Il m’a trahi. Je vis les yeux pleins de reproches de Georg fixés sur moi et je criai : – Tu ne comprends pas ! Il a donné des ordres terribles, et maintenant, il nous laisse seuls affronter le blâme… au lieu de se dresser… au lieu de dire : « C’est moi le responsable ! » (…) Il s’est défilé, lui que je respectais comme un père. (…) Il aurait dit : « C’est moi qui ai donné à Lang l’ordre de traiter les juifs. Et personne n’aurait eu rien à dire !
Il est finalement arrêté et trainé de prison en prison. Je pensais quelquefois à ma vie passée. Chose curieuse, seule mon enfance me paraissait réelle. Sur tout ce qui s’était passé ensuite, j’avais des souvenirs très précis, mais c’était plutôt le genre de souvenirs qu’on garde d’un film qui vous a frappé. Je me voyais moi-même agir et parler dans ce film, mais je n’avais pas l’impression que c’était à moi que tout cela était arrivé.
Un lieutenant- colonel l’interroge : – Êtes-vous toujours aussi convaincu qu’il fallait exterminer les juifs ? – Non, je n’en suis plus convaincu. – Pourquoi ? – Parce qu’Himmler s’est suicidé. (…)– Par conséquent, si c’était à refaire, vous ne le referiez pas ? – Je le referais, si on m’en donnait l’ordre. (…) – Vous n’éprouvez donc aucun remord ? – Je n’ai pas à avoir de remord. L’extermination était peut-être une erreur. Mais ce n’est pas moi qui l’ai ordonnée. – Depuis votre arrestation, il vous est bien arrivé de penser à ses milliers de pauvres gens que vous avez envoyés à la mort ? – Oui quelquefois. – Eh bien, quand vous y pensez, qu’éprouvez-vous ? – Je n’éprouve rien de particulier.
Histoire d’un homme ordinaire, d’un Allemand qui croyait en son pays et à l’obéissance. Devenu bourreau sans s’en rendre compte, il a exterminé des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants sans prendre conscience de ce qu’il faisait. Et ce n’était même pas l’idéologie qui le conduisait, mais la simple bonne conscience d’obéir.
Les militaires français ont maintenant l’obligation légale de désobéir à des ordres illicites concernant des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre, des actes qui constituent des crimes et délits contre la sûreté de l’Etat la constitution ou la paix publique, ou encore des actes portant atteinte à la vie, l’intégrité, la liberté des personnes, ou au droit de propriété, quand il ne sont pas justifiés par l’application de la loi.
05:09 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, récit, allemagne, nazisme |  Imprimer
Imprimer
22/05/2013
Couleur du temps, récit de Françoise Chandernagor
Une plongée dans un autre siècle, celui des lumières. Ce n’est qu’une histoire imaginée, mais avec un tel réalisme que l’on pense qu’elle fut réelle et que le peintre V*** fut bien un peintre du Roi.
V*** fut-il un grand peintre ou un petit maître ? Un coloriste-né ou un fabricant sans génie ? Nous n’en savons rien : la postérité n’a pas rendu son arrêt. Tout juste peut-on dire que V*** était déjà mort de son vivant : lorsqu’il disparut, sa belle époque était révolue, sa mode démodée. Et pourtant il avait vécu, s’était fait connaître, avait obtenu le succès, avait négligé sa famille, voyageant partout où il était demandé pour peindre les grands de ce monde. Au-delà de l’histoire elle-même de sa vie, Françoise Chandernagor nous décrit à la fois la société de l’époque, sa conception de la peinture, la compétition entre les peintres pour obtenir les faveurs de la famille royale. Elle le fait d’une manière naturelle, introduisant dans le récit ces réflexions sur les événements d’une vie d’artisan-peintre.
sans génie ? Nous n’en savons rien : la postérité n’a pas rendu son arrêt. Tout juste peut-on dire que V*** était déjà mort de son vivant : lorsqu’il disparut, sa belle époque était révolue, sa mode démodée. Et pourtant il avait vécu, s’était fait connaître, avait obtenu le succès, avait négligé sa famille, voyageant partout où il était demandé pour peindre les grands de ce monde. Au-delà de l’histoire elle-même de sa vie, Françoise Chandernagor nous décrit à la fois la société de l’époque, sa conception de la peinture, la compétition entre les peintres pour obtenir les faveurs de la famille royale. Elle le fait d’une manière naturelle, introduisant dans le récit ces réflexions sur les événements d’une vie d’artisan-peintre.
Jeune, il ose : des jeunes gens impatients tirent le tapis. La guerre est finie, on veut s’amuser. Le tableau de bataille rebute, la peinture religieuse assomme, les grands sujets, les grandes idées ennuient les Français ; place au moi, place à l’intime, place au portrait ! (…) On voudrait tout entreprendre, tout oser…Mais les personnes bien nées, si elles ont du goût, hésitent encore à afficher la leur. Le jeune V*** trouva l’art de montrer ce qu’on tient caché sans choquer la décence : les dames de qualité n’avaient qu’à se faire représenter costumées. Pas en Madeleine repentante, évidemment ! Ni en Sainte Elisabeth. Costumées en dévêtues : une muse, une nymphe, une sultane, une allégorie. Il proposa du portrait déguisé « mythologique » ou « oriental ».
Bien sûr il se marie, a des enfants. Il a des instants de joie et des périodes de malheur. Sa vie est à découvrir dans la lecture même du livre. Au-delà, on s’intéresse à l’époque et à sa conception de la peinture.
Nous nous plaignons d’un siècle de courtisans, mais sachons qu’au temps de Voltaire et Diderot la flagornerie et la flatterie étaient obligatoires pour qui voulait se faire connaitre et obtenir des facilités.
A l’époque, l’art de la peinture est tout d’artisanat. C’est par la pratique qu’il pêchait, lit-on à propos du fils de V***. « Pas tant d’huile sur ton pinceau, Nicolas ! Ah oui, je sais : la couleur semble plus facile à étendre, elle est flatteuse, onctueuse, voluptueuse. Et puis, n’est-ce pas, on en a plus vite fini ? Solution de paresseux ! Qui se paie cher : ton tableau séchera, mais seulement en surface – dans dix ans sa peau craquera, il sera gercé de partout, tombera en morceaux. Alors chaque maître possède son atelier, ses apprentis, et le tableau se fait en équipe. Les uns peignent les mains, les autres sont spécialisés dans les pieds, les plus habiles, en passe de devenir maîtres à leur tour, les visages. Le maître met sa touche finale, alanguissant les membres, donnant de la vie aux joues ou à l’œil du sujet représenté. Cela donne une collectivité vivante, soudée, récréative, loin de la méditation individuelle de l’artiste d’aujourd’hui et du travail solitaire d’exécution. Sans doute retrouve-t-on maintenant cela dans certains genres de peinture, tels la production d’œuvres originales en plusieurs exemplaires, dites multiples, ou encore dans l’atelier de Vasarely où les petites mains peignaient inlassablement des ronds et des carrés. Il concevait les tableaux que d’autres exécutaient en grande partie.
Baptiste V*** aime les couleurs, le jaune en particulier. Il en parle avec son nouvel ami sur la fin de sa vie :
– Et qui t’a dit, Baptiste, qu’on peignait avec des couleurs ?
– Si l’on ne peint pas avec des couleurs, avec quoi peint-on ?
– On se sert des couleurs, mais on peint avec le sentiment…
– Le sentiment, Le sentiment ! Et pourquoi pas le naturel tant que tu y es !
Tout au long de sa vie, il conçoit et remanie le portrait de famille, fil directeur du récit. Après tous ses malheurs, il les rajeunit, reprenant les esquisses conservées. Il finit par se peindre lui-même en vieillard. Il l’expose et se retrouve en butte avec tous les critiques. A ce peintre qui ne vendait plus rien, que tout le monde avait cru mort, et dont le nom seul, entouré d’un vague respect, disait encore quelque chose au public, il fallait ôter ce qui lui restait : la renommée. « V*** est fini : Voici le titre. On assure que cet homme a été un bon portraitiste. Il n’est plus rien : le portrait de sa famille est faible, c’est-à-dire flou et léché.
Et ce livre s’achève avec l’interrogation, ma foi somme toute habituelle : V*** fut-il un grand peintre ou un petit maître ? Et d’ailleurs qu’est-ce qu’un grand peintre, qu’est-ce qu’un petit maître ? Vermeer fut un petit maître pendant trois siècles ; et Meissonier qui fut un grand peintre quand Béranger était un grand poète, n'est plus rien…
06:51 Publié dans 21. Impressions picturales, 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, récit, peinture, classicisme, temps |  Imprimer
Imprimer
18/05/2013
La traversée, récit de Philippe Labro
En prologue, les visiteurs : Ils sont debout, en un seul rang serré, en ligne droite, le long du mur blanc et ils sourient tous. Leurs regards, leurs gestes, leurs visages expriment un drôle de sourire, comme une invitation. Tout, dans leur attitude bienveillante, semble vouloir me dire : – Viens ! (…) Ils sont morts, ai-je dit, mais ils ne sont pas morts puisque je suis vivant et puisqu’ils sont là, bien présents le long du mur blanc-jaune, et puisqu’ils me parlent. Ou alors, est-ce moi qui ne suis plus vivant.
ai-je dit, mais ils ne sont pas morts puisque je suis vivant et puisqu’ils sont là, bien présents le long du mur blanc-jaune, et puisqu’ils me parlent. Ou alors, est-ce moi qui ne suis plus vivant.
C’est bien à un récit de Near Deth Experience que nous invite Philippe Labro. Ce n’est plus l’expérience d’une spécialiste de ces événements, le Docteur Elisabeth Kübler-Ross (voir Impressions littéraires les 2 » et 25 mai 2012 : La mort est un nouveau soleil), mais celle d’un homme comme vous et moi, au bord de la mort, et qui, finalement, s’en sort. Il est possible que ces expressions paraissent banales : « Aller de l’autre côté », quel cliché ! « Passer le cap Horn », quelle image facile ! Il faut se moquer de ces remarques. Si l’image paraît facile, c’est qu’elle est l’image vraie. Le problème n’est pas d’écrire : « L’autre côté », mais d’essayer de décrire à quoi il ressemble. Et d’abord, d’affirmer ceci : il y a un autre côté.
Qui eut pu croire que cela suffisait à faire un livre ? Et pourtant, c’est un livre vivant écrit par un ex-moribond et passionnant pour les réflexions qu’il contient.
Comment mesurer le temps lorsqu’on est attaché, perfusé et tubé ? J’ai besoin de me fabriquer une notion du temps. Me raccrocher à tout ce qui évolue : la lumière artificielle, la lumière du jour. Les bruits du matin dans le couloir de la réa, le silence de la nuit.
Il se dédouble, deux voix parlent en lui, celle de la vie et celle de la mort. C’est à l’instant où ce dialogue entre Moi et Moi s’est amorcé que j’ai entamé une nouvelle étape de la traversée. Deux voix vont désormais sans cesse se croiser (…). Elles font partie de moi, ces deux voix sont miennes, mais elles vont s’affronter dans un combat dont je suis le seul acteur et seul témoin. La voix de la tentation de la mort. La voix de la lutte pour la vie.
Et il redécouvre l’amour : Alors revient comme un contre-courant, le visage de l’amour. Alors revient la troisième force. Première force : la volonté et la résistance, transformés en un combat verbal entre les deux voix (la négative et la positive). Deuxième force : le rire. Troisième force : l’amour, les autres.
L’amour qui sauve, c’est non seulement celui des proches, sa femme, ses enfants, mais aussi celui que donne les infirmières, celles qui vous soignent. Ainsi Florence qui parle avec une extrême politesse qui force à l’obéissance.
Trois fois, il passe de l’autre côté, avec une expérience différente à chaque fois. Je me sens sortir de mon corps. J’ai l’impression que je me vois sur le lit, entouré des hommes en blanc et en vert, avec, derrière ce rideau d’hommes, les assistantes et les infirmières. (…) Et voilà que ce corps et cet esprit, qui ne font qu’un, sont entraînés dans le même trou en forme de tunnel qui m’avait fait si peur la première fois. Or ce tunnel n’a plus rien d’effrayant. Non seulement il n’est pas en pente, il ne descend pas, mais il semble monter doucement, dans une ascension bienveillante. En outre, il est clair, de plus en plus clair, il devient même tellement lumineux que je suis aveuglé par cette lumière et je ne vois plus que cela ; de la lumière.
Oui, c’est un livre choc parce que vrai, au-delà des histoires, des visions habituelles de la vie. Philippe Labro a franchi le cap Horn et il en est revenu. Sa vie a changé. Ils sont rares ceux qui sont allés jusqu’à la frontière. Ce sont nos seuls témoins. Alors lisons-les avec respect.
07:55 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, récit, expérience de mort approché |  Imprimer
Imprimer
01/05/2013
Chaque femme est un roman, roman d’Alexandre Jardin
Extrait du prologue :
Parfois, il me semble que les femmes sont des tremplins vers le fabuleux. Ecrivaines pour la plupart non pratiquantes, elles produisent de la prose intérieure destinée à tromper leurs déceptions et à soigner leurs rêves. Changent-elles de métier, d'amant ou d'opinion ? C'est d'abord une césure, un rebond de style, un chapitre qui se tourne. Adressent-elles une œillade à un passant ? C'est un best-seller qui débute. Depuis mon plus jeune âge, je sais que chaque femme est un roman. Voici en quelque sorte mes études littéraires, blondes et brunes.
Alexandre Jardin se penche sur les femmes par l’intermédiaire de scénettes croustillantes d’imagination et de verve. Chacune d’elle se termine par une sorte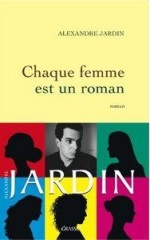 de leçon de chose. Ainsi une erreur sur la personne (féminine bien sûr) fait conclure : Je dois à cette voisine du dessous, avide de cajoleries plurielles, de m’avoir fait sentir combien je suis l’auteur de mes sentiments. Aimons-nous des êtres réels ou l’opinion que nous faisons d’eux ? Ou encore : Alexandre, sommes-nous ce que nous paraissons ? Poser la question, c’était y répondre. Eperonnée d’un vif appétit de vérité, elle aspirait alors, je le suppose, à plus d’authenticité et à redescendre des sommets où je l’avais placée. Miner la perfection, ça use. Notre histoire, asphyxiée de pétrarquisme, ne pouvait plus durer.
de leçon de chose. Ainsi une erreur sur la personne (féminine bien sûr) fait conclure : Je dois à cette voisine du dessous, avide de cajoleries plurielles, de m’avoir fait sentir combien je suis l’auteur de mes sentiments. Aimons-nous des êtres réels ou l’opinion que nous faisons d’eux ? Ou encore : Alexandre, sommes-nous ce que nous paraissons ? Poser la question, c’était y répondre. Eperonnée d’un vif appétit de vérité, elle aspirait alors, je le suppose, à plus d’authenticité et à redescendre des sommets où je l’avais placée. Miner la perfection, ça use. Notre histoire, asphyxiée de pétrarquisme, ne pouvait plus durer.
Les croquis de personnages insolites sont drôles et acidulés. Il décrit ainsi son producteur : J’aime qu’en lui se combattent mille singularités incompatibles et je raffole de l’obstination qu’il met à paraître ce qu’il n’est pas. Romanesque à l’excès, cet animal hors-série s’affiche raisonnable. Suraffectif, il se présente volontiers froid ou blasé en public. Doté d’une curiosité omnidirectionnelle, il raille volontiers les éparpillés et s’il s’installe dans le brillant de l’actualité je l’ai toujours vu passer très au large des modes. Pourquoi pavoise-t-il dans les atours de la réussite alors qu’il n’est qu’aventure ?
Alexandre Jardin campe chaque personnage dans des situations baroques. C’est ainsi qu’il va séjourner dans un hôtel où il est interdit de parler. Et il en tire une conclusion saugrenue : Pendant onze jours, allégé de tout babil, j’ai pu observer qu’on favorise mieux la communication en l’interdisant qu’en la prônant ; car s’obliger à ne pas parler n’a que peu de choses à voir avec le vide. Et encore moins avec le dessèchement de l’indifférence. Vidangé de son trop-plein de mots, le monde devient alors transparent. Comme si la parole empêchait les dialogues de grande amplitude. Jamais je n’ai eu autant le sentiment d’échanger avec celle que j’aime. Dans le vacarme de notre mutisme, au bord du grand soupir de l’océan, chaque regard de Liberté (sa femme) se mit à compter. Tout gémissement avait valeur de discours incandescent. Le moindre devenait colossal. C’est là-bas, épargné par la dérobade du langage, dans cet ermitage des tempêtes tropicales, que j’ai appris ma femme. En la dessinant bouche cousue, je l’ai mieux sue.
Les hommes ont toujours à apprendre des femmes. De plus, ils aiment se laisser surprendre pour se retrouver dans l’inconnu imprévisible, l’univers féminin. Madame Equal, professeur de maths, a adopté un système éducatif radical, elle vire les bons élèves. La semaine suivante, je savais mes cours par cœur avant d’entrer en classe : pour pouvoir sortir au plus vite et jouer au foot avec vacarme. Et nous fîmes tous de même, nous les « virés » afin de ne pas moisir parmi les « inclus » condamnés à végéter devant un pupitre. Mme Equal est la seule prof de maths qui ait jamais su me motiver indirectement, comme si elle avait compris que le plus court chemin entre deux points reste le zigzag. (..) Mais à la fin de l’année, c’est elle qui fut virée !
Alexandre Jardin ne manque pas d’imagination et d’observation. En observant les femmes, il se construit lui-même. La plupart d’entre nous ne tirent que peu de conclusions à nos habitudes de penser. Lui, d’un coup d’œil, croque le comportement féminin et lui rend sa puissance imaginative. Alors le regard sur les femmes change l’homme et ouvre en lui la porte de l’amour. Peut-être sommes-nous essoufflés dans la dernière partie du livre. Trop, c’est trop ! La verve devient lassante. Il termine sur un pied de nez : A ma montre, celle de papa, il est exactement huit heures vingt du matin à l’instant où je tape ces mots ; l’heure où j’ai aperçu Liberté pour la première fois il y a sept ans, d’un coup d’œil dilaté. Parviendrai-je à épouser cette femme qui, déjà, m’apprend à mourir en dansant sur les tables ? Elle sait si bien me mettre en demeure de rencontrer l’inattendu ; à son bras, je consens à vieillir.
07:23 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, femme, récit |  Imprimer
Imprimer











