30/11/2014
Poussière
Elle lui fit mordre la poussière. Qu’était-elle, cette furie ?
Pourtant ses cheveux d’or lui donnaient l’air guilleret
Il tenta sa chance, cherchant à l’embrasser à pleine bouche
Sans dire mot elle lui prit le col, le regarda sans haine
Et d’une hanche adroite le fit passer sur sa tête
Souviens-toi, une femme est un roseau de douceur
Pour qui sait l’approcher avec mérite et respect
Elle ne jette pas la poussière aux yeux du monde
Elle se tient droite, implorante et discrète
Et t’entraine dans son sillage odorant et subtil
Tu es poussière et tu retourneras à la poussière
Le vent te chassera de tes lieux habituels
Tu erreras en solitaire autour de tes envies
Paillettes de cristaux, gemmes éblouissantes
Et le temps passera, rafraichissant la nuit
Bien souvent les hommes se réduisent en poussière
D’autre fois ils baisent la poussière de ses pas
Ses pas adorés parce que menus et annonciateurs
De caresses et tendresses tant recherchées la nuit
Quand le vaincu pleure son combat perdu
Mais n’est-ce point ces poussières cosmiques
Qui se formèrent un jour au-dessus de nos têtes
Pour devenir soleil et lune en harmonie
L’une soutenue par l’autre, froidure et brûlure
Grains en devenir, tourbillon d’ivresse cosmique
Elle vole, perceptible dans le rayon du matin
Lorsque les yeux ouverts sur le jour naissant
Tu contemples ton avenir en brillance
Et te prends à rêver, la larme à l’œil
A celle qui souffle sur la poussière de ta vie
© Loup Francart
07:10 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, littérature |  Imprimer
Imprimer
26/11/2014
Les rats
Ils sortent par milliers des plaques d’égouts
Des soupiraux, des portes et des fenêtres
Qu’arrive-t-il à cette masse de poils
Qui surgit ventre à terre dans la nuit ?
Sur le seuil d’une porte un enfant est assis
Il joue d’une flûte de bois au son aigrelet
Avec deux doigts qui s’agitent frénétiquement
Et impriment au ciel la valse lente des étoiles
Et chaque rat se sent revivre et danse
Sans pouvoir s’arrêter même au lever du jour
Leurs membres sont reclus de fatigue
Mais la danse leur tient au ventre
Quel étonnant spectacle que cette samba
Accompagnée de frôlement de fourrure
Qui font grincer des dents les passants
Et rire les petites filles aux jambes claires
Quand donc cessera ce vacarme insolite
Y a-t-il encore dans ce Paris aux caves sourdes
Un rat non mélomane perclus de rhumatismes
Qui dort sous la gouttière bouchée ?
Non, tous sont là, enchantés et joyeux
Ils dansent à pleines jambes, le tutu de travers
Souriant de leurs longues dents de lait
Pensant aux enfants qui vont sortir des portes
Tout à coup l’un d’entre eux donne l’alarme
Le tintement de l’ouverture électrique
Déclenche l’hallali à la porte de l’immeuble
Ils se précipitent tous dans l’ouverture...
Ce qu’il se passa au-delà de l’entrée
Ne peut être raconté...
Les journaux en parlèrent le lendemain
Mais personne ne sut le triste sort
Des enfants de l’immeuble 69
Dans la rue des Martyrs
Dont les caves s’effondrèrent
Dans un frôlement de poussière
Seul l’évêque Denis, décapité
Qui marcha jusqu’à la basilique
Connait cette histoire ignorée
Car il portait sa tête à hauteur des soupiraux
© Loup Francart
Cette rue fut ainsi nommée car c'est celle qu'aurait empruntée, selon une très ancienne tradition, saint Denis, premier évêque de Paris, martyr, sous l'Empire romain. Après avoir été décapité, il marcha sur cette route, tenant sa tête entre les mains, pour s'écrouler quelques kilomètres plus au nord, où fut fondée la basilique de Saint-Denis. (http://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_des_Martyrs)
07:18 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer
Imprimer
22/11/2014
Le grand repos
Elle est venue l’heure sans en connaître le lieu
Tu as senti cette crevasse qui s’ouvrait en toi
Un éclair et puis rien que ce silence mélodieux
Et ce pas dans le vide qui te laisse pantois
As-tu encore le droit de vivre sans connaître
Le temps et l’espace de ta détermination
Ou sais-tu déjà à qui remettre ta lettre
De démission à faire sans vertes ablutions
S’ouvre sous tes pieds fragiles l’ouverture
D’un univers sans fin et même sans reliure
Tu tombes évanoui dans les plis de l’oubli
Et tu ressors lavé de toute forfaiture
Planant en solitaire et déployant toute voilure
Jusqu’à l’instant mythique du bref coupe-circuit
© Loup Francart
07:25 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, littérature |  Imprimer
Imprimer
18/11/2014
Cosmos
Où cours-tu ? Ne peux-tu rester calme ?
Entre en toi-même et admire cet espace
La liberté est là, présente et enchanteresse
Une brise douce sous un soleil radieux
Tel le bouchon de champagne qui saute
Tu changes de monde et de portage
La grande classe du cosmos est ouverte
Tu t’y promènes les mains au dos
Et contemples les croisements galactiques
Le siphon du monde ancien vers le nouveau
Te rend plus léger. Le liquide devient gaz
Qui t’élève en toi-même. La vie s’écoule
Les secondes résonnent en toi patiemment
Le temps s’arrête ou, au moins, ralentit
Les images se dédoublent en louchant
Qu’emporterai-je dans cette nouvelle destinée ?
Quelques miettes d’amour, un brin d’amitié
Un trou d’air à la surface des pensées
Et le passage émouvant de mes turpitudes
Aux yeux de ceux qui restent
Merci la terre, le cosmos m’appelle
Désormais je me glisse, mince et serein
Dans l’espace virtuel de la page blanche
Pour y déposer la tache de l’immortalité
© Loup Francart
07:44 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, littérature |  Imprimer
Imprimer
13/11/2014
La chambre à grâce
Il arrive que je sente en moi des fuites.
Quelques temps je regonfle mon fond,
Puis, flottant au vent de l’inconduite,
Je repars, à nouveau, vêtu en caméléon.
D’autres fois, le cœur n’y est plus.
La fuite s’accentue jusqu’au trou d’air.
Ce n’est pas que je me sente exclu,
Mais je n’ai plus l’allant de l’écuyère.
Les batteries usées de la tempérance
M’inclinent à la modestie. Trou noir !
Je n’attends pas cette panne de conscience.
Elle survient comme un coup de tranchoir.
L’air me manque, j’étouffe et suffoque ;
Je panique telle la grenouille mal à l’aise
Dans l’eau qui chauffe et la rend équivoque.
Sur mon véhicule, je ne suis plus qu’un obèse.
Sans s’annoncer, elle survient en catimini.
La chute s’accentue, mais je me regonfle
A cette bouffée rafraichissante de paradis,
Telle une caresse vers l’homme qui ronfle.
Je m’éveille à moi-même, l’esprit purifié.
J’aborde cette étape avec circonspection.
Suis-je certain de pouvoir m’évader ?
Je redoute encore une nouvelle crevaison.
Pourtant je repars les naseaux ouverts,
Humant ce ciel limpide en amoureux,
Appréciant ces mouvements de l’air
Qui m’agitent et me font un être radieux.
L’audace revient à grands coups de pagaie.
J’ai chassé en une pensée mes angoisses.
Gonflé à bloc, enivré et béat, je me recrée.
Au fond de l'être, j'ai trouvé la chambre à grâce…
© Loup Francart
07:23 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer
Imprimer
09/11/2014
Lui
Longtemps elle l’a rêvé, il est là l’homme radieux.
Qu’est-il devant elle, la charmante résolue ?
Il vient, se sachant découvert et craignant Dieu.
Elle le regarde, mais signifie-t-il l’absolu ?
Lui qui n’a jamais rêvé devant une femme nue,
S’interroge sur son destin d’homme délétère.
Le guerrier a-t-il encore le pouvoir malvenu
D’outrepasser son rôle et passer la frontière ?
Elle est pourtant ténue cette limite imaginée.
Tendre le bras, pailleté d’or… Vêtue de nuée...
Elle ouvre son regard d’ange et le contemple.
L’homme n’est qu’un double incertain d’elle-même.
Il a moins de forme et se peut-il qu’il m’aime ?
Elle le reconnait et, seule, le conduit au temple.
© Loup Francart
07:13 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer
Imprimer
08/11/2014
Parution de "Dictionnaire poétique"
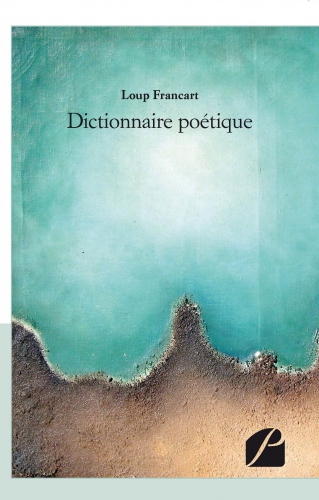
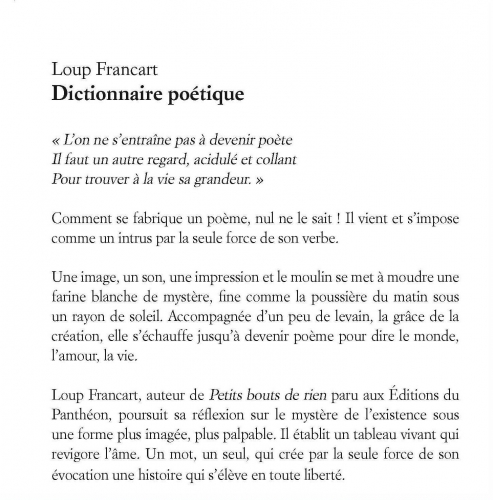
Faites rêver... Offrez donc un recueil de poésie en cadeau de Noël. L'heureux élu vous en sera gré, il pourra rêver pendant ces jours où la réalité dépasse parfois la fiction. Avec cet ouvrage, la fiction n'est jamais dépassée.
Un mot, c'est une image, un son, un picotement qui étire un fil ténu qui, s'il est suivi, vous entraîne au bout du monde et de l'imagination. Vous fermez le livre et cela se poursuit en vous inconsciemment. Alors, vous devenez vous-même poète.
|
Détails du Livre |
|
|
Pages : |
186 pages |
|
Genre : |
Poésie |
|
Paru le : |
07/11/2014 |
|
Référence : |
ISBN 978-2-7547-2626-9 |
|
Format : |
13x20 Broché |
07:29 Publié dans 44. Livres | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, recueil de poésie, littérature, édition |  Imprimer
Imprimer
04/11/2014
Annonce
Hier, couché sans sentiments ni appréhension
L’aménité de l’air incitait à l’absence.
Tu sombras dans un sommeil englué et profond.
Rien ne viendrait troubler ta béate défaillance.
Tu te levas dans la nuit, l’œil encore endormi.
Au dehors la douceur assassinait l’automne.
Noir d’encre, sans couleur, hors de toute académie,
La furie sans parole, perverse et tatillonne.
Qui vit ce ciel encombré, serré sous la lune
D’une éclaircie parcimonieuse et tendre,
Mariage du jour, mêlée de l’infortune ?
Jusqu’au cœur de l’obscurité, rien à attendre.
De lourds nuages volaient très bas. Levant le doigt,
Tu les comptas entiers sans pouvoir les partager.
Ils annonçaient les eaux promises, avec la joie,
Sans incision, d’une mort de l’été annoncée.
C’est bien le dernier jour des rêves alanguis,
Reposant dans l’océan, bercé par la vague,
Avant les cataractes qui te laissent groggy,
Sans soutien solide ni même au doigt une bague.
© Loup Francart
07:09 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : popème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer
Imprimer
31/10/2014
Vitalité
Laisse monter en toi le délire de mots
Ferme les yeux à l’apostat !
Elle partit d’un jet, courant sur le pré
Encombrée de sa robe de mariée
Elle nous quitta sans bruit
Pfuit… Plus rien devant nous
J’eus beau chercher sa taille
Je ne trouvais que le bruissement
Des fils de soie de sa ceinture
Qui se dévidaient entre mes doigts
Alors moi aussi je me mis à courir
Derrière les courants d’air
Prenant garde de ne pas m’enrhumer
Jamais je ne pus la rattraper
Nous parcourûmes le monde
Puissant dans nos besaces
L’espoir de nous retrouver
Et de nous jeter dans les bras l’un de l’autre
Mais elle s’échappait plus vite
Allez savoir pourquoi
Elle sentait le stupre et la caresse
Mais volait comme une princesse
Nous passâmes au pôle nord
Refroidis jusque sous les aisselles
Nous parcourûmes le désert
Pleurant de soif derrière l’ombre
Nous naviguâmes toutes voiles dehors
Jusqu’aux confins de la terre
L’œil sur l’horizon, la main sur la barre
Sans jamais rencontrer un être vivant
Aujourd’hui, je poursuis nos fantasmes
Seul, sans pilote ni moteur
Ronronnant petitement, nu sous le soleil
Et me brûle au rêve de mes prédécesseurs
Où donc es-tu passé sous ta robe de taffetas ?
Ton fantôme court-il encore, invisible
Aux regards des hommes en attente
D’un plus grand désespoir ou abandon
Fuis-tu toujours sous l’opprobre
De cette matinée aérienne
Quand tu te levas avant de dire oui
Et sortis sereine sans un pleur
Plus rien ne pourra cacher
Cette blessure béante à ton flanc
Celle de la séparation mortelle
D’avec l’homme d’une vie morose
Altière tu nous quittas, tête haute
Les larmes aux yeux, mais souriante
Et marchas vers ton destin
L’adoration sans faille de la vitalité
© Loup Francart
07:58 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer
Imprimer
30/10/2014
Ne pars pas avant moi, roman de Jean-Marie Rouart
Le dernier chapitre éclaire le livre et le résume. L’orage. Eclatera-t-il ou se contentera-t-il d’agacer les nerfs ? L’auteur condense en une description des aléas de la nature celle d'une vie qui semble familière, mais dont les plis recèlent de multiples réminiscences. Je pense à Berthe Morisot, qui a écrit dans ses carnets la phrase la plus belle et la plus désolée qu’on puisse confier à soi-même quand on s’apprête à quitter le monde : « Mon ambition se bornerait à fixer quelque chose de ce qui se passe ; quelque chose, la moindre des choses ; une attitude de Julie, un sourire, une fleur, un fruit, une branche d’arbre et, quelques fois, un souvenir plus spirituel des miens, une seule de ces choses me suffirait. » J’ai l’impression d’appartenir comme elle à cette race qui se désespère de ne trouver rien qui lui apporte la preuve de son existence, sinon en la mettant en peinture ou en mots. Ces mots capables de façonner les visages et les paysages, il me semble qu’ils me relient à la seule vie par laquelle j’existe. (…) Qu’est-ce qui demeure encore ? (…) Quel sens, tout cela ? (…)
Le soleil réapparaît éclairant le cap Corse, effaçant le souvenir de l’orage. Un petit nuage rose à même l’impudence de gambader au-dessus de l’horizon. Je regagne ma chambre. Un message de Jean d’Ormesson m’attend : « Ne pars pas avant moi. »
Ainsi s’achève ce roman autobiographique, fait de morceaux de vie de l’adolescence à la vieillesse qui n'est qu'évoquée dans ce dernier chapitre. L’auteur se dévoile tout en s’interrogeant sur les mystères du destin. Un jeune homme lointain et proche, qui vit l’amour avec ironie et qui conte ses rencontres avec le sérieux qu’il semble attacher au côtoiement des grands de ce monde, en particulier de la littérature.
Qu’en retenir ? L’évocation de ses conquêtes. D’abord Solange qui le trompe, mais qui l’aime malgré son mariage, Sara qui abandonne ses futilités pour le rejoindre dans sa chambre d’étudiant et quelques autres, toutes enchantées et enchanteresses. L’évocation de ses rencontres aussi, avec Vergès, Cardin, Nourrisier, l’écrivain du désenchantement du monde, mais surtout Jean d’Ormesson, l’écrivain fétiche du jeune homme qu’il était et qu’il veut nous faire croire qu’il est toujours.
Cette dernière évocation donne le style du livre. Oui, il est merveilleusement écrit, plein de descriptions oniriques et d’extases sur cette vie de rencontre, promenade dans les salons littéraires quelque peu compassés. Car si le style est enchanteur, les enchantements décrits restent très personnels et font preuve d’un certain contentement de soi. Il se décrit comme un être rejeté parce qu’il a raté son bac ; J’avais dix-sept ans. Ce soir-là, je n’attendais rien de la nouvelle année. Pourtant j’en attendais tout. J’avais peur de m’enliser dans une existence grise et banale et, au fond de moi, j’étais gonflé d’espoir. (première page du livre qui en donne la trame). Mais il fait apparaître son contentement dans les descriptions de cette vie bourgeoise, riche matériellement et intellectuellement.
A la manière de Jean d’Ormesson, Jean-Marie Rouart est un enchanteur qui tourne sur lui-même, y revient sans cesse et se délecte dans ce mélange de réalité et de fiction, d’impressions et de descriptions, de liberté et d’obligations.
Ecoutez-le et vous comprendrez :
http://www.youtube.com/watch?v=VEAaG9t7yQ0&feature=player_embedded
07:09 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, livre, écrivains, vie, société |  Imprimer
Imprimer
27/10/2014
Danse
Ils étaient trois
Trois pigeons sur le bord d’un toit
Dans le carreau de ma fenêtre
Ils dansaient la valse des pigeons
Non… Il était seul, sans autre aide
Que celui du rebord de pierre
Sur lequel il s’épanchait
Sous l’œil impavide des deux autres
La gorge haute, il se dressait
Et avançait à petits pas
Puis deux tours sur lui-même
Sans autre forme de procès
Il revenait vers eux, crânement
Reprenait ses deux tours
En sens inverse, en métronome
Puis repartait en riant
Vraisemblablement, il délivrait
Aux deux autres un message
Que je ne compris pas
Je le voyais, aller et venir
Il poursuivit sa complainte
Devant le manque de réaction
De ces compagnons ahuris
Et s’arrêta, interrogatif
– Ne voyez-vous pas, compatriotes
Que j’esquisse la danse sacrée
Des pigeons délurés
Jamais je ne tombe ni m’étourdis
Oui, il est temps de partir
Devant tant d’incrédulité
D’ailleurs l’un d’eux
Se jeta dans le vide
L’autre, penaud et embarrassé
Voulut conclure ce message
Il se redressa courroucé
Et monta droit dans les cieux
Le danseur resta unique
Sur le bord du toit
Là où toi et moi
Ouvrons nos cœurs de chair
Alors il partit lui aussi
D’un coup d’aile, un froufrou
Qui traversa la rue
Et vint frapper l’attente
Oui, trois pigeons au coin du toit
Dont un dansait la valse
Pour les deux autres
Qui ne virent rien
© Loup Francart
07:48 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer
Imprimer
22/10/2014
Double
Il est parti celui qui est plus que moi-même
Et je ne sais même plus qui je suis devenu
Un grand noir s’est installé, froid de marbre
Je m’y cogne la tête. Elle est toute cabossée
Où es-tu passé mon frère, toi qui m’accompagnais
Au cours du périple inhumain de la vie ?
Dans un brouillard intense, j’erre, solitaire
Je marche les yeux fermés, les oreilles bouchées
Le nez au vent, les mains en avant
Sans revivre ces jours intenses et rafraîchissants
D’une présence personnelle et troublante
Moi-même devenu autre et pourtant moi
Errant dans l’absurdité du monde déchu
Percé de courants d’air et de gaz purulent
Quel malheur ce départ !
Il est parti celui qui est plus que moi-même
Et je ne sais même plus si je suis.
© Loup Francart
07:28 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer
Imprimer
19/10/2014
L'ombre
Longtemps, je ne l’ai pas remarquée
Elle passait inaperçue à mes yeux
Peut-être ne voyais-je pas le soleil ?
Un jour cependant, ou plutôt un soir
Elle m’est apparue, fragile
Comme une ombre d’elle-même
C’était bien mon ombre à moi
Oui, elle me ressemblait
Même profil, encore que j’ai du mal
A contempler mon profil altier
Sans utiliser une glace fraiche
Embuée à sa sortie du frigo
Depuis elle ne m’a plus quitté
Je la trimbale avec moi
C’est ma sœur, encombrante
Elle veut parfois passer devant moi
Elle me pousse vers le chambranle
Et se propulse en courant d’air
Pour entrer la première, rosissant
Devant les regards acérés
Oui, elle me fait de l’ombre
Cette enveloppe sombre
Qui se détache de moi
Sans avoir le courage de me quitter
Parfois elle me sourit
– Qu’en penses-tu ?
Semble-t-elle me demander
J’avoue ne plus savoir
Si elle est mon double
Ou si elle se joue de mes hésitations
Je la contemple se mouvoir
Et sourire à tous, enchantée
De ce subterfuge honteux
Et je dois moi-même sourire
Pour ne pas délier ce mariage
Hors nature avec mon double
Oui, il lui arrive de se coucher
A mes pieds, vers midi,
Et de me dire – Ne bouge plus
Je suis bien près de toi
Laisse-moi reposer contre toi
Me réchauffer à ton corps brûlé
Enflamme-moi dans tes bras
Et courre plonger dans l’eau
Là où les rayons de l’astre
Ne peuvent m’atteindre
Je pourrai alors te laisser en paix
Blottie dans ton corps refroidi
Jusqu’à devenir transparente
– Quelle idée, lui ai-je répondu
Sans toi je ne serai plus
Si tu deviens invisible
C’est que moi-même ne suis plus
Même dans l’eau claire
J’ai besoin de ma consistance
Comment pourrai-je nager ?
Je coulerai et disparaîtrai
A jamais aux yeux de tous
Et c’est ainsi qu’un jour
Il y a déjà longtemps
Je devins transparent
Invisible
Nu
Comme une amibe
Même au microscope
Mes voisins ne m’ont pas trouvé
Ils pleurèrent quelques jours
Puis, de guerre lasse
Me laissèrent partir vers d’autres cieux
Dans ce pays où la lumière
Envahit tout, y compris les êtres
Là l’ombre n’existe pas
Et ne fait plus peur aux femmes
Elles ne se remaquillent plus
Sûres de leur effet sur l’unique
Sans doublure vertueuse
Qui les regarde béatement
Volant de ses petites ailes
Autour de leur personne
Qui rayonne de bonheur
Sans l’ombre d’un doute
© Loup Francart
07:53 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, littérature, poème, écriture |  Imprimer
Imprimer
15/10/2014
Ange
Quelle expression ! Il est aux anges.
Serait-il confit de sucre et d’olives
Dans un sourire figé et malheureux
Comme le chevalier du ciel
Certains en font le saut
Ils s’élancent de la falaise
De leurs idées préconçues
Et plongent dans la folie
D’autres, en cheveux fins
Enlacent leur possession
D’un filet protecteur
Pour mieux les conserver
Les anges de mer
Planent dans les eaux
Et font de l’ombre
Aux plongeurs ensommeillés
Ils se mangent également
Ces fins vermicelles argentés
Flottant dans leur potage
Comme des bras de poulpe
Peut-être vivront-ils assez longtemps
Pour entreprendre l’estomac
Et vous courber en deux
Dans une crampe dithyrambique
Avec une patience d’ange
Elle contourne le viril
Et le retourne sur le gril
Pour convertir son égo
Les enfants comme les anges
Volent en paquets rieurs
Ils s’amusent de l’effroi
Qu’ils causent inconsciemment
Parfois même, ils se moquent
Des remontrances outragées
Que font dans le village
Les guetteurs de scandale
Pourtant ils existent ces anges
Qui protègent la victime
De l’inlassable opprobre
Des veilleuses à la fenêtre
Mon ange s’exclame la mère
Mais ange est-il celui-ci
Qui court en sabots
Dans la neige de l’innocence
L’ange est fidèle et serein
Il ne cache pas sa préférence
Pour le meilleur de l’homme
Il l’enrobe de ses bras protecteurs
Certains cependant se sont révoltés
Et on acquit l’indépendance
Mais pour quoi faire ?
Ils errent dans le noir et le froid
Déchus, ils recherchent compagnie
Et tendent leur bâton sucré
A ceux qui méditent en silence
Sans savoir vers quoi pencher
Les quatre cavaliers de l’Apocalypse
Ministres de la vengeance divine
Epuisent en rond leurs montures
Pour assurer une victoire amère
Mais il est des anges féminins
Qui font craquer l’homme quel qu’il soit
D’un regard assuré et d’une caresse maligne
Le cœur retourné, le baiser sur la bouche
L’ange de lumière ne se dévoile
Qu'à ceux qui se laisse aller
Dans les bras de l’absence
En toute innocence
Toi, mon ange,
Qu’es-tu pour m’attirer à toi
Ouvrir mon âme asséchée
Et la couvrir de baisers ?
© Loup Francart
07:02 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, littérature |  Imprimer
Imprimer
11/10/2014
Moi et Toi
Moi et Toi. Qui de nous deux ?
Serais-tu celle que je suis ?
Suis-je celui que tu es ?
Nous sommes deux ou un
Selon le cas, selon l’heure.
La nuit, dans l’obscurité,
Je prends ta main pour la mienne.
Tu me caresses le visage
Et ton souffle veille sur mon corps.
Enveloppé de douceur
Je ne sais plus où je suis.
Suis-je même encore moi-même ?
Je m’approche de ton être.
Tu deviens ce que je suis
Et je suis ce que tu es.
Ensemble nous marchons
Dans notre tête enrubannée
Et portons haut et fort
Notre volonté de vaincre
Ceux qui ne savent pas
Qu’ils sont un en étant deux.
Moi et Toi. Qui sommes-nous ?
Nous sommes l’un multiple
Et rien ne nous détachera.
Si ! Sans doute… la mort.
Mais qu’est-elle finalement
Au regard de l’amour.
© Loup Francart
07:29 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer
Imprimer
07/10/2014
Elle avait des bagues
Elle avait des bagues plein les doigts
Peut-être pour cacher leur fragilité?
Des bagues en poils d’éléphant.
D’autres en eussent fait un manteau,
Le chameau est si commun.
Il eut sans doute été trop lourd
A soutenir par la tige d’acier
Où repose la pyramide de verre.
La tête, comme les doigts, entourée de bagues
Se tisse une couronne d’innocence volontaire.
© Loup Francart
07:11 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer
Imprimer
03/10/2014
Qu'es-tu, toi qui n'es rien
Qu’es-tu, toi qui n’es rien ?
D’où viens-tu, toi qui n’as pas été ?
Où vas-tu, toi qui deviens tout ?
Je me cherche à l’extérieur de moi-même
Je me trouve derrière la frontière
Elle est de verre, invisible, incolore
Je la trouve en un clin d’œil
Mais cette enveloppe est vide
Et d’une richesse infinie
Rien ne vient la troubler
Enfermé dans cette coquille de noix
Je promène mon inexistence
Au-delà des planètes et des galaxies
Tu es ce que je ne suis pas
Je suis de chair et d’os
Tu me donnes l’inexistence
Un être sans squelette
Je flotte entre les strates
Des univers cloisonnés
La lumière se dévoile
Et me rend aveugle
Oui, qui est-il lui qui est tout ?
© Loup Francart
07:38 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer
Imprimer
01/10/2014
Mort d’un berger, roman de Franz-Olivier Giesbert
Un roman à la Pagnol ou Giono, qui enchante l’air vif du matin et redonne à la nuit l’odeur des contes. La montagne dans toute sa splendeur unique qui accueille le troupeau des hommes, petit, lent, coléreux et chaque individu si singulier, unique qui tente de se prendre pour Dieu. Le curé est ivrogne, mais si près du ciel qu’il ne peut en redescendre. Le berger, un vieillard de 80 ans, mène son troupeau avec Mohamed VI, un muet bien guilleret qui très vite Juliette Bénichou, tout cela sur fond de mort d’un furieux, Fuchs, qui se fait tuer dans sa maison. La gendarmerie est là, bien sûr, avec un capitaine interrogateur et un berger muet. Tout cela se passe dans l’odeur de la lavande, le son des grelots du troupeau, la vue de la plaine, en bas, immense vu d’en haut, dans l’herbe jaune et fraiche des hauteurs où les moutons vivent le meilleur de leur temps.
berger muet. Tout cela se passe dans l’odeur de la lavande, le son des grelots du troupeau, la vue de la plaine, en bas, immense vu d’en haut, dans l’herbe jaune et fraiche des hauteurs où les moutons vivent le meilleur de leur temps.
Cela commence par la mort de son fils. Un papillon s’était posé sur son front mort. Le vieil homme commença à parler au papillon. Il causait toujours beaucoup aux bêtes. Aux ombles chevaliers, surtout, qu’il allait retrouver de temps en temps au lac d’Allos, après la pêche, certains jours de canicule. Dans son genre s’était une attraction, Marcel Parpaillon. Les ombles chevaliers venaient, de tous les coins du las, l’écouter glouglouter en agitant les bras. Il leur disait des tas de choses qui ne peuvent s’écrire, parce qu’elles sont au-delà des mots.
Quelques jours plus tard un autre malheur. Un matin, quand il arriva à la bergerie, Marcel Parpaillon roula de grands yeux stupéfaits, avec une expression d’horreur, et il lui fallut s’agripper à Mohammed VI pour ne pas tomber, avant de laisser choir son derrière sur une souche de pin. Ses lèvres se mirent à trembler comme des feuilles, et il sanglota, mais sans pleure, car il n’avait plus de larmes depuis la mort de son fils. Il resta un long moment, la bouche en O, tandis que Mohammed VI s’agitait dans le parc à moutons. C’était comme une forêt après la tempête du siècle. Des tas de brebis couchées les unes sur les autres ? Dans un mouvement de panique, elles s’étaient jetées, par vagues, contre un muret de bois, pour y crever. La moitié du troupeau était morte ainsi de peur, de bêtise et d’étouffement.
Et le berger part en guerre contre le loup, contre le maire qui ne veut pas que l’on parle du loup, contre les gendarmes qui cherche maintenant l’assassin de Fuchs. Ils partent en montaison, le berger, Mohammed VI et Juliette. Il se réfugie dans l’air libre des hauteurs. On aurait dit que le temps s’était arrêté. Ça arrive souvent, l’été, dans la patantare. Il suffit que le vent faiblisse et c’est comme si le monde entier retenait son souffle. Ça peut durer toute une journée. Il était dans les deux heures de l’après-midi, mais il aurait pu être tôt le matin ou tard le soir, c’eût été pareil. Le même silence. La même langueur. Une sorte d’éternité.
Le loup est tué, mais le berger est blessé. Il mourra quelques jours plus tard après être redescendu de la montaison. Marcel Parpaillon a rejoint le mouvement perpétuel qui va et vient, en emportant tout, un jour ou l’autre, dans ses ténèbres vivantes. Il est l’eau, le feu, l’air qu’on respire, le sommeil des siens, ou le bonheur qui danse dans leurs yeux. Il est les étoiles aussi. Nous sommes tous des poussières d’étoiles. On prend toutes sortes de formes, des airs importants et des chemins vairés, mais on reste un petits tas d’acides aminés qui pantelle, longtemps après que la flamme a été soufflée.
Quand elle ne s’éteint jamais, c’est un berger.
07:18 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, livre, roman, mort, vie, société |  Imprimer
Imprimer
29/09/2014
L'huître
Ce n’est qu’une sorte de caillou
Très grossier et difficile à saisir
Transpirant des larmes vertes
Ouvrant parfois un sourire
Et riant béatement d’une bouche
Sans lèvres ni douceur
Il sent la marée des matins d’été
Quand vous partez à peine levé
Vers l’écailler du port fantôme
Et que vous entendez les cris
Des marins partant vers le large
Vous éprouvez l’irrésistible envie
De vous immerger dans l’iode
Rugueuse et foisonnante
Et d’éclater en les pressant
Les bourgeons des algues noires
Alors vous quittez vous aussi le port
Et voguez librement dans vos rêves
Secoué par les ondulations
D’un bateau qui vous emporte
Dans le monde inconnu et cruel
Des sirènes et des dauphins
Réveil !
Le couteau à la main, vous cherchez
Cette lèvre émincée qui suinte
Son odeur subtile et froide
Ne vous laissez pas charmer
Prenez l’air du tueur à gage
Fouillez dans ce corps dur
Pour d’une pression de la pointe
Enfoncer la lame aiguisée
Et d’un revers du poignet
Forcer l’animal à se dévoiler
Il résiste encore faiblement
Et du tranchant cette fois
Vous achevez votre sinistre besogne
Coupant le lien ténu, maintenant
Fermement le couvercle
Encore un effort pour désolidariser
Ce contenant aux reflets voilés
Du liquide clair et transparent
Qui sent le fond des mers
La folie des grouillements obscurs
La vie sans mouvement des pierres
Qui se révèlent fécondes
Baignant dans ce désir palpable
Elle est là, légèrement rosée
Et dévoilant son corps nu
Offerte au regard concupiscent
De l’amateur éclairé et enfiévré
Elle n’est parcourue que d’un frémissement
De ses membranes ondulées
Comme les amants avant l’amour
Avec douceur et respect
Vous approchez vos lèvres de sa froideur
Pour y trouver ce surplus de vie
Que vous guettiez dans l’inertie
D’un caillou fermé sur lui-même
Ce baiser glacé, au goût de mort
Envahi votre bouche et la réveille
Vous montez dans l’air du matin
Et vous êtes à la porte du paradis
Délicatement, avec soin, avec intérêt
Vous détachez cette chair offerte
De son point d’encrage
Pour la laisser une dernière fois
Baigner dans son élément fluide
Et s’épanouir avant de mourir
Vous portez cette coupe improvisée
A vos lèvres avides et aspirantes
Et goûtez toute la subtilité
La fraicheur, l’innocence,
De cette chair qui s’offre
En toute impudicité et bravement
A vos dents qui la tranche
Pour en goûter intimement
Le suc ailé de l’éternité
Etes-vous au ciel ou sous les eaux ?
Vous ne le savez
Englobé de fraicheur acide
Vous n’êtes plus sur terre
Vous flottez à nouveau
Dans le liquide amniotique
Du commencement du monde
Lorsque vous n’étiez qu’en devenir
En espérance de volupté
Prêt à mourir ou à vivre
De cette expérience inqualifiable
© Loup Francart
07:40 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, littérature |  Imprimer
Imprimer
25/09/2014
Neuf heures
Neuf heures…
La ville dort, l’ombre veille
Les yeux ouverts sur ton image
Je t’entends ébaucher de tes lèvres vivantes
Mon nom comme un murmure insaisissable
Au-delà des collines
Derrière l’amas de fer et de béton
Qui crée notre séparation
Tous les mots prononcés
Tous les rires jetés en l’air
Rebondissent sur le miroir
De ton regard tourné vers moi
Neuf heures encore…
Comme un sourire inépuisable
Lorsque le soleil apparaissant
Sur tes cheveux épars
Parmi les aiguilles de pin
Proche et lointaine
Vivante ou morte
Ton absence évanouie sur cette heure
Cerne mon visage attentif
Encore quelques secondes
Quelques minutes volées
Une caresse rêvée et malhabile
Et la nuit reprendra son bien
Pour l’ensevelir parmi les étoiles
© Loup Francart
07:20 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer
Imprimer
21/09/2014
Abstrait
Le regard éperdu, il courre
Il échappe ainsi à l’abjection
Ils le poursuivent sans le prendre
Il s’est caché entre leurs jambes
Va-t-il arriver à s’en sortir ?
A-t-il encore le souffle
Du lutteur ou du coureur
Ou s’épuise-t-il sans fin ?
Ils le guettent sur la plage
Ils savent qu’il viendra
Savourer sa victoire
Dans l’eau bénie des mers
Pourtant il ne vint pas
Il se glissa dans le tuyau
De l’infamie, discrètement
Jusqu’à disparaître de leur vue
Où donc est l’artiste
Qui s’est moqué de nous ?
Comment croire un instant
Qu’il sait tenir un crayon ?
Non, il n’a rien dessiné
Que quatre traits et un rond
Qui forment la seule forme
Digne d’être contemplée
Ainsi naquit en un seul jour
Par distraction ou crainte
Le trait de génie
De l’abstrait pur et simple
© Loup Francart
07:23 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer
Imprimer
17/09/2014
Perte
Quelle perte ! Rien n’égale cette disparition
Qu’avait-il besoin de partir en toute liberté
Et de laisser derrière lui la porte ouverte
Les objets se sont envolés, en rangs serrés
Sans autre forme de procès que leur adieu
Et le vide laissé derrière eux, gonflé d’air
Empli de senteur molle de putréfaction
Laisse un goût de défaite sur la corde à linge
Toujours tendue entre les colonnes vertes
Soutenant le balcon du premier étage
Oui, c’est la perte de notre identité
Le reproche toujours vif des petits chefs
Qui cherchent encore à assurer leur pouvoir
Sur les gens, insensibles à leurs cris
Gonflés de prétention absurde et voyante
Les papiers de reconnaissance citoyenne
N’existent que pour maîtriser
Les aller et retour des mouvements de la vie
Au-delà d’une obéissance apparente
Il est parti sans rien laisser et rien prendre
Le vide s’est installé. Les bras tendus
Il erre dans le temple de la sagesse
A la recherche de l’’inconnu ailé
Qui parfois lui prend la main et l’emmène
Si loin qu’il se dissout dans le cosmos
Qui n’est que la prison de l’existence
De l’autre côté, le calme sans nom
De l’absence, du repos préparé et conquis
Sur les ans qui s’étirent comme un élastique
Et rompent le destin inachevé de chacun
Pour revêtir l’uniforme des mortels
© Loup Francart
07:14 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer
Imprimer
14/09/2014
Chroniques enfantines, récits de Nathalie Bouvy (Edilivre 2014)
Ce sont des moments épars dans la vie d’une jeune enfant ou même des sensations, des impressions sans suite, des instants d’émotion dans la fuite du temps et des souvenirs. On saisit les incompréhensions des grandes personnes devant ces récits sans rationalité, mais également celles de la petite fille qui s’exprime. Pourquoi tel adulte se comporte-t-il ainsi ? Pourquoi fait-il semblant de ne pas ressentir ce qu’elle même ressent ? Mystère des grandes personnes à l’opposé de la transparence enfantine.
Elle fait des visites à une multitude de tantes. Elles sont vieilles pour la plupart, majestueuses de dignité, dans de grandes maisons cirées, pleines de beaux meubles. L’enfant n’en retire que de petites impressions, le bonbon dans la coupe de verre, les bas mal tourbichonnés de l’une d’entre elles, l’odeur de la vieillesse.
Souvenirs… Souvenirs : Le poêle abandonné sous un auvent qui a aiguisé sa curiosité et fait frémir les grandes personnes. L’autre petite fille, également en barboteuse, avec laquelle elle n’a jamais joué, mais qui la fascine au-delà du talus raide fraîchement biné et parsemé de plantes et arbustes piquants les jambes nues. Les convenances du divan vers lequel elle avance à quatre pattes : dans mon souvenir, le divan est en arc-de-cercle. En passant devant les dames, mon regard arrive juste à hauteur de leurs genoux. J’aime observer leurs boucles d’oreilles et leurs belles robes. Je regarde aussi entre leurs jambes qui se referment brusquement comme les pages d’un livre. J’avance un peu plus vite pour voir si mon regard a bien cet effet inattendu. Les genoux se resserrent rapidement, instinctivement, impulsivement comme si ils se recollaient. Le cadeau de Monsieur Bertholet : une guêpe-cendrier en cuivre. J’étais émerveillée par le cadeau et par l’objet. On pouvait soulever les ailes de la guêpe et on découvrait son ventre creux. Ce fut mon premier cadeau de grande personne, car ce n’était pas un jouet. J’en étais très fière.
Des réminiscences précises dans leurs sensations, auréolées du flou du contexte de l’enfance. Le toucher d’un objet, sa dangerosité, les désirs d’une petite fille, sa lucidité devant les adultes, mais toujours environnée du brouillard d’une réalité ressentie ou inversement de récits racontés plus tard par les uns ou les autres. Les deux sont désormais liés dans la cage des souvenances à n’ouvrir qu'en cas de spleen.
07:41 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, souvenirs, société, enfant |  Imprimer
Imprimer
13/09/2014
L’art du phare
D’une part, elle fait la part du feu ;
D’autre part, elle lui fait la part belle.
Mais de quelle part parle-t-on ?
S’agit-il du départ de Gaspard,
L’homme-léopard fumant des boyards
Et courant d’un air égrillard
Vers d’anciens Louis-Philippards
Pour, gaillardement, leur faire part
Des gares éparses de Montbéliard.
Il se déclare grenouillard
Et tente comme les braillards
De s’en prendre aux Magyars.
Participer c’est prendre part,
Avec quel écart, au rempart
De la plupart des salopards,
De tristes vieillards en retard,
Errant dans le brouillard
Et guettant le nasillard renard
Avec l’art d’un franchouillard.
Sans art et sans antibrouillard,
Elle s’empare de milliards
Et se pare de rondouillards gaillards
Pour noyer son cafard
Dans le lupanar de Kandjar.
Mais elle repart vers le corbillard
Qu’elle déclare vasouillard.
Par quel hasard la bagarre
Barre-t-elle aux scribouillards
Le départ du tortillard ?
Ah, la plus grande part
Des pillards accaparent
Le billard qui effare
Le regard des paillards.
Où part-il ce canard
Qui s’autodéclare débrouillard ?
Départ hasardeux des chevillards
Vers une partie de colin-maillard.
Fini, je le déclare, ce retard
Des couards qui s’effarent
Des déboires sans espoir.
Edouard le bavard, tais-toi !
© Loup Francart
07:22 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer
Imprimer
09/09/2014
Au fil des heures
Au fil des heures, au fil des jours
Dans la pâleur de ma solitude
Je retrouve l’ignorance et l’absence
Je perds mon manteau de lumière
Le monde s’endort et pèse
La pesanteur reprend ses droits
J’en ressens le poids intense
Et le pouvoir de son enracinement
Pourtant, je le sais, présente,
Elle est encore au rivage
Le corps tendu vers l’amour
Le cœur noyé de bonheur
Les heures et les jours passent
Le ciel descend sur son image
Ensevelie de sa certitude
Elle s’épanouit en moi.
© Loup Francart
07:51 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer
Imprimer
06/09/2014
Pétronille, roman d’Amélie Nothomb
Ce roman débute de manière majestueuse et finit assez lamentablement. Il est vrai que tenir le lecteur en haleine pendant 169 pages sur la manière de prendre une cuite est déjà un exploit. Mais faire tant d’effort pour rendre parfaitement réaliste les rencontres entre l’auteur et Pétronille et terminer par une pirouette si bizarre qu’elle peut sembler drôle, fait du roman un chaud-froid difficile à digérer.
« Pétronille, c’est mon roman exotique ». Elle s’explique : « le grand thème de Pétronille c'est la France (...), qui est l'exotisme absolu. Pour découvrir un pays, il faut aller à la rencontre de l'indigène et Pétronille joue le rôle de l'indigène. Cette "quête picaresque" est celle de la rencontre entre une amoureuse du champagne -qui refuse de le boire seule- et sa compagne de beuverie. »
Chaque chapitre est une aventure de beuverie, une découverte de la France profonde, non pas des campagnes, mais des banlieues. Pétronille se révèle fantasque, intelligente (elle écrit des romans, elle aussi, et ils sont acceptables et acceptées), égoïste et imprévisible, à l’égal de la population française. Amélie, belge, peine à la suivre dans ses élucubrations. Mais le couple fait une bonne paire de beuverie, pleine de bulles de champagne, car on ne boit que du champagne millésimé. Il erre d’une librairie, pour le premier roman de Pétronille, aux rues de Soho à Londres, en passant par les sports d’hiver. Amélie tente de se consoler du départ de Pétronille pour le Sahara en trouvant une autre buveuse, mais cela ne passe pas. Elle retrouve Pétronille à l’hôpital Cochin, l’héberge, ne la supporte plus. Nouvelle rencontre quelques années plus tard. Pétronille joue à la roulette russe. Elle finit par tuer Amélie, propose le manuscrit d’Amélie à un éditeur et le livre finit sur une conclusion à la manière de La Fontaine : Quand à moi, en bon macchabée, je médite et tire de cette affaire des leçons qui ne me serviront pas. J’ai beau savoir qu’écrire est dangereux et qu’on y risque sa vie, je m’y laisse toujours prendre.
Les trois premiers chapitres sont un régal littéraire. Il faut les lire plusieurs fois, en goûter chaque page comme on lèche une glace devant la devanture d’un magasin aux mannequins nus :
« Pourquoi du champagne ? Parce que son ivresse ne ressemble à nulle autre. Chaque alcool possède une force de frappe particulière ; le champagne et l’un des seuls à ne pas susciter de métaphore grossière. Il élève l’âme cers de que dut être la condition de gentilhomme à l’époque où ce bon mot avait du sens. Il rend gracieux, à la fois léger et profond, désintéressé, il exalte l’amour et confère de l’élégance à la perte de celui-ci. (…) J’ai continué courageusement à boire et, à mesure que je vidais la bouteille, j’ai senti que l’expérience changeait de nature : ce que j’atteignais méritait moins le nom d’ivresse que ce que l’on appelle, dans la pompe scientifique d’aujourd’hui, un état augmenté de conscience. Un chaman aurait qualifié cela de transe, un toxicomane aurait parlé de trip. (…) J’ai titubé jusqu’au lit et je m’y suis effondré.
Cette dépossession était un délice. J'ai compris que l’esprit du champagne approuvait ma conduite : je l’avais accueilli en moi comme un hôte de marque, je l’avais reçu avec une déférence extrême, en échange de quoi il me prodiguait des bienfaits à foison ; il n’était pas jusqu’à ce naufrage final qui ne soit une grâce.
07:30 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, littérature, ivresse, société, écrivain |  Imprimer
Imprimer
05/09/2014
L’assassin des idées nouvelles
Qui es-tu, toi l’assassin des belles idées ?
Et nous sommes tous des assassins !
Qui d’entre nous n’a pas médit
A l’annonce d’une idée nouvelle ?
La France n’a pas de pétrole,
Elle a des idées. Oui, certes,
Mais personne n’en veut de ces idées.
Le Français est un homme ou une femme
Qui vit sur un lit d’idées toutes faites
Il se bauge dans sa vision du monde
Sans tenter même d’y trouver satisfaction
Car, de plus, il vitupère sur celle-ci…
Mais en changer, jamais !
Cependant il a l’avantage inusité
De répondre toujours présent
Aux sollicitations de la mode
A condition qu’elle ait déjà été expérimentée
Et de préférence aux Etats-Unis
Ainsi un bon quart des Français marche
Le derrière à l’air, comme un prisonnier
De cette mode idiote apportée des Amériques
Plus je montre mon slip
Plus je suis décontracté…
Curieux non ? Heureusement
Les femmes ne s’y sont pas encore mises.
Il est vrai que libres du haut comme du bas
Elles pourraient très vite abandonner
Toute idée de s’habiller…
Oui, le Français est un être plein de contradiction
Pour le prestige et non pour le plaisir
Il construit une ligne à grande vitesse
Et il sait qu’elle ne sera pas rentable
Peu importe, le décideur aura laissé sa marque
L’empreinte de son pouvoir sur le sol
Cela se passe à tous les niveaux
Le président du Conseil général
Veut son musée dans le désert
Le maire veut sa piscine chauffante
Un gouffre à faire monter les impôts…
Mais ceci fait-il avancer les idées nouvelles ?
Non, une idée nouvelle assaille le cerveau
Et est rejetée derrière la haie, vulgairement
Elle enhardit la critique…
Alors lorsqu’une idée nouvelle
Germe dans la tête d’un Français
Il la garde bien au chaud et attend
Un moment favorable pour qu’elle fasse mode…
En faisant un tour au dépôt des idées nouvelles
J’ai rencontré des auteurs et des inventeurs
J’ai vu des femmes merveilleuses
J’ai vu des hommes entreprenants
Tous venaient déposer leur enfant
Sur l’hôtel de la déficience…
Oui, le Français et un assassin
De la France inventive et généreuse
Au nom de l’égalité et de la fraternité
Où se trouve la liberté ?
Que produire dans un pays
Où tous veulent être l’égal de tous ?
© Loup Francart
07:33 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, littérature |  Imprimer
Imprimer
01/09/2014
Grandeur
Chacun se veut grand, mais grand de quoi ?
Les rêves ont-ils le pouvoir de faire grandir ?
La grenouille sauteuse rêve au kangourou
La puce à l’éléphant qu’elle ne peut même pas voir
Quel univers sans dimension si ce n’est celle
De l’imagination débridée, insolite et impossible
Chacun de nous se peuple d’ambitions
Est prêt à échanger sa montre
Contre un baladeur de secondes vides
Qui le fera gonfler jusqu’à l’éclatement
Suis-je plus grand que vous ?
Et je regarde ce malotru gonflable
Qui tente de jouer dans la cour des grands
Mais moi-même, je ne sais si je suis
Sur le dos d’un éléphant ou d’un poisson pilote
Ma taille importe peu au fond
Ce qui compte c’est l’univers qui nous reçoit
Si je n’en vois l’horizon et ne peux me rendre
Au-delà des collines qui barrent la visibilité
Je reste le freluquet qui achète des échasses
Qui tombe bien souvent dans la boue
Collant à ses bâtons et entravant ses pas
Mais si d’un coup d’œil j’admire
Ma grandeur dans le paysage étroit
Je m’abuse moi-même et ne peux bouger
Pour rire et m’esclaffer de cette immensité
Prisonnier de mon regard désenchanté
Je m’interpelle moi-même en un clin d’œil
Fait le tour du pâté de maison
Et me réfugie dans ma faconde vertueuse
Oui, la grandeur est le propre des petits hommes
Elle leur permet d’attendre le jour
Où rien ne sera comparable à rien
© Loup Francart
07:29 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer
Imprimer
28/08/2014
La vérité ?
Le soleil revient, il écarte le manteau,
Et les nuages fuient, volés au soleil par le vent.
Chacun s’affaire, avec sérénité,
Dans une maison où passe la vie.
Hier, longue discussion :
Qu’est-ce que la vérité ?
Cela me rappelle Ponce-Pilate !
Elle n’est ni blanche, ni noire, elle n’est pas grise non plus.
Elle n’a pas de couleurs, et pourtant
C’est la couleur !
Elle n’a pas de VE majuscule,
Elle ne RIt pas,
Elle TE parle, à toi seule,
Au fond de toi et tu la connaîtras,
Un jour d’abandon, une nuit d’espoir.
Alléluia !
© Loup Francart
07:09 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, littérature |  Imprimer
Imprimer
24/08/2014
Indolence
Il a longtemps hésité : que faire ?
Et encore, faire est un bien grand mot
Que devenir ? Trop volontaire...
Qu’être ? Quelle surenchère...
Que penser ?
Stop ! C’est fini...
Plus rien ne sera comme avant
Le chat longe la gouttière
L’écureuil valse sur la branche
Et lui que fait-il ?
Rien, tel est son charme...
Peut-être caresser l’étoffe
D’un lit défait sur la nuit
Ou la remonter sur le corps
Par crainte de l’invasion
Le jour se lève
Quel chaos ! La chambre,
Qu’est-elle ? Le refuge
De son indolence
Eperdu, il se regarde
Et ne voit rien
Qu’un trou, noir
Comme la braise éteinte
© Loup Francart
07:27 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer
Imprimer











