16/10/2011
Ma bicyclette est devenue une partie de moi-même
Ma bicyclette est devenue une partie de moi-même.
Je suis muni de roues qui divaguent sur l’asphalte.
Roule, roule, dans les flaques et le gas-oil,
Passe entre les voitures, sous les échafaudages,
La tête au dessus de la mêlée, hors d’atteinte.
Je contemple serein la marée humaine,
Glissant au milieu d’eux, comme un pélican
Navigue entre les mats des navires
Avant de se poser, majestueux, sur le pont.
Pied à terre, chevalier ! Vous voici redevenu piéton,
Homme de petits pas, aux ailes rognées,
Qui marche pesamment, ralenti, écorné,
Parmi ses semblables, invisible et appauvri.
Et vous revenez de votre course, altier,
Pour reprendre la monture indélébile
Et repartir triomphant, enrobé de lumière,
Se guidant aux étoiles des lampadaires,
Roulant légèrement, le nez au vent,
En toute liberté.
Ah, qu’il est bon de se sentir un autre
Lorsque rien ne s’oppose aux rêves
Les plus simples et les plus beaux.
06:42 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, poème |  Imprimer
Imprimer
14/10/2011
Les catilinaires, roman d’Amélie Nothomb
« A l’approche de mes soixante-cinq ans, Juliette et moi cherchions quelque chose à la campagne ? Nous avons vu cette maison et aussitôt nous avons su que ce serait la maison ? Malgré mon dédain des majuscules, je me dois d’écrire la Maison, car ce serait celle que nous ne quitterions plus, celle qui nous attendait, celle que nous attendions depuis toujours. »
Ainsi commence Les catilinaires qui racontent l’arrivée inopinée dans ce paradis d’un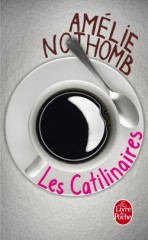 emmerdeur, monsieur Bernardin, cardiologue de son état, qui chaque jour entre chez eux, de quatre heures à six heures, prend son café, ne répond que par oui ou non à leurs imaginatives questions, et s’impose sans aucune politesse. Palamède, car tel est son prénom, les dérange à tel point qu’ils ne savent plus quoi inventer pour s’en débarrasser. Un jour, ils partent se promener à 4 heures moins dix, le laissant seul devant leur porte. Le lendemain, elle est au lit parce qu’elle a pris froid. Il frappe à la porte qu’ils ne veulent pas ouvrir, à tel point qu’ils leur semblent qu’il va la casser. Emile, son mari, celui qui raconte leur mésaventure, finit par ouvrir. Mais Palamède refuse d’examiner Juliette et lui demande une tasse de café. Il finit par monter et pose sa main sur le front de Juliette. – Rien, elle n’a rien. Mais il est dans la chambre et s’installe sur une chaise. – Docteur, vous n’allez pas rester là ? Si je vais au salon, vous devez venir aussi. – Je ne peux pas la laisser seule. – Elle n’est pas malade.
emmerdeur, monsieur Bernardin, cardiologue de son état, qui chaque jour entre chez eux, de quatre heures à six heures, prend son café, ne répond que par oui ou non à leurs imaginatives questions, et s’impose sans aucune politesse. Palamède, car tel est son prénom, les dérange à tel point qu’ils ne savent plus quoi inventer pour s’en débarrasser. Un jour, ils partent se promener à 4 heures moins dix, le laissant seul devant leur porte. Le lendemain, elle est au lit parce qu’elle a pris froid. Il frappe à la porte qu’ils ne veulent pas ouvrir, à tel point qu’ils leur semblent qu’il va la casser. Emile, son mari, celui qui raconte leur mésaventure, finit par ouvrir. Mais Palamède refuse d’examiner Juliette et lui demande une tasse de café. Il finit par monter et pose sa main sur le front de Juliette. – Rien, elle n’a rien. Mais il est dans la chambre et s’installe sur une chaise. – Docteur, vous n’allez pas rester là ? Si je vais au salon, vous devez venir aussi. – Je ne peux pas la laisser seule. – Elle n’est pas malade.
Ils choisissent alors la dérision. Mon cher Palamède, que pensez-vous de la taxonomie chinoise ? Et pendant dix pages, le couple échange des réflexions sur la manière d’effectuer des classifications, tout cela de manière extraordinairement savante et ponctuée de citations inconnues dont le but est de faire sortir de ses gonds Palamède. Imaginez, cher ami, que je me mette en tête de vous d’écrire en commençant par énumérer tout ce que vous n’êtes pas. Ce serait fou. Par où débuter ? Par exemple, on pourrait dire que le docteur n’est pas un animal à plumes : En effet, et il n’est pas un emmerdeur, ni un rustre, ni un idiot. Mais l’hôte reste impassible.
Alors ils imaginent d’inviter le docteur avec sa femme à diner. Un kyste, cette chose était un kyste. Eve fut tirée d’une côte d’Adam. Madame Bernardin avait sans doute poussé comme un kyste dans le ventre de notre tortionnaire… Palamède avait épousé l’amoncellement de chair dont on l’avait libéré. […] Chère madame, quelle joie de vous rencontrer. A ma grande surprise, un tentacule de gras se détacha de la masse et se laissa toucher par les doigts de ma femme.
Et reprirent les visites imposées de Bernardin chaque jour de quatre à six. Ils découvrent que Palamède est un homme qui n’éprouve aucun plaisir à quoi que ce soit ? Ni à manger, ni à boire, ni même à emmerder. C’est un cauchemar. Il fait fuir une ancienne élève d’Emile. Le lendemain celui-ci accueille monsieur Bernardin par un « Foutez le camp et ne revenez plus jamais ! ».
Dans la nuit, Emile se lève, réveillé par un bruit de moteur qui venait de la maison d’en face. Il découvre Palamède dans sa voiture en situation de suicide par les gaz d’échappement. Il le sort et l’apostrophe en attendant l’ambulance. Rentrés chez eux, la pensée de sa femme seule dans sa maison les oblige à y revenir. Elle dort. Ils prépare une soupe, seule nourriture qui lui convienne vraiment.
C’est maintenant le printemps. Monsieur Bernardin ne vient plus de 4 à 6. Il rit de ce que Juliette et Emile font pour eux. Après quelques autres péripéties et énervements, Emile tue Palamède dans son lit en l’étouffant. Juliette ne sait rien ? Je ne le lui dirai jamais. Si elle se doutait que l’homme qui partage son lit est un assassin, elle mourrait d’horreur. A la faveur de son ignorance, elle a estimé que le trépas du voisin était une bonne chose. Elle allait enfin pouvoir s’occuper de Bernadette… C’est ma meilleure amie, m’a dit Juliette après quelques mois.
Ce livre laisse une impression mitigée. L’histoire est loufoque, exagérée, rien de tout cela ne peut se passer dans la réalité. Mais elle est contée d’une manière tellement proche de la réalité possible qu’elle parait vraie et donc ni drôle, ni attendrissante. Plutôt estomaquante, comme les deux Bernardin. Mais dans le même temps, l’art de conter d’Amélie Nothomb en fait un petit chef d’œuvre qui permet d’oublier l’histoire pour ne s’arrêter qu’aux dialogues, aux descriptions, aux sentiments exprimés par le couple qui croyait avoir trouvé un refuge pour leur vieillesse. L’écriture permet au lecteur de dépasser la fable et de ressentir tout l’art de la romancière, cinglant, plein d’humour caché. Bref, une leçon d’écriture.
06:37 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, imagination |  Imprimer
Imprimer
12/10/2011
Voyage dans le temps de l'enfance
Voyage dans le temps de l’enfance,
Quand déjà s’entendait l’oiseau au matin
Et qu’au-delà du chant la brillance,
Sous le drap tiède, je trouvais du rêve le chemin.
Longtemps je crus pouvoir y être insensible.
Mais ce retour sur le lieu des rêveries,
Quand j’épanchais une rage ostensible,
Me donne à méditer sans bruit.
Je retrouve l’odeur moite de la cuisine,
Quand je glissais la tête devant la porte
Pour découvrir les raisons d’odeurs subtiles
Et de sons d’ustensiles de toutes sortes.
Je reconnais la vieille armoire
Où se trouvaient les trésors de bouche,
Fruits confis ou petits gâteaux du soir,
A partager sans restriction avec les mouches.
Souvenir d’un jour, d’un moment unique,
Quand le temps s’arrête sur un geste
Et que toujours cette attitude modique
Revêtira l’élégance d’un vieux reste.
Et je repars mélancolique et blême,
Vers les horizons du présent bien vivant,
Gardant au fond de moi-même
Le pincement de l’évocation d’antan.
02:30 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, poésie, poème |  Imprimer
Imprimer
11/10/2011
Oh ! Les beaux jours, de Samuel Beckett
Théâtre de l’inéluctable. Chaque jour passe et ressemble aux autres jours, toujours semblables, mais pendant lequel, imperceptiblement, inéluctablement, les êtres changent sans qu’ils en aient conscience : « Je vois de moins en moins bien… Pas moins qu’hier… Pas mieux que d emain… ».
emain… ».
Chaque geste de la vie quotidienne devient un évènement attendu impatiemment au cours de la journée, de même que la moindre démonstration d’intérêt, de prévenance de la part d’autrui, un sourire, un mot, un geste même, le plus petit soit-il (lever le petit doigt) prend une importance considérable et suffit à éclairer la journée. « Çà que je trouve merveilleux », dit Winnie pour tout ce qui vient rompre la monotonie des heures.
« Quel beau jour encore », telle est la morale de Beckett : il y a toujours une raison d’être heureux, il y a toujours un évènement qui, si on y prend garde, suffit à donner la joie pour une journée. Ce jour où Willie, malgré ses infirmités, sa condition humaine réduite à la vie animale, sort de son trou pour regarder sa femme, est le plus beau jour de la vie de celle-ci, parce qu’il est là, présent, réel. Et cet homme qu’elle ne reconnaît plus, dont la laideur l’effraie, tente de lui témoigner ce qu’il lui reste d’amour, faisant de l’enlisement, de l’incapacité de bouger de sa femme, un paradis aussi beau que celui de sa jeunesse.
06:28 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, théâtre, philosophie |  Imprimer
Imprimer
08/10/2011
C'était il y a huit jours
Rien que l’immobilité et le silence.
C’est le début de l’après-midi,
Lorsqu’hommes et animaux reposent
Dans une douce somnolence, repus de chaleur.
Pas un bruit. La campagne est atone.
Si ! Lointain, le roucoulement d’un pigeon.
Ce silence est léger, ce n’est plus celui de l’été.
Il semble chantonner, bouche fermée.
Sur la rivière, les lentilles d’eau,
Sans vie, sans courant, sans enthousiasme,
Encombrent le lit de flots morts.
Là aussi, tout dort, tout s’immobilise.
Seul havre de fraicheur, le petit sous-bois.
Les pas y craquellent les feuilles mortes,
Mais le corps se dérobe sous les pieds
Pour s’affaisser et s’endormir, enfin.
06:18 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, poème |  Imprimer
Imprimer
03/10/2011
Que dire devant la page vide
Que dire devant la page vide
D’une nuit verte, au coin d’un réverbère ?
Premiers mots qui passent comme un vol de cormorans.
Mais qu’y a-t-il derrière ? Un vent de fronde
Chassé par la profusion du langage.
Silence des sentiments.
Un vide dans le noir de l’esprit,
Image de la floraison du cœur.
Dans la tiédeur de l’obscurité monte en moi
Le chant heurté, puissant et magique,
Des sirènes mouvantes et volubiles.
Au loin le son aigu d’une voiture
Qui flotte au gré du vent sur la route de l’Espagne.
Pas un passant ne vient à mon secours,
Ne m’apporte le mot qui permettra la suite
De cette histoire sans fin, ni commencement.
Dorment les passants du jour,
Eveillés les fantômes de la nuit
Qui montent une garde acide
Aux tréfonds des portes cochères
Et rient de me voir, assis
Dans mes pensées sordides,
Faute de pouvoir dormir
Et laisser aller mon esprit
Dans la fraicheur du rêve.
Oui, la nuit s’enfonce en moi
Creusant un large trou
Que je remplis de verbes
Comme on enfile les huitres
Sur le fil à couper le beurre.
Elle ne cessera pas
Avant l’aube qui ne vient pas
De me dire « étends-toi ! ».
07:08 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, poème |  Imprimer
Imprimer
02/10/2011
Cosmétique de l’ennemi, roman d’Amélie Nothomb
Désolé, mais cette fois-ci je ne crierai pas au chef d’œuvre. Ce roman m’a paru plat, sans consistance, une performance littéraire peut-être, mais surement pas un livre enchanteur ou passionnant. Un exercice de style, sans intérêt littéraire.
"COSMETIQUE, l’homme se lissa les cheveux avec le plat de la main. Il fallait qu’il fût présentable afin de rencontrer sa victime dans les règles de l’art." Ainsi commence le livre qui raconte, dans un hall d’aéroport où les passagers attendent un avion en partance, l’étrange rencontre entre Jérôme Angust, qui part en voyage d’affaires, et Textor Texel, un homme qui veut à tout prix engager la conversation et ne plus le quitter. Jeux de passe verbaux, refus, redémarrage de la conversation, injures, rien n’y fait, Textor ne décolle pas de Jérôme.
Je ne vous raconterai pas la suite, je me suis arrêté à la page 75 après que Textor ait raconté le viol d’une jeune fille dans le cimetière de Montmartre, puis sa rencontre quelques années plus tard. J’ai estimé à cet endroit du livre que j’en avais assez lu pour me faire une idée de son contenu. J’avais tenu bon jusque là, mais je craquais. C’en était trop.
Alors, je regardais à la fin du livre. Oh stupeur (sans tremblement). Il finissait en suicide (dernière page) ou en meurtre (avant-dernière page). De quel personnage, me direz-vous ? Si le meurtre de Textor par Angus est bien conté de manière à peu près clair en quelques lignes, le suicide reste incertain, malgré une demi-page, entre une deuxième mort de Textor ou celle de l’auteur du meurtre précédent. Cela finissait aussi mal que cela avait commencé.
Que dire ? Amélie Nothomb ne signe pas là son meilleur livre, c’est certain. Elle a voulu jouer, jouer avec les mots, jouer avec l’échange entre deux êtres, jouer à tromper ses lecteurs au travers d’un dialogue qui lasse très vite, tel un échange de balles interminables entre deux mauvais joueurs de tennis. La seule fois où l’on entend la frappe sèche sur les raquettes se trouve en fin de livre, par la mort de l’un, puis peut-être de l’autre. Et encore, il faut dresser l’oreille pour l’entendre !
05:30 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman |  Imprimer
Imprimer
28/09/2011
Elle est là, glorieuse de féminité
Elle est là, glorieuse de féminité,
Assise, allongée sur le banc sous le rosier.
Elle lit, calme, la tête dans une main,
Concentrée, mais détendue, entière.
Je la revois au temps de notre connaissance ;
Quand j’aspirais à ces jours de quiétude,
Ne sachant si ce serait toi, ou une autre,
Ou même personne, peut-être.
Et tu es là, toujours, belle comme au premier jour,
Reine du jardin, évadée des songes,
Et je te regarde, rêveur, transi encore,
Je caresse mentalement ton visage épanoui,
Je baise ta bouche de feu, rose,
Je contemple ton attitude, fière,
Et derrière le feuillage qui obscurcit en partie
Ton corps, je rêve à nouveau à ces jours vécus,
A ces instants où le monde était toi.
Tu étais l’or des soirs d’automne,
La fraicheur des matins de printemps,
La chaleur des journées d’hiver,
Le rire enjôleur des nuits d’été.
Oui, c’est bien toi que j’aime,
Et que je continue de voir avec les yeux
De celui qui s’envole en te contemplant.
07:30 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, poésie, poème |  Imprimer
Imprimer
25/09/2011
Il y a longtemps mon amour, roman de Vladimir Volkoff (1998)
Ce n’est pas un roman, plutôt une autobiographie voilée. Volkoff se raconte ou plutôt raconte ses amours passés, parce que le temps le poursuit et qu’il a encore beaucoup de choses à dire. Alors il relate sous le personnage de Ladislas Radowa-Dzikowski, vicomte de La Vieillevigne, totalement fictif, mais très proche sentimentalement de lui, ses aventures féminines jusqu’au grand amour de sa vie, Elise. Grand nostalgique d’un passé révolu, qu’il considère en même temps comme totalement dépassé, il use de son ton à la fois romantique et réaliste, charmeur et désabusé. Volkoff traditionnel et moderne, aristo et homme de l’ombre.
Il décrit ainsi son premier amour, Aude, fille du secrétaire de mairie, qui était le sacré, la poésie même. A quinze ans, il apprit qu’elle était enceinte du mécano du village. Ils se revirent encore un fois, des lustres de lustres après, dans un bistrot, au fond d’une autre province… Touchant, oui, mais, finalement, ils n’avaient rien d’autre à se dire, sinon qu’ils s’étaient attendus et qu’ils ne s’attendraient plus.
Etudiant à la Sorbonne, il connut Rosemonde. Ils prennent le métro ensemble, saine distraction. Il l’invite au bal de la Sorbonne auquel elle va avec sa mère comme chaperon et où elle fit connaissance avec Michmich, jeune garçon qui va finir par ravir la belle à Ladislas sans toutefois en devenir le mari ou même l’amant. Mais, entre temps, Ladislas l’embrasse et en profite jusqu’au moment du choix, qu’il refuse.
Militaire, aspirant, il fait connaissance avec un personnel féminin de l’armée de terre, une PFAT, Yvonne, employée comme lui dans le renseignement. Ils sont faits l’un pour l’autre, affamés d’amour l’un et l’autre, lecteurs de romans et auditeurs de musique classique. Ladislas veut parfaire son éducation. Il voulait Yvonne transplantée, transmutée, il voulait une Yvonne qui ne fut plus Yvonne, et elle l’y encouragea. Le malentendu n’apparut pas immédiatement. Quinze jours plus tard, Ladislas lui demande si elle veut l’épouser. Ils se marièrent. Cela ne dura guère plus d’un an. Ce fut alors la séparation. Pour Ladislas, l’attente et la rencontre de l’âme sœur se terminaient dans la déconfiture totale.
Rentré en France, toujours dans le théâtre d’ombres, il découvre Luciole, secrétaire dans les mêmes lieux. Il déjeune chaque jour avec elle, mais elle est mariée. Il cherche à la prendre un soir, mais elle refuse. Il prenne une chambre dans un hôtel, mais elle refuse encore. Enfin, un jour, il la raccompagne et elle lui dit viens, maintenant, j’ai envie. Mais son père les surprend au lit. Il fuit. Après un dernier entretien, il ne la revit plus.
Toute autre est Bérénice de Fruminy, comtesse du Saint-Empire. Lorsque Bérénice parut au Hache-menu, elle déplut. Son port de tête altier, son cou sculptural, l’ovale irréprochable de son visage, la rigueur de ses traits classiques, la plénitude de ses formes, surprenante dans une aussi jeune femme, et l’arrogance constante de son maintien avait de quoi irriter de jeunes hommes qui aiment aimer facilement. Ladislas, lui, fut ravi de cette attitude hautaine à laquelle ce physique se prêtait si bien ; son orgueil trouvait enfin à qui parler ; il avait rencontré une femme à qui il n’avait rien à apprendre sur le chapitre du dédain. Ils se lièrent. Après les aventures habituelles entre une jeune fille et un jeune homme, une absence insolite et prolongée de sa petite amie, elle lui déclara : « Il y a une chose que je ne vous ai pas dite hier. Je devais avoir un enfant, d’où mon retard à rentrer à Paris. Une fausse couche la semaine passée. Passez me prendre ce soir à la même heure. » Mythomane, affabulatrice ? Il ne sut pas, il ne la revit pas.
Il y eut Emmeline (oui, avec deux m) avant Elise. Bretonne, un peu sorcière, il s’intéressait lui-même à l’ésotérisme, elle avait aimé un allemand pendant la guerre, puis s’était mariée avec un autre allemand. Avec d’autres, j’ai joué à des jeux. La coquetterie, la jalousie, la bouderie, les piques, le bras de fer amoureux. Vous, je veux vous aider à vivre. Vous n’aurez jamais un instant de déplaisir par ma faute.
Enfin, Elise dont Ladislas est tombé amoureux deux fois, à dix ans de distance en une pièce en quatre actes. Premier acte : A la Sorbonne, échange de lettres enflammées, mais elle refuse cette amourette. Deuxième acte : l’amitié, une affinité, sans doute, et l’élection de cette affinité, plus la confiance l’un dans l’autre, le besoin l’un de l’autre, l’admiration l’un pour l’autre, l’être bien avec l’autre, bref une flexion complète des prépositions sympathiques. Bien après le mariage de Ladislas avec Yvonne, il la revit et elle tombe amoureuse de lui. Troisième acte : l’amour. Il était à l’époque l’amant d’Emmeline. Vinrent les aveux, empreints d’une consternation amusée : « J’éprouve pour vous de l’amitié, de la confiance, de l’estime, de la tendresse, du respect, du désir. La somme ne s’appelle-t-elle pas amour ? écrivait Ladislas à son amie, et elle répondait, médusée : « Sans doute… » Comme l’annulation de son mariage tardait, elle le suit dans ses pérégrination et lui inspire la poésie. Quatrième acte : le mariage, lorsque l’annulation en cour de Rome arrive. L’amour qui liait Elise à Ladislas leur était si précieux qu’un instant ils hésitèrent à le hasarder sur la case mariage, comme jadis ils avaient hésité à miser leur amitié sur la case amour. Après la vente du château, ils s’installent dans la métairie voisine. Mais, époux et parents, ils restaient avant tout des amants.
Et voilà… Il y a longtemps, mon amour… Oui, il y avait longtemps.
C’était Volkoff, funambule et poète, homme de l’ombre, que j’ai rencontré dans le train pour Lille où nous allions à une table ronde parler de renseignement et d’information. Nous avions devisé toute la durée du voyage sur la manipulation, lui prétendant que toute conversation, voire toute rencontre humaine est une recherche de manipulation, moi défendant l’idée que ce qui différencie le juste des autres hommes est sa faculté à laisser libre l’autre de penser ce qu’il veut après lui avoir donné les raisons de croire à ce que lui, l’homme juste, croit.
05:16 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, amour |  Imprimer
Imprimer
24/09/2011
De tes doigts de fée, je ne retiens qu’une chose
De tes doigts de fée, je ne retiens qu’une chose
Le tremblement de mes paupières à leur frôlement
Comme un séisme sous-marin au passage de la comète
La nuit s’embrase alors d’étranges lueurs
Aux sons de tes doigts sur le verre de mon attente
J’avais pourtant connu la caresse des vents d’été
Le souffle froid de la source jaillissante
J’avais frissonné les nuits d’hiver sous le gel
Mais tes doigts ont la candeur de l’enfance
Et l’aisance de l’oiseau dans le vide
Avais-je déjà vu d’autres mains avant celles-ci
Avais-je déjà appris d’autres caresses
Je ne sais plus
Un grand vide est comblé
Un vide où les regards coupaient comme la glace
Où les mains fondaient entre les miennes
Comme s’évanouit l’inconsistante réalité des neiges
Tes mains devenues le fruit de ton amour
Esquissent une pâle lumière aux êtres et aux choses
Avant de rejoindre ton visage aux yeux clos
Pour y puiser de nouvelles forces
09:27 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, poème |  Imprimer
Imprimer
21/09/2011
Première des « Cinq méditations sur la beauté », de François Cheng
François Cheng nous parle de la beauté en tant qu’élément essentiel de définition de la vie. Homme de nulle part, ou de toute part, comme il le dit, il observe sans parti pris culturel, lui qui appartient aux cultures chinoise et occidentale. Il dit qu’il comprend le vrai qui permet l’existence de la réalité, qu’il comprend le bon, sinon l’humanité s’entretuerait et ne survivrait pas. Mais la beauté ? Elle est là, de façon omniprésente, insistante, pénétrante, tout en donnant l’impression d’être superflue, et c’est là le grand mystère.
Le mystère est pour lui la singularité de chaque être. Chaque herbe, chaque fleur, chacun de nous est unique et irremplaçable. C’est un don inouï. On pourrait imaginer un monde dans lequel chaque catégorie se différencie sans distinction des éléments qui la composent. Non, dans notre monde, toute unité est toujours unique. Et cela, parce que notre unicité est liée à notre condition de mortels. La beauté est effectivement éphémère. Une vraie beauté ne saurait être un état figé perpétuellement dans sa fixité. Son advenir, son apparaître-là, constitue toujours un instant unique ; c’est son mode d’être. Chaque être étant unique, chacun de ses instants étant unique, sa beauté réside dans son élan instantané vers la beauté, sans cesse renouvelé, et à chaque fois comme neuf.
Chaque être est présence, virtuellement habitée par la capacité de beauté, mieux par le désir de beauté. Et cette présence est transcendance. Plus l’être est conscient, plus ce désir chez lui se complexifie : désir de soi, désir de l’autre, désir de transformation dans le sens d’une transfiguration. François Cheng va au-delà, il rejoint les grands mystiques et montre que l’homme, par ce désir, rejoint le désir originel d’une relation qui l’élève et le dépasse. La vraie transcendance est dans l’autre.
Quelle belle méditation, discrète et profonde, pleine de poésie et de mysticisme. Penser la beauté à travers l’Etre, unique, en mouvement, que dis-je, en désir de beauté, n’est-ce pas une idée merveilleusement vraie, fruit d’une connaissance de la vie que peu d’hommes ont.
02:07 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philosophie, beauté, transcendance |  Imprimer
Imprimer
19/09/2011
Brouillard fou de la percée informationnelle
Brouillard fou de la percée informationnelle
Comme une bataille de lettres et de chiffres
Qui engendre la peur et la concupiscence
Et qui colle sur chaque être une déformation
Comme l’homme s’amuse à faire le singe
La rumeur se déploie en volutes doucereuses
Comme la fumée d’un cigare autour d’un cendrier
Et contamine l’entourage qui respire ce poison
Pour le distiller à son tour, insidieusement
Et le jugement se détache en lambeaux indolores
Pour laisser place à l’arrogante certitude
Chaque nouvelle est commentée, jamais expliquée
Information tronquée et poudre aux yeux
Qui fait pleurer l’innocent et rire l’initié
Jusqu’au moment où il devient cible
Et perd toute prestance jusqu’à l’oubli
Car c’est le risque des adeptes de la diffusion
Jusqu’où aller pour ne pas tomber
Chaque jour déverse son flot d’évènements
Mais chacun d’eux s’interprète et se diffuse
A sa manière, selon la volonté de l’informateur
Dire au plus vite sans connaître ce qui se passe
Interpréter sur la base de rumeurs colportées
Propager le premier sans regard sur les conséquences
Dévoiler sans pudeur ce qui tuera la vie
Sans considération sur la personne
Tel est le monde où nous vivons
Un petit monde fait de pressions
Un monde où le scoop, même insensé
Vaut mieux que l’absence pour vérification
Un monde où l’homme n’est plus l’homme
Mais le propulseur d’évènements
Qui déclenche l’avalanche médiatique
Un monde où la personne n’a pas de droits
Face au maquillage des faits
Par ignorance, méconnaissance ou machiavélisme
05:57 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, poème |  Imprimer
Imprimer
18/09/2011
Stupeurs et tremblements, roman d’Amélie Nothomb
Monsieur Haneda était le supérieur de monsieur Omochi, qui était le supérieur de monsieur Saito, qui était le supérieur de mademoiselle Mori, qui était ma supérieure. Et moi, je n’étais la supérieure de personne. […] Donc, dans la compagnie Yumumoto, j’étais aux ordres de tout le monde.
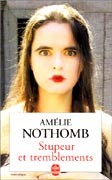
Ainsi commence cette incroyable histoire qui est bien quelque peu autobiographique. Amélie est embauchée pour un an par la compagnie. Elle va connaître les affres de tous les japonais débutants. On commence en bas de l’échelle et l’on ne s’élève qu’à la condition d’une obéissance sans limite. Pas d’initiatives, elles sont toutes mal vues.
Elle commence, sur demande d’un de ses supérieurs, par rédiger une lettre à un certain Adam Johnson pour accepter son invitation à jouer au golfe. Ce directeur lui fait recommencer, recommencer, recommencer, sans explications, jusqu’à ce que sa supérieure, mademoiselle Mori, arrive. Fubuki, c’est son prénom, la charme. Elle était svelte et gracieuse à ravir, malgré la raideur nippone à laquelle elle devait sacrifier. Mais ce qui me terrifiait, c’était la splendeur de son visage. […] Elle avait le plus beau nez du monde, le nez japonais, ce nez inimitable, aux narines délicates et reconnaissables entre mille. […] Fubuki incarnait à la perfection la beauté nippone, à la stupéfiante exception de sa taille. Elle mesurait en effet un mètre quatre-vingt.
Elle prend la fonction de l’ôchakumi, l’honorable thé. Mais lors de la réception d’une délégation étrangère à l’entreprise, elle psalmodie les plus raffinées des formules d’usage, baissant la tête et s’inclinant. On lui donne l’ordre d’oublier le japonais, car il est indécent qu’une blanche parle le japonais. Alors, pour s’occuper, elle décide de distribuer le courrier. Mais elle se fait très vite rabrouée, car voler son travail à quelqu’un est une très mauvaise action. Donc, toujours pour s’occuper, elle décide de mettre les calendriers à jour, après accord de son supérieur. Aussi Monsieur Saito, sans la contredire ouvertement, lui demande de faire des photocopies. Ce qu’elle fait rapidement avec la machine munie d’une « avaleuse ». Il lui demande de le refaire à la main, une fois, puis deux, puis trois, sous prétexte qu’elles sont décentrées. Tout ça pour un règlement de son club de golf. Fubuki compatit. Monsieur Tenshi lui demande alors de rédiger un rapport sur les procédés de fabrication du beurre allégé. Elle se met à la tâche, recherche les raisons des japonais de s’intéresser à ce procédé, téléphone en Belgique où il est mis en œuvre, et sort le lendemain son rapport que l’autre s’attribue sans vergogne. Quelques jours plus tard, nouvelle engueulade, cette fois-ci pour Monsieur Tenshi. Elle apprend ensuite qu’elle a été dénoncée par mademoiselle Mori, qui a souffert des années pour obtenir le poste qu’elle a aujourd’hui. Elle tente une explication avec Kubuki, peine perdue : « Vous avez brigué une promotion à laquelle vous n’aviez aucun droit. » Elle répond : « Vous êtes ma supérieure, oui. Je n’ai aucun droit, je sais. Mais je voulais que vous sachiez combien je suis déçue. Je vous tenais en si haute estime. » Elle eut un rire élégant : « Moi, je ne suis pas déçue. Je n’avais pas d’estime pour vous. »
Alors, Kubuki la met à la comptabilité. Comptable, moi ? Pourquoi pas trapéziste ? lui demande-t-elle. Il n’était pas rare qu’entre deux additions je relève la tête pour contempler celle qui m’avait mise aux galères. Sa beauté me stupéfiait. Mon seul regret était son brushing propret qui immobilisait ses cheveux mi-longs en une courbe imperturbable dont la rigidité signifiait : Je suis une executive woman. Alors elle passe les trois dernières nuits au bureau pour tenter de venir à bout de son travail. La dernière nuit, « soudain, je ne fus plus amarrée. Je me levai. J’étais libre. Jamais je n’avais été aussi libre. Je marchais jusqu’à la baie vitrée. La ville illuminée était très loin au-dessous de moi. Je dominais le monde ? J’étais Dieu. Je défenestrai mon corps pour en être quitte ».
Enfin, après d’autres péripéties, comble de l’horreur, pendant sept mois, elle fut postée aux toilettes de la compagnie Yumimoto. Elle ne perdit pas la face. Mais elle acquit la désaffection des hommes pour les toilettes de son étage. Aussi reçut-elle l’ordre d’être aux toilettes sans y être, c’est-à-dire de sortir lorsqu’un homme entre et d’entrer lorsqu’il ressort pour remettre du papier et nettoyer comme il se doit. Cela dura jusqu’au 7 janvier, date de fin de contrat. Elle eut encore une dernière mission à accomplir : remercier ses supérieurs : la compagnie Yumimoto m’a donné de multiples occasions de faire mes preuves. Je lui en serai éternellement reconnaissante. Hélas, je n’ai pas pu me montrer à la hauteur de l’honneur qui m’était accordé… Nous approchons du terme de mon contrat et je voulais vous annoncer avec regret que je ne pourrai le reconduire.
Elle passe ces derniers instants aux toilettes. « D’instinct je marchai vers la fenêtre… Elle était la frontière entre la lumière horrible et l’admirable obscurité, entre les cabinets et l’infini, entre l’hygiénique et l’impossible à laver, entre la chasse d’eau et le ciel… Une ultime fois, je me jetais dans le vide. Je regardais mon corps tomber. Quand j’eu contenté ma soif de défénestration, je quittai l’immeuble Yumimoto. On ne m’y revit jamais.
Une fois de plus, Amélie Nothomb enchante ses lecteurs d’une histoire qui semble vraie, mais à dormir debout. Sa particularité : décrire avec un sérieux imperturbable ce qui est farfelu, relater avec humour ce qui est sérieux. Au fond, ce livre est-il autobiographique ou non ? Dans les deux cas, le lecteur passe un bon moment, voire un moment merveilleux, comme une oie qui passe au dessus d’une ville lors de sa migration et qui rit des contorsions des humains qui l’habite.
05:56 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, société |  Imprimer
Imprimer
15/09/2011
Dorure subtile d’une feuille
Dorure subtile d’une feuille
Dont le soleil darde de lumière
La nervure plus solide, tandis que l’épiderme
Étincelle de l’éclat de sa sève blonde
Bercée d’autres feuilles vertes
Elle se réjouit de son règne doré
Diffusant son spectre royal
Sur ses compagnes alentour
Et bientôt, vieillie et flétrie
De cette sève absente
Qui dessèche sa tige frêle
Elle s’en ira au vent
Légère, attendrie, gondolée
Secouée par d’invisibles ondes
Pour tomber ignorante
Sous les pas d’un petit garçon
Qui la glissera dans un cahier
Avant de la laisser voler
Au printemps, dans la rue
07:13 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, poème |  Imprimer
Imprimer
11/09/2011
Le livre de ma mère, d'Albert Cohen

« C’était ma mère et jamais plus je ne vivrai ces merveilleux moments passés ensemble ». Chacun de nous, ou presque, pourrait le dire à propos de sa mère, mais personne ne saurait le dire aussi bien, de manière aussi belle, qu’Albert Cohen. Avec la même verve et la même délicatesse que dans Belle du seigneur, l’auteur se rappelle ces petits riens qui constituent l’ensemble des souvenirs d’une personne aimée au-delà d’un amour des corps.
Il a des mots tendres et drôles comme l’herbe au printemps :
« Mais si je la grondais, elle obéissait, pleine de foi, immédiatement atterrée par les perspectives de maladie, me croyant si je lui disais qu’en six mois de régime sérieux elle aurait une tournure de mannequin. Elle restait alors toute la journée scrupuleusement sans manger, se forgeant tristement mille félicités de sveltesse. Si, pris soudain de pitié et sentant que out cela ne servirait à rien, je lui disais qu’en somme ces régimes ce n’était pas très utile, elle approuvait avec enthousiasme. « Vois-tu, mon fils, je crois que tous ces régimes pour maigrir, ça déprime et ça fait grossir. » Je lui proposais alors de dîner dans un très bon restaurant. « Eh oui, mon fils, divertissons-nous un peu avant de mourir ! » Et dans sa plus belle robe, linotte et petite fille, elle mangeait de bon cœur et sans remords puisqu’elle était approuvée par moi. »
Il décrit les délirantes promenades dans les rues de Genève, en été, lorsque sa mère, cardiaque, avançait à pas menus :
« Quand on traversait la rue ensemble à Genève, elle était un peu nigaude. Consciente de sa gaucherie héréditaire, et marchant péniblement, ma cardiaque, elle avait si peur des autos, si peur d’être écrasée, et elle traversait, sous ma conduite, si studieusement, avec tant de brave application affolée. Je la prenais paternellement par le bras et elle baisait la tête et fonçait, ne regardant pas les autos, fermant les yeux pour pouvoir mieux me suivre ma conduite, toute livrée à ma direction, un peu ridicule d’aller avec tant de hâte et d’épouvante, si soucieuse de n’être pas écrasée et de vivre. Faisant si bien son devoir de vivre, elle fonçait bravement, avec une immense peur, mais toute convaincue de ma science et puissance et qu’avec son protecteur nul mal ne pouvait lui survenir. »
Il a la mélancolie des jours d’automne lorsque les souvenirs viennent effleurer la conscience :
« Maman de mon enfance, auprès de qui je me sentais au chaud, ses tisanes, jamais plus. Jamais plus, son odorante armoire aux piles de linge à la verveine et aux familiales dentelles rassurantes, sa belle armoire de cerisier que j’ouvrais les jeudis et qui était mon royaume enfantin, une vallée de calme merveille, sombre et fruitée de confitures, aussi réconfortante que l’ombre de la table du salon sous laquelle je me croyais un chef de guerre. Jamais plus son trousseau de clefs qui sonnaillaient au cordon du tablier et qui étaient sa décoration, son Ordre du mérite domestique. Jamais plus son coffret plein d’anciennes bricoles d’argent avec lesquelles je jouais quand j’étais convalescent. O meubles disparus de ma mère. Maman, qui fus vivante et qui tant m’encourageas, donneuse de force, qui sus m’encourager aveuglément, avec d’absurdes raisons, qui me rassuraient, Maman, de là-haut, vois-tu ton petit garçon obéissant de dix ans ? »
Il a enfin les pleurs de l’hiver lorsque le ciel si bas fait resurgir la complainte des regrets :
« Elle attendait tout de moi avec sa figure un peu grosse, toute aimante, si naïve et enfantine, ma vieille Maman. Et je lui ai donné si peu. Trop tard. Maintenant le train est parti pour toujours, pour le toujours. Défaite et décoiffée et bénissante, ma mère morte est toujours la portière du train de la mort. Et moi je vais derrière le train qui va et je m’essouffle, tout pâle et transpirant et obséquieux, derrière le train qui va emportant ma mère morte et bénissante. »
Oui, ce livre est un petit chef d’œuvre de mémoire, drôle, plein d’anecdotes, aux souvenirs embués des regrets qu’ont tous les enfants à la mort d’un parent. Méditation d’un enfant vieilli resté seul face à son enfance, il fait revivre celle-ci, l’enjolive, puis revient aux derniers jours, ceux de son âge adulte, se reprochant ses manquements, son impuissance à lui faire plaisir parce que trop préoccupé de sa propre vie.
« Voilà, j’ai fini ce livre et c’est dommage. Pendant que je l’écrivais, j’étais avec elle. Mais sa Majesté ma mère morte ne lira pas ces lignes écrites pour elle et qu’une main filiale a tracées avec une maladive lenteur. Je ne sais plus que faire maintenant. Lire ce poème moderne qui se gratte les méninges pour être incompréhensible ? »
04:23 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman |  Imprimer
Imprimer
10/09/2011
Vacances 6 (et fin) : La maison
Le silence et rien d’autre.
Du fond de la ruelle
Monte le fracas de la ville
Murmures et cris
Pétarades de scooters
Bruits assourdis des voitures
Mais franchi le seuil
Rien, l’absence, le désert auditif
Tel le vizir dans sa cellule
Nous nous enfermons
Dans ce calme d’Olympie
Pour jouir plus réellement
De cette paix entière
De ce paysage de rien
De cette absence de bruits
Et pourtant,
Cette maison doit résonner
De pleurs d’enfants
De pépiements de petites filles
De cris sauvages de garçons
De murmures entre fiancés
De conversations passionnées
Entre personnes sensées
D’échanges secourables
Et de nostalgie rentrée
Tout cela on l’entend
Lorsque, la porte close,
On prend garde
Aux effluves de la salle du bas
A l’odeur de fenaison de l’escalier
Après l’ouverture du loquet
A la fragrance de pin de la chambre
Aux exhalaisons du vent au dehors
A l’arôme du fond du jardin
C’est une vraie maison,
De celle qu’on habite volontiers
Parce qu’elle fait revivre
Les années passées
Et qu’elle donne à chacun
Une idée de l’avenir.
Quel silence dans la maison pour faire parler une mémoire imaginaire !
06:53 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, poésie, poème |  Imprimer
Imprimer
07/09/2011
Qu'est-ce que la poésie ?
Qu’est-ce que la poésie ?
L’art de la métamorphose du réel.
Ce matin, je lisais dans la chambre, tout entier dans la douceur du matin, quand le ciel s’étire de bleu en dansant sur les nuages. Je finissais le livre de Didier Decoin, « Une Anglaise à bicyclette », et je me disais qu’il était bon de n’avoir pas d’heure, aucune obligation et que je pourrais, si je le désirais, rester toute la matinée au lit, sur le lit, couché entre les draps, l’esprit au frais, les pieds dans la douceur. Et tout d’un coup, à l’image évocatrice des fées rencontrées par Emily au cours de sa promenade à bicyclette, j’ai senti l’essence de la poésie monter en moi, s’engouffrer dans ma poitrine comme un ruisseau s’engouffre dans une faille terrestre, en grosses cataractes, dans un bruit inquiétant.
La poésie, c’est faire de tout ce qui est extérieur votre intérieur, en personnalisant par cette transmutation subtile du passage de la frontière chacun des objets, décors, personnages que vous choisissez pour leurs attraits indétectables à d’autres. La casserole qui chauffe sur le feu, la main de l’enfant qui joue à vos pieds, la tenture qui clôt la porte du salon où se cachent les fantômes, jusqu’à votre propre corps dont les extrémités semblent ne plus vous appartenir. Tout cela est devenu vôtre, par la grâce de la poésie, et vous les chérissez non pas d’un amour possessif, mais d’un sentiment doucereux, miel sauvage et agapanthe odoriférante, qui vous conduit dans un autre monde, où les jours ne se comptent plus, où les nuits s’écoulent sans que les heures s’égrènent, où seul le souvenir de ces évocations renforcent en vous le plaisir de vivre.
Cette métamorphose s’accompagne d’une modification de la vue, de l’odorat, de l’ouïe et du toucher, et même du goût. Plus rien ne se vit comme avant. La moindre attention à un objet devient un évènement, un livre, presqu’un monument. Vous y découvrez ce que vous n’aviez jamais vu auparavant : le charme ignoré, la couleur cachée, la froideur glacée et bienfaisante, le son rugueux au toucher et bien d’autres choses encore dont vous ne conservez pas forcément un souvenir intangible. Et cette métamorphose vous enchante, vous fait découvrir un nouvel art de vivre, un décor inédit à vos réflexions, une version originale de votre appréhension de la réalité. Celle-ci devient rêve éveillé, voyage sur un nuage doré, symphonie exubérante, mélange de parfums passés et de touches évanescentes du futur. Et pourtant cette transmutation est celle du présent, variable à chaque seconde, faisant de chaque instant une éternité vécue pleinement, douloureuse comme un enfantement.
Mais, simultanément, la poésie, c’est également faire de tout son intérieur un extérieur à donner à tous. C’est se mettre à nu devant les autres, sans peur ni pudeur. C’est accepter de ne plus avoir d’intimité, de dévoiler sa fragilité. C’est s’ouvrir sans fard et donner à contempler ce que d’autres cachent à tout prix : ce que vous ressentez en vérité, ce que vous vivez réellement, au-delà d’une façade de bon ton que vous avez pris l’habitude de fabriquer quotidiennement. Et ce n’est pas toujours simple. Ça peut même, parfois, être une souffrance qu’il faut vaincre.
Et, soudainement, le charme se rompt, chaque objet reprend sa place habituelle. L’œil redevient clair, les bruits coutumiers. Vous caressez la table qui ne résonne plus, vous goûtez le bout du crayon qui ne sent que le bois. Le monde est revenu, il s’étale devant vous, sans mystère ni peur. Vous êtes dans ce qui est et plus rien ne fait que ce qui est extérieur ne devienne intérieur. Avez-vous rêvé ?
En fait, vous avez retracé la ligne de démarcation entre l’imaginaire et l’identitaire, tout cela parce que vous êtes à nouveau entré dans votre coquille, celle que vous vous êtes fabriqué, l’image que vous vous donnez, à vous et aux autres.
Comment repartir vers les cieux de la poésie ? Guetter ce qui vous touche pour le saisir lorsqu’il arrive et ne plus le lâcher avant de l’avoir exploité. Face à la feuille blanche, vous êtes seul, mais dans un entourage de légendes personnelles.
03:45 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, poésie, poème |  Imprimer
Imprimer
06/09/2011
Vacances 4 : Port
Horizontal : blanc
Vertical : Gris, noir ou argenté
Partout, des taches rouges et bleues
Renforçant l’enchevêtrement des coques
Quelques pavillons flottent au vent
Et, au centre, les flots, gris, endormis
Bête immobile et doucereuse
Prenant du bon temps, câlinante
Comme il sied à un port abrité.
Au loin, court sur l’horizon
Un chapelet de nuages cotonneux
Hachuré par la forêt de mâts
Et la vie court autour du port
Comme un orage sur la plaine
Bruyante, mouvementée, insensible
A la quiétude des voiliers amarrés
Comme des chevaux de course
Pour le pansage aux murs des écuries
L’eau reflète les couleurs diffuses, mollement
En pâtés marbrés, étirés, ridés
Comme un film à vitesse accélérée
Contrastant avec l’immobilité des monstres
D’acier, effilés comme des aiguilles
Prêts à bondir sur la vague
En ouvrant leur parapluie
07:00 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, poème |  Imprimer
Imprimer
05/09/2011
Métaphysique des tubes, roman d’Amélie Nothom
La vie d’Amélie, de un à trois ans. Cela se passe au Japon, mais surtout cela se passe à travers les yeux d’un enfant de cet âge, y compris dès la naissance, une naissance en trois temps.
Premier temps : le rien, pendant deux ans. Et ce rien n’était ni vide ni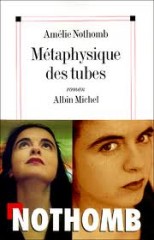 vague : il n’appelait rien d’autre que lui-même. Ce rien est Dieu, absolue satisfaction. Dieu était Dieu. Il était satiété et éternité…Les seules occupations de Dieu étaient la déglutition, la digestion et, conséquence directe, l’excrétion. […] C’est pourquoi à ce stade de son développement, nous appellerons Dieu le tube. Il y a une métaphysique des tubes. […] Dieu avait la souplesse du tuyau, mais demeurait rigide et inerte, confirmant ainsi sa nature de cube. Il connaissait la sérénité absolue du cylindre. Il filtrait l’univers et ne retenait rien.
vague : il n’appelait rien d’autre que lui-même. Ce rien est Dieu, absolue satisfaction. Dieu était Dieu. Il était satiété et éternité…Les seules occupations de Dieu étaient la déglutition, la digestion et, conséquence directe, l’excrétion. […] C’est pourquoi à ce stade de son développement, nous appellerons Dieu le tube. Il y a une métaphysique des tubes. […] Dieu avait la souplesse du tuyau, mais demeurait rigide et inerte, confirmant ainsi sa nature de cube. Il connaissait la sérénité absolue du cylindre. Il filtrait l’univers et ne retenait rien.
Deuxième temps, plus bref, six mois : hurlements et colères. La plante n’est plus une plante ! Dieu se conduisait comme Louis XIV : il ne tolérait pas qu’on dorme s’il ne dormait pas, qu’on mange s’il ne mangeait pas, qu’on marche s’il ne marchait pas et qu’on parle s’il ne parlait pas. Ce dernier point surtout le rendait fou. Découverte du langage.
Troisième temps : deuxième naissance. Ce fut alors qu’elle naquit, à l’âge de deux ans et demi, en février 1970, dans les montagnes du Kansai, un village de Shukugawa, sous les yeux de ma grand-mère paternelle, par la grâce du chocolat blanc. C’est moi ! C’est moi qui vis ! C’est moi qui parle ! Je ne suis pas « il » ni « lui », je suis moi ! […] En me donnant une identité, le chocolat blanc m’avait aussi fourni une mémoire : depuis février 1070, je me souviens de tout. […] Je devins le genre d’enfant dont rêvent les parents : à la fois sage et éveillée, silencieuse et présente, drôle et réfléchie, enthousiaste et métaphysique, obéissante et autonome. […] On commença à m’appeler par un prénom.
Elle se parle peu à peu à elle-même sans vouloir cependant le dire aux autres. Quel mot choisir en premier pour le révéler : maman, puis papa ; mais le troisième fut aspirateur. Elle découvre la mort et en parle avec Nishio-san, sa gouvernante. Elle apprend la haine, celle de Kashima-san, la seconde gouvernante, appartenant à la vieille noblesse japonaise et qui rend tous les blancs responsables de sa destitution. A l’occasion d’une presque noyade, elle parle comme tout le monde d’une voix posée. « Elle parle ! Elle parle comme une impératrice ! », jubile son père.
Chaque chapitre contient une histoire, un petit rien qui fait le charme de ce livre, épisode burlesque ou malheureux. Il y a celui des leçons de chant de nô de son père qui se finit dans les égouts un jour d’inondation, celui des querelles entre les deux gouvernantes, enfin celui des carpes offertes pour son anniversaire et l’étrange comportement de Kashima-san face à son évanouissement et sa nouvelle noyade.
« Ensuite, il ne s’est plus rien passé. » Ainsi se finit le roman d’Amélie Nothomb, à l’âge de trois ans, fin de l’enfance divine des Japonais et Japonaises. Ce n’est en fait pas vraiment un roman, mais pas non plus un livre de souvenirs. C’est un récit plein de vigueur enjouée, de remarques comiques, de profondeurs métaphysiques déguisées sous des pantalonnades. Un livre plein d’esprit, pétillant d’intelligence.
06:40 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman |  Imprimer
Imprimer
04/09/2011
Vacances 3 : Entrer dans le rien
Entrer dans le rien, à la surface du miroir,
Quelle tentation ! S’évanouir aux yeux du monde
Et mourir à soi-même : silence et repos.
J’avançais un pied craintif vers l’onde brillante
Et je le regardais passer à l’envers du miroir,
Un doigt de pied, puis un autre jusqu’au pouce.
Plus rien, plus de doigts de pied bleuis.
Une surface bleu vert et le couperet.
Je tire vers l’arrière et retrouve mon pied.
Quel bonheur ! Marcher avec des béquilles ?
Sûrement pas, autant devenir sourd !
Comment disparaît-il et revient-il, ce pied ?
Réessayons. Le pied entier, comme emprisonné.
Je n’ai plus qu’une jambe complète
Seigneur, que faire ? Avance et vois !
L’autre pied, puis les deux tibias,
Envolés, perdus, quelle légèreté !
Il me manque une partie de moi-même ;
Ce n’est pas la plus important, mais tout de même.
Je ne me vois pas revenir en petite voiture !
Alors poursuivons, stoïque, sans hésitation.
Le miroir est toujours semblable à lui-même
Bleu-vert, gris à certains endroits,
Tremblotant légèrement, ondulé en vagues,
Comme une bête mécontente ou frileuse.
Au dessous, un autre monde, inconnu,
Séparé par une ligne ténue, la surface.
On ne peut la toucher. Elle vous méconnaît.
On plonge dans le rien, éperdu,
Et l’on perd conscience, sans consistance,
Redevenu momie, cadavérisé, froid.
Mais qu’il est bon ce monde caramel
Qui fait de vous un glaçon enchanté,
Les poils hérissés au dessus
Un rien de rien au dessous
Comme un oiseau entre l’air et l’eau
Perdu dans un océan de miroirs
Qui ressort libre du trou sans fin
Qui le nourrit gratuitement.
Avançons, encore et toujours, petitement,
Courageusement, à petits pas,
Sans réfléchir aux conséquences désastreuses
Comme par une nuit d’orage : éclair
De convoitise, d’anéantissement, de volupté.
Oui, pourquoi cédais-je à cet attrait
Comme un aimant se dirige vers le nord
Sans hésitation, pour ne rien trouver,
Se noyer à la verticale du point d’orgue
En un sursaut final après un frisson
Et une pensée émue pour ceux qu’on quitte.
Allons, poursuivons, j’entre jusqu’au nombril.
Il disparaît à son tour, happé par la surface
Je n’ai plus mon trou de vie, mais je suis là
Toujours regardant un ciel rayonnant
Qui projette son ombre sur un corps réduit.
Rien ne me manque et pourtant
Je commence à éprouver une certaine gêne,
A l’équivalent d’un éléphant sans trompe
Ou d’un aspirateur bouché qui cherche l’air.
Pourtant, on ne respire pas par l’abdomen ?
Alors continuons, sans penser, sans ressentir.
J’entre les doigts d’une main, puis l’autre,
Je suis démuni et sans défense.
Comment faire, puisque je ne suis plus qu’un torse
Qui dore au soleil et frissonne de froid et de peur.
J’avance encore, je ne sais comment.
Je n’ai plus ni jambes, ni bras,
Je ne suis plus qu’une tête, encore vaillante,
Mais qui s’inquiète malgré tout.
Vais-je retrouver ce corps, certes mécanique,
Mais bien pratique pour explorer la méconnaissance.
La surface s’est rapprochée des yeux, elle luit,
Elle me nargue, scintillante et riante,
Comme un serpent de désir clos, mais tentant.
Je sors une langue bleuie et goûte.
Dieu, cela brûle et enflamme la gorge.
Un feu acide avec des relents de verdure
Un peu de pétrole aussi, pollution oblige.
Non, l’expérience n’est pas concluante.
Alors je ferme mes orifices avec force
Et je poursuis, inexorablement
Avançant vers une mort annoncée.
Çà y est, je suis dans le noir
Les yeux clos, la bouche condamnée.
Plus de remarques possibles,
Plus de pensées proférées, chantées, versifiées.
Plus rien qu’un silence profond, écrasant.
Seuls les cheveux doivent émerger encore
Comme une botte de radis sur un étalage
Entre des pommes de terre et la laitue
Que vous repêchez d’une main ferme
Parce qu’elle reste fraiche et appétissante.
Puis vous sentez le froid vous saisir
Jusqu’en haut du crâne, main de glace
Qui enfonce votre être sans pensée
Dans la poussière fluide et vaine
D’un courant que vous ne ressentez plus.
Mort au monde des images vraies,
Des sons clairs comme les baguettes
Des tambours d’une vie trépidante,
Des odeurs fraiches telles l’enivrant
Parfum d’une femme étendue ou
L’odeur aigre de la cuisson du chou
Ou encore la senteur du bébé repu.
Mort à la vie, naissance à un monde
Où toucher remplace la vue,
Où le froid et le chaud sont indicateurs
De changements dangereux ou bienheureux.
Je vois du bout des doigts, je respire
En vase clos, comme un poisson,
Puisant un air gorgé de rien,
Je magnifie mes sens, étonné
D’apprendre que je vis encore
A moitié, penserons certains,
Différemment dirais-je.
Encore, encore, encore…
Perdu dans l’immensité du miroir
Un corps dérive, les yeux rêveurs,
Un sourire aux lèvres, les bras en croix,
Alangui d’un bonheur sourd
Clos dans sa totalité,
Perdu aux autres,
Loin des siens,
Replié sur lui,
Déconnecté,
Vide,
Rien.
Telle est la vie !
07:00 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, poème |  Imprimer
Imprimer
30/08/2011
Loup, je m'appelle
Dédié à un petit garçon qui est fasciné par un prénom inhabituel :
Loup, je m’appelle et carnassier je suis
Où donc mes parents ont-ils pêché ce prénom ?
Pourtant comme il est doux ce nom
Doux comme le hibou, piquant comme le houx
Cela fait de moi un être à part
Qui fait rêver les enfants et les fées
Parce que toujours dans leurs songes
Ils me voient terrifiant et innocent
Je suis l’homme des peurs ancestrales
Qui ouvre au mystère des contes
Où l’animal maudit se délecte de lutins
Pourtant rien ne m’avait prédestiné
A devenir un objet de rêverie
J’avais la tête sur les épaules
Comme tout vivant d’aujourd’hui
Mais ce fut un grand malheur
Le jour où l’on cria au loup
Me rejetant, seul, dans les limbes
Des souvenirs d’enfance à petites peurs
Je suis celui qui sert à l’inventeur d’histoires
Parce qu’il a toujours un événement
A conter, pour provoquer l’hilarité
Ou la crainte ou la pitié ou peut-être
L’indifférence des bien-pensants
Voilà quelle est ma vocation
Devenir l’œil invincible qui lit
Au travers des autres et voit dans leur regard
La curiosité insatiable du pou
Devant le bijou tel un caillou
Ou un joujou sur le genou
Que le hibou viendra saisir
Comme un chou, fleur de la vie
Quel chou de hibou, ce Loup !
06:02 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, poésie, poème |  Imprimer
Imprimer
27/08/2011
Le soleil éclairait la nuit d’encre
Le soleil éclairait la nuit d’encre
Des mâts de la mer indivisible
Au creux des rochers sanglants
Se perdent ses rayons d’enluminure
Les pins s’échappent vers l’azur léger
Où les mouettes blanches épanchent leur griserie
Les vagues dorment au sein des terres
Alourdies par la pesanteur de l’homme
Les toits gris d’ardoise des maisons
Oublient leur blancheur de sel et de vent
Pour blêmir dans la brume des soleils trop vivants
Qui couvrent les herbes de tiédeur morose
La fin des matins sur la mer
Pointe son triste clocher de pierre
Une cloche sonne, puis deux, puis trois,
Auxquelles répondent les coups sourds
Du travail des eaux sur les coques de bois
06:05 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, poème |  Imprimer
Imprimer
24/08/2011
Ennemonde et autres caractères, de Jean Giono
Une fois encore, et dans le même ravissement, Giono nous fait pénétrer dans ce monde métaphysique de la Haute Provence, là où les routes font prudemment le tour du pays, où un homme doit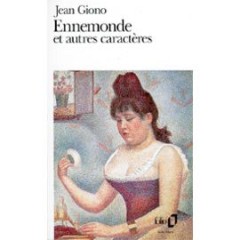 faire dix kilomètres à pied pour rencontrer un autre homme. Terre primitive, très proche de la virginité, elle nourrit l’homme de sa solitude et l’oblige à se conformer à elle.
faire dix kilomètres à pied pour rencontrer un autre homme. Terre primitive, très proche de la virginité, elle nourrit l’homme de sa solitude et l’oblige à se conformer à elle.
Les personnages sont des figures de légende, d’Ennemonde à Honoré, en passant par Clef des cœurs et bien d’autres. Ils vivent dans une métaphysique concrète où tout est poussé à l’extrême. L’amour dans ce pays est une nécessité biologique ou une folie éternelle.
Giono écrit : « Cette façon de procéder réaliste semble au premier abord mal s’accorder avec le fait qu’ils habitent un pays où la vie ne subsiste qu’avec une constante alimentation d’irréalité. Mais c’est que la réalité poussée à l’extrême rejoint précisément l’irréalité. Aller droit aux choses, c’est accepter leur magie ».
06:13 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature |  Imprimer
Imprimer
22/08/2011
Le geste plein d'espoir
Le geste plein d’espoir
Nous avancions sur la grève rocailleuse
Entre l’air et l’eau, vers le ciel et la mer
Accompagnés des cris hostiles des oiseaux
Nous trébuchions sur le sol visqueux
Et tes pieds nus s’enfonçaient dans le granit
Nous devions ensemble tirer dessus
Pour les ressortir gris et poisseux
Et je les essuyais avant de repartir
Le ciel était descendu sur l’horizon
Jusqu’à toucher nos fronts de sa voute poussiéreuse
Et nous nous courbions un peu plus sur la pierre
Escaladant avec peine de grosses roches gluantes
Qui gémissaient à l’atteinte de nos ongles crispés
Ta main parfois m’enserrait la taille
Je goûtais la morsure de tes doigts sur ma chair
Qui faisait tressaillir les muscles
Nous marchions depuis le matin, sans nourriture
La langue sèche, l’œil fiévreux
Et le soir ne voulait pas tomber
Où d’ailleurs aurions-nous pu nous étendre ?
06:07 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, poème |  Imprimer
Imprimer
19/08/2011
Certes, l’herbe est plus verte
Certes, l’herbe est plus verte lorsqu’il pleut, mais le ciel est plus noir. Les gouttes tombent une à une et sordides, mais c’est un rideau qui frôle nos yeux et mouille nos cils.
_ Madame, votre cœur est léger !
_ Tu me diras, Monsieur, ce qui est préférable,
Un cœur lourd de maux inconnus
Ou la légèreté de l’insouciance.
_ Sais-tu, maudite, que tu me feras mourir.
Regarde dans le miroir tes longs cheveux.
Ils couvrent tes épaules d’or
Et moi, je n’ai qu’un peu de laine.
Regarde encore ta bouche,
Une fontaine de bonheur
Qui ne sait que dire oui
Et qui pourtant connaît le non.
_ Tais-toi, le printemps est là.
Pense aux fleurs, aux oiseaux,
Pense aux trois sabots qui courent
Le long des routes acerbes.
Le soleil caresse ton ventre
Et la serpe te court sur le dos
Pour fermer le battant de la mort.
Regarde comme est beau l’azur
De ton cœur, du mien et du ciel.
J’ai perdu des ans à chercher
Ce que je trouve aujourd’hui.
Et tu ne m’as pas dit
Comment je pourrai le faire :
Prendre un verre d’eau et du pain
Et pleurer dehors le soleil qui part.
Jusqu’à ce qu’un jour,
Je vis, seul, le soleil apparaître
Derrière la grotte où je dormais.
Alors tu es revenue de là-bas,
Là-bas dont je ne savais rien,
Sinon que tu m’oubliais peu à peu
A courir après une mort incertaine
Qui ne semblait pas vouloir de toi.
L’herbe était blanche comme l’eau,
Mais il faisait bon s’y étendre
Pour pleurer son bonheur
Avec tous les efforts nécessaires.
_ Ma belle, tu parles sans réfléchir.
Tu crois toujours trouver
Ce qu’en fait il n’y avait pas à chercher.
Viens, que nous visitions notre royaume.
Il fait quatre pieds de long
Et sa largeur n’en fait pas plus de trois.
Mais c’est tout un continent qui s’écoule
Doucement sous nos pas attendris,
Pour dévoiler ce qu’il nous avait caché :
Des rivières aux eaux ronflantes
Qui sentent la fraicheur des nuits,
Du sable d’or isolé dans les herbes
Qui gardent la chaleur du jour,
De longs fruits rouges qui pleurent
Pour nous laisser boire,
De longues grappes d’oriflamme
Pour éclairer nos jours heureux.
_ Monsieur, vous ne faites que me dire
Que tu n’écoutes que ton cœur
Sans entendre les paroles de ma bouche.
Tu parles et tu ne sais
Quelles sont les règles d’or du miroir
Où se cache la clarté du bonheur.
Cherche la vie sans voir la mort.
Regarde la mort sans voir
Ce qui la rend triste à mes yeux.
Des trésors te tendent les bras
Tous les jours en tout lieu
Sans que tu te rendes compte
De ce que tu peux prendre.
Ensuite tu ris, aussi niaisement
Que d’autres pleurent la mort d’une souris
Qui avait l’habitude de courir sur leur lit
Et de grignoter les restes de leur barbe.
Tu ris sans savoir la triste concession
Que j’ai dû faire pour m’occuper de cela.
J’ai quitté ce que j’aimais à jamais,
La tranquillité d’une douce chaleur
Et la sûreté des montagnes isolées
Où seul le vent hurle contre les loups,
La griserie des descentes dans le froid
Et la chute des fééries blanches.
_ Adieu, Madame, mon cœur est las
D’écouter vos amours sans savoir les choisir.
Pour moi, je reprends mon indépendance
Faite de premières visions et de nuits.
Le reste, je l’ai vu pour toujours
Sans envie de refaire l’expérience.
Pourquoi abandonner l’espérance ?
Pourquoi me dire que jamais tu ne reviendras ?
Ta vie est faite de longs trous noirs
Que tu aimes pour leur quiétude,
Mais qui ne sont que des vides où se perd
Pour longtemps ce qui m’a charmé en toi.
Abandonne-les pour t’ouvrir à l’air du temps
Qui puise sa force dans la mer et les cieux,
Qui l’emporte au dessus des terres pour pleurer
Et tromper de leurs larmes l’humanité
Qui s’imagine noyée dans ses longues rivières.
_ Où m’emmènerais-tu, toi dont j’ai tout attendu,
Dont j’ai recueilli la chaleur sur ma joue,
Qui m’a donné la ferveur et la joie.
Tu voudrais me montrer le monde
Où les jours durent comme trois nuits
Et les nuits sont sans moyen de voir
Où me mènent les autres voies.
Regarde où va le monde qui dort.
Les yeux fermés, il tourne
Sans jamais perdre son équilibre,
Bien que toi, tu ne sentes que la chaleur
Des terres chauffées par l’astre central.
Ta tête tourne sans arrêt
Et ton cœur reste seul à jamais.
J’ai espéré longtemps voir un jour
Les longues marches des déserts inconnus
Où se cachent les êtres amassés
Par nos soins dans des trous profonds.
Nous fuyons ceux-ci pour l’entassement
Dans un bloc de pierre et de fer
Façonné par nos soins, sans cependant
Avoir la forme que nous avions voulue.
Regarde aussi derrière toi
La longue misère des trois faunes
Qui couraient sans cesse
Dans le feuillage de la vie alanguie,
La longue tristesse des grands bras
Qui s’élèvent pour pleurer
Les atours qu’ils passent dans leurs doigts
Et les laines précoces qui poussaient
Sur le dos délabré des brebis.
La route est longue vers la mer,
Celle des grandes vertus
Qui courent le long des eaux
Sans jamais trouver un moulin
Qui pourrait tourner pour elles.
Tu cherches aussi comment admettre
Que les stigmates de la grandeur
S’élèvent plus haut que les monts
De la guerre et de la paix réunies
Pour trouver ensemble
Ce qu’ils ne peuvent donner séparément.
C’est le problème de la magie naturelle :
Perdre à la guerre les bagues de la paix
Ou donner pour la paix
Ce que la guerre ne leur avait pas demandé.
Pourquoi crois-tu que je sois encore là ?
Car je pourrais fuir ce chêne
Qui abrite les regards de notre conversation
Et nous permet de perdre
Nos paroles sous la voûte
Je veux te convaincre qu’il n’est pas toujours facile
De se perdre dans la forêt de la sérénité
Pour devenir sourd et assombri
Par le silence qui martyrise.
Pourquoi fuir devant l’autre,
Se perdre parmi la solitude
Du désert au soleil vert et cru
Où, seuls êtres vivants, se perdent
Les oiseaux aux ailes longues et limpides.
L’homme est nécessaire à l’homme,
Comme il est nécessaire à l’anthropophage
Qui coure longtemps pour attraper
Une nourriture céleste pour lui.
06:33 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, poème |  Imprimer
Imprimer
17/08/2011
Hier, j’ai joué avec des enfants
Hier, j’ai joué avec des enfants.
Une odeur d’amertume m’en est restée.
J’ai perdu le pouvoir de la naïveté,
J’ai tenté mille fois, patiemment,
De plier ces machines de papier
Qui volent de leurs ailes déployées.
Mais il leur manquait le souffle
Transmis par les pouvoirs de l’enfance
Pour voir dans l’univers de la petite pièce
Planer la feuille de papier pliée.
Aurais-je déjà revêtu malgré moi
Le masque figé des adultes
Et perdu les sortilèges enfantins ?
Serais-je devenu cet homme dur,
Au regard fixé sur les mots,
À la parole sûre et au geste incertain,
Celui que tu reconnais de loin
Pour l’assurance de ces affirmations.
Je me rappelle ces jours d’enfance
Où un sourire avait le poids de l’or,
Où un baiser éclairait la journée,
Quand une cabane devenait un palais
Et une poupée l’objet d’attendrissement.
Pourtant il me semble bien encore
Que derrière ton sourire de petite fille
Se cache un cœur d’enfant fragile
Et que mon âme suspendue à ton rire
Conserve la vertu des premières naïvetés.
Je suis, devant toi, les mains tendues,
Un petit garçon qui s’émerveille
06:24 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, poème |  Imprimer
Imprimer
11/08/2011
Le reliquaire, chronique de Frantz André Burguet
« S’il nous est donné d’envisager sans désespoir le cours du temps, c’est parce que notre passé grandit à mesure que notre mort approche, que les souvenirs nous occupent et nous émeuvent. Reliquaire inviolable, notre mémoire fait pour nous ce que les musées ne sauraient faire pour les arts et les techniques : c’est qu’il n’y a jusqu’à notre mort aucun progrès possible en dehors d’un passé qui est éclairé après coup, mais déformé, mais trahi.
Le privilège de notre mémoire, Elia, c’est sa faiblesse, son infidélité, cette fausseté qui nous permet, en un passé formé à notre image, de vivre selon notre cœur. »
L’auteur nous dit qu’il s’agit d’une chronique. En effet, le récit est conté par l’intermédiaire de lettres non envoyées, de phrases inachevées, de notes sans suite, de fragments de journal. Celle-ci dépeint le drame d’adolescents qui éprouvent leur sensualité en la refusant.
Poétique recherche du souvenir d’heures merveilleuses, le reliquaire est formé des images que l’amour a façonnées au cours des heures de solitude et de rêve. Sans doute, le narrateur n’a-t-il pas vécu les heures qu’il dépeint avec la même force d’âme et la même sensibilité, mais la mémoire a le privilège d’abolir ces imperfections qui nous empêchent de réaliser la béatitude de certains moments.
Il nous reste de ces heures une étrange sensibilité mise à vif par l’impossibilité matérielle de les revivre dans leur réalité propre (et d’ailleurs elles nous décevraient), l’impression que donne un tableau de Corot ou un prélude de Chopin.
05:23 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature |  Imprimer
Imprimer
10/08/2011
Attente
Attente…
Du bout des doigts, ce tremblement léger
Une fièvre parcourt les veines
Le creux adouci des bras se teinte de crépuscule
Chaque bruit à la mesure d’une symphonie
Chaque regard d’un oiseau dans la nuit
L’oublie d’un pétale au fond des mains
La chaleur de nos pieds sur la terre mouillée
Ses doigts entrelacés de fleurs
Comme un feu d’artifice
Sont le soir le parfum de notre remord
Les diamants mouillés de la pluie
Ensevelissent de bijoux sa parure de cheveux
Les pieds écartelés dans la mousse de l’abandon
Nous écoutons ensemble la naissance de l’herbe
05:38 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, poème |  Imprimer
Imprimer
05/08/2011
A nouveau, le silence de la nuit
A nouveau, le silence de la nuit
Comme une auréole sur le tissu
Des souvenirs et de l’avenir
Où donc m’entraîne cette indolence
Avant le lever du jour, pâle et désorienté
J’erre dans ma solitude bénite
Comme un amant se noie
Dans les bras échevelés et caressant
D’une belle au visage de marbre
C’est le temps de la création
Des virages sublimes de l’imagination
Emportée par les courants improvisés
De l’air et du palpable imperceptible
Qui chemine dans la peau transparente
Qui me sépare de la vie réelle
Et je me noie, englué dans l’ignorance
De jours meilleurs, de plaisirs subtils
En contact avec le vrai et le beau
Et j’erre inlassablement, détourné
De cette connaissance chaleureuse
D’une intimité de pensée conduisant les héros
Vers les cieux blancs et vides
De la présence souhaitable
De cette évanescence indescriptible
Seule, sensible, brûlante et mystérieuse
Au fond de soi, de toi,
Oui, de nous… Probablement.
05:04 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, poème |  Imprimer
Imprimer
03/08/2011
La vie se crée dans le délire
La vie se crée dans le délire et se défait dans l’ennui. L’ennui, cette maladie incurable… L’univers transformé en après-midi de dimanche.
Nous ne pourrions atteindre le terme d’un seul jour si la possibilité d’en finir ne nous incitait pas à recommencer le jour d’après. Pouvoir disposer absolument de soi-même et s’y refuser, est-il don plus mystérieux ?
Qui fut assez audacieux pour ne plus rien faire parce que tout acte est ridicule dans l’infini ?
On ne discute pas l’univers, on l’exprime : nous ne commençons à vivre réellement qu’au bout de la philosophie.
L’être est muet et l’esprit bavard. Cela s’appelle connaître.
J’ai voulu supprimer en moi les raisons qu’invoquent les hommes pour exister et pour agir… Et, me voilà dans l’hébétude, vide…
Notre existence, réduite à son essence, continue à être un combat contre les éléments de toujours, combat que notre savoir n’adoucit aucunement.
Qui n’a convoité l’ignominie, pour couper à jamais les liens qui l’attachaient aux autres, pour subir une condamnation sans appel et arriver ainsi à la quiétude de l’abîme ?
L’homme est l’être dogmatique par excellence, et ses dogmes sont d’autant plus profonds qu’il ne les formule pas, qu’il les ignore et qu’il les suit.
06:48 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philosophie |  Imprimer
Imprimer











