09/12/2012
La vie, c’est le mouvement
Flottements de mouvements perpétuels
Quel étrange monde que la ville
Bruits en collision permanente
Sursaut et atonie vous frôle les sens
Seul le geste reste placide
Et flotte dans l’air froid de l’automne
Le piétinement des passants
Immense charge journalière
Vers la dévoration bureautique
Dans les rires dépersonnalisés des uns
Et les grognements d’autres délaissés
Ces inconnus vous passent à travers le corps
Sans même vous toucher, insistants
Légers, parfois cependant caressants
Fin du jour, entrée dans la nuit
Nausée de paroles et d’ignorance
Chercher refuge dans sa boîte
Havre de paix…
Ouf, j’y suis
Cerclé de ces révolutions fugaces
Vous laissez tomber votre masque
Le noir, l’absence, le non-être
Vite,
remettre sa peau civilisée
Ouvrir son monde à l'univers médiatique
Pouvoir à nouveau respirer
L’odeur de cette agitation
De ces rumeurs, de ces affrontements
Et se dire : « Aujourd’hui encore,
Je vis ! »
07:04 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écriture, poème, littérature, poésie |  Imprimer
Imprimer
08/12/2012
Le démon et mademoiselle Prym, récit de Paulo Coelho
Le bien et le mal, éternels opposés, mais toujours tellement proches l’un de l’autre en un seul être humain, si bien que le problème permanent de l’homme, n’est pas de se comporter tantôt bien tantôt mal, mais de marcher sur la crête incertaine qui les sépare, sans jamais tomber d’un côté ou de l’autre.
Quelle idiotie, me direz-vous. Certes, je ne parle pas du bien à la manière de saint François d’Assise ou du mal à la manière d’Hitler (sans doute parce que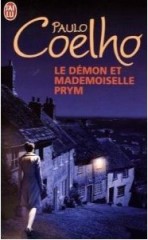 j’ai encore en souvenir le livre d’Eric-Emmanuel Schmitt). Je parle des petits biens et des petits maux qui sont à notre portée. Ils sont si opposés et si proches en même temps. On croît faire le bien, mais le résultat ou les conséquences deviennent des maux, et inversement. De plus, la frontière n’est jamais visible. Elle se faufile comme une ficelle tombée par terre, tantôt à gauche vers le mal, tantôt à droite, vers le bien. Et elle bouge. Alors cette instabilité est décourageante. Comme l’équilibriste sur son fil, il faut regarder au loin, et ne jamais baisser les yeux, sinon le vertige vous prend et vous conduit d’un côté ou de l’autre.
j’ai encore en souvenir le livre d’Eric-Emmanuel Schmitt). Je parle des petits biens et des petits maux qui sont à notre portée. Ils sont si opposés et si proches en même temps. On croît faire le bien, mais le résultat ou les conséquences deviennent des maux, et inversement. De plus, la frontière n’est jamais visible. Elle se faufile comme une ficelle tombée par terre, tantôt à gauche vers le mal, tantôt à droite, vers le bien. Et elle bouge. Alors cette instabilité est décourageante. Comme l’équilibriste sur son fil, il faut regarder au loin, et ne jamais baisser les yeux, sinon le vertige vous prend et vous conduit d’un côté ou de l’autre.
C’est l’histoire de Mademoiselle Prym, Chantal, serveuse de bar dans un village perdu et paisible qui, en un jour, ne regarde plus au loin et se laisse entraîner à droite et à gauche selon les circonstances. L’étranger, arrivé la veille, lui montre des lingots d’or qu’il a cachés dans la terre. Pour la séduire, pense-t-elle. Je ne me laisse pas prendre par un piège aussi grossier. Mais… Elle pourrait apprendre à l’aimer. Et l’homme lui dit : « C’est exactement ce que je veux savoir. Si nous vivons au paradis ou en enfer. » Il poursuit : « J’ai découvert que si nous avons le malheur d’être tentés, nous finissons par succomber. Selon les circonstances, tous les êtres humains sont disposés à faire le mal. » Enfin, il propose son marché : « Si au bout de sept jours, quelqu’un dans le village est trouvé mort, cet argent reviendra aux habitants et j’en conclurai que nous sommes tous méchants. Si vous volez ce lingot d’or mais que le village résiste à la tentation, ou vice versa, je conclurai qu’il y a des bons et des méchants, ce qui me pose un sérieux problème, car cela signifie qu’il y a une lutte au plan spirituel et que l’un ou l’autre camp peut l’emporter. (…) Si, finalement, je quitte la ville avec les onze lingots d’or, ce sera la preuve que tout ce en quoi j’ai voulu croire est un mensonge. Je mourrai avec la réponse que je ne voulais pas recevoir, car la vie me sera plus légère si j’ai raison – et si le monde est voué au mal. »
Et commence les tractations qui font l’objet du livre. Vers quoi Chantal, puis les habitants, vont-ils pencher ? Va-t-elle dire aux autres ce que l’étranger lui a dit ? Va-t-elle prendre au moins un lingot ? Les habitants vont-ils s’entendre pour tuer quelqu’un ?
C’est une fable que nous conte Paulo Coelho qui dévoile en même temps la nature humaine, ni ange, ni démon. Chantal explique : « Moi, je ne sais pas si Dieu est juste. En tout cas, Il n’a pas été très correct avec moi et ce qui a miné mon âme, c’est cette sensation d’impuissance. Je n’arrive pas à être bonne comme je le voudrais, ni méchante comme à mon avis je le devrais. »
06:30 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, spiritualité, religion, philosophie, bien et mal |  Imprimer
Imprimer
07/12/2012
Douze variations en sol majeur pour violon et piano, de Wolfgang Amadeus Mozart
http://www.youtube.com/watch?v=HoGdiwtvt10
Une musique fraiche et enfantine, mais si difficile à jouer ! Elle vous enchante l’ouïe et vous détend le corps. Vous êtes baigné d’ondes chaleureuses et vous partez au bord du Danube pour une promenade intemporelle dans un autre siècle, sans souci.
L’interprétation est parfois un peu lourde pour le piano, à tendance appuyée (il n’est pas dit qui interprète), mais les nuances sont brillantes, avec ses ralentissements et glissandos. Ces défauts sont peut-être dus à l’enregistrement, le piano couvre parfois le violon.
Il n'empêche, quelle fraicheur !
07:27 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique classique, piano, mozart |  Imprimer
Imprimer
06/12/2012
L'art en guerre, exposition au musée d'Art moderne (1ère partie)
Cette exposition rassemble près de 400 œuvres et plus de 100 artistes. Elle montre ce qui restait dans les cartons à l’époque, une peinture qui s’exprime en toute liberté, qui éclate en tendances très variées, qui redéfinit la manière dont le peintre voit la société et le monde. De cette période naîtra l’art brut, le tachisme, l’art informel, l’emploi de matériaux de récupération dont certains proviennent directement des combats.
Comme dans toute exposition, il est impossible d’avoir le coup de cœur pour toutes les œuvres présentées. La visite commence par l’exposition internationale du surréalisme, en janvier 1938. La salamandre pompéienne, de Gérard Vulliamy est particulièrement intéressante, mais je n’en ai pas trouvé de reproduction sur la toile.
Puis, avec l’occupation, de nombreuses œuvres sont présentés : La maternité au lange, d’Edouard Pignon, peinte en 1942, est représentative d’une partie de son art, figurative, alors qu’il s’exprime dans le même temps dans des déchainements de couleurs et de traits de manière presque totalement abstraite. Il dit de lui : « Je suis un mélange d’anarchiste et de conservateur, dans des proportions qui restent à déterminer. »

La chaise de cuisine, une toile magnifique de couleurs et d’expression, sur un sujet bateau quasiment sans intérêt, de Maurice Estève, montre la richesse des styles de ce peintre qui, finalement, s’oriente vers le non figuratif avec des toiles très colorés, aux tons chauds et vifs. Cette chaise, peinte en 1942, est magnifique d’évocation d’une réalité de tous les jours, à la fois très matérielle, mais qui laisse transparaître une certaine joie ou même un vrai bonheur de vivre, malgré un contexte difficile.

Un autre coloriste, d’un style bien différent, mais qui a la même verve des couleurs est le peintre et sculpteur allemand Otto Freudlich, ami de Picasso. Qualifié d’artiste dégénéré, il pensait que l’art a le pouvoir de changer l’homme et de créer une société nouvelle. Sa morale cosmique lui permet de transcender la matière et de mettre en évidence cet « espace intermédiaire » qui rend toute chose interdépendante des autres.
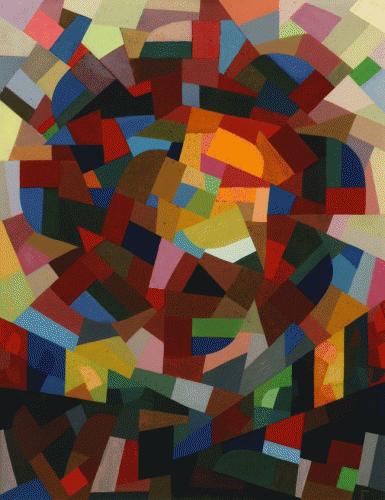
Et, bien sûr Picasso, avec L’aubade, peinte en 1942. Quel étrange concert que cette aubade d’une musicienne à une femme couchée, nue, qui semble apprécier pleinement ce délassement. Tout est mouvement dans ce tableau, si bien qu’on ne sait de quel endroit on regarde et comment se situent les corps dans l’espace. Et pourtant, l’impression de détente est bien là, présente et absente dans la semi-obscurité de la chambre.

07:03 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art moderne, abstrait, guerre, surréalisme, histoire de l'art |  Imprimer
Imprimer
05/12/2012
Maison de campagne en hiver
Entrée dans l’eau glacée du vestibule
Pépiement lumineux du noir charbon
Avant que la lumière ne soit faite
Sur la montée d’escalier vertigineuse
Rien ne vient…
la congélation verte
Du billard immobilisé sur ses quatre pieds
Le salon rouge comme un poisson
Au-delà le gouffre des casseroles
Qui tintent d’aigreur pétrifiée
Enfin, la porte du néant, jardin olivâtre
Sans poignée…
Retournement de l’être
Les yeux vers le cerveau opaque
Je contemple cette image absconse
Enroulé sur moi-même
Bras et mains en extase
Jambes et pieds cramponnés
Dispersé, le sang se meut en serpent câlin
Qui relie les grains d’être
En étranges colliers d’alignements
Je passe de l’un à l’autre, sans sauter
Guidé par le fil des pensées noires
Plongeon dans l’absence
Saut dans l’irréalité caressante
Qui frissonne dangereusement
Entre les cils entrouverts
Qui ne veulent voir au-delà
De la froidure impalpable
Du crabe aux yeux fixes et glauques
Dieu, pourquoi la vie se pare-t-elle
D’autant de sens pour l’inconnu ?
07:18 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, littérature |  Imprimer
Imprimer
04/12/2012
La guerre du sens, de Loup Francart
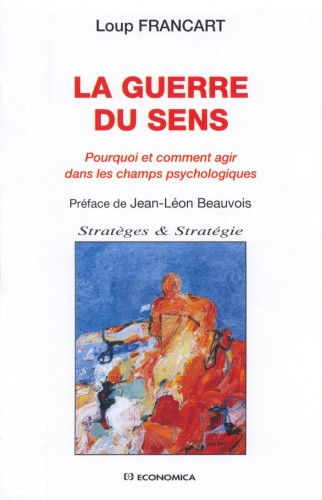
Préfacé par le professeur Jean-Léon Beauvois, socio-psychologue, « La guerre du sens » est éditée chez Economica, dans la collection Stratèges et Stratégie.
Depuis dix ans les nations occidentales sont confrontées à des conflits dans lesquelles le sens de la guerre et la recherche de légitimité par les belligérants entraîne une véritable guerre du sens par médias et opinions interposés. L’art de persuader par le verbe prend le pas sur l’art de l’affrontement physique. La guerre du sens ne peut être évitée. Ne pas vouloir y participer revient à laisser aux autres le soin d’expliquer ce que nous voulons et ce que nous faisons.
Le général (2S)Loup Francart en décrit les raisons et les modes d’action : communication, persuasion, désinformation, intoxication, propagande. Il en définit les règles pour que la démocratie n’y perde pas son âme.
07:40 Publié dans 44. Livres | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : stratégie, psychologie, société, communication, information, désinformation |  Imprimer
Imprimer
Le bonheur
Le bonheur, c’est la délivrance de son petit personnage. Non pas une évasion dans un obscur néant, mais l’absence de ces grains de matière qui obscurcissent notre vision. Le moi s’efface pour le soi, universel, hors de l’espace et du temps, lumière qui change le regard.
Certains parleront de la découverte de notre véritable nature, d’autres, de l'irruption du divin. Mais n’est-ce pas tout simplement la rencontre des deux ? Cette rencontre n’a lieu ni hors de soi, ni en soi. Ni hors de soi, sinon en quoi nous concernerait-elle personnellement ? Ni en soi, car le moi n’est plus concerné par cette rencontre.
Je pense souvent à l’eau qui chauffe, puis qui commence à bouillir. Elle devient vapeur, s’élève en volutes dans l’air, semble mourir pour renaître ensuite dans les pluies bienfaisantes. Le bonheur est un changement de nature, l’abandon des lunettes du moi. C’est alors que je suis véritablement présent, un avec la matière, avec l’autre qui devient moi.
Le bonheur est l’abolition de la distance entre le monde et moi par la transformation réciproque de l’un et de l’autre. C’est en cela que « le royaume des cieux n’est pas de ce monde », mais que « En vérité, je vous le dis, le royaume des cieux est au milieu de vous ». Quelle contradiction !
06:07 Publié dans 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bonheur, avent, religion, spiritualité |  Imprimer
Imprimer
03/12/2012
La part de l’autre, roman d’Eric-Emmanuel Schmitt
– Adolf Hitler : recalé.
– Adolf H. ; admis.
Cette annonce de l’Académie des beaux-arts change le monde. On oscille entre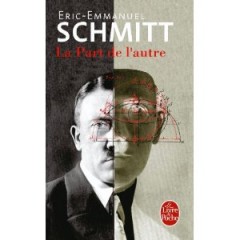 un monde réel, dans lequel le personnage d’Hitler se promène avec difficulté jusqu’à son suicide et un monde imaginaire où Hitler devient peintre. Pas le grand peintre qu’il souhaite devenir, mais un artiste acceptable qui finit par reconnaître qu’il n’a pas l’étoffe d’un grand maître et qui survit à cela.
un monde réel, dans lequel le personnage d’Hitler se promène avec difficulté jusqu’à son suicide et un monde imaginaire où Hitler devient peintre. Pas le grand peintre qu’il souhaite devenir, mais un artiste acceptable qui finit par reconnaître qu’il n’a pas l’étoffe d’un grand maître et qui survit à cela.
Toutes les deux ou quatre pages, on passe d’un personnage à l’autre, parfois en se demandant duquel il s’agit : Docteur Jekyll ou Mrs Hyde ?
Du nouveau chancelier de l’Allemagne, l’auteur écrit : « Ils ignoraient qu’ils n’avaient pas désigné un homme politique, mais un artiste. C’est-à-dire son exact contraire. Un artiste ne se plie pas à la réalité, il l’invente. C’est parce que l’artiste déteste la réalité que, par dépit, il la crée. D’ordinaire, les artistes n’accèdent pas au pouvoir : ils se sont réalisés avant, se réconciliant avec l’imaginaire et le réel dans leurs œuvres. Hitler, lui, accédait au pouvoir parce qu’il était un artiste raté. »
Du peintre, il imagine, dans un dialogue entre le professeur et un de ses élèves, la lutte de celui qui découvre qu’il n’est pas un grand peintre : « – Une vie, ça ne se fait pas tout seul. Ce n’est pas vous qui la donnez. Ce n’est pas vous qui choisissez vos dons. (…) A quarante ans, vous décidez de faire des enfants et vous décidez de ne plus peindre. En fait, ce que vous désirez, c’est décider. Maîtriser votre vie. La dominer. Fût-ce en étouffant ce qui s’agite en vous et qui vous échappe. Peut-être ce qu’il y a de plus précieux. Voilà, vous avez supprimé la part de l’autre en vous comme à l’extérieur de vous. Et tout ça pour contrôler. Mais contrôler quoi ? »
Eric-Emmanuel Schmitt se justifie et explique son roman dans son journal : « J’élabore un double portrait antagoniste. Adolf H. cherche à se comprendre tandis que le véritable Hitler s’ignore. Adolf H. reconnaît en lui l’existence de problèmes tandis qu’Hitler les enterre. Adolf H. guérit et s’ouvre aux autres tandis qu’Hitler s’enfonce dans sa névrose en se coupant de tout rapport humain. Adolf H. affronte la réalité tandis qu’Hitler la nie dès qu’elle contrarie ses désirs. Adolf H. apprend l’humilité tandis qu’Hitler devient le Führer, un dieu vivant. Adolf H. s’ouvre au monde ; Hitler le détruit pour le refaire. Non seulement La part de l’autre donne le principe du livre mais ce titre en suggère la dimension éthique : poursuite de l’altérité chez Adolf H., fuite de l’altérité chez Hitler. »
C’est un livre profond, parfois intéressant, mais qui devient lassant pendant sa lecture. Où veut-on en venir ? Cette question vous taraude tout au long des pages et la réponse ne se trouve pas dans le livre, mais dans le journal où l’auteur décrit ses interrogations. Vous êtes frustré lorsque vous fermez ce long roman de 500 pages, vous l’aimez lorsque vous le refouillez et retournez au point de départ. Que ce serait-il passé si l’Académie des beaux-arts en avait décidé autrement ? Adolf H. manque sans doute un peu de personnalité pour devenir la controverse d’un Hitler névrosé, mais sorcier des foules. A l’opposé d’Adolf Hitler, qui craint les femmes, Adolf H. réussit sa vie grâce aux femmes : Onze-heures-trente, sœur Lucie, Sarah, sa femme, juive.
05:18 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, histoire, psychologie, femme |  Imprimer
Imprimer
Maîtriser la violence, une option stratégique, de Loup Francart
Depuis la fin de la guerre froide, se sont développées des situations conflictuelles intra-étatiques dans lesquelles une violence multiforme remplace les batailles conventionnelles qui caractérisent les conflits inter-étatiques.
Publié en 1999, anticipant les événements du Kosovo, ce livre fait l’objet d’une réédition tenant compte des évolutions de ce type de conflits dans lesquels la communauté internationale mandate une force pour préserver, rétablir ou recréer la stabilité. Dans ces opérations, destinées à empêcher la guerre, les armées ne peuvent s’attaquer directement à la puissance militaire adverse. Leur position sera le plus souvent en interposition plutôt qu’en opposition. Dans bien des cas, il ne sera pas désigné d’adversaire.
l’objet d’une réédition tenant compte des évolutions de ce type de conflits dans lesquels la communauté internationale mandate une force pour préserver, rétablir ou recréer la stabilité. Dans ces opérations, destinées à empêcher la guerre, les armées ne peuvent s’attaquer directement à la puissance militaire adverse. Leur position sera le plus souvent en interposition plutôt qu’en opposition. Dans bien des cas, il ne sera pas désigné d’adversaire.
Cette approche nouvelle propose une stratégie de contre-violence destinée à prévenir, contrôler, contenir l’escalade de la violence. Après avoir analysé les types de violence rencontrés par les forces dans ces engagements et précisé les différences entre l’emploi de la force et l’utilisation de la violence, les auteurs explicitent les éléments de conception de ces opérations et décrivent les procédés de maîtrise à mettre en œuvre sur le théâtre lui-même.
Le général (2s) Loup Francart dirige la société EUROCRISE, spécialisée dans la gestion des crises et l’intelligence stratégique. Au cours des années 90, Il a été l’initiateur de la nouvelle doctrine d’emploi des forces armées en tant que chargé de mission à l’état-major de l’armée de terre. Il a ensuite été directeur de recherche à l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques où il a travaillé sur les problèmes stratégiques européens. Il a également publié La guerre du sens (Economica, mai 2000), ouvrage traitant de la guerre médiatique et de la gestion de l’environnement psychologique dans les conflits. Il est considéré comme un expert international en matière de stratégie et de doctrine d’emploi des forces.
Jean-Jacques Patry a largement contribué aux recherches multidisciplinaires et à la mise en forme des chapitres. Il est docteur en Droit Public et Sciences Politiques et titulaire d’un DESS de défense.
Voir : http://www.eurocrise.com/
04:22 Publié dans 44. Livres | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : stratégie, géopolitique, violence, emploi des forces |  Imprimer
Imprimer











