12/01/2014
Au commencement...
Rien et Tout, en une première seconde
L’infini naît du fini
Qui lui-même est né du vide
Et ce vide contenait tout
Le vide était présence
Il donna l’existence
Et passa de l’absence
A l’essence même des choses
Le vide transcende-t-il le plein
Ou le plein émane-t-il du vide
Aspire au vide pour être plein
Car le plein n’est que vide
Dans l’âme qui se cherche
© Loup Francart
07:35 Publié dans 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : réalisation de soi, spiritualité, philosophie, univers, homme |  Imprimer
Imprimer
11/01/2014
La cuisinière d’Himmler, roman de Frantz-Olivier Giesbert
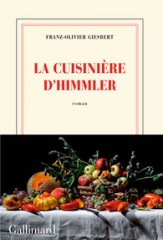 Une cuisinière centenaire nous raconte sa vie. Elle croit à l’amour, au rire à la vengeance. L’histoire la laisse maintenant de côté : Je suis bien contente que l’Histoire soit partie, elle a fait assez de dégâts comme ça. (…) Mons histoire n’est rien, enfin, pas grand-chose : un minuscule clapotis dans l’Histoire, cette fange où nous pataugeons tous et qui nous entraîne vers le fond, d’un siècle à l’autre. Elle décide d’écrire ses mémoires, un livre pour célébrer l’amour et pour prévenir l’humanité des dangers qu’elle court. Pour qu’elle ne revive jamais ce que j’ai vécu.
Une cuisinière centenaire nous raconte sa vie. Elle croit à l’amour, au rire à la vengeance. L’histoire la laisse maintenant de côté : Je suis bien contente que l’Histoire soit partie, elle a fait assez de dégâts comme ça. (…) Mons histoire n’est rien, enfin, pas grand-chose : un minuscule clapotis dans l’Histoire, cette fange où nous pataugeons tous et qui nous entraîne vers le fond, d’un siècle à l’autre. Elle décide d’écrire ses mémoires, un livre pour célébrer l’amour et pour prévenir l’humanité des dangers qu’elle court. Pour qu’elle ne revive jamais ce que j’ai vécu.
On lui laisse son récit. Il n’est pas bon de dévoiler ce qui fait le sel d’un livre, ici, les aventures drolatiques d’une femme qui a tout fait et bien aimé, donc ses rapports avec les hommes de sa vie ou non. Ce récit s’étage entre 2012 et les longues années de son existence. Elle raconte celle-ci à sa manière avec des petites phrases truculentes, parfois avec une emphase déclinante, souvent avec justesse et observation. Le jour de ma naissance, les trois personnages qui allaient ravager l’humanité étaient déjà de ce monde : Hitler avait dix-huit ans, Staline vingt-huit et Mao, treize. Elle naît en Arménie, entouré de l’amour de sa mère. Ma grand-mère sentait l’oignon de partout, des pieds, des aisselles ou de la bouche. Même si j’en mange beaucoup moins, c’est d’elle que j’ai hérité cette odeur sucrée qui me suit du matin au soir, jusque sous mes draps ; l’odeur de l’Arménie. Mais la « turquification » met fin à tout cela. Ses parents sont déportés, sa ferme est brûlée, et elle doit partir. Son épopée commence.
L’amour est le fil directeur de la vie de Rose. Elle se présente ainsi : Il y a des jours où j’ai envie d’embrasser n’importe quoi, les plantes comme les meubles, mais je m’en garde bien. Je ne voudrais pas qu’on me prenne pour une vieille folle, un épouvantail à enfants. A près de cent cinq ans, il ne me reste plus qu’un maigre filet de voix, cinq dents valides, une expression de hibou, et je ne sens pas la violette. Pourtant en matière de cuisine, je tiens encore la route : je suis même l’une des reines de Marseille, juste derrière l’autre Rose, une jeunesse de quatre-vingt-huit ans, qui fait des plats siciliens épatants, 25 rue Glandevès, non loin de l’Opéra.
Oui, je le reconnais maintenant, Frantz-Olivier Giesbert est un excellent écrivain. Ce livre est gai, léger, plein de délices, de jeu de mots, de faits picaresques. Sa manière est innocente. Il vous sort une petite phrase de rien, qui renverse les perspectives et remplace la sinistrose du siècle par un grand éclat de rire. Ainsi, violée par un mamelouk, elle constate : Quand je sortis des draps, je découvris qu’ils étaient pleins de sang, mais je savais ce que cela signifiait, ma grand-mère me l’avait expliqué, Fatima aussi, et je ne pus, malgré mon dégoût, réprimer une certaine fierté. Elle philosophe également, à sa manière : Quand on regarde tout le temps la télévision, c’est qu’on va mourir. Je ne sais s’il y a un lien de cause à effet, mais l’expérience m’a appris qu’elle était l’antichambre de la mort. Ou encore : S’ils ne sont pas forcément plus heureux là-haut, les morts sont moins fatigués que les vivants sur la terre. Ils n’ont pas à lutter. Ils ont le temps pour eux.
Et Rose conclut :
La vie s’est comme un livre qu’on aime, un récit, un roman, un ouvrage historique. On s’attache aux personnages, on se laisse porter par les événements. A la fin, qu’on l’écrive ou qu’on le dise, on n’a jamais envie de le terminer. C’est mon cas…
07:24 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, livre |  Imprimer
Imprimer
10/01/2014
Les insomnies de François Ducassier
François Ducassier se leva brusquement, dit à peine bonsoir et sortit dans la nuit. Il avait hâte de se coucher. Arrivé chez lui, il se changea et s’offrit aux dieux de la nuit.
A deux heures quarante-cinq, il se réveilla. Il ne reconnut pas sa chambre au papier de fleurs mauves. Il tendit la main vers la petite table où se trouvaient ses lunettes et trouva le flanc de bois massif d’un meuble important, une commode probablement. Il chercha vainement le fil électrique et le commutateur. Alors il se dressa sur son lit. Il lui sembla plus haut, plus large, plus imposant. La lumière lunaire permettait de distinguer la masse des objets qui peuplaient la chambre. Lourdeur, pensa-t-il. Il sortit ses jambes, les laissant pendre sur le bord du lit sans qu’elles touchent par terre. Ses pantoufles étaient encore là. Il sauta, les enfila, passa une robe de chambre et, tendant les bras en avant, marcha vers ce qui était auparavant la fenêtre. Il n’y avait qu’une glace qui reflétait les pâles rayons diffusés par une autre ouverture, à gauche. Il trouva enfin un commutateur électrique. Hésitant, il alluma et poussa un cri étouffé.
Ce n’était pas sa chambre. Plus solennelle, elle était large, revêtue d’un épais tapis, chargée de meubles imposants, un bureau empire, une commode Louis XVI, une table entourée de quelques chaises. Elle était ornée de miroirs encadrés richement et de tableaux représentant des campagnes foisonnantes. La fenêtre s’entourait de rideaux lourds, surchargés de perroquets opulents. Il se rassit sur le bord du lit, plongeant en lui-même pour essayer de se souvenir de ce qu’il avait fait la veille. Oui, il s’était bien couché dans sa chambre. Alors que faisait-il là ? N’ayant pas de réponse, il entrouvrit la porte et contempla le long couloir sur lequel s’ouvraient de nombreux seuils, tous semblables. Il sortit, laissant ouverte la porte de cette chambre insolite et fit quelques pas. Pas un bruit, pas un mouvement signalant une présence. Un tombeau ! Il courut jusqu’au bout du couloir, un escalier s’ouvrait montant et descendant autour de son axe central. Il monta un étage. Même couloir encadré de portes imposantes. Il poursuivit un étage plus haut, puis deux, puis trois. Même désolation opulente et silencieuse. Alors, il redescendit cinq étages, toujours le même couloir. Se penchant par-dessus la rampe, il vit une interminable descente d’escalier qui s’enfonçait dans la terre, sans fin, comme une illusion d’optique. Levant la tête, même impression, une hélice tourbillonnante sans limite. Il remonta d’un étage, traversa le couloir et retrouva la porte de sa nouvelle chambre, entrouverte sur son opulence. De guerre lasse, il se recoucha, réfléchissant à ce qui lui arrivait. Mais à peine s’était-il installé confortablement, qu’il s’endormit.
Le lendemain matin, il se réveilla dans sa chambre, la vraie, celle qu’il connaissait depuis toujours, plus modeste et familière. Il se rappela ce réveil inconfortable, son errance dans les couloirs, l’escalier sans fin. L’impression d’infini lui serra à nouveau le cœur, lui laissant une vague nausée dans la gorge. Sa journée se déroula normalement, mais il ne se sentait pas réel. Un léger décalage s’était emparé de sa vision habituelle. Il se regardait travailler, déjeuner, converser, se promener. C’était un autre lui-même, en tout point semblable, mais il n’était pas au centre de ce personnage, au centre de son monde et même du monde en général. Cet imperceptible décalage n’était pas véritablement gênant en soi, mais il le mettait mal à l’aise. Il allait comme s’il avait un caillou dans sa chaussure, claudiquant dans sa présence face au temps qui coule.
Le soir, il rentra plus vite que d’habitude. Il se coucha, songeant à mettre à portée de main une boite d’allumette, une lampe électrique et ses lunettes. Il s’endormit sans appréhension, comme chaque jour. A deux heures quarante-cinq, il se réveilla. Même changement de chambre, même impression de grandiloquence et même silence. Il se leva, marcha vers la porte, l’entrouvrit. C’était le même couloir avec les mêmes portes et, au fond, la cage d’escalier. Il parcourut sa longueur pour se retrouver devant la vertigineuse montée ou descente. Il se sentit suffoquer. Une odeur de mort semblait l’engloutir. Il regagna péniblement sa chambre, se recoucha et n’eut à nouveau aucun mal à s’endormir.
Pendant presqu’un mois, la même aventure se renouvela. Il dépérissait. Ses yeux rougis par l’insomnie ne reflétaient qu’une immense inquiétude. Il marchait à côté de lui-même, regardant son ombre vivre, manger, rire et parfois pleurer. Il entama une liaison avec une jeune femme drôle et enjouée qui lui permit de survivre. Lorsqu’il la serrait dans ses bras, il avait l’impression d’exister. Son parfum sucré remplaçait la senteur de mort qui l’habitait toutes les nuits. Il revivait, prenant un certain intérêt à pétrir la chair tendre et ferme du corps de cette femme qui tous les matins le sortait de sa prison imaginaire ou réelle.
Un jour, le trentième du mois, il lui parla de ce rêve réel qui l’assaillait. Elle eut l’air étonné, mais sans plus. La première nuit, elle s’efforça de se tenir éveillée, mais s’endormit à deux heures. La deuxième nuit, elle mit un réveil sous son oreiller, ouvrit un œil et s’assit sur le lit sans faire de bruit. Elle attendit. A deux heures quarante-cinq, il se leva d’une manière tout à fait naturelle, et sortit. Il rentra trois-quarts d’heure plus tard et se recoucha comme si de rien n’était. Au petit déjeuner, dans l’intimité du matin, elle lui raconta ce qu’elle avait vu. En fait rien d’autre que cette sortie qui lui semblait normale. Elle le serra contre elle, l’enfermant dans ses effluves qui l’enivraient joyeusement et accepta un retour dans les draps froissés. Chaque matin, elle écoutait le récit de la nuit, toujours le même et à chaque fois elle l’emportait dans l’ivresse de l’amour jusqu’à lui faire oublier l’épisode nocturne qui le faisait dépérir. Enfin vint le jour où il dormit sans être réveillé. Le lendemain, il n’eut rien à raconter si ce n’était sa délivrance. Alors elle se leva, revêtit avec lenteur sa robe blanche qui lui tombait sur les pieds, se maquilla, rangea ses quelques affaires dans une petite mallette, l’embrassa sur la bouche et sortit en laissant la porte ouverte. Pas un mot ne fut échangé, pas un geste qui pouvait dire « ne pars pas ». Et d’un coup, le décalage devenu habituel s’interrompit.
L’esprit de François avait retrouvé sa place dans son corps, au centre de lui-même. Une vague nostalgie restait en lui. Elle se manifestait le soir avant de se coucher. Mais dès qu’il fermait les yeux tout s’évanouissait. Il ne resta bientôt rien de cette division du temps et de l’espace qu’il ne comprit jamais, et qu’il finit par oublier.
07:55 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, littérature, écriture, rêve |  Imprimer
Imprimer
09/01/2014
L'art et la création
Au fond, qu’est-ce qui nous incline à créer dans le domaine de l’art ?
Il ne s’agit pas d’améliorer la pratique du monde, c’est le domaine de l’artisan. Il ne s’agit pas non plus, du moins directement, de s’enrichir, c’est le domaine des profiteurs.
L’artiste crée parce que la création l’élève. A la fois, elle le sort de lui-même et le fouille au plus profond de son existence. Elle le sort de lui-même parce qu’elle l’oblige à se dépasser par le travail, l’émotion, la réflexion. C’est une hygiène de vie autant qu’un plaisir rugueux. La création contraint et, par cette contrainte, enrichie. L’artiste exhibe dans le même temps de lui-même les derniers trésors enfouis : une idée, une impression, un sentiment qu’il va exploiter pour lui donner une forme artistique.
Pourquoi cette forme devient-elle artistique ? Parce qu’elle correspond à sa vision du monde et que cette vision est unique, comme chaque homme est unique. L’art, c’est l’ouverture d’un manteau pour se montrer nu devant les autres (j'ai toujours été frappé par cette image étonnante : à la sortie de l’hiver, à Moscou, le long des remparts, les femmes pour commencer leur bronzage, mettent un manteau de fourrure sur leurs dessous et vont s’installer au soleil, entrouvrant les poils du manteau pour réchauffer leurs chairs bleuettes).
L’art, c’est la création pure, sans réserve, dans laquelle on se donne jusqu’à l’ivresse ou la dépression. Pourquoi le fait-on ? Parce qu’on ne peut faire autrement. C’est un impératif catégorique ou, peut-être, pratique. L’artiste crée parce qu’il Est. S’il ne crée pas, il n’est pas. Sa vie ne vaut pas d’être vécue. Peu importe le résultat, c’est l’acte lui-même qui compte. Il peut être intellectuel, si l’on se veut écrivain. Il peut être sensitif si l'on est musicien. Il peut être sensuel, dans le cas du peintre ou, plus encore, du sculpteur. Dans tous les cas, il doit être créateur.
08:00 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, création, société, humanité, motivation, réalisation de soi |  Imprimer
Imprimer
08/01/2014
Neige
Un flocon, puis deux, puis trois…
Ils éclairent la campagne
Ils délaissent le goudron…
La nature seule les charme…
Ils adoptent les doigts ouverts
Des arbres noirs et dépouillés
Ils craquent sous le pied
Et jouent à l’étouffoir …
Ralenti, le passant coule
Le long du chemin blanc
Laissant ses pas, fil ténu
Entre présent et avenir…
Dors petite fille, dors
Que tes rêves t’enlacent
Dans leurs saveurs aigres…
Ne regarde pas dehors
La montagne approche
Et entre par la fenêtre
Elle ouvre ses mains de glace
Mais ne l’écoute pas
Elle ne sait pas ce qu’elle veut
Sinon te dire « Viens, viens »…
Surtout ne sors pas
Ne la regarde pas, tiens-toi close
De tout regard fiévreux
Et d’envie de courir dans cette neige claire
Qui atténue toute réserve et crainte
Et te fait t’envoler en pensée…
Et… peut-être… en action
© Loup Francart
07:54 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, écriture, poème, littérature |  Imprimer
Imprimer
07/01/2014
Hilary Dymond

Le toit du monde où la matière rejoint l’invisible, où la roche s’osmose avec la goutte de brouillard pour donner l’intuition d’une existence au-delà du temps et de l’espace. C’est beau parce que cela élève l’âme, à l’image de la brume qui monte vers les cimes.
Hilary Dymond expose à la galerie Sibman, 28 place des Vosges jusqu’au 26 janvier. Faites le détour si vous passez à proximité, cela en vaut la peine. Née en Grande Bretagne en 1953, elle vit et travaille en France (69). Elle peint des paysages et les classe par thème : le littoral, les étangs, l’eau d’une manière générale, qu’elle soit liquide, en vapeur ou même solide comme les tableaux de montagne.

Ce qui enchante dans ses tableaux c’est avant tout la lumière. Celle-ci est rendue par les contrastes dans les blancs entre celui d’un plein soleil sur la neige et celui d’un gris très pâle porté par les ombres où se mêlent les brumes légères ou fortes montant des vallées. Contrastes saisissants donnant la vision d’un éternel infini.

Mais dans le même temps ses tableaux sont très figuratifs. Il s’agit de représenter la réalité, telle qu’elle est et non de tricher pour laisser des impressions plus ou moins imaginées.

Parfois cela fait penser à Turner :

A d’autres moments à la peinture abstraite, lorsque la matière prend le dessus sur l’éthéré :

En regardant ces paysages, on devient transparent, on s’enfouit dans le silence, on se laisse engloutir par la neige pour en ressortir vierge et transformé.
Oui, Hilary Dymond est une vraie artiste, parce qu’elle transforme l’être de celui qui regarde ses tableaux.
Vous pouvez prendre connaissance de ses œuvres sur les deux sites suivants :
http://www.lesoleilsurlaplace.com/artistes/hilary_dymond-7.php
http://hilarydymond.com/mountains/uvcp139on3q66wuoxwcj0bynpalvtz
06:51 Publié dans 21. Impressions picturales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, figuratif, transparence, lumière |  Imprimer
Imprimer
06/01/2014
Les coloriés, roman d’Alexandre Jardin
 Une civilisation fondée sur le jeu. Le sérieux est banni, de même que le passé et l’avenir. Le présent seul existe. Quel puissant motif d’intérêt pour l’ethnologue qu’est le conteur du roman, Hippolyte Le Play. Une culture de l’enfance, avec ses règles, ses tabous et ses interdits. Une organisation improvisée, fondée sur le plaisir et l’imagination d’où les adultes sont exclus. « Au départ, il s'est produit un événement fondamental : les garçons se sont battus entre bandes. Les filles ont eu peur et se sont réfugiées dans les arbres. Quand la puberté est arrivée, les garçons sont venus sous les arbres et se sont demandés comment faire descendre les filles des branches ! Tandis que les filles se demandaient comment faire grimper les garçons… C'est cela qui a donné naissance à une culture complète où l'amour est devenu le jeu préféré. »
Une civilisation fondée sur le jeu. Le sérieux est banni, de même que le passé et l’avenir. Le présent seul existe. Quel puissant motif d’intérêt pour l’ethnologue qu’est le conteur du roman, Hippolyte Le Play. Une culture de l’enfance, avec ses règles, ses tabous et ses interdits. Une organisation improvisée, fondée sur le plaisir et l’imagination d’où les adultes sont exclus. « Au départ, il s'est produit un événement fondamental : les garçons se sont battus entre bandes. Les filles ont eu peur et se sont réfugiées dans les arbres. Quand la puberté est arrivée, les garçons sont venus sous les arbres et se sont demandés comment faire descendre les filles des branches ! Tandis que les filles se demandaient comment faire grimper les garçons… C'est cela qui a donné naissance à une culture complète où l'amour est devenu le jeu préféré. »
Une adulenfant qui charme Hippolyte et qui l’entraîne dans une aventure salace, dans un premier temps en plein Paris, puis sur l’île de la Délivrance, celle dont les culottés (les adultes) sont bannis. Dafna découvre le monde des adultes avec une certaine aisance malgré une absence totale d’éducation et de conscience. Hippolyte découvre le monde des coloriés (ils se peignent des vêtements sur la peau) avec difficulté. Il ne peut s’empêcher de revenir à des raisonnements et des sentiments édulcorés d’adulte civilisé malgré toute sa bonne volonté. Inversement, la culture des enfants semble considérer la stabilité des caractères comme une pathologie, une infirmité réservée aux grandes personnes encroutées. Pour eux, vivre c’est changer sans cesse. Moi, je jubilais en secret d’assister à ses écarts qui me dédommageaient d’années trop strictes. Dans les grandes surfaces, dès qu’une musique l’envoutait, Dafna zigzaguait entre les ménagères en improvisant des ballets qui mêlaient claquettes, marelles frénétiques et entrechats. Jouir de bouger lui était nécessaire. Sa licence enfantine et débridée me grisait. Quand tant d’êtres se contentent d’exister, Dafna osait vivre !
Ce livre invite chacun de nous à réveiller sa part la plus authentique, à tourner le dos à cette société « raisonnable » qui aspire en permanence à la « cohérence ». Il nous renvoie à la place que nous laissons à nos désirs.
On s’amuse bien, la fable est comique et conduit à des quiproquos drolatiques. Mais on finit par se lasser de ces « on dirait qu’on serait », « jouer à être invisible » grâce à une couche de peinture blanche, etc. Ce n’est plus une guerre de civilisation, mais un combat contre la bêtise des adultes dans leurs partis pris serrés et celle des coloriés enfoncés dans leur rêverie excédée. Et l’auteur, près de rejoindre les culottés, exécute au dernier moment un plongeon : En prenant plaisir à nager vers la Délivrance, je laissai derrière moi un sillage de couleurs dans les eaux du Pacifique. Ma trace était une palette. L’amour vécu comme une récréation m’attendait. Protégé de l’Occident, j’allais oublier le triste scepticisme, le garrottage des émotions et l’esprit de gravité qui corrompt tout. Vivre ne serait plus l’art de cultiver un héritage, mais l’occasion unique de foncer vers soi, en échappant à la noyade du vieillissement.
(…) Il faisait très beau, un temps à zouaver sur une plage, à ne pas sérieuser avec cette fille inespérée. Après tout, la vie valait d’être vécue si l’on avait la maturité de la colorier. Je recommençais mon enfance, pour toujours.
10:47 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : roman, littérature, conte, récit |  Imprimer
Imprimer












