01/06/2014
Un maître soufi, le sheikh al-‘Arabî ad-Darqâwî
« L’âme est une chose immense ; elle est le cosmos entier, puisqu’elle en est la copie. Tout ce qui est en lui, se retrouve en elle, et tout ce qui est en elle, est également en lui. De ce fait, celui qui la domine, le domine certainement, de même que celui qui est dominé par elle, est certainement dominé par le cosmos entier. »
Sheikh al-‘Arabî ad-Darqâwî
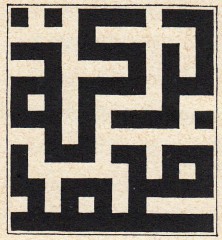
Le Sheikh al-‘Arabî ad-Darqâwî vécut au Maroc et y mourut en 1823 à l’âge de 80 ans. Son enseignement peut se comparer à celui des vrais maîtres de tous les temps, par son contenu doctrinal autant que par sa spontanéité spirituelle. Il est essentiellement pratique et sa forme d’expression est simple et directe. Mais n’oublions pas qu’un maître soufi n’invente rien. S’il est une source spirituelle immédiate et originale, il ne fait que reprendre la tradition pour l’adapter au cas par cas. Il ne s’agit pas pour lui de préconiser un mode de vie, mais de recommander à chacun ce qui lui convient.
Maintenant écoutons bien : "l’âme est le cosmos entier.Tout ce qui est en lui, se retrouve en elle, et tout ce qui est en elle, est également en lui". Contempler les étoiles serait contempler son âme. Le monde invisible est en nous, à l’égal du monde visible extérieur que constitue le cosmos. Aussi le Sheikh ajoute : "De là je compris la parole prophétique : « Une heure de méditation est meilleure que soixante-dix ans de pratique religieuse. », étant donné que par une telle méditation, l’homme est transporté du monde créé au monde de la pureté, et l’on peut également dire, de la présence du créé à la présence du créateur".
La méditation permet de s’oublier soi-même et de s’ouvrir à la liberté du cosmos, au vide sidéral qui fait apparaître la présence de Dieu. N’est-il pas étonnant que la vision du satellite COBE montrant la naissance de l’univers soit considérer comme la vision du visage de Dieu ? Là où la première image de l’univers (ou dernière image de ce qui était avant le Big-Bang) apparaît, on entrevoit Dieu. Il en est de même dans l’âme : au-delà de nous-même, aux confins du connu et de l’inconnu, l’âme découvre la divinité.
Et le Sheikh de conclure : "Il est impossible qu’on voit notre Seigneur tout en voyant autre chose que Lui".
Un petit livre à lire et relire : Lettres d’un maître soufi, le Sheikh al-‘Arabî ad-Darqâwî, traduites de l’arabe par Titus Burckhardt, Edition Archè Milano, 1978.
07:10 Publié dans 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : spiritualité, islam, soufisme, connaissance de soi, religion |  Imprimer
Imprimer
31/05/2014
Equilibre
Vertu annoncée française, comme le cartésianisme
Souvent contredite par la réalité des faits
Elle soutient l’opinion et la conforte dans son arrogance.
Ne serait-ce pas de l’inertie dont parlent nos citoyens ?
Certes l’équilibre des façades de nos châteaux altiers
Donnent un sens harmonieux aux apparences
La réalité n’est-elle pas toute autre, plus statique
Cet équilibre est fondé sur deux béquilles égales
Le véritable équilibre ne serait-il pas impression ?
Balance des sentiments, des émotions, des perceptions
L’équilibre de la terreur de l’égalité des cerveaux
Les poids seraient-ils la preuve de la même consistance ?
L’équilibre ne se trouve pas, il advient et s’impose !
Il est léger comme l’air au soleil, vapeur de bonheur
Un souffle et sa constance se brise, altérée
Il fuit la logique et le poids des mots recherchés
L’équilibre des pouvoirs contrebalance l’autorité
Est-ce une vertu française, un souhait non exprimé ?
Ici la vie est contraire à la parole, contradiction
Entre l’intégrité austère et l’amitié chaude
Aucune prédominance, pas de passe-droit
L’œil à l’horizon, la face non corrompue
Transpirant sous la bise de l’intégrité
Le citoyen ravive sa fureur révolutionnaire
Mais l’équilibre n’est-il pas harmonie ?
Comme deux sons emmêlés chers à l’oreille
Ils vont dans les chemins de la vie heureuse
Et se détendent sur l’herbe caressée de rires
Vraiment, quel avenir sans équilibre
De quel côté pencher : raison ou imagination ?
Le papillon noir s’élève dans l’azur
Il monte, vide, empli d’espoir, sans pensée
© Loup Francart
07:20 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer
Imprimer
30/05/2014
Un dimanche après-midi après un déjeuner
Il vous arrive d’être invité à déjeuner un dimanche. L’épreuve n’est pas le déjeuner, mais les quelques heures qui le suivent. Instants d’indécision, de mal-être et d’ennui.
Vous rentrez chez vous, repu, trop, l’esprit lourd et brouillé, sans savoir pourquoi. Vous avez encore en tête le cercle des paroles échangées qui tournent autour de vous comme les hirondelles avant la pluie. Vous entendez le rire aigre d’une des convives, l’histoire égrillarde du maître de maison, la toux sèche d’une de vos voisines. Vous vous remémorez le goût du rôti saignant, mais pas trop, et de la salade qui l’accompagnait, verte et prolixe. Vous sentez encore les barreaux de la chaise de jardin qui vous entre dans le dos. Mais tout ceci s’efface dans une sorte de brouillard trouble comme un voile de gaze blanc faseillant sous le vent. Vous avez pris le volant sans l’allégresse habituelle et sans les images de détente d’un après-midi de farniente. Vous voici devant votre porte, ouvrant celle-ci après avoir cherché votre clef dans plusieurs poches. Vous entrez et… Qu’allez-vous faire ?
Rien. Non seulement vous n’avez envie de rien, mais rien ne vous attire. Et ce rien devient votre obsession. Rien de rien. Le jardin ? Il fait un peu chaud ! Et puis, quoi faire dans un jardin lorsqu’on a envie de rien ? Rien ! S’installer au salon pour lire un livre ? Mais lequel ? Depuis quelque temps, vous constatez une acédie pour la lecture. Chaque livre commencée ne signifie plus un bon moment d’oubli du monde, mais une lourdeur pénible qui vous fait fermer les paupières à la vitesse de l’éclair. Alors, vous ouvrez le piano, vous vous laissez aller à quelques accords, incertains, pauvres, qui vous cogne la tête et vous embrouillent les idées. A-t-on besoin de notes égrainées dans le désordre pour survivre à une après-midi de dimanche ? Votre double erre comme vous, avec le même manque d’entrain, assise sur le canapé, les yeux dans le vague, souriante, modeste, sans savoir quoi faire. Pour elle aussi, ce rien devient un tout, vide d’objet, vide de sensations, vide de sentiments. Si encore vos deux trous noirs se rejoignaient. Mais non, ce rien reste rien et non deux riens qui pourraient peut-être devenir quelque chose. Vous vous levez. Vous allez boire un verre d’eau à la cuisine pour vous sortir de ce marécage. Mais rien n’y fait. Vous ne ressentez rien. Quel ennui !
Alors vous prenez la décision qui s’impose. Vous montez tous les deux vers votre chambre, vous vous étendez sur votre lit en justifiant cela par la facilité de lecture d’une bande dessinée, seule littérature autorisée ces jours de tremblements du bonnet. Vous mettez quelque temps à trouver de quoi satisfaire votre impécuniosité. Ni à l’eau de rose, ni à l’action éperdue qui offre trop de contraste avec votre acédie. Vous trouvez Lefranc ou un autre héros tout aussi mobilisateur. Mais aujourd’hui cela ne marche pas. Rien n’y fait. Les aventures vous laissent de marbre, froid et lisse comme le dessus de la commode. Vous mélangez ce que vous lisez avec ce que vous avez entendu pendant le déjeuner. Tout cela s’embrouille dans votre tête qui pourtant ne veut pas encore se laisser aller complètement et s’endormir divinement. Vous reprenez le récit sans même savoir ce que vous avez déjà lu. Mais vos mains laissent tomber ce livre trop grand, trop encombrant. Vous vous tournez vers elle, vous la regardez, vous fermez les yeux involontairement, lui tendez la main pour une ultime caresse. Elle n’atteint pas son objectif et elle repose, inerte, sur le drap, rattrapée par le sommeil qui vous envahit.
Vingt minutes plus tard, vous émergez. Vous n’êtes pas éveillé comme chaque matin, en pleine forme à l’ouverture de paupières. Celles-ci ne vous ouvrent pas à la joie de vivre. Mais, progressivement, vous reprenez vos esprits, vous poussez quelques manettes, cherchez à entraîner les poulies de la compréhension. Cela met du temps. Peu à peu vous réalisez que ce dimanche vaut la peine d’être vécue. Vous vous levez, vous buvez un verre d’eau. L’éclair de la fraicheur dans votre bouche vous réveille complètement et vous êtes vif, prêt à entrer dans cette après-midi sacrée qui vous offre ce rien que vous allez transformer en création.
07:22 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, ordinaire, acédie, création |  Imprimer
Imprimer
29/05/2014
violence et force
« La force oui, la violence non ! » proclame le cardinal Philippe Barbarin en parlant du film Cristeros qui raconte la révolte des catholiques mexicains dans les années 1926-1926 face à l’action du président maçonnique Calles.
Certes, la différenciation entre la force et la violence est difficile. Il n’y a pas une ligne de séparation bien nette puisqu’elle s’opère selon le contexte de la crise vécue. Alors examinons d’un peu plus près comment se différencie l’emploi de la force et l’usage de la violence.
Le terme force vient du bas-latin fortia, pluriel neutre de fortis, solide, énergique, vigoureux. Au sens ordinaire, il signifie puissance d'action d'un être, capacité de contraindre, énergie potentielle. Il a une acception physique : la force physique est une capacité d'action que l'on évalue objectivement en fonction des effets qu'elle produit ou qu'elle peut produire. Il a aussi un sens moral qui se manifeste par des capacités émancipatrices ou créatrices (détermination, autonomie, indépendance d'esprit...). La force, chez l'homme, n'est donc pas la violence, mais une qualité moralement neutre et dont, seul, l'usage violent peut donner lieu à la réprobation ou à la sanction.
Le mot violence provient du latin violentia qui signifie “ abus de la force ”, de vis, “ force ” ou “ violence ”. Mais il renvoie dans le même temps à violare “ violer ”, “ agir contre ”, “ enfreindre le respect dû à une personne ”. La notion grecque de démesure évoque l’ensemble de ces significations : la violence est hybris, c’est-à-dire abus de puissance, profanation de la nature, fruit de la démesure.
De cette analyse sémantique, on peut tirer deux conclusions :
-
La force est une capacité d'agir, physique et morale. C'est une qualité que chacun possède à des degrés variables au même titre que la beauté ou l'intelligence. Elle se cultive et la civilisation grecque l'avait élevée au rang de vertu. Elle est nécessaire à la vie puisque pour vivre, il faut agir un tant soit peu.
-
La violence est un excès d'emploi de la force et est atteinte à la personne. Mais qu'entendre par personne ? N'y a-t-il pas aussi violence contre les animaux et même la vie en général et n'y a-t-il pas violence lorsque les biens publics ou privés font l'objet de violence ? Alors disons que la violence est un exercice abusif des relations de dépendance des êtres entre eux ou avec l'environnement.
07:01 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : violence, force, politique, société, institutions |  Imprimer
Imprimer
28/05/2014
rêve et réalité
Il se tenait droit. Son front couvert de poussière ruisselait de transpiration. Il marchait depuis des heures, perdu dans ces galeries souterraines. Il faisait chaud, trop chaud, et il avait du mal à respirer. Il haletait parfois et s’arrêtait, asphyxié. Ses chaussures lui faisaient mal aux pieds. Il se dit : « Je vis mes derniers instants. Je vais mourir enterré et personne ne saura ce que je suis devenu. Tous ignoreront où ma folie m’a conduit. Mais je ne regrette rien, ni ma peine, ni mon effroi. J’ai marché et je vais en finir avec la vie. Pourtant celle-ci avait bien commencé. J’ai connu la tendre douceur après l’effort, la virginale caresse des êtres de l’autre sexe, la détente de la boisson, l’indifférence des grands, la reconnaissance des sans culottes, le bourdonnement des mouches autour d’un pot de confiture, la lente décomposition de ce que j’avais construit. La face contre terre, j’ai crié mon désespoir et j’ai ri de mes regrets. Quelle absurdité ! Qui donc voudra et pourra me faire revenir sur cette terre acide et froide ? »
Elle dormait lorsqu’un rêve traversa son esprit. Elle le vit errant sous terre, les yeux fous. Eveillée, elle le regardait. Il ne sut qui elle était, mais il sentit cette sollicitude d’un être pour un autre être et il l’appela, dans le noir, à genoux, incapable de faire un pas de plus. Elle s’habilla, revêtit son kimono préféré, s’empara d’une lampe de poche et sortit. Elle se laissa guider jusqu’au puits, enjamba le rebord, mis les pieds dans le seau, fit basculer la corde au fond et se laissa descendre doucement. Peu à peu ses mains furent ensanglantées. Retenir son propre poids lui sembla surhumain. Elle tint bon néanmoins jusqu’au moment où elle toucha le fond du puits. Pas une goutte d’eau, mais un couloir qui s’enfonçait elle ne savait où. Elle attacha la corde au seau, certaine de pouvoir remonter à la force des poignets, alluma sa lampe et partit. « Il est là », se disait-elle pour se donner du courage. Elle le voyait, grand, altier, mais épuisé. Alors, rassemblant ses forces, elle continuait, avançant à petite pas, la soif à la gorge. Au tournant du boyau elle le vit, assis, le dos reposant sur la paroi, la tête entre les mains. Elle s’approcha doucement, murmurant des mots sans signification. Elle avança la main et la posa sur sa tête. « Viens, partons ! » En le soutenant, elle parcourut le chemin inverse. Ils arrivèrent au fond du puits. Le seau était là. Elle réalisa qu’elle ne pourrait le hisser à la force des poignets et il était trop faible pour l’aider. Elle cria longtemps, mais personne ne répondit. Elle tenta de se hisser elle-même pour aller chercher du secours, mais retomba deux fois de suite, malgré les lambeaux de sa robe dont elle avait entouré ses poignets. Alors elle s’assit, posa la tête de l'homme sur ses genoux et lui parla avec une douceur extrême : « Nous sommes arrivés au bout de la route. Je t’ai rêvé. Je t’ai cherché. Je t’ai trouvé. Je t’ai porté jusqu’ici. Nous allons vivre nos derniers instants et je suis heureuse de t’avoir connu. Oui l’absurde vaut la peine d’être vécu. Rien de ce qui nous arrive n’est vain. J’ai gagné en confiance. Je réalise que ton appel cette nuit m’a surprise. Je ne m’y suis pas opposée. J’ai suivi ma voie sans faiblir. Et mon cœur est joyeux, libre comme il ne l’a jamais été. J’appelle une dernière fois et nous mourrons la tête haute. » Elle appela plusieurs fois, jusqu’à épuisement.
Lydia jouait dans son jardin. Elle s’assit un moment après avoir couru. Elle entendit les appels, se redressa, cherchant d’où venait le son. Derrière la haie ! Elle se glissa sous les branches, déchira sa robe et poursuivit jusqu’au puits qui résonnait des cris de la jeune femme. Elle se dressa sur la pointe des pieds, se pencha avec précaution et appela : « Il y a quelqu’un ? ». « Au secours », entendit-elle. « Nous arrivons », cria-t-elle. Rentrée chez elle, elle appela les pompiers et les entendit venir cinq minutes plus tard. Elle pleurait de joie lorsque les deux jeunes gens furent remontés. Ils étaient exténués, hagards et se tenaient par la main sans vouloir se lâcher. Ils se regardaient. Rien ne pourrait plus les séparer. Ils ne parlaient pas. Ils ne pensaient pas. Ils se touchaient et cela leur suffisaient.
Ce jour-là l'amour fit un pied de nez à la mort. Le rêve de la jeune femme était devenu réalité et la réalité devint rêve.
07:17 Publié dans 43. Récits et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : secours, errance, fin, amour |  Imprimer
Imprimer
27/05/2014
L'arc de la nuit
De retour sur l’arc de la nuit
J’approfondis ton absence…
Un trou immense s’est ouvert
Sous les pieds de l’infortune…
Perdue la moitié consistante
Qui donne sa dimension
Au jour comme à l’obscurité…
Ici le noir remplace le vert
Le gris implique l’ombre
Courbant les branches
De lourdeur invisible…
Pourquoi chercher toujours
Au-delà de l’invisibilité
La lueur d’une autre
Quand déjà tu t’élances
Et romps avec l’habitude ?
Oui, le silence t’atteint
Et tu pars, vertueuse
Au long de la route,
Inaccessible et distante
Moi, vide et errant
Je reste sur la plaine
Et feuillette le livre
Des jours sans partage
© Loup Francart
07:46 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, écriture, poésie, littérature |  Imprimer
Imprimer
26/05/2014
Deux boutons de nénuphar
Deux boutons de fleurs de nénuphar s’agitent dans une eau boueuse. N’est-ce pas un événement ordinaire, sans intérêt ? Pourtant ce matin, j’ai contemplé pendant une demi-heure deux boutons qui dansaient au milieu de la rivière, sans jamais me lasser ni penser à autre chose. Ils sautillaient tous les deux, très proches l’un de l’autre, comme deux êtres humains peuvent le faire s’ils sont attirés l’un vers l’autre. Et rien n’existait autour d’eux. C’était une danse amoureuse, le regard perdu, les bras ouverts, ils regardaient, se rapprochaient, se disaient deux mots avant de s’embrasser en petits baisers, traversés de tremblements discrets comme si, sous l’eau, une force extraordinaire irrésistiblement les amenaient au contact l’un de l’autre, infléchis par un courant discret, fluide, mais ferme, qui les empêchait de se séparer. En tremblant, ils s’embrassaient avec amour et s’étreignaient avant de se séparer sans cependant se quitter des yeux, pour finalement revenir l’un face à l’autre, se mettre à trembler et s’attoucher à nouveau comme aimantés. Et cela durait, durait, sans lassitude, au gré du courant invisible qui leur communiquait cette passion.

Sept heures du matin. La journée commençait sous un soleil radieux, un soleil dégagé de tout souci, dans un air pur et frais. Un instant d’éternité comme on en voit peu ou, peut-être, comme on en perçoit peu, car ces moments supposent un état d’esprit spécial, une fraicheur dans la tête rarissime. Gonflé à l’hélium, on se laisse dériver dans l’ouate claire sans ressentir autre chose qu’une évanescence qui pince le cœur et lui ouvre les portes de la prison quotidienne. J’étais venu pour regarder les carpes qui, habituellement à cette époque de l’année, frayent dans les nénuphars, s’ébattant lourdement, montrant leur dos puissants, éclaboussant la surface de leur ébats. Mais elles n’étaient pas là ou tout au moins je ne les voyais pas. Dans cette atmosphère figée d’un matin de printemps, seuls deux boutons de fleurs non encore ouvertes, frémissaient, se contemplaient, se caressaient avec passion comme deux amoureux transis. J’ai pensé pendant un moment que c’était deux carpes sous la surface qui s’ébattaient, mais cela durait, durait à tel point qu’il semblait impossible qu’elles ne se déplacent pas de quelques centimètres, rompant l’enchantement de cette danse insolite. J’étais hypnotisé en douceur, l’esprit uniquement préoccupé par cette rencontre surréaliste, un homme contemplant l’ébat de deux boutons de fleurs de nénuphars, sans autre préoccupation que cette irrésistible attirance du regard pour les frémissements enflammés qui se manifestait sous ses yeux.
Oui, ce fut un instant d’éternité, un aperçu du paradis, une bouffée d’invisible, très palpable. Je me demande parfois si le paradis n’est pas de ce monde, invisible en raison de nos préoccupations. Faire, faire, nous ne pensons qu’à cela, enfermés dans notre monde personnel, dans notre psychologie de pacotille, alors qu’à chaque instant l’Esprit nous met en contact avec l’invisible et nous offre gratuitement le meilleur de l’univers. Les ravis de ce monde ne seraient-ils pas les seuls sages ?
07:33 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : éternité, paradis, contemplation, ravissement |  Imprimer
Imprimer











