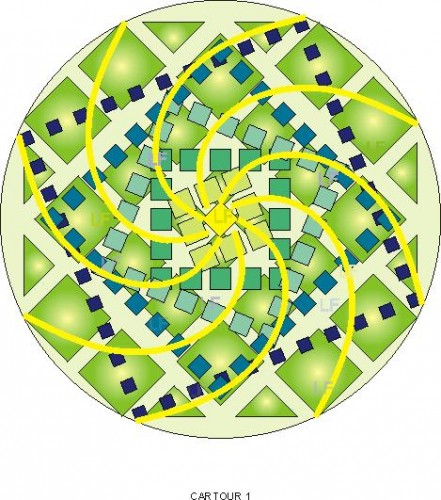06/03/2011
Improvisation
Je joue du piano. J’ai fermé la porte du salon, j’ai ouvert le couvercle du clavier. J’attends. Je n’aime pas qu’on écoute ce que je joue au cours des premiers éclats de notes tâtonnantes. Je me trouble, me mécanise et m’égare dans le cheminement des accords. J’attends, je choisis ma position sur la chaise, j’appuie sur les pédales, je caresse les touches. Je m’entoure d’une enveloppe transparente qui englobe le piano. Je me fabrique une tente de solitude. J'entre dans la musique, en frappant à la porte.
C’est étonnant cette capacité de l’homme de s’abstraire du monde pour devenir la musique, la peinture, le sport ou même le jardin ou encore le calcul. Plus rien ne le dérange. Il est entré dans une bulle tiède, dans laquelle les sons résonnent d’une étrange manière, comme dans une cloche au fond de l’eau. J’entends encore les voitures qui passent dans la rue, mais je ne les perçois plus, elles ne troublent pas mon univers qui se réduit à ce piano, dont le bois diffuse les rayons du soleil, l’environnant d’un brillant qui réchauffe l’âme. Je cherche des sons hors de ma mémoire, mais dans les premiers instants d’une improvisation ce sont toujours les accords habituels qui sortent avant de s’égarer vers des mondes inconnus. Progressivement, ils forment une conjonction d’harmonies qui sonnent agréablement à l’oreille, puis d'enchaînements qui leur donnent la puissance de suggestion attendue. Alors ces accords, dans leur déroulement, finissent par donner une mélodie que l’on peut ensuite construire, améliorer jusqu’à ce qu’elle prenne sa place première et frappe le cœur d’un pincement de beauté qui emplit la bulle d’émotion. Parfois, la mélodie s’impose d’emblée, comme une phrase qui subitement, dans la construction d’un poème, s’impose à la pensée. Alors que cette phrase musicale se déroule seule dans la tête, les mains progressivement construisent autour d’elle le décor, un environnement musical qui donnera l’ambiance harmonique. Lentement, je rentre dans l’improvisation et me donne à l’intense joie d’enchaînements d’accords, de variations, de changement de modes, pour toujours revenir à l’impression initiale ou qui s’est progressivement construite, une mélodie simple que j’ai déroulée à l’extrême de mes possibilités. Elle retourne à sa forme primitive pour le plaisir d’en goûter à nouveau la sonorité, la sensation encore inédite de cette source d’eau fraiche qui coule à sa manière jusqu’au moment où elle est intégrée. C’est cette petite phrase de notes qui constitue la clé de l’improvisation parce qu’elle se construit autour d’elle. Bien d’autres éléments lui donneront la brillance, le charme, la force, la tristesse ; mais cette petite phrase est le centre de ce travail de l’émotion sans quoi la musique ne serait qu’un attrape-cœur. Cet univers de sons me prend tout entier jusqu’à l’instant de lassitude. Alors, à regret, mais empli de couleurs sonores, comme dans un musée des sons, je laisse le clavier refroidir, les dernières vibrations encore perceptibles, et poursuis dans le monde intérieur l’étrange périple d’une bulle créée de toute pièce.

J’appris les notes au lycée dans la monotonie des dictées musicales. C’était un jeu pour moi, une devinette, une échelle dont on doit connaître chaque barreau et sa place par rapport aux autres. En rentrant le soir à la maison, je m’installais au piano, sur un annuaire de téléphone. Le son d’une note me fascinait, l’enchaînement mélodique de plusieurs me ravissait. J’appris progressivement à jouer à deux mains. Je m’appliquais. Il me fallut longtemps pour rendre indépendante la main gauche de la main droite. Il fallut également maîtriser la clé de sol, puis la clé de fa. A chaque nouveau signe inconnu, je cherchais dans le dictionnaire, jusqu’à assimilation. Et cette maîtrise très lente me donna des joies simples. Je me « donnais du ciel » dans ces instants où rien ne peux venir vous troubler. Le musicien n’est pas seul à pouvoir entrer ainsi dans ce ressourcement. Le peintre, le sculpteur, le sportif et toute personne qui se passionne intimement, et non superficiellement, ressent ces instants de plaisirs subtils, personnels et intransmissibles pendant lesquels un courant d’air frais vient caresser son visage et l’invite au voyage dans l’inexprimable.
En jouant, je regarde les vitres de la fenêtre en face du piano. Je regarde une vitre, celle qui a des défauts. C’est la perception du mur de la maison d’en face qui est la clé de mes pensées. Chaque verre a un défaut qu’on ne perçoit pas lorsqu’on le regarde. Mais il suffit de bouger un peu la tête pour voir l’image derrière le verre prendre de nouvelles formes. L’image ondule, flotte dans l’air, se rétracte, respire comme un être vivant. La maison d’en face n’est plus un mur sale, avec des fenêtres et des volets, des coins d’ombre et de lumière, elle devient une mer démontée, une plante qui pousse, une figure de style. Chaque forme de la maison d’en face varie avec la musique, avec son mode, avec le rythme de l’accompagnement. Elle évolue aussi selon la position de la tête qui change en fonction de celle des mains, un forte de la pédale retentit sur la perception de l’image plus encore que celle de la tonalité. L’image de la maison d’en face devient la ligne mélodique, le livre où je lis la portée. J’y trouve selon sa vibration, selon l’état de l’air, le pianissimo ou le forte des impressions. Ce n’est plus la réalité, ce n’est pas le rêve, c’est une sorte d’hypnose qui émane de la façon du verre.
Du rêve à la réalité : Ce piano à queue, dans un état dégradé, était mystérieusement apparu le 1er janvier 2011 sur un petit banc de sable dans la baie de Biscayne, légèrement au sud de Miami (Floride, sud-est), sans que les autorités ne puissent expliquer les raisons de cet échouage peu banal.
05:40 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, improvisation, piano, impression |  Imprimer
Imprimer
05/03/2011
Comme l’âme dépareillée des marins
Comme l’âme dépareillée des marins ensevelis en terre,
Chaque pierre a son éloquence. Il y a la pierre du fou
Et celle du bienheureux. Celle de la tristesse et celle de l’opulence.
Les unes ont la densité de l’espoir ou la corpulence du crime,
d’autres la légèreté de l’ignorance ou la beauté de l’inconséquence.
Et chaque caillou sur le chemin montant vers le cimetière
S’arrondit lentement au pied des foules compassées
Qui y montent tristement, aussi lourdement que la douleur,
Pour redescendre joyeuses et plus légères d’insouciance
Vers le petit bistrot des âmes disparues au pied de la colline.
Lentement les âmes s’usent aux années plus rugueuses
Comme la corde d’amarrage des navires sous le sel.
Et un jour elles se détachent en petits cailloux brisés
Qui s’en vont un à un, le long du chemin,
Pour renforcer l’asphalte rectiligne et éternel
Jusqu’à l’arrêt de la mécanique humaine.
00:38 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, poème, littérature, écriture |  Imprimer
Imprimer
04/03/2011
Cheminement chaotique
Cheminement chaotique de l'imaginaire dans le rêve :
05:38 Publié dans 22. Créations numériques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dessin, peinture, op'art, art cinétique |  Imprimer
Imprimer
03/03/2011
Dans le désert plat de l’imagerie télévisuelle
Dans le désert plat de l’imagerie télévisuelle
Que n’ai-je vu de beautés factices
Dédiées aux plus choquants des prêtres,
Ceux d’une publicité criante ou de jeux tapageurs,
Ou encore aux vertus de voitures carrossées
Par le dernier éphèbe en délire du jour ?
Que n’ai-je vu aussi, de guerres sanglantes
Et de soldats perdus pour un pouvoir obscur
Ou encore de rires émouvants et fragiles
De jeunes adolescentes effarouchées
Un soir de grisante veillée au bar délétère ?
Oui, j’ai contemplé
La noirceur des meurtres en série,
Le bleuissement des rêves enivrants,
Le jaunissement des fins d’une vie,
Le verdoiement des explorations perdues,
La griserie des fêtes mondaines,
Le brunissement de papyrus en miettes,
L’écarlate des bouches de femmes,
L’orangeté des délires printaniers
Dans l’étrange chambre de nos vingt ans,
Le vermillon des petits pas menus
Des danseuses chinoises aux pieds bandés,
La pâle blondeur des cheveux de reines,
Le bref éclair des couteaux affutés
Dans les rues inconnues de villes lointaines,
Jusqu’aux évanescentes rencontres
De sordides réseaux en mal de reconnaissance
Par des enfants insoumis et brutaux.
Parfois, vient un instant de pur délice,
Comme l’ombre de Dieu sur le ciel assombri,
Qui éclaire d’un reflet étincelant
Le lent cheminement de l’âme
A la recherche d’un plaisir sain.
Alors s’attardent les cœurs endurcis
Et les intellects obscurs et sordides
Pour contempler, fruit du pur hasard,
L’apparition attendue d’un désert sans fin
Où rien ne se passe hors du silence des sens.
07:22 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, poème, littérature, télévision, désert |  Imprimer
Imprimer
02/03/2011
Souvenir lointain
La nuit, quand je ne pouvais dormir, peut-être parce que je n’étais pas assez fatigué ou que la fatigue déclenchait irrémédiablement le souvenir de chacun des mouvements du corps que j’avais fait dans la journée, je regardais, dans la torpeur irrésistible et insuffisante que donne l’approche du sommeil, mais qui n’est pas encore celle du sommeil, le couvre-lit qui protégeait les couvertures de la poussière, irisée par le soleil du matin, que soulevait ma mère en faisant un ménage méticuleux et soigné.
Ce couvre-lit éveillait en moi le souvenir d’années lointaines où, petit garçon épris des caresses de ma mère, ou plutôt de la douce et tiède odeur que dégageait son lit le matin quand je venais l’embrasser par un besoin irrésistible qui me faisait sortir de la chaleur bienheureuse de mon lit, je venais me blottir dans ce havre de paix, essayant vainement de mettre en contact le maximum des parties de mon corps avec le grain rude et perceptible de son tissu usé par le frottement de nos ébats enfantins. Le plus souvent, ma mère s’étant levée et préparant l’instant sacré et tant attendu du petit déjeuner dont nous n’entendions pour le moment que le cliquetis des cuillères sur les soucoupes et le grincement de l’armoire où se trouvaient les tasses, nous sautions avec mes frères sur le lit pour retomber dans les plis mystérieux du couvre-lit. Alors, le nez enfoui dans le vallonnement que faisaient les côtes du tissu dont j’apercevais chacun des fils de laine qui sortaient en chevelure brouillonne de ces vallées allongées côte à côte, je regardais l’entremêlement des fils roses et blancs retenus et soudés par d’autres fils de la même couleur et qui avait pris dans le vieillissement de l’usage la couleur de ce saumon qui m’avait émerveillé le jour du mariage d’une de mes cousines quand il reposait comme un jouet tendre et coloré dans la blancheur de l’assiette entre deux demi-lunes dorées qui se rejoignaient en auréoles dans le cercle délicat et parfaitement défini de la porcelaine.
J’aurais pu rester de longues heures ainsi étendu, les mains enfouies sous le pli que faisait le couvre-lit rabattu vers les pieds pour laisser apparaître la fraicheur du drap (et l’envers du couvre-lit par sa construction moins riche en fil rose me paraissait être la couleur du saumon vivant quand on le découpe cru en filets allongés) si je n’avais pas préféré pénétrer lentement dans la chaleur des draps imprégnés du souvenir de l’odeur unique des joues de ma mère. Je m’y blottissais en fermant les yeux comme si la couverture rabattue sur la tête n’eut pas suffi à donner à mon esprit l’impression de repos que je venais chercher. J’abolissais toute notions de temps qui me semblait arrêté puisque je n’entendais plus le mouvement du réveil qui était mon ennemi quand je venais ainsi retrouver le bonheur d’encore plus jeunes années où, malade, ma mère m’avait installé dans sa chambre à côté de la cheminée du pétrin que faisait tourner jour et nuit le boulanger du rez-de-chaussée, me berçant de son ronronnement lointain transmis, me semblait-il, par le chaleur de la cheminée que je percevais au toucher du mur blanc.
06:09 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : impression, souvenir, mémoire, enfance, réveil |  Imprimer
Imprimer
01/03/2011
Le chant liturgique
Le chant liturgique est destiné, par sa beauté, à préparer, au sein de la communauté, la rencontre intime avec Dieu.
Il est d'abord expression communautaire de la foi. Il efface les différences, fait converger les cœurs et les âmes. Uni aux autres, chantant d'une même voix, chacun fait taire sans effort ses préoccupations.
Plus profondément, il est destiné à devenir prière, à recueillir le cœur et l'esprit par sa tranquille sérénité, par la joie profonde qu'il engendre, une joie dénuée d'émotion et de sentimentalisme. Le chant liturgique suppose un certain oubli, un certain détachement vis à vis de son exécution. Il lave ainsi l'âme de son égocentrisme et la rend transparente.
Alors se dévoile la réalité profonde de la liturgie. Dans sa beauté, elle ouvre au mystère divin. Elle dilate l'être qui perçoit le don de Dieu. Le chant devient écho de la gloire du ciel, il fait pénétrer dans l'éternité.
Ceci suppose une unité interne des chants : unité destinée non à engendrer la monotonie, mais à préparer le cœur sans le distraire, à favoriser la concentration. C’était bien le cas du chant grégorien, chant liturgique par excellence. Cette unité permet l'entrée dans le mystère. Cependant, elle ne doit pas enfermer l'expression. Dans le chant liturgique, c’est la parole qui donne son rythme au chant et non la musique, ou plutôt, la musique ne crée que le contexte de l’expression de la parole de Dieu et le chant évolue selon le sens et la rythmique des phrases, et le moment de la liturgie. Il doit être très libre, léger, d’un rythme très nuancé, fait d'accélérations et de ralentissements, murmurée ou chantée à pleine voix, en prenant garde de toujours articuler les mots de façon à pénétrer dans le mystère et laisser la parole toucher le cœur.
05:41 Publié dans 52. Théorie de la musique, 62. Liturgie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, liturgie, chant, spiritualité |  Imprimer
Imprimer
28/02/2011
Le poète
Le poète est un homme qui perpétuellement se confesse. L’impudeur est à la base de son talent. Contrairement au romancier, tricheur plus ou moins habile, le poète possède l’œil interne. Il pense le monde avec ses rêves, ses envies, son ennui et le décrit au travers de son prisme déformant qui le réconcilie avec lui-même.
Le mot poésie, qui vient du grec ποιεῖν (poiein), signifie "faire, créer". La création poétique fut d’abord très formelle, codifiée, et couvrait un vaste champ : de la tragédie aux contes épiques, voire comiques. De tradition orale, c’est par le vers que se différenciait la poésie de la prose. Le vers facilitait la déclamation, donnant un rythme à la parole, voire des effets sonores à travers les rimes. Mais le poète recherche aussi l'expressivité par le poids accordé aux mots comme par l'utilisation fréquente des figures de styles et au premier chef des images, comparaisons et métaphores, recherchées pour leur force suggestive.
Ce n’est que plus tard qu’elle devint principalement un moyen d’expression des sensations et des sentiments jusqu’à s’affranchir des contraintes formelles du vers et de la rime. La tendance est le "vers international libre", d’après l’expression de Jacques Roubaud. La poésie se fait par l’image, le jeu de mots, le sens du rythme. Elle s’affranchit également de la narration. Seule compte in fine l’évocation qui va germer au fond de l’être et le faire rêver, qu’il soit l’auteur ou le spectateur.
La poésie est l’art d’émouvoir l’auditoire par des mots et de lui faire partager une autre vision du monde, insolite et personnelle. Elle est la conjonction d’instants magiques dans la durée du poème, car le poète fait de lui une grotte retentissante des échos de l’univers.
02:29 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poète, poésie, image, expression poétique, chant |  Imprimer
Imprimer