18/09/2011
Stupeurs et tremblements, roman d’Amélie Nothomb
Monsieur Haneda était le supérieur de monsieur Omochi, qui était le supérieur de monsieur Saito, qui était le supérieur de mademoiselle Mori, qui était ma supérieure. Et moi, je n’étais la supérieure de personne. […] Donc, dans la compagnie Yumumoto, j’étais aux ordres de tout le monde.
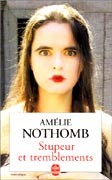
Ainsi commence cette incroyable histoire qui est bien quelque peu autobiographique. Amélie est embauchée pour un an par la compagnie. Elle va connaître les affres de tous les japonais débutants. On commence en bas de l’échelle et l’on ne s’élève qu’à la condition d’une obéissance sans limite. Pas d’initiatives, elles sont toutes mal vues.
Elle commence, sur demande d’un de ses supérieurs, par rédiger une lettre à un certain Adam Johnson pour accepter son invitation à jouer au golfe. Ce directeur lui fait recommencer, recommencer, recommencer, sans explications, jusqu’à ce que sa supérieure, mademoiselle Mori, arrive. Fubuki, c’est son prénom, la charme. Elle était svelte et gracieuse à ravir, malgré la raideur nippone à laquelle elle devait sacrifier. Mais ce qui me terrifiait, c’était la splendeur de son visage. […] Elle avait le plus beau nez du monde, le nez japonais, ce nez inimitable, aux narines délicates et reconnaissables entre mille. […] Fubuki incarnait à la perfection la beauté nippone, à la stupéfiante exception de sa taille. Elle mesurait en effet un mètre quatre-vingt.
Elle prend la fonction de l’ôchakumi, l’honorable thé. Mais lors de la réception d’une délégation étrangère à l’entreprise, elle psalmodie les plus raffinées des formules d’usage, baissant la tête et s’inclinant. On lui donne l’ordre d’oublier le japonais, car il est indécent qu’une blanche parle le japonais. Alors, pour s’occuper, elle décide de distribuer le courrier. Mais elle se fait très vite rabrouée, car voler son travail à quelqu’un est une très mauvaise action. Donc, toujours pour s’occuper, elle décide de mettre les calendriers à jour, après accord de son supérieur. Aussi Monsieur Saito, sans la contredire ouvertement, lui demande de faire des photocopies. Ce qu’elle fait rapidement avec la machine munie d’une « avaleuse ». Il lui demande de le refaire à la main, une fois, puis deux, puis trois, sous prétexte qu’elles sont décentrées. Tout ça pour un règlement de son club de golf. Fubuki compatit. Monsieur Tenshi lui demande alors de rédiger un rapport sur les procédés de fabrication du beurre allégé. Elle se met à la tâche, recherche les raisons des japonais de s’intéresser à ce procédé, téléphone en Belgique où il est mis en œuvre, et sort le lendemain son rapport que l’autre s’attribue sans vergogne. Quelques jours plus tard, nouvelle engueulade, cette fois-ci pour Monsieur Tenshi. Elle apprend ensuite qu’elle a été dénoncée par mademoiselle Mori, qui a souffert des années pour obtenir le poste qu’elle a aujourd’hui. Elle tente une explication avec Kubuki, peine perdue : « Vous avez brigué une promotion à laquelle vous n’aviez aucun droit. » Elle répond : « Vous êtes ma supérieure, oui. Je n’ai aucun droit, je sais. Mais je voulais que vous sachiez combien je suis déçue. Je vous tenais en si haute estime. » Elle eut un rire élégant : « Moi, je ne suis pas déçue. Je n’avais pas d’estime pour vous. »
Alors, Kubuki la met à la comptabilité. Comptable, moi ? Pourquoi pas trapéziste ? lui demande-t-elle. Il n’était pas rare qu’entre deux additions je relève la tête pour contempler celle qui m’avait mise aux galères. Sa beauté me stupéfiait. Mon seul regret était son brushing propret qui immobilisait ses cheveux mi-longs en une courbe imperturbable dont la rigidité signifiait : Je suis une executive woman. Alors elle passe les trois dernières nuits au bureau pour tenter de venir à bout de son travail. La dernière nuit, « soudain, je ne fus plus amarrée. Je me levai. J’étais libre. Jamais je n’avais été aussi libre. Je marchais jusqu’à la baie vitrée. La ville illuminée était très loin au-dessous de moi. Je dominais le monde ? J’étais Dieu. Je défenestrai mon corps pour en être quitte ».
Enfin, après d’autres péripéties, comble de l’horreur, pendant sept mois, elle fut postée aux toilettes de la compagnie Yumimoto. Elle ne perdit pas la face. Mais elle acquit la désaffection des hommes pour les toilettes de son étage. Aussi reçut-elle l’ordre d’être aux toilettes sans y être, c’est-à-dire de sortir lorsqu’un homme entre et d’entrer lorsqu’il ressort pour remettre du papier et nettoyer comme il se doit. Cela dura jusqu’au 7 janvier, date de fin de contrat. Elle eut encore une dernière mission à accomplir : remercier ses supérieurs : la compagnie Yumimoto m’a donné de multiples occasions de faire mes preuves. Je lui en serai éternellement reconnaissante. Hélas, je n’ai pas pu me montrer à la hauteur de l’honneur qui m’était accordé… Nous approchons du terme de mon contrat et je voulais vous annoncer avec regret que je ne pourrai le reconduire.
Elle passe ces derniers instants aux toilettes. « D’instinct je marchai vers la fenêtre… Elle était la frontière entre la lumière horrible et l’admirable obscurité, entre les cabinets et l’infini, entre l’hygiénique et l’impossible à laver, entre la chasse d’eau et le ciel… Une ultime fois, je me jetais dans le vide. Je regardais mon corps tomber. Quand j’eu contenté ma soif de défénestration, je quittai l’immeuble Yumimoto. On ne m’y revit jamais.
Une fois de plus, Amélie Nothomb enchante ses lecteurs d’une histoire qui semble vraie, mais à dormir debout. Sa particularité : décrire avec un sérieux imperturbable ce qui est farfelu, relater avec humour ce qui est sérieux. Au fond, ce livre est-il autobiographique ou non ? Dans les deux cas, le lecteur passe un bon moment, voire un moment merveilleux, comme une oie qui passe au dessus d’une ville lors de sa migration et qui rit des contorsions des humains qui l’habite.
05:56 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, société |  Imprimer
Imprimer
17/09/2011
Blow-Up, film de Michelangelo Antonioni (1966)
Blow-Up est un film anglo-italo-américain de Michelangelo Antonioni, sorti en 1966 et inspiré de la nouvelle Las babas del diablo (Les fils de la Vierge) de Julio Cortázar. Il obtint la Palme d'or au festival de Cannes en 1967.
Bande annonce du film :
http://www.youtube.com/watch?v=2Xz1utzILj4&feature=re...
Episode du film :
http://www.youtube.com/watch?v=r9u78vNOvvQ&feature=re...
 "À Londres, Thomas, un photographe de mode, se rend dans un parc où un couple qui s'embrasse attire son attention. Il prend des clichés, mais la jeune femme, Jane, exige les négatifs, allant jusqu'à s'offrir à lui pour les obtenir. Thomas lui donne une autre pellicule et il développe les photos du parc. En agrandissant celles-ci, il découvre un crime, ce qu'il vérifie dès la nuit suivante, en déco
"À Londres, Thomas, un photographe de mode, se rend dans un parc où un couple qui s'embrasse attire son attention. Il prend des clichés, mais la jeune femme, Jane, exige les négatifs, allant jusqu'à s'offrir à lui pour les obtenir. Thomas lui donne une autre pellicule et il développe les photos du parc. En agrandissant celles-ci, il découvre un crime, ce qu'il vérifie dès la nuit suivante, en déco uvrant la présence du cadavre dans le parc. Désemparé, il cherche conseil auprès de ses amis, en vain. Pendant ce temps, les bobines ont été volées dans son atelier. De retour au parc, il s'aperçoit que le corps a disparu. Tout près de là, une troupe de clowns mime une partie de tennis, se renvoyant une balle invisible."
uvrant la présence du cadavre dans le parc. Désemparé, il cherche conseil auprès de ses amis, en vain. Pendant ce temps, les bobines ont été volées dans son atelier. De retour au parc, il s'aperçoit que le corps a disparu. Tout près de là, une troupe de clowns mime une partie de tennis, se renvoyant une balle invisible."
Mais au-delà de ce bref résumé, tiré de l'encyclopédie Hachette, l’apothéose du film se trouve dans cette partie de tennis où chacun suit l’effort des joueurs, la trajectoire de la balle, le choc de celle-ci  contre le grillage et que le photographe prend d’abord pour un jeu, mais qui, à partir du moment où il s’associe au jeu involontairement en ramassant la balle imaginaire, devient une réalité, jusqu’à lui faire percevoir le choc de la balle contre les raquettes. Ainsi la réalité et l’imaginaire se rejoignent à la fin du film comme ce fut le cas au commencement quand la femme lui demande les négatifs. Le cercle est fermé.
contre le grillage et que le photographe prend d’abord pour un jeu, mais qui, à partir du moment où il s’associe au jeu involontairement en ramassant la balle imaginaire, devient une réalité, jusqu’à lui faire percevoir le choc de la balle contre les raquettes. Ainsi la réalité et l’imaginaire se rejoignent à la fin du film comme ce fut le cas au commencement quand la femme lui demande les négatifs. Le cercle est fermé.
Le film reprend le vieux thème énoncé par Platon sur la réalité du monde extérieur, celui de la réversibilité des choses de Cocteau : derrière chaque objet perçu se cache une existence insoupçonnée. Percevoir, c’est toujours interpréter par l’intelligence une sensation (ce que fait que le photographe dans sa recherche sur les photos) et chacun recrée à chaque instant le monde, car la vision n’est qu’un agrégat de raisonnement et comme il y a illusion des sens, il peut y avoir des illusions psychologiques (le choc des balles contre les raquettes). Cette balle qui, bien que n’existant pas, existe virtuellement comme le cadavre, ces photos qui, bien qu’ayant existé, semblent n’avoir jamais existé, où est au fond la vérité : dans qu’on voit ou dans ce qu’on devine derrière ce que l’on voit ?
Certes, le film ne date pas d’hier, mais d’avant-hier, avec ses images provocantes et pseudo-modernes. Mais ces quelques défauts qui viennent avec le temps n’effacent pas la beauté du film, mieux même, ils la font ressortir.
07:40 Publié dans 13. Cinéma et théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, réalité, imaginaire |  Imprimer
Imprimer
16/09/2011
Un musicien chinois à Paris
Il se tenait là, sur le trottoir, bien propret, magnifique dans son costume gris, mal coupé, mais beaucoup plus élégant que les vêtements habituels des passants, entouré de ses quelques biens, une sacoche pour ordinateur portable, qui n’en contenait pas, et l’étrange boite protectrice de son drôle d’instrument dont il tirait des sons…chinois.
costume gris, mal coupé, mais beaucoup plus élégant que les vêtements habituels des passants, entouré de ses quelques biens, une sacoche pour ordinateur portable, qui n’en contenait pas, et l’étrange boite protectrice de son drôle d’instrument dont il tirait des sons…chinois.
L’Erhu est une sorte de violon à deux cordes. D’abord instrument d’accompagnement dans les opéras, il devint instrument solo grâce aux améliorations apportées par deux grands artistes à la fin du XIXème siècle. Il possède une sorte de tambour en bois d’ébène ou de santal qui constitue sa caisse de résonance. Le manche est en roseau et mesure 81 cm de long. Il a deux cordes. L’artiste en joue assis, l’instrument posé sur la cuisse gauche, la main gauche tenant le manche et la droite l’archet. L’erhu est un des représentants les plus communs de la famille des huqins (vielles chinoises à deux cordes) qui compte une trentaine de modèles différents.
http://video.google.com/videoplay?docid=-3875038914279072592&q=erhu&pl=true#
Ecoutez une interprète de la musique traditionnelle d’Erhu accompagné par un yang qin, instrument à cordes d’acier sur lesquels l’artiste joue avec deux maillets en bambou. Musique typiquement chinoise dans laquelle les notes s’enchaînent sans rupture, en passant de l’une à l’autre par glissement.
http://video.google.com/videoplay?docid=-3875038914279072...
Voici une interprétation très différente sur le même instrument, beaucoup plus moderne. L’interprète est doué et joue en s’amusant, avec ou sans archet.
http://video.google.com/videoplay?docid=-3875038914279072...
Admirez le mariage entre l’Erhu et le violon, dans une interprétation tout à fait occidentale. L’Erhu vaut le violon.
http://video.google.com/videoplay?docid=-3875038914279072...
Mais ce que j’ai entendu du chinois à Paris était plus de ce style. Ce n’était pas un grand interprète. Il avait cependant eu le courage de s’expatrier en France, ne parlant pas notre langue ni même l’anglais, et il méritait bien une grosse pièce pour continuer à nous faire écouter de la musique chinoise.
08:07 Publié dans 11. Considérations diverses, 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, chine |  Imprimer
Imprimer
15/09/2011
Dorure subtile d’une feuille
Dorure subtile d’une feuille
Dont le soleil darde de lumière
La nervure plus solide, tandis que l’épiderme
Étincelle de l’éclat de sa sève blonde
Bercée d’autres feuilles vertes
Elle se réjouit de son règne doré
Diffusant son spectre royal
Sur ses compagnes alentour
Et bientôt, vieillie et flétrie
De cette sève absente
Qui dessèche sa tige frêle
Elle s’en ira au vent
Légère, attendrie, gondolée
Secouée par d’invisibles ondes
Pour tomber ignorante
Sous les pas d’un petit garçon
Qui la glissera dans un cahier
Avant de la laisser voler
Au printemps, dans la rue
07:13 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, poème |  Imprimer
Imprimer
14/09/2011
L'autre jour, dans le métro
J’étais l’autre jour dans le métro, je ne sais pour quelle raison. Sans doute à cause du mauvais temps. Mais peu importe, l’essentiel est ailleurs. C’était un métro ordinaire, sale, bruyant, sentant la poussière, bref, un métro comme les autres. Je me préparais à faire les dix stations de mon trajet en pensant à autre chose, en m’abstrayant du contexte morose d’une après-midi pluvieuse qui m’avait contraint à prendre la chenille infernale.
Debout parce que je n’avais pas trouvé de place assise, je regardais autour de moi. En face, face à face pourrait-on dire, se trouvait une femme, la quarantaine, au premier abord sans signes particuliers. Mais en la regardant plus attentivement, je notais un maintien élégant, une expression du visage heureuse, comme une fée qui se promène aujourd’hui parmi les humains, emprunte de sérénité. Elle ne bougeait pas, se contentait de contempler au loin un rêve inaccessible aux autres, et ce rêve embellissait son visage au point qu’il le transfigurait (au figuré bien sûr !). Mais je ne saisis pas tout de suite cette transformation de l’atmosphère (en formation, évidemment). Laissant poursuivre mon regard sur d’autres occupants de la voiture, je remarquais un homme, la trentaine, également sans signes distinctifs. Son attitude respirait une certaine noblesse, par sa façon de se tenir à la barre verticale qui se trouve au centre de l’emplacement dégagé devant chaque porte. Drôle, cette rampe qui, en d’autres lieux, sert à d’autres contorsions qui n’ont rien d’aristocratiques. Mais là c’était un ange qui se tenait à la barre, un ange de tous les jours que l’on ne distingue des autres que parce que l’on est attentif à son apparence. Les doigts légèrement recourbés sur la barre de métal, il semblait aérien, ne tenir debout que par la simple pression de l’extrémité d’un doigt, comme un équilibre merveilleux de grâce et de gravité.
Je m’interrogeais : Que se passe-t-il dans ce métro aujourd’hui ? Je regardais à côté de moi. Etait assise une jeune fille. Elle n’était pas d’une beauté éblouissante, ses vêtements n’avaient pas l’aspect soigné des toilettes de femmes qui attachent de l’importance à leur apparence. Elle regardait au loin, les yeux perdus dans ses préoccupations. Et pourtant, en la regardant un peu plus, je remarquais à nouveau une extrême harmonie qui transfigurait tout son être. Tiens, un deuxième ange, me dis-je, étonné. Comme je continuais à la regarder, elle se tourna vers moi et me fit un sourire. Très rares sont les jeunes femmes qui font un sourire à un homme dans le métro. C’est un signal fort d’invitation que se garde bien de manifester toute personne sensée. Mais il s’agissait d’un sourire autre, comme une invitation au bonheur, à profiter de la vie, à s’ouvrir les bronches pour crier sa joie d’être en vie et d’aller où bon vous semble, monté sur un nuage de béatitude. Très vite, elle reprit une attitude conventionnelle. Mais combien était émouvant ce clin d’œil qui ouvrait sur une autre dimension, celle d’un vol au dessus du métro accompagnant les âmes qui s’y trouvaient.
Intrigué, je poursuivis l’inspection des autres occupants de la voiture. Je n’en trouvais aucun qui donne un sentiment de vulgarité, de laideur ou d’abjection. Chacun possédait une aura propre, qui ne se remarquait pas au premier abord, mais qui, en un instant magique, se dévoilait au travers d’un coup d’œil, d’une expression, d’une attitude, d’un maintien particulier. Ce métro était-il véritablement ensorcelé ou bien était-ce moi qui avait changé mon regard sur les autres ? Je ne sus le dire, mais l’effet était là : le monde était différent, l’invisible devenait visible, sa beauté transparaissait comme une sudation interne que l’on remarque et que l’on caresse de l’œil pour imprégner ce jour d’un titre spécial que je n’ai pas encore trouvé. Mais peu importe le nom, peu importe la manière de le raconter. Seul compte la naissance en soi d’une bouffée évanescente de la grandeur sidérale de l’être humain.
07:12 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : société, transfiguration |  Imprimer
Imprimer
13/09/2011
Reptile
Comment à partir d’une pince de forge on imagine un reptile monstrueux pourvu de défenses inquiétantes.
Et ce monstre envahit l’imaginaire pour construire un monde virtuel plein d’imprévu et de peur réjouissante.


05:38 Publié dans 26. Créations sculptures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : beaux-arts, scupture |  Imprimer
Imprimer
12/09/2011
Aux champignons
Arrivé sur place, j’empruntais le chemin pénétrant dans les sous-bois. Il faisait chaud, une chaleur écrasante qui vous contraint à marcher lentement, en respirant petitement. Pas un bruit, même pas le chant d’un oiseau. La forêt dormait, en léthargie. Seul le bruit de mes pas sur les branches mortes emplissait le silence d’un chant de percussions. Le soleil donnait dans les feuillages, réchauffant le sol, brûlant les feuilles mortes, enfermant la végétation dans un immobilisme écrasant. Le sol était trop sec, bien sûr. Quelle idée de partir aux champignons alors qu’il n’a pas plu suffisamment. Et pourtant, à un carrefour de chemins, je tombais sur une amanite rougissante, excellent champignon dont le nom fait fuir les faux amateurs. Elle était seule. Aussi, repérant son emplacement, j’attendis d’en voir plusieurs avant de la cueillir. Connaissant le coin, je me dirigeais vers l’ « Emplacement », celui que tous connaissent, qui est piétiné, mais dont on ne parle à personne. Pas l’ombre d’un renflement sur le sol de feuilles mortes et de fougères. Je continuais et sentis tout d’un coup l’odeur, signe caractéristique de leur présence, une odeur forte de pourriture parfumée, comme, dans votre potager, vous sentez l’odeur des tiges d’oignon, prenante et audacieuse. Mais j’eus beau chercher, me mettre à quatre pattes pour tenter d’apercevoir un chapeau de n’importe quelle couleur. Rien, pas l’ombre d’un tube ou d’une lamelle. Plus loin, cependant, surprise, une amanite épaisse, espèce assez proche de l’amanite rougissante. A la troisième, je les cueille. Mais il n’y eu pas de troisième.
Comme il était bon de se promener, seul, environné de silence lourd et charnu, marchant à petits pas, les yeux au sol, écrasé par l’atmosphère lénifiante d’une après-midi magique. Et soudain, je me suis rappelé cette même ambiance, il y a longtemps déjà, lorsque la chaleur enveloppait nos corps d’enfants, mais que notre vivacité surmontait facilement jusqu’au moment où nous tombions, écrasés de fatigue et mourant de faim. Après les courses éprouvantes dans les bois, il fallait rentrer. Plus rien ne pouvait nous faire bouger. Nous reprenions le chemin du retour, assis dans la charrette, l’un d’entre nous conduisant l’âne, les autres endormis sens dessus-dessous, jusqu’au réveil à l’arrivée à la maison, où, reposés, nous repartions pour mille autres folies à faire avant la fin de la journée.
Pourquoi y avait-il des ceps dans le jardin ? Sans doute parce qu’il conserve l’humidité plus facilement qu’un sous-bois inondé de soleil ; mais aussi, c’est certain, parce que ce jour-là, je devais forcément faire un tour en forêt pour me souvenir de ces journées d’enfance : une vie dans l'instant, libre de toute intention.
05:41 Publié dans 11. Considérations diverses | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : champignon, chaleur |  Imprimer
Imprimer











