28/08/2011
L'écriture : la parole de Dieu en nous
L’écriture est mystère, mystère de la Parole de Dieu. Elle est mystère parce qu’on ne peut la saisir dans sa totalité et qu’elle possède une multitude de sens. Elle est mystère parce qu’elle est parole vivante qui s’adresse à moi-même, au plus profond de moi-même, à travers les personnages et les événements qu’elle raconte. Elle est mystère enfin parce qu’elle permet l’Incarnation du Verbe au plus profond de chacun de nous s’il accepte de s’ouvrir.
Le mystère des sens de l’écriture
Avez-vous songé aux différents commentaires que vous avez entendus sur un même épisode de la Bible. Chacun d’eux exprimait une certaine vérité contenue dans cet épisode. Mais vous n’avez jamais entendu un commentaire qui épuisait tout ce qui peut être dit sur cet épisode.
Si l’explication de texte telle qu’on apprend à la pratiquer à l’école, en se référant à la biographie de l’auteur, à son milieu, à la civilisation dans laquelle il évoluait, peut apporter des divergences entre les commentateurs, elle n’en aura pas moins une grande base de similitude pour un même texte. En fait l’explication de la Bible va plus loin qu’une simple explication de texte, même si l’exégèse actuelle a tenté de rationaliser l’étude de l’écriture en se référant à diverses méthodes d’analyse : critique historique, analyse structurelle, analyse marxiste même, ou encore psychanalytique. Oui, les commentaires vont au delà, parce que la Bible est plus qu’un simple récit événements historiques qu’un simple traité de sagesse ou même qu’un simple recueil de préceptes moraux tels qu’ont pu en décrire les grecs ou les romains. Ils vont au delà parce que la Bible contient différents sens, les uns apparents, les autres cachés.
Origène (185-253), génie du christianisme naissant, discerne dans l’écriture trois sens. Parce qu’elle est tout entière accordée au salut de l’homme, comme l’homme, elle a :
. un corps, donc un sens corporel qui est l’histoire,
. une âme, donc un sens psychique qui tire une morale,
. un esprit, donc un sens spirituel qui introduit à la mystique.
Pédagogue, il compare l’évangile à une amande :
« L’écorce amère, c’est la lettre qui tue et qu’il faut rejeter. La coque protectrice, c’est l’enseignement éthique, qui suscite, comme un nécessaire chemin d’approfondissement, une ascèse de purification et d’attention. Alors on parvient au noyau spirituel, qui seul compte, et qui nourrit l’âme des mystères de la sagesse divine.
Le premier visage (de l’écriture), celui de la lettre, est assez amère. Il prescrit la circoncision de la chair, règle les sacrifices et tout ce que signifie la lettre qui tue. Rejette tout cela comme l’écorce amère de l’amande.
En second lieu, tu arriveras aux défenses de la coque, qui désigne l’enseignement moral, l’obligation de la maîtrise de soi : ces choses sont nécessaires pour protéger ce qui est conservé à l’intérieur, mais elles doivent être brisées et ont trouvera enfermés et cachés sous ces enveloppes les mystères de la Sagesse et de la connaissance de Dieu qui restaurent et nourrissent les âmes des saints.
A travers toutes les écritures se dessine ce triple mystère.
Origène
9° homélie sur les nombres, 7
Ainsi va se préciser, d’Origène à Cassien et Grégoire le Grand, la doctrine des quatre sens de l’Écriture. Quatre, car le sens moral, souvent déjà chez Origène se dédouble, désignant non seulement l’enseignement ascétique de la Bible, mais la vie du Verbe de Dieu dans l’âme.
On distinguera donc, comme l’a admirablement montré Henri de Lubac dans son « Exégèse médiévale : les quatre sens de l’Écriture », le sens historique ou littéral, le sens allégorique ou typologique, le sens topologique ou moral, le sens anagogique ou mystique. Cette lecture contemplative de la Bible nourrira longtemps, en Occident, une théologie spirituelle qui résistera à la théologie scolastique. »
Olivier Clément
Sources, p.91
Remarquons cependant que cette distinction des quatre sens reste théorique. Origène lui-même suit presque toujours un autre ordre : du fondement historique, il passe au mystère chrétien vu dans toute son ampleur : à l’Église, à l’Évangile éternel. Ensuite, il revient à l’âme individuelle, et le sens moral est alors, lui aussi, spirituel, christologique, ecclésial, sacramentaire.
Disons simplement que l’Écriture derrière le sens premier, apparent, celui de la lettre, qui raconte une histoire, un événement ou donne une leçon de comportement, révèle un deuxième sens, caché, plus profond, celui de l’esprit, esprit du texte au delà des mots bien sûr, mais surtout Esprit de Dieu qui se manifeste.
Dieu est Esprit. Nous devons entendre spirituellement ce que dit l’Esprit. « Les paroles que je vous ai dites sont Esprit et Vie ».
Origène
Hom. Lev. 4
Percevoir l’esprit du texte, c’est comprendre qu’il s’adresse à moi personnellement. Laisser l’Esprit se manifester, c’est se laisser façonner par la parole qui alors devient vie.
L’Écriture : histoire de Dieu en moi
L’Écriture est bien une histoire, mais c’est une histoire en acte. Elle est mouvement. En fait, lire la Bible, c’est récapituler en soi-même toute l’histoire du salut. C’est comprendre que chaque histoire qui y est racontée, est mon histoire, ou plutôt que chaque histoire est l’histoire de Dieu en moi.
La Bible est l’histoire du développement de la vie spirituelle de tout homme. Je découvre dans la Bible ma propre histoire, celle de mon être profond qui cherche à découvrir la vérité à son sujet et au sujet de son rapport avec Dieu et avec le monde. J’y découvre par là même l’histoire de celui qui, en moi, trahi par ses sens qui lui font croire que la seule réalité est extérieure, exerce sa volonté à lutter contre Dieu, c’est-à-dire contre la perfection qui est en lui. Par histoires répétées, la Bible, et en particulier l’Ancien Testament, décrit le voyage volontaire de l’homme dans l’esclavage, celui qu’il s’impose en choisissant de vivre dans une vision du monde séparée de Dieu.
La Bible conduit donc à la découverte de soi. Elle est l’histoire de ma vie. Histoire de ma vie sur le plan extérieur, c’est-à-dire de mes réactions aux événements, mais aussi histoire de ma vie sur le plan intérieur, c’est-à-dire des différents personnages qui existent en moi, des pensées en permanence engendrées par mon mental et même de mon inconscient. Enfin, elle est histoire de l’esprit qui existe en moi, au delà de toute pensée.
Par la lecture de la Bible, nous découvrons la fausseté de notre vie intérieure. Nous découvrons que ce sont nos pensées qui engendrent notre bonheur ou notre malheur, que c’est notre vie intérieure qui façonne notre vie extérieure et les événements qui nous arrivent. Nous découvrons que le secret de la vie est en nous, dans ce qui se passe dans notre mental.
Tout comme la semence minuscule qui produit une grande plante, la pensée semble insignifiante comparée à l’expérience extérieure qui souvent est exagérée. L’esprit subconscient, médium créatif de la vie, agit par sentiment, et il est dépourvu du sens de l’humour. Il reçoit, tel un ordinateur, ce qui lui est donné et se met à l’œuvre pour produire ses effets semblables aux semences-pensées qui lui sont données.
Cette semence plantée dans l’esprit va germer et porter ses fruits, nourrie par la quantité de sentiments qui l’accompagnent. Je ne puis pas plus vous dire comment cela se fait, que je ne puis, en ouvrant une graine, y voir la force-vie. Je sais seulement qu’elle est là et que la loi de la vie travaille sans cesse à reproduire la semence implantée dans me terrain créatif de l’esprit.
Jack Ensign Addington
Les mystères de la Bible
(Ed; du Dauphin p. 19)
07:04 Publié dans 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, bible, religion |  Imprimer
Imprimer
27/08/2011
Le soleil éclairait la nuit d’encre
Le soleil éclairait la nuit d’encre
Des mâts de la mer indivisible
Au creux des rochers sanglants
Se perdent ses rayons d’enluminure
Les pins s’échappent vers l’azur léger
Où les mouettes blanches épanchent leur griserie
Les vagues dorment au sein des terres
Alourdies par la pesanteur de l’homme
Les toits gris d’ardoise des maisons
Oublient leur blancheur de sel et de vent
Pour blêmir dans la brume des soleils trop vivants
Qui couvrent les herbes de tiédeur morose
La fin des matins sur la mer
Pointe son triste clocher de pierre
Une cloche sonne, puis deux, puis trois,
Auxquelles répondent les coups sourds
Du travail des eaux sur les coques de bois
06:05 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, poème |  Imprimer
Imprimer
26/08/2011
Une femme douce, film de Robert Bresson
Voir :
http://www.youtube.com/watch?v=68350YcASZo
http://www.youtube.com/watch?v=TlQMeqr6zrA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=tRP1Ud_wVTk&feature=related
http://comediennes.org/video/dominique-sanda-une-femme-douce-robert-bresson
L’histoire est simple : un homme achète une jeune étudiante et en fait sa femme. Mais ils n’ont rien à se dire. Il croit qu’elle le trompe, elle pense à le tuer. Ils en viennent à faire chambre à part. Elle s’envole par la fenêtre et se tue.

Inspiré du récit de Dostoïevski, transposé à notre époque, le film recèle la même atmosphère oppressante et froide. Ce malaise, fait de dégout et de gène, donne parfois envie de sortir de la salle. Rien ne vient distraire le réalisme du récit : images du regard quotidien, sans poésie, sans artifices sentimentaux, le film en devient même un peu sec, trop journalistique et ne pénètre pas l’âme des personnages, si ce n’est par les faits racontés par le prêteur à gages.

Est-il possible d’aimer ainsi sans aucune manifestation extérieure, même envers l’être aimé ? Pas un signe, pas une parole, pas un geste (si ce n’est ceux de l’amour charnel), seule une attention matérielle sur les objets qui l’entourent.
L’amour ne s’achète pas, même avec les meilleures intentions.
06:59 Publié dans 13. Cinéma et théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, film, art et essai |  Imprimer
Imprimer
25/08/2011
Grandeur et misère de l’homme
L’homme, dans la contemplation intérieure de son propre corps, peut accéder à la compréhension de sa grandeur et de sa misère.
Il peut saisir sa grandeur par le fait que son corps est un univers à lui seul, qu’il constitue un tout indépendant par son physique et sa pensée du reste du monde. Mais cette vision le mène à la compréhension de sa misère par le fait même que tout serait néant sans le monde.
L’homme est l’exact intermédiaire entre le néant et l’infini et, par cela, il est partagé entre le bien et le mal. Il est heureux pour lui que Dieu n’est pas permis qu’il ait connaissance de ce qu’est le néant et l’infini, car seule cette méconnaissance lui permet de vivre.
La difficulté d’être ne vient qu’avec l’intuition de ces deux extrêmes. Cette difficulté est un premier pas vers l’accomplissement. Mais quel chemin à parcourir.
06:56 Publié dans 61. Considérations spirituelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, religion, accomplissement |  Imprimer
Imprimer
24/08/2011
Ennemonde et autres caractères, de Jean Giono
Une fois encore, et dans le même ravissement, Giono nous fait pénétrer dans ce monde métaphysique de la Haute Provence, là où les routes font prudemment le tour du pays, où un homme doit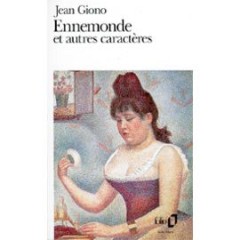 faire dix kilomètres à pied pour rencontrer un autre homme. Terre primitive, très proche de la virginité, elle nourrit l’homme de sa solitude et l’oblige à se conformer à elle.
faire dix kilomètres à pied pour rencontrer un autre homme. Terre primitive, très proche de la virginité, elle nourrit l’homme de sa solitude et l’oblige à se conformer à elle.
Les personnages sont des figures de légende, d’Ennemonde à Honoré, en passant par Clef des cœurs et bien d’autres. Ils vivent dans une métaphysique concrète où tout est poussé à l’extrême. L’amour dans ce pays est une nécessité biologique ou une folie éternelle.
Giono écrit : « Cette façon de procéder réaliste semble au premier abord mal s’accorder avec le fait qu’ils habitent un pays où la vie ne subsiste qu’avec une constante alimentation d’irréalité. Mais c’est que la réalité poussée à l’extrême rejoint précisément l’irréalité. Aller droit aux choses, c’est accepter leur magie ».
06:13 Publié dans 41. Impressions littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature |  Imprimer
Imprimer
23/08/2011
Jacky Terrasson et Michel Portal à l’amphi jazz (7/7)
http://jazznrockcommunay.blogspot.com/2010/10/michel-portal-jacky-terrasson-lamphi.html
Pour accéder au morceau décrit, joué au piano par Jacky Terrasson et à l’accordéon par Michel Portal, allez directement à la fin du premier morceau. Vous verrez apparaître les sept improvisations proposées, choisissez le 7/7.
Quelle belle promenade dans l’imaginaire, une promenade de sons et de souvenirs, comme une chanson qui vous trotte dans la tête et dont on ne peut se débarrasser. Et vous marchez, vous marchez, sans discontinuer, vers un avenir inconnu, mais plaisant, fait de paillettes et d’arbres de Noël.
Et pourtant, au-delà de ces impressions échevelées, on perçoit une telle intensité d’expression et de mélancolie que l’on se penche sur un passé défunt et qu’immanquablement remontent en vous les souvenirs de jours pluvieux, où vous êtes parti vous libérer l’esprit dans une ville inconnue que vous découvrez au fil des pas, un peu glauque, mais si nouvelle, tellement fraîche, que vous en sortez rasséréné, repu, le cœur en fête.
Promenade indolente, tu m’as fait du bien, en remuant des souvenirs oubliés, comme on soulève la poussière dans un grenier alors que l’on tente de retrouver les vieilles photos, fanées, de jours d’enfance, quand la vie riait dans les yeux innocents que vous aviez.
Mais si vous avez le temps et que cette musique vous enchante, vous pouvez aussi écouter le 6/7 et les autres. Ce sont des moments de bonheur.
05:57 Publié dans 51. Impressions musicales | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, jazz |  Imprimer
Imprimer
22/08/2011
Le geste plein d'espoir
Le geste plein d’espoir
Nous avancions sur la grève rocailleuse
Entre l’air et l’eau, vers le ciel et la mer
Accompagnés des cris hostiles des oiseaux
Nous trébuchions sur le sol visqueux
Et tes pieds nus s’enfonçaient dans le granit
Nous devions ensemble tirer dessus
Pour les ressortir gris et poisseux
Et je les essuyais avant de repartir
Le ciel était descendu sur l’horizon
Jusqu’à toucher nos fronts de sa voute poussiéreuse
Et nous nous courbions un peu plus sur la pierre
Escaladant avec peine de grosses roches gluantes
Qui gémissaient à l’atteinte de nos ongles crispés
Ta main parfois m’enserrait la taille
Je goûtais la morsure de tes doigts sur ma chair
Qui faisait tressaillir les muscles
Nous marchions depuis le matin, sans nourriture
La langue sèche, l’œil fiévreux
Et le soir ne voulait pas tomber
Où d’ailleurs aurions-nous pu nous étendre ?
06:07 Publié dans 42. Créations poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, poème |  Imprimer
Imprimer











